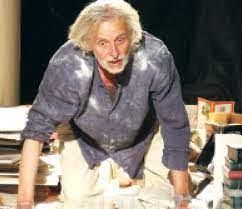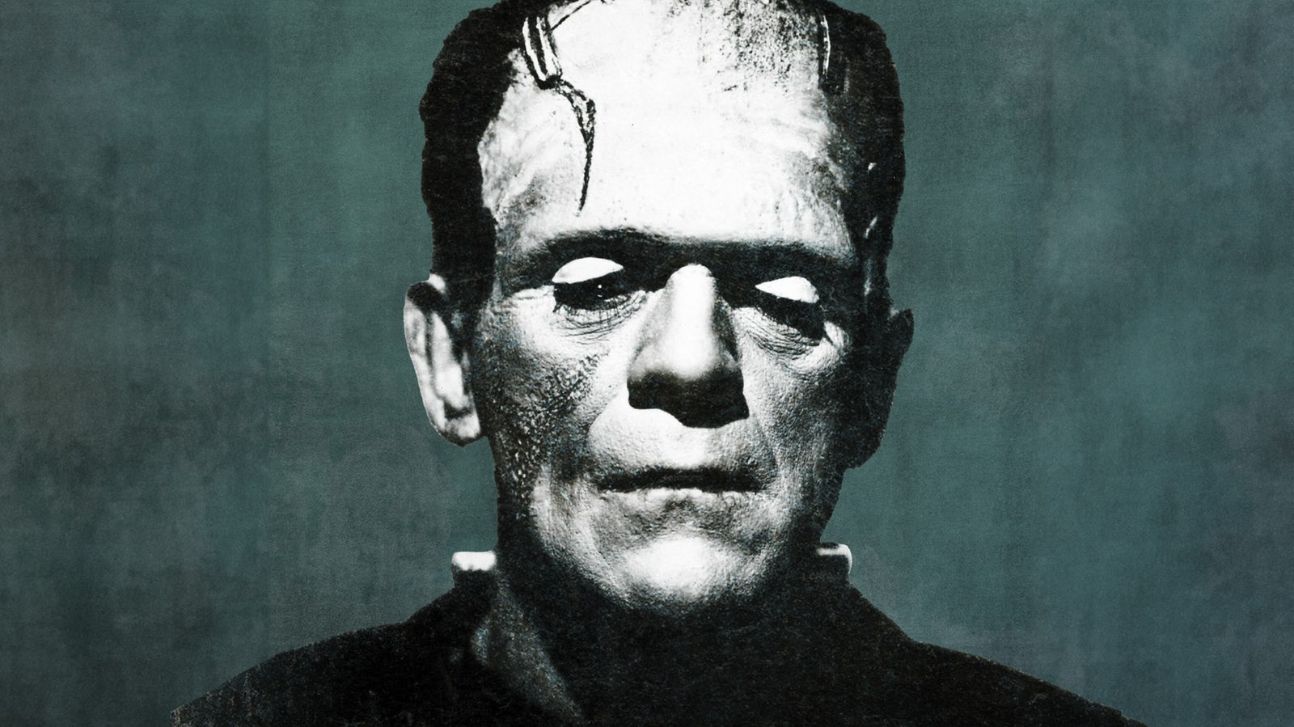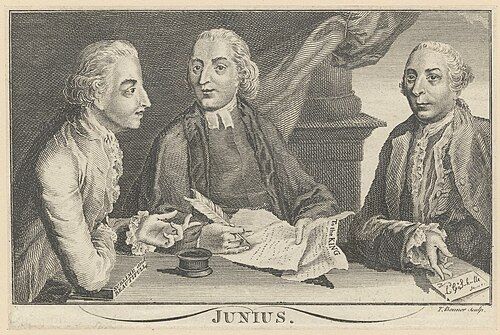Politiques de la littérature. Fortunes et infortunes d’une formule critique
Quinze ans après la publication de Politique de la littérature (Galilée, 2007) de Jacques Rancière, dont Pascale Fautrier avait rendu compte pour Acta fabula, la formule "politique(s) de la littérature" s’est largement répandue dans la recherche littéraire contemporaine. Son usage témoigne d’une volonté de repenser la place du littéraire dans l’espace social, et de la tentation de déplacer « hors du livre » l’enquête sur les liens entre politique et littérature. Plusieurs travaux se sont approprié la réflexion de Rancière, mais également les conceptualisations amorcées par Benoît Denis et Jean-Francois Hamel au sujet des "politiques de la littérature". Un nouveau dossier accueilli dans la collection "Le fond de l'air" des Colloques en ligne de Fabula propose de revenir sur cette formule. Le sommaire réuni par Lucie Amir, Justine Huppe et Julien Jeusette prend acte de son hétérogénéité, présente les objets de recherche qu’elle a permis de penser et les prolongements auxquels elle a pu – et peut encore – donner lieu.
(Illustr. : The Book Bloc)