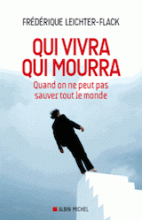
Qui vivra qui mourra : éthique des naufrages
1L’éthique des naufrages, ou lifeboat ethics, est une branche à part entière de la philosophie morale depuis l’Antiquité. Hécaton de Rhodes se demandait si, lors d’un naufrage, voyant un sot attraper une planche, le sage devait la lui arracher. Formulée par un philosophe stoïcien, la question de savoir qui sauver quand tout le monde ne peut pas survivre ne tient pas compte de la panique, de la confusion, de l'instinct de survie : elle se pose en termes purement moraux. Lilian Griffith raconte dans Les Faux‑Monnayeurs1une tout autre histoire : celle du naufrage de La Bourgogne (un épisode réel, qui eut lieu en 1898, mais que Gide semble romancer). En plein naufrage, la jeune femme sauve une petite fille qui se noie et parvient à la transporter dans un canot de sauvetage. C’est là que l’horreur commence : deux marins, avec une hache et un couteau de cuisine, coupent les mains des naufragés qui tentent de monter à bord : « S’il en monte un seul de plus, nous sommes tous foutus. La barque est pleine. »
2Le naufrage est un des paradigmes de la question de la priorisation des vies en situation d'urgence, au centre de l'ouvrage de Frédérique Leichter‑Flack. Mais le naufrage est un aléa, de l’ordre de la catastrophe naturelle ; tandis que la question de la priorisation des vies peut malheureusement advenir dans une situation volontairement organisée.
Les camps & le paradigme de la sélection
3L’introduction de Qui vivra qui mourra est saisissante :
Vous vous tenez debout au milieu d’un groupe de gens rassemblés en carré ; mais on vous bouscule de toute part car ceux qui sont sur les bords veulent votre place au centre. Sur les bords, en effet, on prend des coups de manière aléatoire, et, à force, des coups vous achèvent. Le but du jeu est de rester le dernier sur la piste et, pour durer, il faut s’efforcer d’être toujours le plus possible au centre du groupe, protégé par les autres. (p. 7)
4Ce « jeu », c’est celui de la sélection sur la place d’appel de Buchenwald, tel que l’a raconté David Rousset dans Les Jours de notre mort2. La machine exterminatrice nazie ne se contente pas de tuer en masse ses victimes ; elle organise préalablement leur déshumanisation. Elle créé artificiellement des situations bloquées, où le dispositif de « mort pour tous » prend d’abord l’apparence de « pas assez de vie pour tous ». La structure du camp impose aux prisonniers, pourtant condamnés, une compétition pour la survie : nourriture en quantité insuffisante pour les besoins vitaux, charge de travail inhumaine, soins médicaux extrêmement sommaires et rationnés... Ce système sadique empêche la solidarité de ses victimes, puisque chacun comprend que sa chance de survie immédiate est corrélée à la mort d'un autre prisonnier. Chaque survivant est donc malgré lui, et toujours momentanément, le bénéficiaire d'un assassinat : un autre est mort à sa place.
5Primo Levi évoque la honte du survivant dans Si c'est un homme3, ainsi que dans Les Naufragés et les Rescapés. Quarante ans après Auschwitz4. La survie dans le camp d'un être humain plutôt que d'un autre peut sembler si absurde qu'elle fait vaciller la raison humaine. Il peut être tentant de voir dans la survie une forme d'élection ; non pas comme récompense d'actions passées (nul n'ignore l'innocence des victimes) mais comme mission pour l'avenir : témoigner de l'horreur. Or Pr. Levi récuse avec force cette idée d'élection, qui revient à donner une forme de légitimité au massacre. Le fait même de rendre grâce de sa survie immédiate lui fait honte. Un de ses codétenus, le vieux Kuhn, remercie ainsi Dieu de ne pas faire partie de la sélection du lendemain. Pour Pr. Levi, c'est une folie et une indécence. Car le vieux Kuhn n'a provisoirement la vie sauve que parce que Beppo le Grec est envoyé à la mort. Remercier la providence dans ces conditions relève pour Pr. Levi d'un aveuglement coupable. Même la « chance », l'aléa, le hasard, n'expliquent pas la sélection de l'un plutôt que l'autre. La chance se provoque, il faut certaines aptitudes pour rester en vie dans le camp. L'altruisme n'est pas une option, se contenter d'essayer de survivre même n'est pas suffisant. Il faut ruser, faire jouer les règles à son avantage, et peut‑être empiéter, plus ou moins consciemment, sur la chance du voisin. Il ne s'agit évidemment en aucun cas de faire honte au survivant de sa survie, mais de comprendre en partie la honte éprouvée par le survivant, celle qui fait dire à Pr. Levi : « Les pires survivaient, c'est‑à‑dire les plus adaptés, les meilleurs sont tous morts.5 » Au camp, les hommes n'ont pas d'autre choix que d'être « submergés » (sommersi) ou sauvés (salvati) — on notera que l'on retrouve ici le vocabulaire du naufrage. « Dans la vie, il existe une troisième voie, c'est même la plus courante ; au camp de concentration, il n'existe pas de troisième voie6 ».
6« Les pires survivaient » : on peut être dérangé par cette affirmation, qui provient pourtant de la bouche même d'un survivant. Bruno Bettelheim écrit quant à lui dans Survivre que cette honte éprouvée par les rescapés est une manière de conserver son humanité, en maintenant l'idée que les hommes se doivent d'être solidaires, même si cela a été volontairement rendu impossible par les nazis.
Le survivant, en tant qu'être pensant, sait très bien qu'il n'est pas coupable […] mais cela ne change rien au fait que l'humanité profonde du survivant, en tant qu'être humain, exige qu'il se sente coupable, et c'est ce qu'il fait7.
7« Les pires survivaient » : ce sentiment évoqué par Primo Levi est en outre le fruit d'un système conscient de destruction morale des victimes. L’idée d'une « troisième voie », où l'on n’est ni victime ni complice, et que les nazis ont rendue volontairement impossible, est travaillée par Hannah Arendt dans Le Système totalitaire8. Les nazis ont instauré des situations où il n’est plus possible d’être moral, où la voie du martyr elle‑même n’est plus une alternative au crime. Le choix, dès lors, n’est plus pour la victime entre le bien et le mal, mais entre le mal et le mal. Le système nazi, et par la suite tout système totalitaire, rend ses victimes complices de sa corruption.
8Fr. Leichter‑Flack présente le cas emblématique des Judenräte9. Les membres de ces conseils juifs ont été contraints à collaborer avec les nazis, y compris dans la mise en œuvre de la solution finale10. Rendus responsables de l’exécution des ordres nazis dans les ghettos, ils étaient détestés de leurs administrés. Après avoir tenté, le plus souvent en vain, d’exempter certaines personnes de la déportation, Adam Czerniaków se suicide à Varsovie la veille du premier départ de convois pour les camps de la mort. Le très controversé Benjamin Murmelstein, placé dans la même position à Theresienstadt, est interrogé à ce propos par Claude Lanzmann dans Le Dernier des injustes (2013). Il dit avoir du respect pour Czerniaków, mais considérer que le suicide n’avançait à rien. Il a préféré quant à lui négocier, sauver autant de vies que possible. Benjamin Murmelstein insiste néanmoins sur le fait qu'il a toujours refusé de faire des listes de transport du ghetto au camp de la mort, c'est‑à‑dire de choisir quel Juif devait survivre plutôt que tel autre. Le tout aussi controversé Jacob Gens, à Vilnius, faisait au contraire lui‑même les sélections exigées par les nazis. Son choix personnel fut donc d’accepter une forme de complicité et de déshonneur pour lui, afin de sauver les jeunes gens ou les travailleurs, au détriment des vieillards ou des malades, dans l’optique de sauver ce qui pouvait l'être des forces vives du peuple juif.
9Il serait évidemment aussi absurde qu’indécent de prétendre juger les hommes qui se sont trouvés dans cette position impossible, infernale. Fr. Leichter‑Flack considère d’ailleurs à juste titre que la fameuse question « Qu’aurais-je fait pendant la guerre ? » est oiseuse. La bonne question n’est pas celle, purement hypothétique, de la valeur personnelle de chacun. Le véritable enjeu est de construire ou préserver des structures collectives, «dispositifs sociaux, politiques, éducatifs» (p. 71) qui évitent à l'individu de se retrouver dans la position de devenir héros, martyr ou complice (dans l’alternative entre résistant ou collabo), ou pire encore, dans une situation où il n’est plus possible d'être moral. C’était déjà l’impératif formulé par Günther Anders : « Empêche la naissance de situations où il n’est plus possible d’être moral et qui pour cette raison se soustraient à la compétence de tout jugement moral11. »
10Par ailleurs, Fr. Leichter‑Flack rappelle que les situations où la vie est rationnée ne sont pas toujours le fruit d’une imagination sadique, pas plus qu’elles ne sont exceptionnelles. Par la force des choses, des situations d’arbitrages tragiques quant aux ressources s’imposent tous les jours, notamment dans le secteur médical, sur lequel l'auteur se penche avec attention.
L’éthique médicale face aux dilemmes tragiques
11À la suite de Pierre Valette12, Fr. Leichter‑Flack soulève la question, difficile, taboue, de la priorisation des vies face aux soins. Le personnel des urgences peut se trouver dans l’obligation de faire des arbitrages douloureux, dans des situations où les urgences vitales abondent, excédant les capacités d'accueil. La préparation de protocoles d’éthique vise à empêcher, dans ces situations extrêmes, l’inefficacité consécutive à la panique, mais aussi l’arbitraire de certains choix. Dans des situations où tout le monde ne peut pas être sauvé, la moins inacceptable des solutions semble être de se baser sur des critères connus et admis de tous. Et c’est là que le bât blesse : cette question n'est jamais posée publiquement. On comprend bien pourquoi : il serait extrêmement coûteux pour la cohésion d’une société de demander aux citoyens de prendre position sur les groupes méritant d’être sauvés en premier... Un consensus se dégagerait probablement autour des enfants, mais aussitôt après les difficultés commenceraient. Faut‑il traiter en premier lieu ceux qui ont le plus de chances de survie, donc les plus résistants ou les moins atteints, afin de maximaliser les vies sauvées, ou au contraire les plus faibles, les plus exposés, afin de réduire l’inégalité ? Faut‑il introduire des critères d’utilité sociale13 ? Ou selon un principe démocratique, considérer qu’une vie en vaut une autre, et s’en remettre au tirage au sort, ou à la règle de « premier arrivé premier servi » ? Peut‑on, et doit-on, réintroduire une forme d’équité dans l’aléa du mal ? Sur quels critères ?
12On peut prendre en exemple la question de l'ordre de vaccination dans la gestion d’une pandémie. En France, à l'hiver 2009‑2010, lors de l'épidémie de grippe A, les premiers vaccins ont été administrés aux personnels de la santé et de la sécurité. Viennent ensuite les personnes fragiles : enfants, femmes enceintes, personnes âgées, malades chroniques. «Privilégier les “groupes à risque” est une manière de rétablir une véritable égalité des chances» (p. 128). Mais, note l’auteure, plus le virus est mortel, plus ce rééquilibrage des chances au départ va laisser la place à une logique pragmatique de maximalisation des chances de survie. Dès lors, les personnes les plus fragiles peuvent basculer dans la catégorie des « morituri » : ceux qu'on ne pourra pas sauver — mais qui auraient pu l’être dans une situation non catastrophique. Le film de Steven Soderbegh Contagion (2011) imagine une autre technique de répartition des vaccins : par tirage au sort en fonction du jour de naissance. S’en remettre au sort est une façon d’évacuer, ou plutôt de déplacer, le dilemme tragique. C’est aussi prendre acte qu’une vie a exactement la même valeur qu’une autre ; quitte à produire un sentiment d’injustice. En effet, on considère généralement de manière tacite qu’une personne de vingt ans a davantage qu’une personne de quatre‑vingts ans le « droit » à une longue vie... Ce dont le tirage au sort ne tient pas compte.
13Dans le cas d’une campagne de vaccination, les personnes qui ne sont pas prioritaires ne voient pas augmenter leurs chances de contracter la maladie. Il en va tout autrement des malades en attente d’une greffe d'organe : le risque de mourir augmente en effet quand on est en bas de la liste. La question de savoir qui greffer quand il n’y a pas assez de greffons pour tout le monde est si épineuse, et met en jeu tellement de paramètres (la gravité de la défaillance, l’âge, le bénéfice escompté, la localisation géographique, le groupe immunitaire rare ou fréquent), que c'est un logiciel informatique qui assure la pondération de toutes ces variables. L’informatisation du processus a le mérite de prévenir l’arbitraire, mais chaque malade peut naturellement percevoir comme injuste cette liste si elle ne le place pas en tête des bénéficiaires.
Les fictions catastrophiques : le lieu où se pose la question taboue
14Toutes ces questions demeurent dans ce que Fr. Leichter‑Flack nomme un « clair‑obscur ». Elles ne sont pas portées à la connaissance du public, mais gérées en interne par les professionnels et les experts. De manière très intéressante, cette peur de mettre en lumière la question du rationnement des chances de vie est fréquemment représentée dans les fictions policières, politiques ou apocalyptiques. C’est une scène prototypique : une agence de renseignement ou un gouvernement apprend que la population va être frappée de manière imminente par une quelconque menace (terroriste, environnementale, extra‑terrestre...) et que tout le monde ne pourra pas s’en sortir. Les personnes qui gèrent la crise ne révèlent jamais la situation à la population, de peur de déclencher le chaos, la lutte à mort pour la survie. Les experts conviennent entre eux de la solution qu’ils jugent la moins mauvaise. Très rares sont les fictions à dépasser cette représentation du tabou : on n’a pourtant guère de certitude sur la réaction qu’aurait une population si elle était mise au courant d'une telle situation. L’auteure cite un épisode de la série The Hundred14, dans lequel le chef d’une communauté de rescapés d’un holocauste nucléaire est mis face à un tel dilemme. Dans leur abri spatial, l’oxygène se raréfie : pour que ce qui reste de l’espèce humaine survive, il n’y a pas d'autre option que de sacrifier une partie de la population, celle du secteur 17. Le secret est soigneusement gardé, on prépare l’opération qui doit être maquillée en accident ; mais une médecin révèle la vérité au peuple. Ici, la série surprend : au lieu d’émeutes voire de tueries, on voit se créer des files de volontaires qui acceptent de mourir, s’offrant ainsi en sacrifice pour que leurs proches puissent survivre. La série fait donc le choix, rare, de la confiance absolue dans le peuple, sur un registre sublime et pathétique.
15Fr. Leichter‑Flack observe qu’une bonne partie de la fiction (dans des genres aussi variés que le film catastrophe, la science‑fiction, le thriller, la dystopie, l’horreur....) brode autour du thème de la pénurie de vie : Hunger Games en est le parangon mais on pourrait aussi bien citer Divergente, Le Labyrinthe, Battle Royale, Snowpiercer, Saw... Ces fictions questionnent ce qui reste de l’humanité dans des systèmes où tous n’ont pas une chance de survie, et que tous le savent ; elles semblent radicaliser le fonctionnement de nos sociétés de concurrence généralisée. L’auteure questionne leur finalité et leur effet (qui peuvent être dissociés) : en montrant ces situations verrouillées, ces fictions entendent‑elles les dénoncer et en empêcher l’avènement ? Ou au contraire ne tendent‑elles pas à nous habituer à l’idée qu’il est inéluctable de se retrouver dans de telles situations, où la seule option est de lutter pour sa propre survie, fût‑ce au détriment de celles des autres ? En d’autres termes opèrent‑elles une critique du système ultra‑libéral, ou contribuent‑elles à l’ancrer dans les esprits comme inévitable ?
Une application possible : l’imaginaire du naufrage & la crise migratoire
16Sans attendre les apocalypses hypothétiques qu’Hollywood nous annonce, films catastrophe après films catastrophe, la question de la priorisation des ressources en situation de crise peut être directement appliquée à la crise migratoire que nous sommes en train de vivre. Il s’agirait précisément de questionner cet imaginaire du naufrage qui consiste à se représenter l’Union Européenne comme un radeau sur une mer déchaînée, ne pouvant pas accueillir tous les naufragés désireux de s’y raccrocher (une métaphore d’autant plus impropre qu’un grand nombre de réfugiés est réellement passé par des radeaux de fortune, a réellement survécu à la noyade). L’imaginaire est un acteur puissant du débat et de l’action politique ; et c’est bien l’imaginaire du naufrage qui préside aux discours prédisant l’explosion de notre modèle sous l’afflux de réfugiés, qu’il serait nécessaire de traiter comme des chiffres et non comme des semblables dans le besoin. On répète à l'envi la phrase de Michel Rocard sur l’impossibilité d’accueillir « toute la misère du monde ». Certaines propositions pour l’élection présidentielle prévoient des mesures extrêmement sévères envers les immigrés15, entrant même parfois en contradiction avec la Constitution ou la Déclaration des Droits de l’Homme. Toute la question est de savoir si nous sommes ou non dans une situation de « barque pleine », et donc s’il y a lieu ou non de « couper les mains » qui tentent de s'y raccrocher. Plutôt que de considérer massivement comme une évidence que notre modèle est déjà saturé et ne pas recevoir tous les candidats, ne faudrait‑il pas ouvrir le débat sur une véritable équité dans la distribution des richesses du pays ?
17Le travail de Fr. Leichter‑Flack pose la question de l'entrée dans le régime d’urgence : à partir de quand se trouve‑t‑on en situation de pénurie ? Y a‑t‑il un seuil objectif de basculement ? Ou la perception d’une situation extrême est‑elle en partie tributaire de la subjectivité de l’observateur ? L’auteure soulève, sans la trancher, une question extrêmement délicate : comment éviter de percevoir trop tard la catastrophe ? Et au contraire, comment éviter de s’y croire trop tôt ? Elle avance néanmoins qu'il y a
[…] une importance cruciale [à] préserver un espace pour l'imagination créative en situation de catastrophe. Avant de rationner, il faut toujours se demander si l’on a tout tenté pour augmenter le stock de ressources disponibles et refuser le plus longtemps possible de se reconnaître réellement au pied du mur. (p. 151)
18Il serait salutaire de tâcher collectivement de faire usage de cette imagination créative pour repousser le plus possible, indéfiniment peut‑être, le moment de « couper des mains ».

