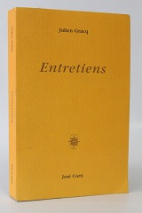
1Julien Gracq avait réuni en « appendice » à la fin du second volume de ses Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, quatre entretiens avec Jean‑Louis de Rambures, Jean‑Louis Tissier, Jean Roudaut et Jean Carrière. Le livre d'Entretiens paru en janvier 2002 chez José Corti reprend ces textes, et en ajoute trois autres : avec Jean Roudaut (un second entretien sur Le Roi Pêcheur), avec Jean‑Paul Dekiss sur Jules Verne, et Bernhild Boie sur la genèse de l’œuvre littéraire. Les entretiens sont rangés, comme les livres de l'auteur sur son étagère, dans l'ordre chronologique ; mais les circonstances – et les choix opérés, car tout n'a pas été repris – ménagent une sorte de composition symétrique : l'ouvrage est encadré par les considérations sur le travail de l'écrivain, ses manies ou ses techniques ; aux deux ailes, les propos échangés avec Tissier sur la carte et le paysage trouvent de nombreux échos dans les considérations sur Jules Verne. Au centre du volume la conversation tourne sur des sujets plus généraux, goûts littéraires, influences, rapport aux arts et à l'histoire, statut de la fiction.
2C’est donc un livre, si ce n'est pas exactement une œuvre : il s'adjoint à celle‑ci sans solution de continuité, mais sans confusion des ordres. Gracq prend acte avec simplicité de « l'élargissement en superficie de la littérature » au cours du siècle, et du déplacement de l'intérêt vers le témoignage, l'essai et le fragment : nous sommes ici au point de tangence où la littérature, sans se renier, alimente l’universel reportage et s’incorpore à la parole sociale. La continuité est celle qui mène en quelque sorte de l'intérieur vers l'extérieur : des « notes » ou « pages » qui font état du commerce avec les livres à un échange en partie double où les réponses destinées au lecteur sont adressées à l'interlocuteur sans que la relation de dialogue soit suspendue. De même que « le passage de la lecture (forcément en partie critique) à l'écriture se fait sans angoisse ni crispation, sans sentiment d'aliénation ni perte d'authenticité » (144), de même la littérature se prolonge dans ce « commerce chaleureux » auquel le lecteur est convié, et qui peut aussi bien introduire à la lecture de l'oeuvre que se greffer sur elle et en activer la mémoire. Mais cette continuité est également celle des lieux communs : les « préférences » dessinent les contours d'une topique adoxale plutôt que paradoxale, indépendante de toute opinion autorisée ; la redondance inhérente au genre y contribue. Gracq signale parfois qu'il va paraphraser ce qu'il a dit ailleurs, mais on trouvait déjà ce genre de remarque dans En lisant en écrivant. Il arrive aussi que ses interlocuteurs le citent (surtout Carrière, p. 169, 181), lui faisant assurer de manière un peu comique les questions et les réponses. Les propos de Gracq, c'est un des plaisirs que l'on prend à sa compagnie, ne sont gâtés par aucune vanité d'auteur. Sa position est celle d'un « usager » des livres et de la langue. Elle ne diffère de la nôtre que parce qu'il ne partage pas nos préjugés. L'entretien avec Jean Carrière est sur ce point très caractéristique : les questions sont empreintes de tout un pathos post‑romantique – l'« élévation des enjeux » surréaliste abondée par le « désespoir » de Blanchot, sur un fond d'élitisme de l'absolu. Les réponses portent la marque d'une réflexion empirique, de l'ordre du constat subjectif (« Pour moi, […] vue à travers la lecture des ouvrages et des périodiques, la vie littéraire est devenue plus ennuyeuse que celle de l'avant et de l'immédiate après‑guerre », 188) ou de la comparaison sur une large échelle géographique et historique (« Il est clair que la littérature se provincialise. […] Mais […] les littératures des pays moyens et des langues en recul peuvent avoir de beaux restes », 189). La même échelle large commande la perception de l'évolution des genres : quand on lui demande « pourquoi n'avez‑vous pas écrit de poésie ? « , Gracq répond qu'au xxe siècle la poésie « nomadise » hors de ses formes institutionnelles (192) ; à propos du théâtre contemporain il observe qu'il « semble vouloir boucler un cycle de quatre siècles » (91). Aucune tension n'apparaît entre l'autonomie du jugement littéraire, qui est une postulation évidente, et la prise en compte des conditions sociales de cet usage : Gracq est attentif au rôle de l'enseignement, aux rituels de la vie littéraire, au déplacement des critères de reconnaissance ; il n'a pas attendu Bourdieu pour relever que Paul Bourget fut le premier romancier à entrer à l'Académie (268).
3La littérature fait ainsi l'objet d'entretiens finis – pour détourner un titre de Blanchot. Usage et institution, elle s'offre à nous comme un lieu de sociabilité, dans une tradition venue de Montaigne, celle de l'« art de conférer ». À cet égard la publication de ces entretiens sous forme de livre chez José Corti est un geste significatif : le mode de relation qu'implique un tel livre et même son accès à l'existence n'ont rien de redondant. Cela vaut précisément dans la mesure où Gracq « penche vers où penche son époque » : contre la tendance des médias à ériger l'auteur en vedette, il recadre ce qui est déjà un lieu commun en le recentrant sur son objet et sur la relation de plaisir partagé dont il est la source ; il propose aussi une bonne forme de la relation entre littérature et journalisme, ce qui en France – malgré l'enquête de Jules Huret – n'est pas monnaie courante.
4Le type idéal qui forme l'horizon de cette relation avait été esquissé par Gracq en 1954 dans un texte qu'il reprendra en tête de Préférences, « Les yeux bien ouverts ». L'auteur fait les demandes et les réponses, il y a un monsieur « D » (ou une dame) et un monsieur « R », un peu comme « lui » et « moi » dans Le Neveu de Rameau. Cependant le dialogue s'inscrivait dans un cercle de sociabilité dont la muse était Lise Deharme, la dame au gant de Nadja, productrice d'une émission de radio ; Gracq y voisinait avec Breton et Reverdy. À cette date Gracq était sorti de l'épisode paradoxal et malencontreux du prix Goncourt, qui lui avait donné à réfléchir. Il avait certainement été attentif à l'apparition de la forme nouvelle qu'étaient alors les entretiens radiophoniques. Ceux de Breton avec André Parinaud avaient paru en 1952 ; les quarante et un entretiens avec Jean Amrouche qui forment les Mémoires improvisés de Claudel, diffusés en 1951, venaient d'être repris en volume. Les deux ressortissent au même genre, celui de mémoires oraux – nullement improvisés dans le cas de Breton, dont on sait que le livre constitue une réfutation de celui de Maurice Nadeau. La parole de Claudel n'engageait que lui‑même, et la réussite exceptionnelle du livre tient autant à l'équilibre des deux voix dans le dialogue qu'à la stricte transcription de l'oral, sans intervention stylistique. Le registre familier que Gracq adopte dans les cahiers qu'il commence à tenir à cette date, et dont il tirera les Lettrines, doit beaucoup à ce modèle de l'entretien radiophonique, poursuivi ou déplacé dans l'espace virtuel d'une conversation avec soi‑même. On observe d'ailleurs dans le volume des Entretiens une certaine évolution : l'entretien avec Jean‑Louis de Rambures, en 1970, reste proche du modèle de Breton, avec des questions brèves, une forte organisation rhétorique des réponses, une rédaction homogénéisée. En revanche trente ans après l'entretien avec Dekiss sur Jules Verne, qui est à mes yeux le meilleur morceau du livre, il tend vers le modèle claudélien : il avance à va‑comme‑je‑te‑pousse, porté par la complicité de deux amateurs qui connaissent leur sujet dans le détail et qui le commentent comme on ferait d'un bon plat (on lira en particulier le développement sur les « types nationaux », p. 208 sq.).
5Ce qui distingue Gracq, c'est que ses entretiens ne sont pas des mémoires : non seulement l'apport biographique est limité, mais il n'y a pas de globalisation, ni sous la figure d'une vie, ni sous celle d'une personnalité. Gracq avait certes accordé un long entretien à Jean Carrière, en 1986, pour une collection qui s'intitulait Qui êtes‑vous ? Mais il ne laisse jamais à cette question l'occasion de prendre forme ; et dans la Pléiade puis dans ce volume il recueille le texte avec d'autres, sans lui accorder une place particulière. Les entretiens ne constituent ni un complément biographique de l’œuvre (comme chez Breton), ni un surplomb (méta‑)critique qui formulerait une cohérence ou justifierait d'une exemplarité. Gracq n'a pas de secrets à révéler, ni d'apologie à présenter. Si l'on admet cette distinction, qui réserve un certain nombre d'informations relatives à l'individu privé, nous sommes frappés de ce que le reste est livré sans réticence ni pensée de derrière la tête. Les entretiens sur la littérature sont une maison de verre, mais dans laquelle il n'y aurait ni « lit de verre » ni « draps de verre » puisqu'à la différence de Nadja il n'est pas question de « livrer les noms ». Le point qui marque d'un paradoxe l’œuvre de Gracq est pourtant qu'elle s'est constituée tout entière autour de la hantise d'un « voyage sans retour de la révélation ». Si nous ne le savions pas, accorderions‑nous autant de prix à ces entretiens qui sont exactement ce pour quoi ils se donnent ? Mais Gracq préserve le désir de romanesque tout en décevant la curiosité. Il nous rappelle que la littérature ne se substitue pas à l'expérience humaine : c'est une leçon qu'il nous offre avec sagesse, humour et générosité.

