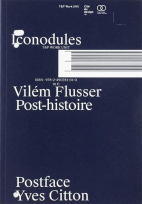
Post-scriptum à Post-histoire
1Il n’est pas de meilleur antidote que Post-histoire aux incessantes tournées des post- qui ont périodiquement occupé nos scènes intellectuelles depuis un demi-siècle. Rédigé entre 1980 et 1982, le texte de Vilém Flusser est presque contemporain de celui où Jean-François Lyotard caractérisait La condition postmoderne (1979) par son incrédulité envers les « grands récits » (des Lumières, du communisme, du capitalisme, de la technoscience), comme d’Orientalisme (1978), où Edward Saïd posait les bases d’une sensibilité « post-coloniale ». Il montre que l’âge prétendument « post-industriel » ne fait en réalité que robotiser l’ensemble de notre vie sociale, et que les médias de masse ont toujours déjà été « post-démocratiques ». À mi-chemin entre les visions désespérées de L’obsolescence de l’homme (1956) de Günther Anders et les rêves exaltés de L’Âge des machines spirituelles (1999) de Ray Kurzweil, il théorise magistralement le « post-humain » qui nous envahit à travers les multiples appareils dont nous nous (as)serv(iss)ons, en même temps qu’il déconstruit avec quarante ans d’avance l’engouement benêt qui nous fait (re)découvrir aujourd’hui les inconforts d’une politique « post-vérité ». Que vous ayez hiberné au cours du dernier demi-siècle ou que vous ayez colporté activement les multiples controverses des post-, ce petit livre vous les fait (re)visiter en intégralité et en accéléré — comme nos dernières secondes d’existence promettent de nous faire revivre notre vie résumée en une série de flashs fulgurants.
2Et pourtant, cet ouvrage qui résume et acère par avance les innombrables post- à venir en fournit également le contrepoison. Parce que les textes de Flusser, rédigés pour des conférences de 50 minutes, avancent toujours à une vitesse proprement inouïe, il transperce irrévérencieusement les post-, là où les autres penseurs se complaisent dans leur rumination. Ces vingt brèves lettres que Flusser adressait à ses contemporains dans des interventions orales à la fin des années 1970 — et que nous lisons pour la première fois sous forme de livre dans leur version française grâce au travail admirable d’Anthony Masure et de l’équipe de T&P Work Unit — sont des lettres qui nous viennent d’ores et déjà d’au-delà des post-. C’est depuis cet au-delà que Flusser, officiellement décédé en 1991 mais moins mort aujourd’hui que jamais, nous envoie les plus précieuses boussoles dont nous disposions dans notre désorientation actuelle. Dans cette postface à une Post-histoire venant d’au-delà des post-, dialoguons avec Flusser — comme il nous invite à le faire dans son « Mode d’emploi » ironique — pour faire un point sommaire sur les mérites, et sur quelques usages possibles, de ces boussoles.
La valse de nos hésitations
3La plupart des vingt chapitres déclinent un même schéma en trois temps, appliqué à des domaines variés qui se complètent et s’éclairent mutuellement. Les grandes évolutions de nos sociétés humaines (occidentales) sont scandées en une période d’avant l’histoire, suivie d’une période historique, qui se trouve aujourd’hui en phase de délitement pour laisser place à un nouveau régime d’après l’histoire. C’est ce régime « post-historique » que s’efforce de (nous faire) comprendre Flusser. Mais c’est en le contrastant avec les deux régimes précédents qu’il entend le rendre intelligible.
4Qu’appelle-t-il donc « histoire » pour servir de pivot à cette valse en trois temps ? L’histoire, pour lui, c’est essentiellement ce qui se laisse raconter par écrit selon un enchaînement de causalités linéaires. Le monde historique — coïncidant globalement avec ce qu’on appelle « modernité » (xviie - xxe siècles) — est celui qui se dote progressivement d’une mémoire documentale écrite, d’institutions publiques répondant à des règles explicites, et de sciences chargées de formuler des explications causales exploitables par des dispositifs techniques assurant aux humains une maîtrise sur leurs collectivités et sur leur environnement. Avant l’histoire, il y a non seulement la pré-histoire, mais aussi bien, selon les chapitres, le monde antique, le Moyen-Âge, les sociétés dites « traditionnelles », bref, tout ce qui relève de la pré-modernité. Après l’histoire, il y a ce que nous vivons depuis quelques décennies comme une série de « crises », symptômes de multiples fractures entre le monde historique qui domine encore nos schèmes explicatifs et le monde post-historique dans lequel nos appareils nous plongent, sans que nous disposions encore des moyens intellectuels requis pour comprendre le futur qui prend déjà forme à travers eux.
5La première boussole est donc rythmique : la valse à trois temps opère comme un principe d’investigation dans les multiples couches de notre présent. On s’aperçoit vite, en effet, que sous les apparences de la succession (pré-/historique/post-), le phénoménologue qu’a toujours été Flusser nous sensibilise à des aspects multiples, présents simultanément, de nos réalités contemporaines. La valse est un outil d’orientation spatiale tout autant qu’une scansion rythmique : avec un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté, elle nous apprend à tâtonner dans l’obscurité de nos hésitations.
La force de la provocation
6Il est toutefois une charnière traumatique qui sert de repère temporel obsédant au sein de ces explorations phénoménologiques. Sous le nom d’Auschwitz apparaît, dès le premier chapitre puis de façon récurrente, un moment de rupture par lequel notre monde a basculé dans l’impensable de la post-histoire. Certaines de ces références aux camps d’extermination pourront paraître choquantes, dans les raccourcis cavaliers qu’elles se permettent. Resituons-les rapidement dans leur contexte, non seulement pour désamorcer certains malentendus possibles, mais pour suggérer que nul n’a su aussi bien que Flusser en tirer des problèmes aussi importants que dérangeants.
7Rappelons d’abord que Flusser n’a échappé que d’extrême justesse à la déportation, qu’il est parvenu à fuir vers Londres grâce à sa belle-famille tandis que les siens, restés à Prague, étaient exterminés dans les camps — et que ce traumatisme l’a bien entendu hanté tout le reste de son existence. Dans la lignée d’Eichmann à Jérusalem (1963) d’Hannah Arendt, Flusser voit dans Auschwitz le cas extrême d’une « banalité du mal » qu’il réinterprète à travers une théorie des appareils et de leurs fonctionnaires. Le raccourci conduisant du supermarché ou de la salle de cinéma au camp de concentration (au chapitre 8) a certes de quoi nous mettre mal à l’aise, par l’assimilation d’un crime contre l’humanité avec un comportement quotidien. Au lieu d’historiciser une entreprise nazie étanchement endiguée dans l’Allemagne des années 1930, un tel raccourci fait surgir l’horreur au sein même de notre banalité d’appareils de divertissement et de consommation. Comprendre (qui n’est pas excuser) l’horreur nazie consiste à repérer (pour le prévenir et l’empêcher) ce qui pourrait nous pousser à la répéter.
8D’autres pages de ce livre pourront également choquer par ce qu’elles disent des masses, des migrants ou des drogués. Si de telles allusions peuvent paraître cavalières, ce n’est pas par irrespect, encore moins par supériorité, mais parce que les « gambades du cheval » évoquées dans le mode d’emploi du livre font la force de l’écriture de Flusser, comme des lectures auxquelles il nous invite. Davantage encore qu’un penseur, il est un provocateur de pensées : jusque dans les discussions les plus graves, il injecte une espièglerie dont les fulgurances nous font sursauter de nos habitudes de pensée. Elles nous « provoquent » littéralement, au sens où elles nous « appellent » à aller de « l’avant », au-delà de ce que nous pouvions penser par nous-mêmes.
9Il faut trouver là une deuxième boussole : au sein d’un monde régi par la double exigence contradictoire de répondre aux attendus et d’attirer l’attention, la force de la provocation est la force de la surprise, celle qui fait vaciller nos habitudes, mais surtout celle qui nous fournit une prise inédite sur ce dont nous subissons l’emprise. Car si la post-histoire multiplie les crises et les plongées dans un inconnu aux relents apocalyptiques, Flusser ne manque jamais de faire surgir une perspective d’espoir et d’émancipation du fond même de l’impasse où il nous accule.
Appareils, programmes et fonctionnaires
10Malgré la grande diversité de thèmes abordés dans les vingt chapitres de l’ouvrage, l’incessant jaillissement de trouvailles qui fait leur richesse tourne autour d’un même schème central, articulé lui aussi comme une valse en trois temps. Au même moment où Gilles Deleuze et Félix Guattari théorisaient un monde de machines désirantes et d’agencements, Vilém Flusser proposait une vision du monde, à la fois parallèle et complémentaire, articulée en termes d’appareils, de programmes et de fonctionnaires. Qu’est-ce donc qu’un appareil ? Qu’il soit technique ou administratif, c’est quelque chose qui « roule tout seul. Il fonctionne de par sa propre inertie. Très vite il échappe au contrôle de ses programmeurs. Il va dans un sens unique : celui d’une manipulation objectivante de l’homme. D’un anéantissement de l’homme en tant que sujet. De sa réduction, non pas en cendres, mais en robot » (chap. 1). L’appareil bureaucratique en donne une illustration cauchemardesque, tandis que l’appareil photo en fournit l’emblème technique1. La phénoménologie de l’expérience du photomaton proposée par le chapitre 15 (« Notre attente ») élève au comique chaplinesque notre asservissement tragique au mixte désormais inextricable d’appareillages techno-bureaucratiques.
11Pour Flusser comme pour Friedrich Kittler2, le hardware des appareils est inséparable du software des programmes qui régissent leur fonctionnement selon certains modèles, et des programmeurs qui ont « écrit par avance » ce que ces appareils feraient (même si ces derniers excèdent toujours ce pour quoi on les a programmés)3. En ces années où Steve Jobs et ses premiers comparses lançaient leur petite entreprise, Flusser ne se contentait pas d’entrevoir dès 1974 la puissance à venir de leurs smartphones4. Il dénonçait déjà la bêtise de leur obsolescence programmée : « les objets bêtes qui nous entourent, les “gadgets”, nous programment en deux directions différentes. D’abord pour ne pas pouvoir survivre sans eux. Ensuite pour ne pas discerner qu’ils sont tout bêtement stupides. »
12Or, non contents d’être stupides, ces gadgets menacent de nous rendre stupides (en même temps qu’ils donnent une puissance inédite à nos intelligences). À travers leur « manipulation objectivante » de l’humain, qui peut aller jusqu’à son « anéantissement », les appareils et leurs programmes nous transforment toutes et tous en fonctionnaires, à savoir en des agents réduits aux fonctions qui leur sont assignées par les appareils et les programmes en conformité avec certains modèles préétablis. Le fonctionnaire incarne tendanciellement la « boîte noire » (parfois appelée ici « caisse noire », par rémanence du portugais caixa preta) au sein de laquelle il opère : l’appareil et son agent exécutif n’existent qu’en fonction des inputs qui y entrent et des outputs qui en sortent, sans que leur singularité ni leurs motivations intérieures ne soient ni accessibles ni pertinentes. La fonctionnarisation tend à la désubjectivation. Le chauffeur (de taxi ou d’Uber) se réduit à l’opération qu’il exécute, emmener un client d’un point A vers un point B. On le remplacera avantageusement par une « voiture autonome », laquelle révèle du coup l’absence de réelle « autonomie » accordée à ce(ux) qui condui(sen)t nos voitures.
13De tous les écrits de Flusser, Post-histoire est sans doute celui qui développe le plus richement les modalités et les enjeux de cette dynamique entre appareils, programmes et fonctionnaires, illustrée de façon traumatique par Auschwitz, mais répandue depuis lors à travers toutes les sphères de nos relations sociales. À l’heure de l’algorithmisation ubiquitaire et de la fétichisation d’une « gouvernance » qui multiplie les strates d’opacité bureaucratique au nom de l’impératif de transparence, l’analyse critique de cette fonctionnarisation est plus éclairante que jamais. Elle fournit la troisième boussole que nous propose le livre. Ce que le chapitre 9, consacré à « Nos jeux », dit du réalisateur de film est vrai de la plupart de celles et ceux qui se trouvent en position de programmer les discours, les imaginaires, les gestes d’autrui : « le réalisateur doit programmer son programme en fonction d’un méta-programme d’appareils (aussi bien l’appareil de l’industrie cinématographique que l’appareil de gouvernement, l’appareil de la circulation urbaine, l’appareil confessionnel). Il est un programmeur programmé. Un joueur joué ».
14Plutôt qu’une hiérarchie de programmeurs, dont les plus haut placés seraient en position « méta- » de commandeurs par rapport à leurs inférieurs, Flusser entrevoit un univers qu’il qualifie de cybernétique, pour désigner le fait que les dynamiques de feedback y jouent un rôle au moins aussi important que les rapports de domination. C’est toute l’économie des big data et les effets politiques de la socialité en réseaux que Flusser entrevoit dans le chapitre 7 (« Notre communication ») : « le propos du dialogue en réseau est de servir du feedback aux mass media. […] Les appareils irradient des informations vers la masse, ils suscitent le dialogue en réseau afin de s’informer eux-mêmes, et de programmer la masse, en fonction des informations. Le dialogue en réseau ne produit d’information nouvelle que pour les appareils ».
15Or un tel univers cybernétisé valorise avant tout ce qui « fonctionne », à savoir les appareils qui produisent les outputs dont les autres appareils ont besoin au titre d’input. Un tel régime implique que, pour le fonctionnaire, « le vecteur de signification s’est inverti » – tendance funeste qui fournit une quatrième boussole à tirer de ce livre. Qu’est-ce que cette inversion ? Les statuts accordés au passeport et au citoyen, évoqués au chapitre 4 (« Notre travail »), peuvent en servir d’emblème. Tant que les appareils n’ont pas pris le dessus, la personne en chair et en os que l’on a devant soi constitue le référent premier, concret, dont le passeport n’est qu’une représentation secondaire. Au contraire, « pour le fonctionnaire, le concret donné, c’est le passeport. La personne là-dehors est une abstraction. Absorbé dans son monde des codes, le fonctionnaire ne se sent pas concerné par la personne là-dehors. Son travail à lui consiste à changer le monde des codes. Tel est le caractère propre à tout fonctionnement : invertir les vecteurs des significations ».
16Cette inversion cybernétique qu’analyse et dénonce Flusser chapitre après chapitre est à repérer aussi bien au sein des plus grandes structures technocratiques multinationales qu’au sein des gestes bureaucratiques les plus quotidiens de nos associations de quartier. C’est à de multiples niveaux superposés qu’il faut apprendre à repérer l’objectivation de l’humain par des appareils à la fois humains, puisqu’ils sont agencés par et pour (certains d’entre) nous, et inhumains, puisqu’ils déshumanisent nos rapports aux êtres concrets qui nous entourent en les occultant derrière des jeux de signes. Chaque fois que la réalité codée des demandes appareillées reçoit la primauté sur les réalités des besoins concrets, « ce seront les appareils eux-mêmes qui gouverneront » et « ce sera une société “trans-humaine” ».
Crises migratoires et problèmes d’habit(u)ation
17L’exemple du passeport n’est pas choisi au hasard : c’est sans doute dans le traitement infligé aux migrant.e.s par nos sociétés cybernétisées qu’on peut trouver l’une des illustrations les plus douloureuses de cette trans-humanisation. Et c’est dans l’extraordinaire chapitre 11 (« Notre habitation ») qu’on trouve certaines des pages les plus actuelles et les plus dérangeantes de cet ouvrage. Elles replacent la question des migrations dans le cadre d’une réflexion plus générale sur ce que nos modes d’habitation doivent à nos capacités d’habituation : à l’époque où Deleuze et Guattari parlent de « déterritorialisation », Flusser analyse notre condition à partir de l’arrachement que les appareils imposent à nos habitudes et à nos modes d’habiter nos milieux de vie5.
18Ici aussi, les formulations provocatrices ont de quoi nous choquer : il n’est guère politiquement correct de parler des migrants en termes de « barbares envahisseurs », ni de réduire les populations venues du Sud aux clichés des femmes enceintes miséreuses et de « bébés au ventre gonflé » – et encore moins de souligner leur « laideur » ! Et pourtant, ces quelques pages méritent d’être lues comme l’une des caractérisations les plus profondes et les plus virulentes de notre traitement (post ?) colonial des migrations contemporaines. Car ici aussi, Flusser nous provoque : il nous pousse (sans ménagement) à penser au-delà de nos habitudes (coloniales), lui qui a connu par deux fois au moins les chemins et les affres de la migration (de Prague au Brésil, puis de Sao Paolo à Robion, dans le sud de la France), et qui en a tiré une série d’écrits essentiels sur la Liberté du migrant6. On peut résumer sommairement son analyse en six points.
191° « C’est cette triple violence qu’on trouve au cœur de la migration actuelle des peuples » : violence ethnique et sexiste, violence de classe, violence des appareils.
202° Ces violences sont « post-coloniales », au sens où de multiples formes d’exploitations (racistes, sexistes, classistes) se sont superposées dans une colonisation terminée de droit, mais persistante de fait : « les visages douloureux de ces enfants-femmes » qui arrivent chez nous donnent un « relief palpable à ce que fut la violence de nos grands-pères : après avoir abusé de nos grands-mères, ils continuent à abuser de ces filles ».
213° Ces violences et les migrations qu’elles entraînent ne peuvent être comprises qu’au sein des appareils, des programmes et des modèles qui les gouvernent : modernisation, globalisation, innovation, libéralisation, démocratisation sont autant d’impératifs qui sapent nos habitations en bouleversant nos habituations. Français.e.s et Soudanais.e.s, Allemand.e.s et Syrien.ne.s, nous sommes tou.te.s emporté.e.s dans un énorme « transcodage du monde par les appareils qui ont abattu nos habitations ». Les migrations ne peuvent désormais être pensées que sous le poids du dérèglement climatique et de l’effondrement de nos écosystèmes : « Le déménagement nous concerne tous, aussi bien ceux qui bougent que ceux qui ne bougent pas. Notre monde tout entier est devenu inhabituel, nous ne nous y reconnaissons plus. Notre monde est devenu inhabitable. »
224° « Bouchons autoroutiers », « excroissances pernicieuses des villes tentaculaires », « flux migratoires » démontrent une même incapacité de nos appareils et de nos programmeurs actuels à mettre en place autre chose que « des lignes Maginot ». La « myopie des programmeurs » s’explique par le fait que – sur nos routes, dans nos banlieues comme à nos frontières – nos schémas mentaux sont obsolètes : nous craignons l’envahissement comme une conquête, alors qu’il relève bien plutôt d’une nécessité de partage. « Les envahisseurs d’aujourd’hui ne sont pas des vainqueurs. La migration actuelle des peuples est faite d’envahisseurs et d’envahis, qui sont, tous, des vaincus. Telle est la nouveauté ». Nous sommes toutes et tous « des grands-pères » désorientés devant « nos petits-enfants [qui] sont les envahisseurs du monde auquel nous sommes habitués ».
235° Aussi bien les calculs du GIEC que les politiques migratoires ou les mesures écologiques dictées par nos gouvernants émanent des fonctionnaires que nous sommes tous et toutes devenu.e.s, dans les universités comme dans les ministères, dans les multinationales comme dans les banques – avec « l’inversion des vecteurs de signification » qui donne au fonctionnariat son caractère « trans-humain » (au mieux), inhumain (au pire). Notre déménagement généralisé exige de nous tou.te.s des gestes d’aménagement, aussi (ré-)humanisés et (ré-)humanisants que possible. Ces gestes sont peut-être à chercher davantage aujourd’hui du côté de nos (vieilles) habitudes d’accueil, d’hospitalité, de secours et d’humanité, pratiquées à hauteur de corps mitoyens, plutôt que dans les fichiers Excel des compteurs de passeports, ou dans les fichiers Word des philosophes cosmopolites.
Pratiques artistiques de dysfonctionnarisation
24La réflexion de Flusser sur les migrations post-coloniales achève de nous prendre à contrepied avec son dernier tournant, qui déplace la question depuis le terrain sociologique vers un modèle d’ordre esthétique, celui de « la circulation de la beauté (joli-laid-beau-joli) ».
25 6° Les misères lointaines, les « bébés au gros ventre », les radeaux de sauvetage surpeuplés hantent nos imaginaires de clichés angoissants qui se situent aux antipodes de ce que nous considérons comme « joli » (c’est-à-dire habituel). Au premier regard, en fonction de nos attendus préexistants, l’inhabituel qui nous vient de loin (dans des conditions souvent dégradantes) nous apparaît comme « laid ». C’est en ce point précis que l’avenir nous appelle à nous élever au-dessus de nous-mêmes, à excéder les attendus. « La tension dialectique entre l’habituel et l’inhabituel, entre le joli et le laid, ne trouve sa synthèse qu’à travers la beauté » : la « laideur immédiate [des barbares] appelle au grand saut, au grand passage qui fait découvrir leur beauté. Joie alors de reconnaître la beauté dans leurs visages ».
26Ce grand saut, Flusser l’associe étroitement au geste artistique, qui constitue la cinquième grande boussole proposée par le livre. Les pratiques artistiques offrent en effet la principale perspective d’espoir à l’horizon des vingt chapitres de cet ouvrage plutôt crépusculaire. Elles fournissent aux fonctionnaires que nous sommes tou.te.s l’occasion et le défi de nous dys-fonctionnariser, c’est-à-dire de faire autre chose que répondre aux attendus des fonctions que les appareils ont programmés à travers nous. Notre premier devoir, on l’a vu, est de nous surprendre nous-mêmes, pour déjouer les attentes fonctionnelles qui nous fonctionnarisent. Cela peut commencer par découvrir une certaine beauté dans l’impression de laideur que nous apporte initialement l’inhabituel, l’étranger, l’alien – contre nos habitudes qui nous poussent à chercher le joli et à fuir le laid.
27Dans un monde où « les appareils fonctionnent dans le sens de la dé-politisation », Flusser voit dans le geste artistique une façon privilégiée de réintroduire de la politique au sein de notre monde fonctionnarisé. Dans le chapitre 17 consacré aux drogues (« Notre transport »), il décompose ce geste en quatre temps : « un premier mouvement qui sort du contexte culturel vers l’espace privé. Un deuxième mouvement qui cueille une expérience concrète. Un troisième mouvement qui la recodifie. Un mouvement final qui annonce le tout à sa culture. » Si l’art illustre au mieux ce geste, qui constitue une forme de « transport » (comparable à l’usage de stupéfiants), Flusser en fait plus largement « le geste humain par excellence, le geste dans lequel se reconnaît chaque fois et toujours toute définition d’activité humaine » : « c’est le seul geste véritablement politique, puisqu’il publie son expérience privée », en invitant ses adeptes à « se retirer dans leur espace privé, pour revenir sur la scène avec un bout d’information nouvelle7 ».
28La dysfonctionnarisation nécessite un mouvement de retraite dans un espace privé, une vacuole, une chambre-à-soi (premier moment), un temps de latence qui permette à une expérience concrète de pousser et de se laisser cueillir (deuxième moment), ainsi qu’un temps d’élaboration qui puisse recodifier cette expérience concrète (troisième moment), afin de préparer son émission et sa diffusion dans un espace public de résonance (quatrième moment). Flusser donne ainsi une version hétérodoxe mais suggestive du slogan The personal is the political qui se répandait à l’époque. S’il évoque bien une « décision de substituer à la solitude dans la masse la solitude dans l’intime », ce n’est pas pour mettre en avant son ego personnel, mais pour laisser advenir en chacun et chacune une « expérience concrète », c’est-à-dire pour cultiver ce qu’on pourrait appeler un espace monadique de concrescence – espace « à partir duquel on puisse publier » quelque chose qui ne se contente pas d’exécuter les fonctions prédéfinies que les appareils programment à travers nous8.
29Chercher le beau au cœur du laid, s’isoler momentanément des attentes fonctionnaristes et de leurs abstractions programmatrices pour se donner l’occasion de « cueillir une expérience concrète », faire un pas de recul pour mieux oser « le grand saut » d’amour envers ce qui nous envahit : autant de façons artistiques de sur-prendre l’emprise exercée sur nous par les appareils, et d’y réinjecter de « l’activité humaine ». Autant d’espoirs qui, au fur et à mesure de l’avancée des chapitres, font briller une lumière de moins en moins ténue au fond du tunnel de la post-histoire.
La boussole du désarroi
30Toute la complexité — et toute la beauté artistique ! — de la pensée de Flusser se manifeste dans le paradoxe pharmacologique qui semble ériger le poison au rang de remède. Pour lutter contre la déterritorialisation, nos jérémiades les plus communes prônent un retour aux racines. Si nous perdons nos habitudes d’habitation, si la désorientation qui s’ensuit menace à la fois nos santés mentales et nos communautés politiques, alors ne faut-il pas nous accrocher à nos territoires, à nos maisons, à nos bonnes vieilles façons de faire ?
31Les vingt valses que propose Flusser dans ce petit livre mobilisent le rythme ternaire pour refuser obstinément les facilités du binarisme. La post-histoire « se lève sous deux avatars : stupidité des appareils programmeurs, stupidité des barbares qui veulent détruire les appareils ». Quoiqu’opposés comme les deux versants d’une alternative, les seconds ne sont pas plus désirables que les premiers. « Impossible alors de nous raccrocher ni au nouveau ni au vieux. » « Nous sommes devenus réactionnaires dans tous les sens. Contre le “rationalisme éclairé”, et aussi contre l’irrationalisme romantique. Nous savons ce qui est inscrit dans ces deux programmes. La société des appareils, et le fascisme. » Ni l’un ni l’autre ne séduit Flusser. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis.
32Comme le constataient au même moment Jean-François Lyotard et les philosophes de la post-modernité, le principal défi de la post-histoire tient en un brouillage radical des repères qui nous orientaient au sein d’un temps linéaire conçu comme un développement progressif et progressiste : « Si nous avançons encore, ce n’est pas vers le futur, mais pour nous enfuir du futur qui nous poursuit. Nous ne pouvons pas habiter un monde où tout progrès est une fuite du futur. Un monde où tout progressisme est devenu prétexte de réaction. » Paroles prophétiques rédigées au moment où Reagan et Thatcher préparaient leurs vagues de (contre-) « réformes » néolibérales. À la voie linéaire et prometteuse du Progrès se sont substituées les voix contradictoires émanant de l’enchevêtrement des appareils. Aux fières et arrogantes audaces des révolutionnaires s’est substitué l’embarras timoré des fonctionnaires. Et c’est jusqu’à l’opposition entre les deux qui est en voie de liquéfaction, tant ils apparaissent ensemble comme également indéfendables : « toute action révolutionnaire est à présent aussi stupide que le fonctionnement des appareils. Il faut opposer à ces deux stupidités la stratégie du retardement. Ni César, ni Spartacus, mais Fabius Cunctator ». Quintus Fabius Maximus Verrucosus dit Cunctator (le Temporisateur, 275-203) est resté célèbre pour son refus d’emmener les troupes romaines à la bataille contre celles d’Hannibal, dont il savait les forces supérieures. Ce qui était dénoncé comme lâcheté relevait bien davantage de la prudence et de l’intelligence.
33Telle est la sixième boussole, éminemment paradoxale, qui prend forme dans les derniers paragraphes du livre : c’est à partir de notre désarroi même qu’il faut espérer tirer de nouveaux repères d’orientation. « J’ai dû essayer d’écrire ces essais, et il me faut essayer de les publier. Je me dois de le faire. Au nom du déchirement qui est le nôtre. » Contrairement à ce que les soi-disant « nouveaux philosophes » (Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann & cie) bredouillaient lamentablement à la même époque, Flusser n’appelle jamais ni à dénoncer les illusions progressistes qui ont si puissamment animé le xxe siècle, ni à renoncer aux espoirs dont elles étaient porteuses – et encore moins à en faire son deuil. Tout son effort de pensée émane d’un désir obstiné d’ouvrir une troisième voie chaque fois qu’on se sent enfermé dans une alternative binaire entre deux choix exclusifs.
34La valse est pour lui un moyen de répéter inlassablement un tel pas de côté, sans aucunement renier la nécessité de faire des pas en avant comme des pas en arrière. En nous confrontant à une impasse apparente, le désarroi nous appelle non pas tant à changer de sens, selon la linéarité typique de l’époque historique, qui ne pouvait imaginer qu’une bascule entre aller de l’avant et revenir en arrière. Le désarroi nous invite surtout à changer de direction, ou d’étage, pour ouvrir de nouvelles perspectives là même où le chemin semblait bloqué.
Médiatiser l’immédiat
35C’est cette valse pharmacologique qui écarte Flusser d’en appeler à l’immobilisation pour combattre la bougeotte de notre époque, et qui le pousse plutôt à prôner l’art comme un mode de « transport » pouvant servir d’antidote aux affres du grand « déménagement » induit par les appareils. La déshabit(u)ation ne se soignera pas en s’enfermant chez soi, mais en s’habituant à questionner ses habitudes et à aimer l’inhabituel. L’art comme drogue est « un outil pour se transporter hors de la médiation aliénante des outils ». Drogues et arts ont la capacité de nous dysfonctionnariser, en nous fournissant « des moyens pour esquiver la médiation culturelle, afin de toucher l’expérience immédiate ».
36Si Flusser est l’un des plus riches théoriciens des media, c’est qu’il s’intéresse de la façon la plus vive à ce qu’il appelle leur « viscosité ontologique ». Ils ne nous transportent pas sans nous coller à la peau. Ils ne font pas circuler des représentations sans emporter avec eux une part des réalités représentées. Ils sont toujours exposés à la possibilité de nous sur-prendre en dysfonctionnant comme en surfonctionnant. En véhiculant davantage que ce qui en était attendu. En réinjectant du concret au sein des abstractions les mieux codées. En tant que médiations, ils sont généralement récupérables par les appareils dont ils accomplissent les programmes. Mais ils y restent toujours irréductibles, dans la mesure où ils charrient de l’immédiat qui s’insinue en leur sein.
37Comme les drogues, les expériences artistiques nous dysfonctionnarisent dans la mesure où elles offrent « une médiation de l’immédiat9 ». Leur enjeu est d’échapper aux « prémédiations10 », déjà agencées par les appareils et les programmes préexistants pour assurer leur fonctionnement optimal. Leur enjeu est de nous rendre sensibles à des aspects « immédiats » – au sens de non encore médialisés, non encore encodés, non encore programmés – de nos réalités existentielles. Telle est bien la visée que s’est assigné Flusser en écrivant Post-histoire (comme la plupart de ses autres textes) : « Il nous faut essayer de reconquérir le concret, évaporé dans les méandres de l’abstraction. Et en témoigner. Il nous faut essayer, en dépit de tous, de médiatiser l’immédiat. »
38Cette exigence de court-circuiter les appareils, les programmes et les fonctionnaires que nous sommes afin de médiatiser l’immédiat prend une urgence toute particulière pour nous qui lisons ces lignes sous l’épée de Damoclès de l’effondrement de nos milieux de vie terrestres. Il apparaît aujourd’hui avec une clarté cruelle que « les catastrophes inévitables qui nous menacent » se trouvent emportées, sans intention explicite de nuire, comme la « réalisation automatique d’un programme ». Tout porte désormais à croire que nos appareils de mesure et de gouvernance, programmés pour maximiser la croissance, sacrifieront nos existences réelles (et celles de nos descendants) sur l’autel de leurs abstractions codées en termes de PIB, de taux de chômage et de profits actionnariaux. Tout cela — grâce à nous, zélés fonctionnaires que nous sommes — fonctionne désespérément bien !
39La post-histoire est ce moment qui ne nous laisse plus d’autre alternative que devenir artistes — toutes et tous autant que nous sommes. La question ne se pose plus de savoir s’il faut aller de l’avant (vers le gouffre) ou revenir en arrière (notre croissance a brûlé tous les ponts). Le seul vrai problème est de savoir comment nous dysfonctionnariser – non une petite élite d’artistes et d’intellectuel.le.s, mais à l’échelle de chacune des singularités qui composent la multitude et qui assurent le fonctionnement de nos appareils écocidaires. Non pas prévenir la fin du monde, ni l’atténuer, mais la faire bifurquer dans un troisième temps de valse qui lui fasse prendre un pas de côté.
40L’appel à médiatiser l’immédiat par des gestes artistiques — septième et dernière boussole à relever dans cette postface à Post-histoire — conduit non seulement à chercher le beau au cœur du laid, à s’habituer à l’inhabituel, à cueillir des expériences concrètes, à oser le grand saut d’amour vers ce qui nous envahit, mais aussi bien à « désirer les catastrophes que nous craignons ». Flusser ne nous invite nullement à nous accoutumer à ces perspectives crépusculaires pour en prendre notre parti. Le véritable défi est de désirer positivement les catastrophes, d’y voir et surtout d’en faire l’opportunité d’événements reconfigurateurs, au cours desquels la fin et les finalités d’un monde, acculé à l’impasse, pousseraient à un pas de côté ouvrant à des programmes et à des modèles encore inédits, inattendus, mieux soutenables et plus désirables. « La théorie des catastrophes affirme qu’il s’agit de points sur la courbe d’une tendance, là où cette tendance change de structure et devient imprévisible. Nous désirons parvenir à ces points-là. Nous attendons l’inattendu. Parce que tout ce que nous pouvons attendre, prévoir, calculer, futurologiser, c’est la courbe qui se dirige vers la fin du jeu ».
41C’est sans doute l’esprit de Flusser, et les échos (si proches ! si lointains !) de sa Post-histoire, qui animaient en 2010 les étudiants-artistes de Paris Nanterre lorsqu’ils graffaient la formule secrète de notre désir sur les murs de leur université : « Une autre fin du monde est possible11 ». La principale provocation de ce livre est de nous inviter à aimer activement cette autre fin du monde, à la faire advenir comme un défi artistique de ré-humanisation, et à en faire le Nord de nos efforts de réorientation.

