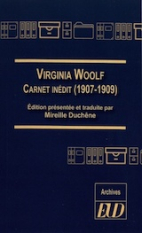
Woolf parrèsiaste
1Mireille Duchêne nous présente un ouvrage curieux, le « carnet d’études grecques et latines » (p. 7) de Virginia Woolf, qui réserve de « belles surprises » (p. 8), tel que l’annonce l’introduction. Le travail d’édition de M. Duchêne s’est appuyé sur la retranscription incomplète de Theodore Koulouris de 2004, conservée à l’université du Sussex, et en a apporté quelques corrections. Comme le titre l’indique, il s’agit d’un inédit, parfois cité par la critique mais rarement étudié dans ses détails, publié pour la première fois dans sa version originale et intégrale ; il est accompagné dans ce volume d’une traduction en français soignée et convaincante, nous renvoyant aux traductions françaises publiées des textes anciens étudiés par Woolf (p. 80-81). Ce carnet contient en effet des notes, traductions et résumés de lectures que Woolf a rédigés entre décembre 1907 et mai 1909 sur les textes suivants (dans l’ordre du carnet) : Satires (Juvénal), Odyssée (Homère), Ion (Euripide), Le Banquet (Platon), Géorgique IV (Virgile), Sophocle (Ajax), Les Grenouilles (Aristophane), Phèdre (Platon). À cette époque, Woolf a déjà choisi l’écriture : à partir de 1904, elle a publié ses premières critiques littéraires dans le Times Literary Supplement et la National Review notamment,elle travaille sur son premier roman, Melymbrosia (qu’elle achèvera en 1912 mais dont elle publiera une version largement remaniée en 1915, sous le titre The Voyage Out1) et vient surtout d’achever une nouvelle « Phyllis et Rosamond » (1906) dans laquelle Rosamond consulte notamment les Études grecques de l’illustre Walter Pater.
2L’intérêt de Woolf pour les textes antiques s’inscrit dans un contexte complexe que l’introduction de soixante-seize pages expose de manière détaillée et circonstanciée, nous permettant de découvrir la densité insoupçonnée des liens que Woolf a noués avec les traditions littéraires gréco-romaines, avec les « genres littéraires nés dans le monde grec » (p. 38), ou encore avec les institutions de son temps : en creux, le texte dresse « le portrait intellectuel d’une apprentie écrivaine qui, comme la narratrice d’une Chambre à soi n’a pas trouvé sa place dans les institutions universitaires » (p. 7). S’appuyant sur un ensemble de manuscrits conservés à l’Université du Sussex ou à la Berg Collection à la New York Public Library, et se référant de manière constante aux grands ouvrages de la critique woolfienne ainsi qu’aux autres grands écrits de Woolf, c’est-à-dire ses essais, journaux, sa correspondance et, surtout, ses textes de fiction, l’introduction nous permet d’entrer aisément dans ce document singulier, qui montre une « existence à la recherche d’un “corpus de la connaissance humaine” » (ibid.). Un premier questionnement, aux enjeux inattendus est soulevé : quelles éditions Woolf a-t-elle consulté ? Rien n’est en effet laissé au hasard dans cette introduction qui fait un remarquable travail de contextualisation de ce carnet d’études. D’autres interrogations, telle celle sur l’importance de la satire dans l’œuvre woolfienne pour n’en citer qu’une, apparaissent au fil de la lecture et contiennent autant d’invitations à des études plus approfondies.
Un objet hybride
3M. Duchêne montre bien que le texte du carnet « ne donne à voir ni la naissance d’un projet d’écriture ni le jaillissement ou le bouillonnement d’une pensée, ni l’état d’un texte à venir » (p. 8) ; mais il n’est pas pour autant « sans qualités » (p. 8). En effet, si Woolf n’a jamais eu aucune intention de publication, le carnet a néanmoins été « conservé au-delà des guerres et des déménagements » (p. 67) et, signe de son intérêt, il a été relu intégralement en 1917, comme le rappelle l’autographe qu’elle commente (p. 67-70). En soi, notons que l’objet n’est pas une rareté puisque soixante-dix carnets de Woolf sont conservés à l’Université du Sussex et dans la Berg Collection de la New York Public Library et M. Duchêne nous rappelle en outre que la pratique du carnet s’est largement « répandue à la fin du xixe siècle » (p. 30). Si le format évoque mutatis mutandis « un cahier d’écolier » (p. 71), il ne s’agit pas pour autant d’un cahier d’apprentissage des langues anciennes puisque Woolf « a dépassé ce stade » (p. 8) ; elle a en revanche numéroté les pages elle-même et « a pris soin de placer sur la page de garde qu’elle avait prévue un sommaire qui retrace l’ordre de ses lectures » (p. 71). Cette forme n’est paradoxalement pas dénuée d’intérêt car, « réservé à un usage personnel, ce notebook ne s’embarrasse guère d’exigences universitaires ou éditoriales » (p. 9) : en effet, si M. Duchêne nous rappelle que Woolf est connue pour ses libertés avec la ponctuation, dans ce carnet « souvent la frontière entre voix extérieures et voix intérieures paraît tenue, comme si la lectrice trouvait dans le fonds antique un écho à sa situation personnelle » (p. 52). L’on comprendra aisément qu’il ne s’agit aucunement d’un simple cahier d’exercice ou d’entraînement (comme le carnet d’italien mentionné p. 8), et encore moins d’un recueil d’une pratique scolaire d’analyse grammaticale ou de traduction, comme d’autres feuillets portant sur les Choéphores et l’Agamemnon d’Eschyle, ne serait-ce que parce que la part des commentaires personnel grandit au fil des lectures (p. 30-31). Bien au contraire, l’objectif de Woolf en tenant ce carnet, si l’on en croit M. Duchêne, est essentiellement « de consigner la teneur de passages jugés intéressants » (p. 10) ou encore « d’approfondir sa connaissance des genres et des registres littéraires […] poésie, théâtre, tragique, comédie, dialogue philosophique, satire » (p. 11). Le format et le contenu nous apparaissent d’emblée comme une source nouvelle permettant de mieux approcher certaines dimensions de l’écriture woolfienne et appellent de nouvelles recherches sur cet ensemble de textes et de fragments placés sous le signe de l’hybridité.
4Comme l’indique M. Duchêne à plusieurs reprises, le discours personnel est ainsi entremêlé des discours d’autrui, auteurs antiques ou universitaires victoriens, « sans délimitation aisément perceptible entre celui de Virginia et celui des éditeurs de textes antiques qu’elle a utilisés […] : la part de citation est difficilement repérable » (p. 9). Mais au fil des entrées, grâce à la présentation accessible qui différencie efficacement les commentaires (en italique) des résumés et traductions, les lecteurs et lectrices peuvent se saisir de cet objet textuel atypique, s’appuyant également sur un appareil de notes conséquent et souvent particulièrement éclairant (notamment p. 95 à propos de Juvénal ou encore p. 137 sur un trait commun à Argos, le chien d’Ulysse, et à Flush, celui d’Elizabeth Barrett Browning à propos duquel Woolf écrit Flush: A Biography en 1933).
Aux origines de l’intérêt pour les textes antiques
5L’introduction va elle aussi bien au-delà de la simple présentation du texte ; elle met en perspective et offre un éclairage original sur l’écriture. Elle nous montre également que Woolf lit, relit et se relit beaucoup (p. 9) et que ses lectures inspirent l’écriture, comme lors d’une analyse des notes sur Le Banquet qui « ne manque[nt] pas d’évoquer l’œuvre dans Melymbrosia » (p. 10). Si l’on regrette que l’influence de Walter Pater, voire celle de Nietzsche, n’ait été que simplement évoquée, c’est que l’introduction se concentre bien davantage sur le contexte immédiat d’écriture. En effet, l’attention portée à la chronologie et au rythme d’écriture (et à ses pauses) nous paraît en effet particulièrement riche tout comme l’étude jointe des entrées du journal (et de ses silences). Si les liens avec certaines notions ou concepts grecs (p. 12-13) ou l’identification posée avec le personnage de Virgile (p. 54) mériteraient probablement un développement plus détaillé, les échos biographiques avec la mort de Thoby en 1906, l’influence de Leslie Stephen (et de son approche morphosyntaxique des langues anciennes dont Woolf aurait cherché à se défaire), les cours de grecs de Janet Chase et Clara Pater (dont le carnet aurait « pris le relais », permettant à Woolf de poursuivre en autodidacte, sa formation initiale, p. 26 et p. 43) ou encore le croisement des références intertextuelles, notamment avec La Chambre de Jacob (p. 50) ou Les Vagues (p. 57), nous semblent particulièrement probants car ils permettent d’aborder la formation intellectuelle et artistique de Woolf sous un angle nouveau. Pour autant, Duchêne est consciente des limites de cette méthode, comme lorsqu’elle précise : « il est tentant mais hasardeux de mêler biographie et activité scripturale, toute modeste et intime qu’elle soit » (p. 60). Clairement, il ne s’agit pas de retrouver à tout prix des éléments biographiques dans ce carnet singulier ; plutôt, l’enjeu est d’en explorer les ressources en l’inscrivant dans un contexte d’écriture particulièrement instable, fait de deuils et de tâtonnements, mais aussi de voyages, d’indépendance, de spectacles et de lectures. De cette façon, en esquissant ces quelques résonances entre les notes de lectures et le cheminement de Woolf, M. Duchêne nous emmène sur « la trace matérielle d’une activité de l’esprit » (p. 8) en traçant les grandes lignes d’une démarche d’écriture peu étudiée par la critique woolfienne qui s’appuierait sur des éléments méconnus d’une culture littéraire personnelle, ou sur des hypotextes insoupçonnés qui auraient pourtant peut-être agi sur la naissance d’un art, ou du moins, influencé une trajectoire d’écriture.
6À notre sens, l’intérêt principal de ce carnet, alimenté d’un « réservoir de références destinées à nourrir et à épaissir la rédaction des textes romanesques ou celle des essais » (p. 10), réside précisément en ce qu’il nous indique de ce qu’a lu Woolf et surtout, de ce qu’elle en a recopié (p. 53) et écrit. L’influence des textes latins sur Woolf, tel celle du « je » de Juvénal (p. 13), constitue ainsi une piste particulièrement intéressante qu’il serait bon d’approfondir plus en détails dans des recherches ultérieures. Car si les références aux textes grecs sont bien documentées par la critique, notamment par Theodore Koulouris (p. 9, p. 20), l’attrait de Woolf pour Juvénal ou encore Virgile (p. 52-59) nous semble recéler nombre de perspectives encore peu explorées, telle cette hypothèse qui suggère que « la fréquentation de Virgile » aurait inspiré le roman Nuit et Jour (p. 61), ou cette autre question : « pourquoi en 1907 et 1908 Juvénal et Virgile trouvent-ils grâce dans un carnet qui réunit cinq auteurs grecs » (p. 38), alors que « le grec sera durablement le moyen et le guide [de son existence] » (p. 20) ?
Réflexions méthodologiques
7Aussi la publication de ce carnet vient-elle enrichir la critique woolfienne et effleure de possibles genèses de certains mouvements de l’écriture. L’étude des textes antiques se mue, selon M. Duchêne, en l’élaboration d’un « principe esthétique que [Woolf] ne cessera d’explorer : donner le sens du réel » (p. 40) et qu’il s’agit maintenant d’étudier avec minutie. Mais le travail de M. Duchêne nous semble en fait également contribuer à une réflexion plus large sur les méthodes littéraires. Ici, il s’agit à la fois d’étudier comment un texte hybride peut s’insérer dans un réseau intertextuel et de se pencher sur les prises de position d’une romancière en devenir, qui étudie de près une tradition à laquelle les femmes n’avaient que trop peu accès, pour n’en sélectionner que quelques une des lignes de forces. Cette orientation de recherche s’interroge sur le statut de l’auctoralité-en-devenir, sur les dynamiques qui sous-tendent les expressions et expérimentations artistiques. De même, M. Duchêne nous explique que « dans le désir de bouleverser et de rénover la forme romanesque, Virginia relit et repense les Anciens à la lumière des deux sens de μελετη : souci — particulièrement souci de soi pour reprendre l’expression de Foucault, et cura sui — exercice » (p. 64). Ces deux dimensions se retrouvent et s’enrichissent au fil des entrées où nous faisons face à la fois à une écriture et à une pensée personnelle en formation. Dès lors, si Woolf lit, relit, écrit et réécrit, « l’idée qu’elle se fait de la lecture vaut pour l’écriture : elle est liée à l’image du retour incessant, du creusement, de la méditation, de l’espoir en un lendemain où l’esprit pourra déployer ce qu’il a commencé de faire naître » (p. 10). C’est également pour cette raison que le carnet (comme lorsque Woolf regrette déjà de ne pas « pouv[oir] lire comme un Grec », p. 213) nous semble déjà annoncer l’essai si connu de 1925, « On Not Knowing Greek », où Woolf fait notamment état de l’altérité radicale des traditions littéraires grecques, et cite quatre des cinq auteurs grecs travaillés dans le carnet.
Woolf lectrice
8Cet objet hybride s’inscrit désormais pleinement dans le corpus woolfien grâce au travail éditorial déployé dans ce volume. Pour M. Duchêne, le corpus des notes contenues dans le carnet constitue un « témoin exceptionnel du travail d’une jeune femme lettrée et d’une période de son existence que le Journal passe largement sous silence […] : il restitue sous l’apparence sobre d’une prise de notes le portrait intellectuel d’une apprentie écrivain » (p. 7). Ce carnet est en outre « révélateur de procédures » (p. 8) d’appropriation de textes plus ou moins nouveaux et difficiles. Il s’agit d’une véritable démarche intertextuelle qui se développe peu à peu avec les lectures, faisant dialoguer les lectures des classiques avec l’écriture woolfienne en devenir ; Woolf lectrice « pose des questions, entend ses interlocuteurs de papier, ose des réponses » (p. 45).
9Que ce dialogue ait eu lieu « en dehors des institutions traditionnelles des lectures et de la diffusion des textes » (p. 46-47), par exemple les institutions universitaires telle la Section Féminine de King’s College que Woolf a brièvement intégrée (p. 25) semble ainsi particulièrement important tant ce « corps à corps solitaire » apparaît fécond et formateur. En effet, le carnet regorge de lectures où Woolf tente de « pénétrer le monde des idées et les beautés d’un style plus que les arcanes d’une langue [et] s’engage aussi en partie […] avec les auteurs des éditions de textes antiques [qui] exercent une influence majeure sur les études classiques » (p. 44). La comparaison avec l’entrée du Journal de juillet 1903, « de quel droit moi qui suis une femme, puis-je lire toutes ces choses qui sont l’œuvre des hommes ? Ils se moqueraient bien de moi s’ils me voyaient » (p. 43), citée par M. Duchêne, nous semble alors très pertinente tant elle rappelle à la fois ce « sentiment d’être une intruse » (faisant lui-même écho aux premières lignes de Juvénal citée par Woolf dans sa première note) et cette remarque fondamentale : « le Carnet de 1907-1909 est celui de la clandestinité, celui dont on ne parle pas mais où l’on s’exprime sur les textes à l’égal des savants du monde universitaire » (p. 43). L’enjeu féministe vient alors se mêler à la formation stylistique et narrative. M. Duchêne remarque d’ailleurs que Woolf « ne se cantonne pas à un rôle de lectrice servile dont l’attention serait retenue par la seule prise de notes. Sa parole s’exprime ici à côté de celle de Platon. Un dialogue philosophique lui suggère cette pensée » (p. 67) et c’est dans ce cadre que nous lisons les notes sur Le Banquet de Platon qui « regrettent que le style de la conversation ordinaire ne soit pas rendu “de manière heureuse par Jowett qui doit les adoucir en des vers amples, sur le modèle du 18e siècle” (Carnet p. 53) » (p. 42). Plusieurs analyses des pages du carnet ainsi offrent un complément intéressant à des volumes tels que Virginia Woolf among the philosophers (2013) de Chantal Delourme ou encore, outre les travaux de Koulouris, ceux de Fowler (1983 et 1999), Nagel (2002), Lamos (2006), McCoskey et Corbett (2012), Spirolou (2014) ou Scourfield (2018) pour n’en citer que quelques-uns sur l’influence grecque ou latine sur les essais, les réflexions féministes et la fiction par exemple.
10Constitué de véritables « leçons de littératures » lors desquelles Woolf « sonde des textes » (p. 14), identifie des ressorts conventionnels (p. 205), autant que des enjeux esthétiques fondateurs (p. 201), le carnet montre parallèlement que Woolf « est à l’écoute » de Platon, de Sophocle et des autres, et qu’elle « s’inscrit à son tour dans cette chaîne de penseurs par l’intermédiaire d’un modeste cahier de notes, et se propose de le méditer, pour entretenir son inspiration, et produire librement sa propre parole » (p. 65). Transposant ses lectures à des genres et formes toujours variés, Woolf développe une analyse fine et experte et esquisse ici et là des lectures personnelles qui évoquent les essais à venir. C’est pour cela que M. Duchêne fait de Woolf une parrèsiaste, c’est-à-dire, d’après Foucault, celle « qui aura à tenir des propos sur ce que c’est que l’homme en général, ce que c’est que l’ordre du monde, ce que c’est que la nécessité des choses » (ibid.). Aussi lorsque M. Duchêne ajoute que « le Carnet construit une mémoire, celle d’une généalogie générique d’auteurs du passé, celle des savoirs de l’humanité, de la poésie à la tragédie en passant par la réflexion philosophique. Virginia veut maîtriser des formes réalisées « par des hommes d’après leurs propres besoins et pour leur propre usage2 », il nous semble en effet que Woolf va au-delà de la simple étude : elle invalide (parfois à tort) certaines traductions en apportant ses propres versions. Il en va de même, lorsqu’elle consigne ce qu’elle apprécie, comme à la page 107 sur l’Odyssée où il est question d’une « magnifique description », ou qu’elle livre ses propres lectures argumentées (p. 121 et p. 127, par exemple).
11Pour autant, la majeure partie des commentaires du carnet semble viser le sens général (p. 171) ; et s’il n’y a pas de protocole arrêté lors de la rédaction des notes (p. 33), Woolf sait déjà quel la neutralité ne lui conviendra pas : outre la récurrence d’un lexique affectif empreint d’une subjectivité puissante, elle émaille ses notes de commentaires qui débordent le cadre littéraire, comme lorsque Napoléon et Kitchener sont évoqués pour mieux saisir le personnage d’Ajax (p. 231) et lorsqu’elle observe à propos d’Euripide, qu’il « jette une lumière curieuse sur la classe cultivée qui méprise un sanctuaire et cela présente une préoccupation subtile pour la condition domestique, inattendue chez un poète ancien » (p. 161). Ce sont en effet le poids et la finesse des analyses personnelles de Woolf qui ressortent de la lecture de ce carnet, articulant nombre de questionnements qui hantent les écrits majeurs, et venant se mêler à ce que M. Duchêne nomme la « beauté muette et figée » inspirée par la peinture et à « la beauté de l’action » (p. 59) portée par les expérimentations modernistes qui se déroulent dans les grands romans.
*
12Citant une entrée du Journal, contemporaine au carnet car datée de septembre 1908 :
Pour ce qui est de l’écriture — je veux moi aussi exprimer la beauté — mais la beauté (la symétrie ?) de la vie & du monde dans l’action […] je parviens à créer une harmonie à partir de discordances infinies, en faisant apparaître toutes les voies qu’emprunte l’esprit pour traverser le monde ; j’obtiens au bout du compte, une sorte d’ensemble fait de fragments frémissants ; voilà, à mon avis, ce qui semble être le processus normal ; l’envol de l’esprit. (p. 59)
13Mireille Duchêne nous incite ainsi à jeter un regard neuf sur l’écriture woolfienne et, à l’image de ce que Woolf elle-même a tenté de faire au fil de ses notes, à construire une réflexion nouvelle, une parrêsia non pas uniquement sur « ce que c’est que l’ordre du monde, ce que c’est que la nécessité des choses » (p. 66), mais peut-être surtout sur l’acte d’écriture et ses ramifications profondes.

