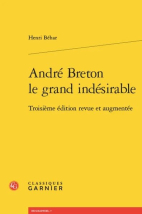
Dans le sillage d’Henri Béhar, biographe d’André Breton
1À en croire ceux qui l’ont approché, la parole d’André Breton exerçait sur les auditoires un ascendant naturel ; sa voix, restituée par les enregistrements des années 1950, a conservé son vibrato, sa clarté et sa fermeté ; y résonne toujours la passion de la liberté sous toutes ses formes et l’écho d’une immense culture. Son écriture, jouant en virtuose de l’écart maximal entre ambition théorique et automatisme, ouverte aux trouvailles, sait déclencher parfois ce « frisson » éprouvé par le poète lisant « Forêt noire » de Rimbaud. Nous pensons spécialement à la superbe formule « je cherche l’or du remps1 », reprise comme épitaphe sur son faire-part de décès. Breton s’est vu en individu singulier, durablement dérangeant et non-récupérable. Au moins est-ce ainsi que nous interprétons le titre, « le grand indésirable », maintenu pour la « troisième édition revue et augmentée » de sa biographie, offerte par Henri Béhar pour le centenaire du Manifeste.
2Les commémorations, comme les manuels de littérature, tendent trop souvent avec le temps à céder le pas au cliché. On range alors le nom de Breton dans la rubrique « surréalisme », réduite à sa seule personne, qu’on s’empresse de refermer passé le tournant des années 1930. La réalité est plus complexe, la trace plus profonde et plus durable Aussi ne saurait-on trop recommander aux amateurs de littérature la lecture de ce livre qui permet de saisir ou de retrouver dans son épaisseur diachronique l’aventure humaine de celui qui fonda avec quelques-uns le mouvement surréaliste, traversa fièrement avec les mêmes ou avec d’autres les grandes épreuves du siècle et s’attacha, tout en restant fidèle au surréalisme comme liberté, à en réinventer les formes au fil de cinq décennies. L’intérêt de cette biographie tient au regard du scripteur, à sa connaissance incomparable de l’œuvre et de son environnement culturel et historique, enrichie au fil d’une vie d’enseignant-chercheur consacrée aux avant-gardes du xxe siècle.
Au fil d’une vie
3Le plan en six parties chronologiques éclaire la genèse et les rebondissements d’une pensée qui se voulut action. Le biographe, comme l’auteur qu’il évoque, est guidé par une empathie que condense la formule empruntée par Breton à Germain Nouveau, « Savoir aimer suffit », reprise dans le numéro inaugural de la revue Médium (1953). Béhar n’ignore pas les réserves suscitées par Breton, critiqué pour son autoritarisme ou son retour larvé au mysticisme. Il choisit de raconter et d’analyser selon le point de vue de l’auteur évoqué mais s’attache à montrer les hésitations de sa pensée. Le propos se nourrit aussi des principales études portant sur l’œuvre ; la présente édition inclut les nouveautés comme ces Lettres [d’Aragon] à André Breton présentées et annotées en 2011 par Lionel Follet. La disposition nouvelle incluant des notes de bas de page facilite la consultation.
4Retrouver l’épaisseur et la complexité du fait humain suppose que soit montrée l’intrication des circonstances, des relations personnelles et des textes, d’abord lus puis simultanément écrits. En contrepoint du parisien, jouant dans la capitale son rôle de chef de mouvement, se dessine ainsi le profil « d’un homme de la campagne », « hanté par le bleu des mers » (p. 44). Du côté des parents, moins bourgeois que ne l’écrivit Sartre, la sévérité ambivalente d’une mère et la présence à distance d’un père, d’abord soucieux du devenir matériel de son fils, puis attentif à sa carrière et fier de lui. Du côté littéraire, la relation et les échanges épistolaires avec Paul Valéry, maître progressivement mis à distance, puis avec Apollinaire et Reverdy, à qui le surréalisme naissant doit une certaine idée de la poésie et peut-être son nom ; la lecture de quelques auteurs de la récente modernité au premier rang desquels Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont et Jarry : tout un horizon de lecture-écriture qui ne cesse de s’élargir et que vient télescoper la vie, alors que la Grande Guerre saisit une génération au sortir de l’adolescence.
5L’interne bénévole affecté à l’hôpital de Nantes en 1915, l’apprenti médecin-auxiliaire au Val-de-Grâce en 1917, se heurte au traumatisme physique et mental des blessés. Ces expériences sont l’occasion de rencontres fortes À Nantes, Breton fait la connaissance du blessé Jacques Vaché, alter ego et modèle d’une certaine radicalité. Vaché, dont il publiera la Correspondance, se singularise par sa manière de vivre. Il représente une « pataphysique active » ou un humour existentiel ; chacun de ses actes rappelle que la Grande Guerre a placé le père Ubu sur le devant de la scène politique. Sa mort en 1918, interprétée comme un suicide, serait l’ultime expression de cette révolte dont Breton cherche ensuite un substitut chez Tzara qui a pris une longueur d’avance en lançant à Zurich le mouvement dada. Entre-temps, il y a eu la rencontre d’Aragon et le début d’une amitié intense, cimentée par des passions littéraires communes, à commencer par la découverte enthousiaste de Lautréamont-Ducasse, lu à voix haute en écho aux cris des blessés rendus fous par leur expérience du front. En 1967, Aragon a donné de cet épisode un récit rétrospectif haut en couleur et peut-être arrangé2. Plus sobrement, Béhar souligne le rôle du duo dans la constitution du surréalisme appelé à dépasser la révolte de dada dont les représentants furent d’abord invités à Paris pour quelques moments partagés de manifestations littéraires riches en provocations.
6Nous ne saurions rendre compte des innombrables relations qui ont contribué à forger la personnalité de l’individu Breton. Le biographe explore un réseau labyrinthique au sein duquel se joue l’aventure surréaliste, indissociablement artistique, politique et amoureuse. Chacune des phases est toutefois dominée par un trio. La révolte contre l’art institutionnel symbolisée par la revue Littérature, à l’intitulé antiphrastique, est pilotée à trois. Aux côtés de Breton et d’Aragon, Philippe Soupault, le « troisième mousquetaire », dont on redécouvre l’importance. Soupault eut un rôle décisif dans la co-écriture avec Breton de cette œuvre inédite, Les Champs magnétiques, dont Aragon prit connaissance à son retour du front en 1919. Si les jeux comme Le Cadavre exquis ou les expériences de sommeil hypnotique, figurent de façon superficielle ou problématique l’automatisme vanté dans le Manifeste de 1924, l’écriture à deux ou à trois ouvre réellement un domaine nouveau, semblant dépasser en partie les frontières du sujet auteur.
7Quand La Révolution surréaliste succède en 1924 à Littérature, un second triumvirat, est à la manœuvre, réunissant Breton, Aragon et Paul Éluard, même si le trois se change souvent en deux plus un : « Aragon et Breton tiennent régulièrement leur permanence à la Centrale [surréaliste] le lundi » (p. 207). La mutation amorcée en 1930 avec Le Surréalisme au Service de la Révolution (nouvel intitulé) conduit à un éclatement partiel du groupe entre ceux qui, comme Aragon, prônent l’allégeance du surréalisme à l’Union soviétique et ceux qui s’y refusent. Fidèle au principe directeur de liberté en art, Breton, après une éphémère adhésion au Parti Communiste Français, prend ses distances et condamne avec une lucidité pionnière les procès de Moscou et les dérives du pouvoir stalinien. Pour mener, selon la formule du biographe, le juste combat pour la « vigilance révolutionnaire », il trouve à ses côtés et à ceux d’Éluard un autre membre du mouvement très tôt rallié au surréalisme, Benjamin Péret.
8Mais la guerre et les combats de la Résistance ainsi que l’exil de Breton aux U.S.A. éloignent Éluard. Dans cette période et dans l’après-guerre, Breton qui n’a pas renoncé à l’ambition avant-gardiste de son mouvement tente de le relancer avec l’appui de deux autres exilés, le peintre Marcel Duchamp et Péret. Ce dernier, auteur d’un pamphlet controversé contre la poésie de Résistance, intitulé Le Déshonneur des poètes, partage avec Breton la sympathie pour Trotski. Lors d’un premier séjour au Mexique, en 1938, Breton avait rencontré Trotski, contraint à l’exil par Staline. Ils avaient cosigné une importante déclaration sur la reconnaissance absolue de la liberté en art par la Révolution.
9Ce qui frappe, jusqu’au bout, est la ténacité avec laquelle Breton s’emploie à faire vivre la dimension collective du mouvement auquel son nom reste attaché. Dès les années 1930, le surréalisme a conquis une renommée internationale, en Europe (Belgique et Tchécoslovaquie, notamment) et, à un moindre degré, aux Amériques. Les peintres qui n’ont pas à affronter la barrière de la langue ont joué un rôle certain. Les revues et les groupes se sont multipliés. En France, la reconstitution d’un groupe surréaliste reste un enjeu fort, relayé par des tracts et des publications. La guerre d’Algérie fournit l’occasion de réaffirmer la dimension politique du mouvement, en écho à la guerre du Rif qui avait contribué en 1925 à l’avènement du surréalisme révolutionnaire.
10Il est toutefois de plus en plus difficile d’occuper le rôle de premier plan, alors que de nouvelles expressions littéraires, comme l’existentialisme ou la philosophie de l’absurde, sont apparues. Leurs figures de proue, Sartre et Camus, portent un regard critique sur le surréalisme, mouvement daté à leurs yeux. Certains membres importants du premier cercle comme Crevel, Desnos ou Artaud sont morts relativement jeunes. Des nouveaux venus prometteurs se sont intégrés au noyau originel, attirés par la promesse de révolution littéraire associée au surréalisme, Parmi eux, Ponge, Char, Caillois, Leiris, Prévert, Gracq, Bonnefoy ou Mandiargues. La plupart sont d’éphémères compagnons qui chercheront ensuite une voie personnelle. L’heure paraît moins propice, dans l’après-guerre, à la constitution de groupes. Ou bien, si de nouveaux collectifs se dessinent auxquels Breton rêve d’agréger un surréalisme rénové, ils rechignent à le suivre, soucieux de leur autonomie. Ainsi de Dotremont et du mouvement Cobra, et plus encore de Dubuffet, un temps assimilé à ce primitivisme qui n’a cessé d’intéresser Breton, grand collectionneur d’objets relevant des arts premiers. Dubuffet préférera fonder l’Art brut, version ironique et distanciée du primitivisme. D’autres intellectuels d’envergure comme Césaire, rencontré lors de l’escale à la Martinique menant les exilés volontaires à New York ou Lévi-Strauss, passager du même bateau, ont pour Breton une grande estime mais chacun suit sa propre trajectoire.
11Après le Manifeste de 1924 qui avait défini le surréalisme comme une forme supérieure de réalisme, intégrant la part inconsciente de notre pensée, après le Second Manifeste de 1930 qui tenta de façon plus ambitieuse la synthèse du marxisme-léninisme et du freudisme, Breton se contente d’esquisser en 1942 les Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non. La négation finale dit bien l’impasse provisoire dans laquelle demeure ce projet. L’échec historique de la Révolution d’Octobre ébranlerait-il la solidité de la science marxiste ? Rien n’interdit de poser au moins la question. À partir des années 1940, Breton ne cesse de relire Fourier, y cherchant ce que Marx aurait perdu en cours de route, tout en maintenant l’objectif d’une révolution sociale. Sa pensée se veut toujours irréligieuse et anticléricale. Mais la note préalable à la deuxième édition du Grand indésirable reproduite dans le volume de 2024 mentionne, parmi les objets inventoriés à son domicile, « une collection de bénitiers et de moules à hosties conservée par le poète athée » (p. 21).
12Ces questions et ces contradictions sont encore pour une large part les nôtres. Délaissant la minutie de la diachronie et ses effets d’échos modulés, tentons librement de revenir sur quelques point-clefs.
Réel, surréel, réalité
13Le premier d’entre eux est la question du réel et de la réalité. Les deux termes ne sont pas équivalents mais apparentés. Le surréalisme y contribue. Si le réel est la part de ce qui existe mais reste inaccessible à notre pensée (le noumène kantien ou peut-être l’inconscient freudien), le surréel serait un réel élargi à l’inconscient par l’automatisme ; le surréalisme en tracerait le programme. Quant à la réalité au sens courant du terme, elle est cette représentation verbale élaborée collectivement par les discours sociaux et fortement mise en crise par la faillite du monde qui vient de s’effondrer. Pour imparfaite et relative qu’elle soit, il est pourtant difficile de dénier à la réalité toute objectivité. Freud ne le voulut pas, qui opposa, comme on le sait, en 1920, principe de plaisir et principe de réalité. Au-delà du principe de plaisir est un texte peu présent dans les théorisations du surréalisme, surtout favorables à l’exaltation du désir. Breton préfère ébaucher un Discours sur le peu de réalité dont il ne parviendra à rédiger en 1925 que l’Introduction. Dans un texte fortement teinté d’idéalisme, s’affirme la volonté de soumettre le réel à l’expression poétique : « La médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d’énonciation ? » (OC, II, p. 276). Le Manifeste aragonien du surréalisme, antérieur de trois mois à celui de Breton mais publié à sa suite, ne dit guère autre chose. Nous ne partageons pas ici la critique d’Henri Béhar qui semble réserver à ce texte, Une Vague de rêves, le reproche d’idéalisme (p. 200). Alors que dans Le Paysan de Paris, Aragon opère un rééquilibrage au profit du réel urbain, le penchant idéaliste est plus fort, du côté de Breton, ainsi que le montre dès 1915, son approche de la ville de Nantes, confirmée tardivement dans un entretien radiophonique de 1952 : « À travers les rues de Nantes, Rimbaud me possède entièrement » (OC, III, p. 442). Toute autre sera, en 1985, l’évocation de cette même ville par Gracq, dont la discipline de formation, la géographie, présuppose l’existence objective des lieux qu’elle étudie3. La suppression de toute barrière entre le rêve poétique (éveillé) et le réel, apparaît encore dans L’Immaculée conception (1930), série de textes écrits avec Paul Éluard et animés par le désir « d’abolir la frontière entre le réel et le fantasme » (p. 297).
14Néanmoins, la dévaluation littéraire de la réalité est contredite en permanence par la pratique consistant à promouvoir le surréalisme par tous les moyens institutionnels. La création de revues, la publication de livres, la participation à des représentations théâtrales, fût-ce pour y provoquer le scandale, se fondent implicitement sur la reconnaissance du principe de réalité. Les cafés où les membres du groupe se retrouvent régulièrement, le Cyrano ou le Certà, sont des lieux d’échange et de socialisation. S’y confrontent des discours, bancs d’essai de paroles littéraires ensuite transposées en écriture, et des tempéraments qui donnent une assise physique à l’altérité.
Rationalité(s)
15Cette contradiction se retrouve si l’on aborde, sous l’angle de la rationalité, le versant philosophique du rapport au réel. Le monde est-il connaissable et par quels moyens ? Par la poésie, répond Breton. Mais cette connaissance supérieure promise par le surréalisme s’affirme d’abord contre la rationalité au sens ordinaire du terme. C’est le passage fameux du premier Manifeste caractérisant le surréalisme comme « dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison ». Le souci de définir, donc de poser une catégorie de pensée, correspond néanmoins, implicitement, à une forme supérieure de rationalité.
16Le dépassement des contradictions par une espèce plus souple de raisonnement se nomme dialectique. Le début du Second Manifeste évoque ce « point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement » (OC, I, p. 781), Breton revient à ce « point sublime » en 1937 dans le chapitre VII de L’Amour fou (OC, II, p. 780), puis dans un entretien radiophonique avec André Parinaud, en 1952, où il le nomme « point suprême », identifiant alors son origine hégélienne : « C’est incontestablement Hegel — et nul autre — qui m’a mis dans les conditions voulues pour apercevoir ce point » (OC, III, p. 525). En 1937, Breton s’est pourtant voulu ou cru marxiste, comme en attestent, dans les parties réflexives de son livre, les allusions à Engels et à Marx (OC, II, p. 690 et p. 745). Marx, comme on le sait, prétendit débarrasser la dialectique hégélienne de la perspective idéaliste qui en fausserait la portée et, dans une optique matérialiste, « la remettre sur ses pieds ». Mais le « socialisme scientifique » visé par le matérialisme dialectique contribua sans doute à obscurcir plus gravement le jugement de ceux qui prirent durablement, après 1930, le parti de l’Union soviétique, avec la caution de la « science », source de foi4. Plus tard, dans Blanche ou l’oubli (1967), Aragon écrira « Il ne suffit pas d’avoir raison pour avoir raison5 ».
17Si, au plan politique, la lucidité de Breton l’emporte sur l’aveuglement de l’auteur du Monde réel, il n’en va pas de même, s’agissant de la visée cognitive de la littérature. Breton paraît plus sensible au mirage d’un absolu de connaissance, quand Aragon se montre durablement marqué par le criticisme kantien6, qui désigne par le noumène la part inaccessible de tout objet de connaissance. L’Amour fou alterne en effet l’écriture poétique avec ses fulgurances automatiques et des pages réflexives qui en livreraient l’interprétation sur le mode de « l’exposé concerté » repéré par Gracq7 dans les écrits de Breton. Mais les psychanalystes Bellemin-Noël et Guillaumin, lisant L’Amour fou, y ont décelé une part d’illusion et de méconnaissance8.
18La réflexion sur la rationalité croise ici la question de l’autoanalyse, un temps essayée par Freud puis délaissée lorsqu’il théorisa la notion de transfert. Lacan en fit un des « quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » dans Le Séminaire XI. Le transfert attire l’attention sur la nécessité de l’autre dans l’interprétation. Si la poésie, s’ouvrant au rêve, puise dans l’imaginaire et le sensible, seule l’écoute par autrui des paroles et des images peut procéder avec le recul nécessaire à leur interprétation au moins partielle et s’immiscer avec quelque espoir de clarté dans la « ténébreuse et profonde unité » des correspondances pour en dégager des lueurs d’intelligibilité. Les mécanismes du Travail de rêve, maquillant un contenu latent en contenu manifeste, d’une part, le transfert, de l’autre, sont les outils théoriques permettant à Freud de briguer pour la psychanalyse le statut de science, lorsqu’il en propose une triple définition dans l’Encyclopædia Britannica en 19229. De l’écart entre une théorie requérant une interaction subjective et la fulgurance poétique individuelle résulta peut-être la déconvenue éprouvée par Breton à l’occasion de ses rencontres ou échanges avec le maître viennois en 1921, 1933, 1938 (p. 156. p. 327, p. 375). L’articulation des raisons au sein d’un freudo-marxisme cohérent reste un chantier ouvert et l’on ne saurait reprocher au seul Breton une difficulté partagée. Il se pourrait toutefois que cette difficulté trouve en ce qui le concerne une de ses racines dans un trait plus profond de sa personnalité dont se fait écho le récit des années d’exil aux U.S.A. : le refus de « parler anglais, par timidité, pour ne pas écorcher une langue qu’il maîtrise mal et ne pas formuler des pensées approximatives », note son biographe (p. 416). Ou par volonté de maîtrise absolue ? Risquons ici cette hypothèse complémentaire. Toujours est-il, selon le récit de Béhar, que ce détail joue semble-t-il un rôle important dans l’éloignement du second grand amour de Breton, Jacqueline Lamba, qui entame alors une liaison avec un peintre américain avec qui elle peut échanger dans sa langue. Contradiction intime de l’être humain : celui qui se ferme à un pan de l’altérité est aussi l’homme des expériences d’écriture à deux voire trois — on pense à Soupault, Éluard, Char ou Césaire — ou de l’attention portée aux cultures autres dont témoignent les collections rassemblées dans son appartement ou sa maison de Saint-Cirq-Lapopie.
19Interroger les failles de la rationalité reste le trait le plus constant de cette écriture dans son ambition théorique réaffirmée. Breton côtoie des rationalistes comme Caillois, dans les années 1930, ou plus tard Lévi-Strauss. L’estime de l’un et de l’autre n’empêchent pas la distance critique de pointer. L’épisode des « haricots sauteurs » — des graines originaires du Mexique « qui font des bonds imprévisibles » — déclenche des réactions différentes : Caillois veut découper les graines à la recherche d’un insecte expliquant le mouvement ; « Breton tient à prolonger la rêverie devant le prodige ». Le biographe condense les raisons amenant le néo-surréaliste à s’éloigner : « Caillois voit […] la marque d’une divergence fondamentale entre l’attitude magique du surréalisme, toute de jouissance et celle du chercheur » (p. 344). Ce penchant vers la pensée magique s’accroît durant l’exil avec un texte comme Arcane 17 (1944). « Il se tourne, note Béhar, vers le savoir de l’Égypte ancienne, vers l’ésotérisme et la haute magie comme clé du symbolisme universel » (p. 439). L’attrait pour la magie va de pair avec la prédilection du poète pour l’analogie. Dans « Signe ascendant » (1948), le mot donc est qualifié de « mot le plus haïssable », tandis que « le mot le plus exaltant dont nous disposons est comme » (OC, III, p. 766 et p. 768). La question, dès lors, est de savoir quel statut Breton accorde à l’analogie et à la pensée magique qui en est le prolongement. Faut-il faire la part du jeu et y voir une figure poétique comme ce fut sans doute le cas pour le Baudelaire de « Correspondances », ou le Rimbaud d’« Alchimie du verbe » et plus encore pour Lautréamont dont la tirade des « beau comme » est évoquée dans « Signe ascendant » ? Ou bien convient-il de prendre la voyance au sérieux, à la manière d’un Guénon ou d’un Renéville lisant Rimbaud dans un sens mystique, le poète s’assignant pour tâche d’atteindre la vérité occulte pressentie par la Tradition ? Malgré de nombreux signes en faveur de la seconde hypothèse, Breton nous paraît trop avisé pour trancher de façon définitive. Aussi place-t-il au début de L’Art magique (1957) une enquête censée accueillir des points de vue contradictoires. Lévi-Strauss qui fait partie des personnes sollicitées, « jugeant le concept inadéquat, s’en explique et donne la parole à son fils Laurent, âgé de 8 ans » (p. 524). Breton publie la réponse mais se brouille avec le père. Si « la grande loi d’analogie » peut être invoquée contre « le rationalisme desséchant », la critique du rationalisme penche de plus en plus vers des formes d’irrationalisme. Artaud, dès 1947, a perçu cette inflexion. Il explique son refus de participer à la seconde exposition internationale du surréalisme à Paris. Pour lui, le surréalisme, sous prétexte de chercher une version profane de l’absolu, « ne peut être mis en parallèle avec l’occultisme et la magie » (p. 466). Le débat sur la rationalité restitué ici dans son épaisseur contradictoire trouve un prolongement dans la controverse opposant aujourd’hui les penseurs de la Reconstruction10 aux héritiers de la déconstruction, qui, sous l’impulsion de Derrida, radicalisèrent au plan théorique l’exploration des failles du rationalisme. Il s’agirait alors de reprendre la question d’une articulation des logiques scientifiques : logique des sciences dures, à la recherche de lois pour penser le monde comme objet de connaissance, logique des sciences humaines et notamment de la psychanalyse, s’attachant à élaborer, à travers les jeux de la parole, une science ou connaissance de la subjectivité humaine.
Nœud littéraire
20La lecture de ce livre nous donne enfin envie de revenir sur un nœud de problèmes plus spécifiquement littéraires. Il peut se condenser en trois termes : roman, fiction et mythe.
21Le différend esthétique entre Breton et Aragon se cristallise très tôt autour d’une forme ou d’un genre que désigne le mot roman. L’affaire est bien connue, depuis le Manifeste de 1924 qui dénonce ironiquement l’écriture romanesque assimilée à un réalisme hérité du siècle précédent. Remarquons en passant que le même texte instruit, bien avant le Nouveau Roman, le procès du personnage comme personne fictive à l’existence de laquelle le lecteur pourrait croire :
[…] on ne m’épargne aucune des hésitations du personnage : sera-t-il blond, comment s’appellera-t-il, irons-nous le prendre en été ? […] il ne m’est laissé d’autre pouvoir discrétionnaire que de fermer le livre, ce dont je ne me fais pas faute aux environs de la première page (OC, I, p. 314).
22Aussi Nadja, le grand texte de la fin des années 1920, sera-t-il un récit et non un roman, en dépit de la demande de la jeune femme dont la rencontre a provoqué ce récit : « André ? André ?... tu écriras un roman sur moi. » (OC, I, p. 707-708). Celui qui se désigne ici par son prénom situe plutôt l’échange rapporté dans le champ de l’autobiographie dont le contrat de vérité porte sur l’adéquation au réel. D’ailleurs Nadja n’est pas un nom inventé par l’auteur mais le surnom que cette dernière s’est choisi, « parce qu’en russe c’est le commencement du mot espérance » (OC, I, p. 686). Surnom allégorique, donc. Comme pour confirmer le caractère non fictif de Nadja, Breton a conservé un dossier sur ses échanges avec celle qui s’appelait en réalité Léona Delcourt11. Si, par la logique onirique et analogique gouvernant de nombreux enchaînements, Nadja représente le récit surréaliste par excellence, ce récit n’opère aucune coupure avec le substrat référentiel qui en constitue le tremplin. « Nadja », a fortiori « André », ne représentent à la rigueur que des formes affaiblies de personnages en tant qu’ils sont figurés par le langage.
23L’interdit romanesque n’est pourtant pas partagé au sein du premier triumvirat. La tenace « volonté de roman » sans cesse réaffirmée sous de multiples formes par Aragon trouve un écho chez Soupault qui utilise le canal indépendant de la Revue européenne pour publier dès 1923 Le Bon Apôtre. « Breton condamnera en privé ce roman » (p. 182). Lui-même n’est pourtant pas hostile à tous les récits publiés sous cette étiquette. S’il rejette le modèle réaliste, il admire le roman noir anglais (Lewis, Radcliff) et vante au début de Nadja un roman comme En rade de Huysmans dans lequel le scénario fantasmatique occupe le devant de la scène narrative. Le même goût pour les décrochements oniriques suscite son intérêt pour Au château d’Argol de Gracq et sans doute moins pour Un balcon en forêt, alors que l’imagination romanesque gracquienne l’amène, semble-t-il, à passer sans heurt d’une forme à l’autre.
24Ce refus constant du roman peut se dire en langage moderne en termes de fiction. Interrogé naguère à propos du différend esthétique entre Aragon et Breton sur la question du roman, Henri Béhar nous avait aimablement indiqué, grâce au recours à la numérisation dont il est l’un des pionniers, le faible nombre des occurrences du terme fiction dans l’œuvre de Breton. Notre constat, côté aragonien, est à peu près similaire. Affaire d’époque. Nous en avons déduit que ce qui se pense à la fin du xxe siècle et aujourd’hui plus que jamais en termes de fiction correspond pour une large part à ce que les auteurs entendirent auparavant sous l’appellation « roman », à savoir un type de discours dont John Searle donna la formule théorique en 1979 dans « Le statut logique du discours de fiction12 » : discours produit et reçu sous le régime de la feintise ludique.
25La fiction et le jeu : voilà qui ne laisse pas de résonner s’agissant des surréalistes qui en inventèrent diverses versions, au fil des décennies. Le jeu surréaliste nous paraît fort éloigné, toutefois, de la feintise ludique. En dépit de ses formes à la simplicité enfantine, un fond de gravité existentielle l’affecte. Quelque chose comme une Révélation est toujours peu ou prou attendu. Ainsi s’explique le rapprochement éphémère avec le groupe rémois du Grand Jeu qui en représenta l’expression radicale. Pour Daumal et surtout Gilbert-Lecomte, reçus au Bar du Château en 1929, le jeu est vertige et expérience des limites, sur fond de soumission au hasard. Ilinx et aléa mêlés, plutôt que mimicry, pour reprendre les catégories posées par Caillois dans Les Jeux et les Hommes (1958). Cette inflexion du jeu vers le risque mortel n’est pas étrangère au projet, dès les années 1940, de constituer et de publier une Anthologie de l’humour noir. L’humour implique certes un dédoublement ludique qui le distingue a priori du sérieux, mais l’adjectif « noir » en altère la sérénité. Le prototype de cet humour noir est Vaché qui, selon Breton, aurait mis en scène sa propre mort comme l’ultime pied-de-nez à la société.
26À deux reprises, l’auteur du Grand indésirable, par concession à l’air du temps ou selon une parcimonie proportionnée à son modèle et objet d’étude, a néanmoins usé du mot « fiction ». À propos de L’Amour fou, d’abord : « l’ensemble donne une impression singulière d’unité, tant il reflète les préoccupations constantes d’un narrateur qui rejette toute fiction et relate la vérité d’une passion » (p. 371). À propos du séjour au Mexique et de la rencontre du peintre muraliste Diego Rivera, ensuite : « Rivera n’a pas très bien compris son hostilité radicale envers la fiction, mais c’est qu’au Mexique, l’art n’est pas frelaté comme en Europe » (p. 384). L’opposition entre fiction et vérité est une autre façon de démarquer le récit de L’Amour fou du roman. L’étonnement de Diego Rivera renvoie peut-être à la vitalité, dans le Nouveau Monde, du roman comme intrication du réel et d’excroissances imaginaires dont le réalisme magique constitua une des formules. Intrication sans fusion, mais avec ouverture à l’interprétation d’un tiers. Autrement dit, rejetant le roman dit réaliste, avec sa part de projection du monde réel, Breton écarte peut-être l’idée que le scénario mimétique interfère toujours peu ou prou avec un scénario fantasmatique, offrant au lecteur, sous le signe du jeu et du dédoublement, un espace interprétatif. On pense ici encore à Gracq ou à la relecture moderne de Zola, attentive à la puissance des images par laquelle le roman naturaliste décolle de la platitude du Roman expérimental.
27Le rejet de la fiction romanesque serait aussi à situer par rapport à la critique mallarméenne de la notion de fiction. Béhar signale l’importance de Mallarmé, au moins pour le premier Breton, sans doute sous l’influence de son disciple Valéry. Il note plus loin : « Depuis longtemps Breton a cessé d’en subir l’influence » (p. 187). Les trois auteurs partagent pourtant une prédilection pour l’expression poétique et pratiquent le contournement du roman, au nom d’une exigence supérieure de vérité. Mais la réflexion critique sur le langage amène Mallarmé à opérer une compréhension extensive de la notion de fiction, assimilée, non plus à un type de scénario narratif, mais à l’usage du langage dans sa généralité. Glosant Descartes dans ses Notes sur la langage13, Mallarmé écrit que « la fiction lui semble être le procédé même de l’esprit humain ». Ce procédé de l’esprit humain dérive de l’emploi du langage en tant que figure de la réalité. D’où la recherche, chez Mallarmé d’un emploi rare et souvent jugé obscur du langage poétique destiné à creuser l’artifice de la figure. Cela au nom de la Vérité comme adéquation supérieure de la Parole poétique à ce qui est. Nous suivons ici le propos de Jacques Rancière14, qui invite à distinguer au sein de la fiction deux régimes de sens : un sens extensif, applicable à tout langage en tant qu’il ne peut cesser d’être figure du réel, « agencement de signes et d’images », et un sens plus restreint, comme « agencement d’actions » ou histoire. Cette dernière acception, sous le régime du jeu, suspend ou diffère la question de la vérité ; la première « est à nouveau sous la législation de la vérité15 ». Il nous semble que, sans utiliser le mot fiction, un récit comme Nadja s’inscrit dans cette acception élargie, ne serait-ce que par l’intense quête de vérité qui en guide l’écriture.
28Ici surgit le troisième terme de notre réflexion : le mythe, mais un mythe compris par Breton comme figure d’une Vérité révélée et non comme figuration, par scénario interposé, d’un noyau indécidable de complexité humaine. Le mythe, depuis l’Antiquité, n’a pourtant cessé d’osciller entre ces deux pôles qui seront aussi ceux de la fiction16. D’un côté, il raconte des histoires qui donnent une forme dramatisée aux contradictions humaines et peuvent ainsi être réinvesties par des écrivains d’époques ultérieures ; d’un autre, il figure par une fable allégorique une vérité préalablement détenue ou pressentie, s’exposant alors au démenti de la démythification au point d’être compris, par les modernes, comme illusion trompeuse. L’écriture poétique et narrative de Breton ne cesse de tendre vers ce pôle du mythe, sous les traits de Nadja (1928) puis de l’Ondine (1937), deux figures de la transparence et de la connaissance absolue. N’est-ce pas ce qui se joue encore dans les appels réitérés de la dernière époque à la constitution d’un mythe nouveau, susceptible de « transcender » les mythes anciens (p. 423) ?
29Dès les années new-yorkaises au cours desquelles est conçu ce projet, Breton s’intéresse à l’allégorie des « Grands Transparents », « êtres invisibles » qui dominent nos comportements » (p. 425) et en détiennent la clef. Une continuité imaginaire relie la « maison de verre », le « cristal » et les « Transparents » : le rêve d’une parole supérieure accédant à une science infaillible. Nous avions avancé naguère l’idée que la puissance de l’écriture bretonienne va à l’encontre de cette postulation, faisant par exemple surgir l’image du sempervivum, « cette plante “effrayante” et qui “se porte bien” […], capable de proliférer “à partir d’un fragment de feuille” et même entre “les pages d’un livre fermé” », le sempervivum comme, une allégorie de la lecture indéfiniment prolongée par d’autres17. Ce faisant, toutefois, l’allégorie, perdant sa valeur transcendante, héritée de la tradition religieuse pencherait vers le sens baroque vanté par Benjamin à propos de son expression littéraire moderne. L’allégorie comme choc pressenti de la parole poétique et de la contre-parole interprétative.
30Nous savons gré à Henri Béhar, dans ce livre d’érudition et de réflexion, d’avoir ouvert, autour d’un des écrivains majeurs du siècle, un espace pour ce genre de méditation.

