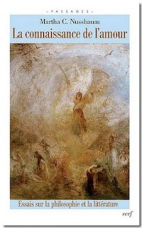
De la littérature comme remède à la prostitution : La Connaissance de l’amour de M. Nussbaum
1Ceci est l’histoire d’un universitaire consciencieux qui, soucieux de combler ses lacunes en théorie littéraire, décide de se former à la « critique éthique ». Aussi entreprend-il de se plonger dans les travaux de Martha Nussbaum, figure de proue de la discipline, dont le dernier ouvrage, La Connaissance de l’amour, vient justement d’être traduit en français.
2L’universitaire consciencieux s’apprête donc à affronter un épais volume de 589 pages et au prix quelque peu dissuasif de 68EUR. C’est un investissement conséquent en temps et en argent ; mais notre héros se dit qu’il n’a pas le choix, que c’est son boulot et que savoir ce qu’est l’amour, ma foi, ça se mérite.
3Très vite, il se demande s’il ne s’est pas trompé de livre : alors qu’il s’attendait à un ouvrage de théorie littéraire, il a la curieuse impression de lire un journal intime où l’auteur se confie sur sa façon d’occuper ses soirées, brode librement sur telle idée qui lui vient à l’esprit et profite de l’occasion pour achever son courrier. Notre universitaire consciencieux ne voit bien sûr aucun mal à ce que l’auteur félicite ses amis pour les articles élogieux qu’ils ont consacrés à ses précédents ouvrages, voire réponde ici ou là à quelques-unes de leurs modestes objections ; mais il a la désagréable impression de déranger par sa lecture l’intimité de ce petit cercle. Il est également désarçonné par cette succession d’articles, dont l’unité n’est pas toujours évidente et qui laisse au lecteur le soin de faire la synthèse. Mais, bon, le devoir avant tout : notre homme se munit d’un surligneur et (sachant, hélas ! combien il est fréquent d’être mal lu et trahi par les comptes rendus) se lance dans une lecture attentive et minutieuse de l’ouvrage.
La fiction, c’est du concret
4La thèse générale est assez vite énoncée : il faut lire la littérature comme expression d’une philosophie morale et considérer les œuvres comme autant de réponses (explicites ou non) à la question « quelles pourraient être les bonnes manières de mener sa vie ? » (p. 344). Ce qui taraude M. Nussbaum, chaque fois qu’elle lit un roman, est en effet de savoir si les pensées et réactions des personnages sont « rationnelles et louables » (p. 136) — le premier critère impliquant le second, à moins que ce ne soit l’inverse.
5Pourquoi faudrait-il lire ainsi ? se demande notre universitaire consciencieux. La réponse claque aussitôt : parce que c’est ainsi que tout le monde lit. Chaque lecteur met spontanément le texte en relation avec son existence — et c’est ce qui explique que la littérature tienne une place si importante dans nos vies : elle traite de questions éthiques et sociales en enquêtant « sur ce qu’est le bien pour un être humain » (p. 572). Aussi importe-t-il d’en finir avec le formalisme réducteur et de proposer « un discours sur la littérature qui s’intéresse aux sujets vraiment importants pour les êtres humains, et qui respecte ces notions actuellement méprisées que sont la vérité, l’objectivité […] » (p. 329).
6L’universitaire consciencieux s’interroge : où est la vérité des univers virtuels de la littérature? Quel enseignement peut-on tirer d’un dispositif artificiel où les exemples sont évidemment ad hoc ? N’est-ce pas confondre l’art et la vie ? la fiction et la réalité ? le langage et le référent ? Mais il s’en voudrait de brouiller par des remarques intempestives la clarté d’un problème présenté avec une biblique simplicité p. 214 : l’important, c’est de déterminer si les conceptions illustrées par le roman « sont ou non exemplaires pour nous ».
7 À la question de savoir ce qui fait la force spécifique de la littérature (et, plus particulièrement, du roman) dans le domaine éthique, les idées avancées se ramènent aux trois propositions suivantes : le roman se focalise sur le particulier (et ouvre donc sur une sagesse pratique, loin des principes généraux et abstraits des systèmes philosophiques) ; la littérature sollicite nos émotions (permettant ainsi une perception intuitive particulièrement adaptée à la connaissance morale) ; la forme littéraire (en particulier, romanesque) permet d’exprimer certaines vérités, inaccessibles aux discours théoriques.
8Sur ces trois points précis, l’universitaire consciencieux ne trouve pas grand‑chose à redire. Il se demande simplement s’il était indispensable de déranger Aristote pour rappeler que les histoires préfèrent les situations concrètes aux principes généraux. Finalement, cette critique éthique lui semble être une section particulière de ce qu’on appelait jadis la critique thématique. Ce qui est intéressant mais pas très nouveau. On lui répondra que la critique éthique — et M. Nussbaum y insiste — prend en compte la forme et les techniques narratives. C’est encore plus intéressant, mais ce n’est toujours pas très nouveau. C’est ici que notre homme (quelque peu naïf) fait une grossière erreur. Il n’a pas compris que les choses sérieuses n’avaient pas vraiment commencé. Car si la critique éthique avait pour seul objet l’univers de valeurs inscrit dans un roman, ce ne serait guère qu’une analyse de l’éthique du texte et non une analyse éthique du texte. L’originalité (si l’on peut dire) de la critique éthique, c’est de s’interroger sur la portée morale de l’œuvre littéraire. Et c’est ici que les choses se gâtent.
Ce « misogyne » de Rabelais » et ce « masturbateur » de Proust
9L’engagement à faire de la théorie littéraire un « allié déviant » et un « critique subversif » (p. 256) de la théorie morale est rapidement oublié. Pour M. Nussbaum, en effet, il ne suffit pas de savoir ce qu’expriment les romans, encore faut-il vérifier qu’ils sont bien du côté de la vérité et de la raison.
10Notre universitaire consciencieux ferait bien remarquer que la littérature peut aussi servir à s’évader dans l’imaginaire, qu’il n’est pas désagréable, le temps d’une lecture, de se mettre dans la peau d’un séducteur cynique, voire d’un tueur en série, que les « mauvaises fréquentations » sont précisément celles qui ouvrent l’horizon en nous arrachant au confort de notre univers de valeurs et que, si l’on s’intéresse à l’autre, il faut peut-être commencer par accepter les différences culturelles et idéologiques ; mais à ceux qui ne l’auraient pas encore compris et qui, comme lui, ont la tête dure, M. Nussbaum le répète inlassablement : le but ultime de la littérature est de nous apprendre à bien vivre « comme un membre de la société » (p. 347). En conséquence, « il existe aussi certaines choses contre lesquelles la critique éthique peut à bon droit s’élever » (p. 348) et, comme l’a bien compris W. Booth1 (auquel M. Nussbaum consacre un article dithyrambique), « particulièrement mauvaises sont les expériences qui nous placent en compagnie d’un auteur implicite dont le caractère est mauvais […] » (p. 349).
11 Notre universitaire consciencieux commence à vaguement s’inquiéter. Mais qui sont ces auteurs qui pourraient pervertir l’esprit et dont la fréquentation est déconseillée ?
12Il y a d’abord ceux qui nous font perdre du temps en nous obligeant à nous focaliser sur un objet unique et restreint. Ainsi de Peter Benchley, le malheureux auteur de Jaws (Les Dents de la mer) : « Booth montre facilement l’étroitesse de nos sentiments et de nos vues pendant cette lecture » (p. 350).
13Ensuite, il y a les auteurs immoraux, comme Rabelais, le misogyne (dont la « conception insultante des femmes » diminue l’estime qu’on lui porte, p. 350-351) ou Twain, le raciste (qui fait preuve de « paternalisme et condescendance » à l’égard des Noirs, ibid.). À ceux qui penseraient que cette approche de la littérature comme instrument d’édification morale est peut-être d’un autre temps, M. Nussbaum répond, dans le style si nuancé qui est le sien, qu’un tel point de vue n’est pas « réactionnaire », mais simplement « rationnel » (p. 362) : l’œuvre doit être jugée en fonction de « principes moraux stables » (p. 351). Certes, M. Nussbaum s’appuie sur des valeurs consensuelles, comme l’anti-racisme ou la compassion pour les plus faibles ; mais on frémit d’imaginer ce qu’aurait pu recouvrir le terme « rationnel » dans d’autres contextes.
14Enfin, sans aller jusqu’à les proscrire (M. Nussbaum reconnaît son admiration pour Proust et Beckett), il faut se méfier de certains auteurs et ne pas hésiter, sur un thème particulier, à dénoncer leurs conceptions erronées en les comparant aux textes plus justes et plus vrais. M. Nussbaum se livre à ce salutaire exercice concernant justement la question de l’amour. Tout en reconnaissant à Proust certaines vues assez justes sur la question, elle pointe chez l’auteur de La Recherche une grande faiblesse : ce qu’il n’a pas compris, c’est que le scepticisme sur l’amour peut être dépassé par l’amour (p. 405). Que ceux qui s’inquiéteraient d’être ainsi maintenus dans l’ignorance se rassurent : l’œuvre de la romancière Ann Beattie va permettre de rétablir la vérité dans nos esprits corrompus. Le génie de Beattie2, c’est en effet d’avoir compris (à la différence du malheureux Marcel) que l’amour n’a pas à voir avec le deuil, mais avec le rire. Chez Beattie, en effet, le couple rit. Il rit, me direz-vous, et alors ? Alors, « nous imaginons que ce couple a une vie sexuelle heureuse, alors que la conception de Marcel implique qu’il n’y a rien d’autre en réalité que la masturbation » (p. 414). Dans la magistrale nouvelle de Beattie, le « solipsisme est dépassé […] non par quelque ruse de l’intellect mais par l’amour lui-même » (p. 418). En effet — et nous avons enfin la réponse que nous attendions avec impatience sur la vérité de l’amour — connaître l’amour, « c’est avant tout se fier à l’autre personne et suspendre les doutes proustiens » (p. 406). S’ensuit un passage particulièrement alambiqué sur les « preuves » de l’amour (et que notre universitaire consciencieux, bien que le relisant pour la sixième fois, n’est toujours pas sûr d’avoir bien compris) :
Une telle connaissance n’est pas indépendante des preuves. Elle est typiquement fondée sur une attention fine déployée sur une longue période, une attention qui fournit de nombreuses preuves sur l’autre personne, sur soi-même, sur les structures de l’interaction entre moi et l’autre. Et elle n’est pas indépendante non plus de puissants sentiments qui ont une réelle valeur de preuve. Mais elle va au-delà des preuves, et s’aventure hors du monde intérieur. (p. 406)
15Ici, l’universitaire consciencieux se dit que le réductionnisme formaliste, finalement, ce n’était pas si mal et il lui prend une envie violente de se replonger dans la lecture des œuvres intégrales de Jakobson, Propp ou Chklovski.
16Après une telle démonstration, on ne s’étonnera pas que M. Nussbaum se fasse un devoir de nous indiquer le corpus requis pour exploiter la dimension éducative de la littérature (p. 327). Elle est cependant plus libérale qu’il n’y paraît car, en vertu d’une théorie du juste-milieu, elle consent à moduler le corpus en fonction du public : il faut confronter chaque lecteur aux livres qui prendront le contre-pied de ses positions radicales pour le ramener sur la bonne voie. Ainsi, « comme le remarque Booth, ce serait une bonne chose qu’un subjectiviste moral lise et réfléchisse sur Le Magasin d’antiquités de Dickens, alors que la même expérience ne conviendrait sans doute pas à quelqu’un qui serait trop enclin au dogmatisme » (p. 360).
17Notre universitaire consciencieux commence à être sérieusement éprouvé. Mais il n’est pas encore au bout de son étonnement.
Où la fiction populaire est louée pour nous sauver des amours tarifées
18M. Nussbaum en vient à un problème crucial, bizarrement négligé par la philosophie morale et la théorie littéraire : est-il excusable de lire pour se délasser, et après une longue journée de travail, l’un de ces romans grand public qui n’élargissent pas l’horizon et ne font pas progresser la pensée ? Voici la réponse, tout à fait inattendue, qui nous est faite (et qui mérite d’être citée assez longuement) :
On a parfois besoin de distractions complètement abrutissantes, de divertissements si complets qu’ils effacent complètement soucis et préoccupations. Considérons maintenant deux personnes qui cherchent cette forme de détente facile. La première recrute une prostituée et s’offre une soirée de sexe. L’autre achète un roman de Dick Francis et passe la soirée à lire couchée sur son canapé. Je pense qu’il y a une énorme différence morale entre ces deux personnes […]. La personne qui recrute une prostituée cherche à se détendre en utilisant un autre être humain ; elle s’engage dans une activité qui exploite et dénigre une personne et une activité intime. Mais je ne crois pas que la personne qui lit Dick Francis fasse du tort à qui que ce soit. Elle n’est certainement pas en train d’exploiter l’écrivain : au contraire, elle le traite exactement de la manière qu’il souhaite, dans une relation commerciale digne. (p. 357-358)
19Si l’on comprend bien — et contrairement à ce que pense W. Booth (c’est l’un des rares points de désaccord entre M. Nussbaum et lui) —, lire des romans simplement divertissants est légitime ; car, si l’on cherche une détente facile, on aurait pu faire pire en faisant appel à une prostituée. Le mauvais roman nous sauve donc de la prostituée.
20Notre universitaire est de plus en plus perplexe. Mais comme il est vraiment très consciencieux, il va aller jusqu’au bout, voir si on peut quand même tirer de tout cela quelque chose comme une vision de la littérature, qu’il sera libre d’accepter ou pas, mais au moins qu’il aura comprise.
De quelques fils à démêler
21L’une des grandes difficultés de l’ouvrage est de savoir ce qu’entend précisément M. Nussbaum par valeur éthique de la littérature. On ne sait jamais si la valeur éthique du roman tient au fait qu’il fournit des données, qu’il exprime une vérité ou qu’il suscite une expérience. Poser que la valeur documentaire ou heuristique entraîne mécaniquement l’efficacité pragmatique serait en effet quelque peu cavalier. Or, à plusieurs reprises, M. Nussbaum semble postuler une équivalence entre les émotions décrites dans le texte et les émotions ressenties par le lecteur. Ainsi, à propos de David Copperfield :
Dickens […] présente un roman dont les structures émotionnelles proviennent de l’expérience originelle d’une mère belle, aimante, protectrice et pourtant vulnérable. Les émotions nées de la rêverie qu’engendre cette expérience sont l’amour, le désir de protéger et d’être protégé, le plaisir devant les beautés de la vie. Les mêmes émotions sont les sources de l’intérêt que le lecteur prend au roman. (p. 535)
22Comme si le passage de ce que dit l’œuvre à ce que ressent le lecteur était automatique et immédiat. Rebelote à propos de Proust : « de même que Marcel, en créant son œuvre, discerne et articule la structure de ses amours, et rend manifeste le schéma de leur intermittence, de même le lecteur, en comprenant la structure générale de l’œuvre de Proust (et en se représentant sa propre vie selon un modèle aussi éclairant), est délivré comme Marcel de l’asservissement à l’expérience présente et prend possession de son amour comme un tout » (p. 415). C’est aller un peu vite en besogne en faisant l’impasse sur l’essentiel : l’analyse du dispositif rhétorique censé provoquer une telle expérience.
23Les choses sont d’autant plus confuses que l’emploi que fait M. Nussbaum du terme « morale » est, malgré son plaidoyer pour « la solidité de l’argumentation » et « la clarté des définitions » (p. 329), pour le moins flottant. Ainsi, dans le passage suivant (où nous apprenons, avec un certain soulagement, qu’il arrive que le roman s’aventure dans des régions troubles) :
[Le roman] fait signe vers les limites de la conscience morale, nous rend conscients des éléments profonds de notre vie morale que leur violence et leur intensité excluent tout à fait de l’attitude morale, de la quête d’une vision équilibrée et d’une rigueur parfaite » (p. 286‑287).
24Autre problème (si l’on retient l’hypothèse pragmatique) : existe-t-il une valeur morale du roman en tant que genre ou faut-il déceler l’effet particulier propre à chaque texte ? Si la distribution des bons et des mauvais points ne laisse guère de doutes sur la réponse de M. Nussbaum, on trouve parfois l’idée que c’est la lecture romanesque comme telle (indépendamment des valeurs véhiculées par un roman particulier) qui a un effet éthique positif. Ainsi tout roman illustrerait la même loi générale : il faut, dans notre relation aux autres, tenir compte de la situation et de la particularité de l’histoire de chacun. De même, dans la mesure où ils nous ouvrent à l’altérité, tous les romans prépareraient à l’amour, apportant ainsi une contribution valable à la société. Notons au passage que ces remarques sont fnalement plus convaincantes que la thèse, répétée chapitre après chapitre, sur la sagesse pratique apportée par la littérature. Car, si le propre du roman est de nous présenter les cas particuliers « comme particuliers et irréductibles à des lois générales » (p. 431), comment pourrait-il nous aider dans les situations elles aussi irréductiblement particulières que nous rencontrons dans nos propres vies ?
25Les développements sur les pouvoirs de la forme laissent également songeur. Si la force du roman est d’exprimer l’essentiel par des figures et des images plutôt que par des formules logiques et des propositions universelles, quel besoin alors de les traduire en langage clair ? N’est-il pas contradictoire de poser qu’il existe certaines connaissances humaines qui ne peuvent être révélées que par des figures impossibles à paraphraser (p. 381) et de les… paraphraser ? S’il ne faut pas élucider les images littéraires, mais les recevoir dans leur « mystère violent et douloureux » (p. 383), à quoi sert donc le livre que nous sommes en train de lire ?
26Passons au centre de la démonstration : le rôle moteur des émotions. On pourrait d’abord se demander pourquoi, si la valeur du roman est de nous permettre de regarder avec une distance critique certaines situations de la vie, insister à ce point sur le rôle majeur de l’émotion. On ne sait d’ailleurs jamais très bien si la force du roman est de jouer sur des émotions antérieures à la lecture ou d’en construire de nouvelles. Il nous est dit parfois que les émotions sont le reflet de la façon dont nous interagissons avec le monde (elles seraient donc en amont de la lecture, dont la force pédagogique serait de nous les révéler), parfois que les histoires sont à la source de nos structures émotionnelles (elles seraient donc un effet des textes qui, en les suscitant, modifieraient notre relation au monde). Dans cette seconde hypothèse, pour changer nos valeurs, il suffirait de changer nos émotions et, pour changer nos émotions (dans la bonne direction, on l’aura compris), il faudrait lire les histoires appropriées. Mais cela suppose que les émotions ressenties dans le cadre de la fiction sont de même nature que celles ressenties dans la réalité, ce qui est loin d’être acquis. Faut-il rappeler que, quand on a peur au cinéma, on ne sort pas de la salle en courant ?
27De toute façon, au terme de cette longue « démonstration » de 589 pages sur la valeur morale du récit, on apprend que les romans n’ont pas pour autant toujours raison contre les théories abstraites : ce qui compte, c’est la fidélité à des valeurs préalables, indépendantes des uns et des autres et issues de « l’examen rationnel » :
L’entreprise d’examen de notre sens de la vie doit être holiste : souvent nous rejetterons une entreprise théorique abstraite parce qu’elle contredit les perceptions concrètes de la vie et les émotions incarnées dans les formes littéraires ; mais il nous faudra parfois critiquer un récit en le rapportant à une description théorique — si nous pensons que cette dernière est plus conforme aux éléments que nous voulons conserver. (p. 460)
28Ce n’est donc pas la littérature qui nous forme à la morale ; c’est la morale qui nous permet de juger de la pertinence de la littérature.
29Dans son compte rendu de The Company we keep, Martha Nussbaum (en pensant probablement aussi à son propre ouvrage, tant elle se retrouve dans les vues de W. Booth) note : « il y aura beaucoup de gens pour détester le livre et le qualifier de réactionnaire : c’est le prix qu’il doit payer pour la défense de la raison » (p. 362). Et de conclure : « Booth devrait garder la tête haute et ignorer ceux qui, dans le monde littéraire, moqueront son antisubjectivisme. Son livre sera toujours là quand ces modes seront oubliées depuis longtemps » (ibid.).
30Notre universitaire, dubitatif, rebouche son surligneur. Cette lecture l’a beaucoup fatigué et il aspire à se délasser. Mais, comme il n’a sous la main ni un roman de Dick Francis ni une prostituée, il se demande — non sans audace — s’il ne va pas opter pour une troisième solution.

