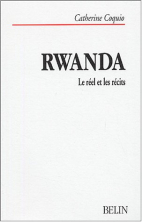
Pour une archéologie des discours sur le Rwanda
1Paru dans la collection dirigée par Claude Lefort, l’ouvrage de Catherine Coquio n’est pas un énième récit sur le génocide rwandais mais se présente comme un discours analytique sur ses récits. En effet, à la différence des nombreux ouvrages parus sur le sujet, l’auteure, présidente de l’Association Internationale de Recherche sur les Crimes contre l’Humanité et les génocides (Aircrige), n’apporte pas de nouveaux témoignages mais elle se donne comme objet d’analyse les récits, récits d’avant le génocide et récits d’après le génocide qui composent les deux parties de l’ouvrage : une première partie « 1894‑1994 — La fable du Hamite. Exotisme racial et idéologie génocidaire » traite des mythes et des fables, dans leurs sens de récits fictionnels et légendaires, dans lesquels la haine raciale et la folie meurtrière ont pu trouver leurs fondements ; la deuxième partie « 1994 — 2004 — Le tiers, la mémoire, l’oubli » analyse les récits du rescapé, du tiers, du survivant exilé, de l’absent, du « témoin d’à côté et d’après », de la victime et du tueur, sous l’angle de leurs fonctions, « devoir de mémoire » et travail de deuil, et de leurs formes entre témoignage et littérature ou expression artistique, et enfin des réceptions auxquelles ont donné lieu les publications et événements suscités par la commémoration des dix ans du génocide.
***
2La première partie montre comment l’idéologie coloniale et précoloniale a produit la haine raciale fondée sur la création d’une figure mythique (le « Hamite ») incarnée dans le Tutsi et investie « des tâches symboliques surhumaines, sinon métaphysiques » (p. 41), « de surmonter le partage ancestral des races noires et blanches et de réconcilier les deux familles bibliques, celles de Cham et de Sem » (p. 42).
3Les explorateurs ont nourri une image fantasmée du royaume du « Ruanda », l’un des derniers pays du continent africain à avoir été conquis en 1894 et dont « le prestige exotique » a été bâti sur l’imaginaire de la quête symbolique des sources du Nil, sur la réputation guerrière du pays qui a longtemps résisté aux conquêtes, et sur « la figure d’une race mystérieuse, proche et lointaine, prestigieuse et redoutable, troublement métissée » (p. 22). C’est sur ces éléments mythiques que s’est construit le « surinvestissement » d’un groupe humain, les « (Wa)tutsi », « une variante de noir supérieur », incarnation de « l’Africain civilisé » (ibid.), « nommée « Hamite », « originaire de la race d’Éthiopie dite « sémitique-hamitique » (p. 31) que son origine « asiatique », c’est‑à‑dire blanche, distinguait de la malheureuse « race de Cham » (p. 19). Dès 1894, l’Européen colporta une narration à prétention historique fondée sur une « théorie ethnologique » (Speke) construite par lui et mettant en scène « les « twa », peuples de Pygmées chasseurs, premiers occupants de ces terres, refoulés dans les forêts par les « Hutu », peuple de Bantous agriculteurs, bientôt promis à la domination fatale des « Tutsi », peuple de Hamites pasteurs et guerriers venus du Nord » (p. 25). La malédiction de Cham serait sauvée par le « Hamite », assimilé à l’Ethiopien, à l’Égyptien puis au Juif ; ainsi les peuples dits hamites ont pu être dénommés les « Juifs d’Afrique » (p. 45). Le Tutsi, représentant du « Hamite », investi du pouvoir de changer le Noir en Blanc et en Juif, a été accusé d’opprimer le Hutu et de vouloir « exterminer le peuple noir » (T. Sotinel cité p. 61).
4Cette prétendue supériorité raciale que l’explorateur puis le colonisateur attribuent au Hamite, le « double de l’Européen », « l’autre du nègre » (p. 34), étayée par les textes bibliques et les thèses « scientifiques », notamment celle de Gobineau sur « l’inégalité des races humaines » (1853), va produire une stéréotypisation positive du Tutsi au détriment des autres groupes. Cette fable raciale issue du fantasme européen, incorporée par les différents groupes, et notamment par les Hutu, qui l’ont subie comme « une école d’humiliation chronique » (p. 22), a engendré le retournement du stéréotype en une stigmatisation du Tutsi exacerbée jusqu’à l’émergence d’une nécessaire extermination « raciale ».
5En Europe, le génocide de 1994 a été catégorisé comme « massacre interethnique » alors même que, selon les recherches de J.‑P. Chrétien1, Tutsis et Hutus ne réfèrent ni à « des races, ni des ethnies, ni même des castes ou des classes, mais des groupes définis à partir de critères socioprofessionnels singuliers et de clans lignagiers dotés de mythes d’origine » (p. 33). Ce choix dénominatif de « massacre ethnique » a eu une fonction rassurante et déculpabilisante pour l’Occident : elle a permis de classer les exactions au registre de « la barbarie africaine », ce qui a contribué à prolonger le mythe colonial, en alimentant ainsi l’imaginaire exotique (p. 65).
6Du côté des rescapés, c’est « le sentiment d’étrangeté » (p. 66‑67) qui domine : les rescapés se sentent étrangers à leur pays, à leurs voisins, étrangers à eux-mêmes aussi car privés de leur passé, incompris, ils se sentent appartenir à « une quatrième ethnie ».
7Dans la deuxième partie, C. Coquio s’interroge sur le sens des formes prises par le travail de mémoire et sur le rôle du tiers dans le travail de deuil. À partir des années 2000 et dans la perspective de la commémoration des dix ans du génocide, on voit en effet se mettre en œuvre un travail de mémoire, à la fois au Rwanda sous la forme d’une politique de la mémoire, et en Europe, par une intense activité éditoriale et artistique, autour de l’expression littéraire et du témoignage. Si la mise en mots, la re-présentation de « l’irreprésentable » (J. Delcuvellerie cité p. 74) a une fonction symbolique de deuil, celle de « donner une forme et un sens à la perte » (p. 75), si cette « fable du deuil » permet de rétablir le lien avec l’humain, le partage de ce deuil entre Africains et Européens ainsi que le relais opéré doublement par la fiction et par le rôle du tiers, posent une série de questions : « celle d’une reconduite éventuelle de postures coloniales dans le processus mémoriel, lorsque l’intervention est européenne ; celle d’une projection ou appropriation abusive lorsqu’elle est africaine ; celle d’une déréalisation de l’événement allant de pair avec l’esthétisation de son écriture, que le tiers soit Européen ou Africain » (p. 76). C. Coquio distingue ainsi, à la suite de Giorgio Agamben2, deux types de témoins : le survivant et le tiers ou l’intermédiaire garant, qui témoignant pour le témoin, à travers la mise en scène du survivant, prend le statut de témoin, en créant « une vérité fictionnelle » en lieu et place de la réalité vécue par les rescapés. Le tiers joue par conséquent un double rôle de « relais » de transmission de la mémoire mais aussi dans le même temps, d’« écran » au travail de deuil (p. 75‑77).
8Du côté rwandais, la politique de la mémoire mise en chantier par le gouvernement n’a pas été simple, d’abord par l’aspect paradoxal des objectifs assignés tels que la restauration d’une vie sociale et la nécessité d’empêcher l’impunité, ou l’entreprise d’un deuil collectif et l’internationalisation de la mémoire du génocide de façon à « l’inscrire dans une autre écriture de l’histoire » (p. 79), mais aussi par des choix difficiles à opérer entre la déclaration d’un deuil collectif national (rassemblant Hutu et Tutsi) et le respect du deuil des victimes du génocide Tutsi. Ces questions ont donné lieu à de nombreux débats entre l’État et les associations de rescapés, entre l’État et l’Église, concernant notamment les sites des mémoriaux et le parti pris d’exposition des corps, entre l’État, les associations et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), émanation de l’ONU, considéré comme impliqué indirectement dans le génocide et accusé de mauvaise gestion de l’enquête. Cependant, la mémoire pour les Rwandais, aux prises avec une détresse matérielle, morale et psychologique s’est instaurée en maladie collective que l’État rwandais et la science occidentale ont eu du mal à prendre en charge de façon adaptée.
9Les événements commémoratifs ont suscité une « étrange actualité culturelle » (p. 97). Tout d’abord l’organisation au Rwanda de résidences d’auteurs et d’artistes africains par l’association française Fest’Africa, Arts et Medias d’Afrique, dont les productions ont donné lieu à des rencontres au Rwanda et en France et à des créations et publications en tout genre, y compris celles de la littérature négationniste, qui a suscité une prise de conscience du devoir de mémoire du génocide rwandais en France.
10Le caractère d’étrangeté que C. Coquio relève dans cette foisonnante actualité culturelle réside dans la contradiction entre texte de témoignage et texte de littérature, contradiction qui se situe d’abord au niveau de l’intention littéraire, dans un pays qui n’a pas développé une culture écrite et encore moins une culture littéraire (p. 100) mais aussi au niveau de la confusion entre preuve et œuvre (p. 105) : tant que le travail du droit et l’histoire n’ont pas attesté de la reconnaissance des événements, le rescapé doit inlassablement administrer les preuves, régulièrement bafouées par la négation, alors même que la question de la fidélité au réel ne se pose pas pour lui, « comme il lui est inutile de “devoir” se souvenir, tant il ne peut oublier » (p. 141). C’est en priorité la nécessité de dire, de crier, de faire sortir hors de soi, pour échapper à la folie, qui suscite « le besoin ou le désir d’écrire (qui) ne se confond pas avec l’intention littéraire » (p. 109).
11Si incontestablement le corpus généré par le génocide a donné naissance à un genre nouveau, cependant C. Coquio relève l’ambiguïté d’une telle production qui repose la question du rôle de l’Européen qui en tant que tiers participe de la production et de la transmission des témoignages. Le texte co-produit par un témoin et un auteur s’expose au risque de la projection du modèle européen sur l’expression des sentiments rwandais ; ce mode d’assistance du tiers européen, qui peut être perçu comme une intrusion, contribue, d’une certaine manière, à faire perdurer la relation de domination coloniale.
12L’ambiguïté est encore patente dans le fait que la publication des œuvres ait été produite en Europe, en langue française, langue des anciens colonisateurs, ce qui leur confèrent une réception limitée au Rwanda, pays dans lequel les traditions orales sont ou étaient — avant d’être partiellement détruites par le génocide — partie de la culture rwandaise.
13Le témoignage du survivant exilé prend un relief particulier, l’exil permettant de prolonger le témoignage par des activités publiques. C. Coquio l’illustre à travers trois cas. Yolande Mukagasana a choisi l’écriture comme substitut au deuil ; dans ses deux ouvrages, elle retrace « les péripéties du parcours d’un retour à l’humanité » (p. 112). Bien que l’auteur ne se revendique pas comme écrivain, les textes écrits et dits sur scène sont des hybridations de témoignage et d’expression artistique (littéraire et théâtrale) qui provoquent émotion et malaise ; cette ambiguïté de genre a permis de dépasser le rapport de forces avec les négationnistes pour toucher directement le tiers à l’état de public. Les textes de Vénuste Kayimahe s’inscrivent plus délibérément dans une démarche politique de dénonciation de la haine raciale, de la trahison française et de la corruption, qu’il y relate les collusions des régimes ou le parcours autobiographique du survivant. Le parcours personnel d’Esther Mujawayo entre le Rwanda et l’Europe et son expérience de survivante lui permettent de porter son regard à la fois sur la réalité rwandaise et européenne. Elle témoigne de « la folie du réel ou plutôt des réels qui forment l’humain (et qui) engendre l’autre folie : celle “normale” des rescapés » (p.122), et après une première réaction de rébellion et de révolte face à l’injustice du monde après le génocide, elle choisit de s’investir aux côtés du « clan des veuves » d’Avega et « folle d’une réalité atroce, mais "forte" aussi d’un savoir traumatique, devient thérapeute » (p.120).
14La position d’absent exilé permet aux auteurs de poser un regard différent, celui d’entre-deux, à la fois de Rwandais et de chercheur français, sur le rôle du tiers, seul détenteur de la documentation et du savoir, et à même de valider les témoignages, et en raison de la langue, seul en capacité de transmettre.
Il y a là une autre dimension de l’histoire à comprendre : celle des effets de la colonisation n’est pas requise seulement pour expliquer la généalogie du génocide, mais pour élaborer une anthropologie de la transmission barrée. (p. 128)
15Catherine Coquio s’interroge ensuite sur le rôle du tiers présent en tant que témoin oculaire, comme le journaliste, dont le « témoignage a toute chance d’être juridiquement et historiquement validé en tant que tel, pour son extériorité supposée “objective” » (p. 131). Pourtant ces témoignages sont empreints de toute la subjectivité de celui dont la vie a été ébranlée par ce qu’il a vu.
16Autre regard extérieur, celui de l’intellectuel africain, comme Boubacar Boris Diop, qui en tant qu’Africain, se sentant investi d’un « devoir d’écriture », choisit la « fiction critique » comme parti pris d’un nouveau type d’« engagement », « à l’égard d’une réalité inédite, et non plus d’une position idéologique » (p. 141) qui s’exprime par « une colère radicale contre l’histoire, ses décideurs et commentateurs : une certaine "intelligentsia française" affichant son mépris des vies africaines, mais aussi de "l’intellectuel africain" qui […] comprend qu’il ne “sert à rien” » (p. 139). Cette forme de témoignage révèle « la distance irréductible » qui sépare l’écrivain engagé de l’écrivain rescapé, témoin direct : alors que le premier s’efforce de ne pas trahir, l’écrivain rescapé, dans son absolue nécessité d’être crédible, est dans l’obligation de déformer, car « si le rescapé se sent forcé de témoigner, ce n’est pas seulement parce qu’on voudrait ne pas l’entendre mais parce qu’il a lui-même du mal à croire ce qu’il a vécu » (p. 122).
17Cette question de la mise en littérature des témoignages se repose avec encore plus d’acuité à la lecture des textes de Jean Hatzfeld, écrits à partir des témoignages des victimes : Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais et des tueurs : Une saison de machettes. Ces ouvrages que C. Coquio situe « entre témoignage réécrit et poème “naturel” », posent à nouveau deux questions à notre auteur : « celle de l’éventuelle reconduite de postures coloniales, d’une part, et celle d’une esthétisation déréalisante du témoignage » (p. 170). Si les deux ouvrages se donnent pour objet la reconstitution des deux expériences parallèles du génocide au quotidien, les deux types de retraitement des témoignages, celui des victimes rescapées, qui « suscite une mélancolie de pensée active » et celui des tueurs, qui « provoque le malaise éthique » (p. 175) ont deux fonctions différenciées : le premier permet d’entrer dans la pensée du génocide en tant que catastrophe humaine » alors que le second, « véritable précis d’anthropologie de la violence génocidaire » (p. 174), « fait saisir la logique du génocide en tant que crime inhumain » (p. 175).
***
18Dans son ouvrage, Catherine Coquio démontre la fonction performative des discours, qui ont le pouvoir de reconstruire le réel, d’asseoir des rapports de domination et de manipuler des masses. L’entreprise de l’auteur de Rwanda. Le réel et les récits n’est pas de relater le « comment » du génocide, ni d’en élucider le « pourquoi », mais plutôt, d’essayer de démêler les fils du tissage d’une mémoire raciale ; construite à partir d’une fable sur l’origine importée par les conquérants, explorateurs ou colons, et prolongée par les textes religieux ou à prétention scientifique, cette mémoire imaginaire a été transmise aux Tutsi comme aux Hutu, qui se la sont appropriée jusqu’à produire, dans la réalité, un clivage identitaire tel, que la nécessité, pour le pouvoir Hutu, d’une libération par l’extermination s’impose.
19La force du texte de C. Coquio repose sur ce démontage de la mécanique discursive propre à l’idéologie civilisatrice qui a conduit au génocide, mais également sur la mise en relief du prolongement d’une construction du réel à travers le filtre occidental; envers et contre la réalité des faits historiques : la représentation des événements du génocide par les différentes catégories de témoins est encore tributaire de l’intervention de l’autre, comme relais dans la transmission d’une mémoire, notamment par le biais de la langue du dominant, et à ce titre, n’échappe pas à la prégnance d’un interdiscours idéologique.
20Le travail de reconstitution de l’imaginaire racial à travers ces ensembles de textes procède d’une entreprise d’« archéologie des discours », pré et post génocidaires, entreprise qui se donnerait pour visée de lever « la part d’impensé nécessaire à l’éternisation de tels mythes et à leur réactualisation possible » (p. 42), d’inverser « l’ordre du discours » (Foucault, 1971).

