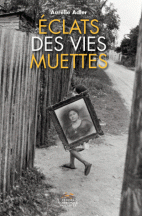
Du minuscule & du marginal
1L’essai Éclats des vies muettes, d’Aurélie Adler, s’inscrit dans la lignée des études portant sur le renouvellement des formes du récit biographique. « Biographie fictive », « biofiction », « vies imaginaires » ou encore « récits de filiation1 », la catégorisation du bio-graphique se trouve en effet, depuis une dizaine d’années, au cœur d’approches diverses qui questionnent autant la mutabilité du genre que sa vigueur littéraire. A. Adler aborde ici les récits de vie d’Annie Ernaux, de Pierre Michon, de Pierre Bergounioux et de François Bon, quatre auteurs souvent convoqués pour illustrer ce renouveau du biographique, mais jamais réunis dans une même perspective. Loin de conforter des pistes critiques déjà bien défrichées, l’étude d’A. Adler est forte d’un angle d’approche original. En partant de la micro-figure inscrite au centre de ces récits biographiques — la « vie » du personnage de peu, telle qu’indiquée par des titres à la résonance volontairement modeste (Vies minuscules, Miette, Une femme, Un fait divers, etc.) — elle parvient à relier chacune de ces démarches narratives autour d’un axe structurant : l’écriture des « figures du minuscule et du marginal. »
L’invention d’un paradigme : minuscule/marginal
2La mise au jour de cette figure socio‑référentielle — « minuscule », si l’on considère sa place d’anonyme en regard de l’Histoire, et « marginale », si on l’envisage comme en retrait de divers espaces (géographique, social, culturel, littéraire) —, pour probante qu’elle soit, n’épuise en rien l’analyse de l’auteur. Au contraire, l’entrée thématique pose les assises d’un véritable doublon conceptuel (minuscule/marginal) qui va innerver jusqu’aux dimensions poétique et auctoriale des récits. La figuration d’identités mineures induirait ainsi un système de représentation minuscule et/ou marginal inédit, propre aux récits composés au tournant des années 1980. En effet, à la péremption des catégories de « personnage » et « d’illusion référentielle » — héritées du réalisme et remises en question par l’ère du soupçon et les années Tel Quel – viennent s’ajouter des bouleversements d’ordre épistémologique, introduits par les sciences sociales dans le courant des années 1960 — micro-histoire, psychanalyse lacanienne, structuralisme –, avec lesquels ces récits de vie doivent composer. Une « double opération de minusculisation des paramètres de la narration et/ou de marginalisation du romanesque » (p. 14) affecte alors ces textes, tant la saisie des « vies muettes » ne peut advenir que sur le mode de l’éclat et du puzzle identitaire à jamais fragmenté. Cependant, contrairement à ce que l’on serait tenté de croire — à l’instar des chantres du déclin d’une certaine littérature à la française — cette raréfaction des normes du romanesque ne signifie en rien l’assèchement de l’invention ou de l’élan fictionnel. La démonstration d’A. Adler nous prouve à l’inverse combien ces récits, écrits depuis le vide des figures parentales, sont en constante expansion vers d’autres aires discursives qu’ils annexent, intègrent ou subvertissent, en cherchant à revigorer les formes du littéraire. Les concepts de minuscule et de marginal éclairent aussi de façon spéculaire la posture que ces quatre auteurs entendent camper dans l’espace littéraire et social actuel. En effet, l’écriture de l’autre — de l’aïeul minuscule (P. Michon, P. Bergounioux, A. Ernaux) ou de l’anonyme marginal (Fr. Bon, A. Ernaux) – travaille ici à une écriture oblique de soi dans laquelle se donnent à lire les hésitations de l’identité auctoriale. Le corps à corps avec une matière biographique pauvre tend à révéler chez ces écrivains une inquiétude quant à la définition du statut d’auteur : entre la volonté de réinscrire le sujet dans les formes d’une histoire racontée et la conscience aiguë des filtres qui l’en séparent, l’écrivain oscille toujours entre connaissance et inconnaissance du minuscule. Partant, c’est l’instance même du narratif qui s’émarge et qui revendique une place en constante tension avec les paradigmes dominants du majuscule et du central.
D’un triple éclat
3Pour faire jouer à plein ce paradigme, A. Adler nous propose un parcours critique en trois temps, empruntant à chaque fois l’une des acceptions de « l’éclat » que son titre métaphorique contient en germe. Ce qui pourrait passer pour une formule facile se révèle au contraire remarquablement opérant ; la métaphore essaime ici dans toute sa vivacité et travaille à une perception affinée des phénomènes littéraires envisagés.
« Éclats » des vies brisées
4Le premier temps de ce livre s’attache à cerner la figure du minuscule et du marginal en la réinscrivant sur la toile de fond socio-historique qui en a favorisé l’émergence. Ce sont des « éclats » de vies — au sens de vies brisées par un changement d’ère culturelle survenu dans le courant des années 1960 — que donnent d’abord à lire thématiquement les récits de P. Bergounioux, de Fr. Bon, d’A. Ernaux et de P. Michon. Chacun de ces écrivains appartient à une génération qui porte en mémoire, par l’héritage des ascendants, le basculement qui s’est opéré entre une France archaïque et une France moderne. Nourrie des travaux récents de l’ethnographie et de la socio-histoire (Braudel, Mendras, Winock, Lipovetsky, Augé), cette partie montre que le sujet minuscule est d’abord un sujet écartelé entre une perte irrépressible des origines — relégation du savoir-faire, brisure des formes communautaires traditionnelles, marginalisation culturelle et linguistique — et un présent qui fait défaut — mondialisation des formes d’échange, constructions de nouveaux espaces urbains, sociabilisation interconnectée mais anonymisée. Les espaces de la Creuse (P. Michon), de la Corrèze (P. Bergounioux) ou encore de la Seine-Maritime (A. Ernaux), constituent en ce sens une géographie mémorielle et douloureuse, dans laquelle l’écrivain-biographe cherche autant à réinscrire les figures aïeules qu’à interroger son présent en regard de ce passé ruiniforme qui ne cesse de le hanter. C’est en scrutant précisément la façon qu’a chacun de ces écrivains de « s’engendrer du passé2 » qu’A. Adler met au jour une tension fondamentale dans cette écriture de la dette. Là est l’un des grands apports de son travail : elle montre combien la soi‑disant objectivité du récit de filiation est souvent débordé par des emprunts intersémiotiques (littéraires, bibliques, picturaux, mythiques ou historiques) qui majorent la figure du minuscule, que ce soit par une stylisation excessive du vocabulaire ou de la syntaxe (P. Bergounioux), une parodie mythifiante délibérée (P. Michon), ou encore une superposition du temps de l’imaginaire et du temps historique (A. Ernaux). Pris dans cette oscillation, les récits témoignent d’un va-et-vient constant entre la minusculisation du sujet et sa majusculisation. Surtout décrites par le biais des journaux extimes d’Annie Ernaux (Journal du dehors, La Vie extérieure) et des premiers récits de Fr. Bon (Un Fait divers, C’était toute une vie), la scénarisation singulière des identités marginales et la spectacularisation des voix pauvres participent pleinement de cette remodélisation du « minuscule ». A. Adler souligne ici combien la représentation traditionnelle de la figure « populaire » se trouve laminée. À cette France des terroirs — reléguée — correspond la nouvelle France du béton et des paysages urbains — mondialisée — où se jouent des formes nouvelles de marginalité qui valent comme autant de « solitudes des non-lieux » (p. 86).
« Éclats » de soi
5La deuxième partie de l’essai se veut moins transversale et aborde la question générique des œuvres en traitant séparément chacun des auteurs envisagés. Ces récits de vies ont tous la particularité de dériver à la fois de « l’autobiographie » et de « l’autofiction » car ils participent peu ou prou des nouvelles formes du « récit de filiation ». Ce genre, au statut particulièrement complexe, travaille à une réinvention fantasmée du sujet narrant depuis les branches familiales de l’ascendance ; l’intériorité se décentre dans les figures de l’antériorité et le travail généalogique se double d’une archéologie de soi. L’écriture des figures du minuscule et du marginal participe ainsi d’une « déformation de l’autre, dans le récit de filiation, [qui] met en évidence le caractère foncièrement réflexif des figures familiales » (p. 123). Selon A. Adler, les « éclats des vies muettes » peuvent se lire comme autant d’« éclats de soi ». Plus que l’émergence de l’autobiographique au sens strict, A. Adler voit ici l’affleurement d’une voix auctoriale en proie au doute. En effet, les auteurs de ces récits de filiation, conscients des bouleversements de la notion d’individu opérés dans le courant du xxe siècle par la psychanalyse, la sociologie, mais aussi la linguistique structuraliste, ne croient plus à la fiction d’une transparence de soi à l’autre et encore moins de soi à soi. L’identité est un feuilletage aux couches multiples dont l’appréhension autonome relève de la pure chimère. Dès lors qu’il est acquis que l’autre est une part déterminante du soi dès l’origine, et que l’autre ne peut être atteint dans son unicité, comment faire advenir une identité sûre d’elle‑même ? Ce questionnement est à l’origine d’une inquiétude au carré dans l’énonciation auctoriale de ces récits : inquiétude quant à la voix propre lorsqu’on parle depuis des voix empruntées, et inquiétude quant à la voix d’emprunt lorsqu’on sait combien sa détermination reste toute relative. Ce deuxième axe nous propose donc un parcours au cœur d’une énonciation d’auteur hasardeuse, déchirée entre instanciation et distanciation, entre recollection et morcellement de soi.
6En se fondant sur les travaux de Dominique Maingueneau relatifs à la « paratopie » énonciative de l’écrivain3, A. Adler s’attache à cerner l’élaboration d’une voix bistre dans l’œuvre de P. Bergounioux. Selon elle, l’auteur parlerait depuis un lieu intenable, un entre‑deux, déchiré entre le « dedans » (le monde du terroir et le poids atavique des héritages socio-culturels) et le « dehors » (le monde du savoir et des livres, où l’abstraction permet justement de s’abstraire). En faisant du récit des origines une épopée du savoir livresque — l’intime est toujours relu par le filtre des sciences sociales — P. Bergounioux tend à muer la voix des minuscules en une œuvre majuscule. Cependant, l’analyse de l’auteur nous montre bien que ce fantasme d’une refondation de soi par le truchement de la Bibliothèque reste toujours précaire. P. Bergounioux demeure dubitatif quant aux possibilités d’une mise en ordre par le seul pouvoir de la langue ; son énonciation demeure en prise au doute et sa posture d’auteur oscille entre certitude et soupçon.
7L’œuvre de P. Michon participe exemplairement de cette écriture de soi qui se fait par l’intermédiaire de l’autre. Les figures familiales des Vies minuscules, mais aussi plus largement les biographies fantasmées des grands « alliés substantiels » (Maîtres et serviteurs, Rimbaud le fils), se présentent comme autant de figures « prétextes » (p. 145). Comme le postule A. Adler, cette autobiographie par éclats n’a pas d’autre ambition que de travailler à une refondation de soi en tant qu’auteur. L’étude détaillée qu’elle mène sur certaines « vies » (Peluchet, Dufourneau, le Père Foucault) prouve par le menu combien le texte de P. Michon est obsédé par la problématique de la création et comment, par tout un jeu alterné de doublure et de distanciation, chacune des figures « réfléchi[t] douloureusement [l’]interrogation » de l’identité auctoriale (p. 147). C’est précisément cette poétique du double — dans tous les sens du terme — que révèle A. Adler : le Verbe est chez P. Michon porteur d’un pouvoir anoblissant de majusculisation du minuscule ; il est aussi aspiré par le vide et l’évanescence, comme le signale la fascination de l’auteur pour le parcours rimbaldien. Fond et forme s’éclairent alors tant il apparaît manifeste que ces « figures à la forte réversibilité stylistique et générique fonctionnent comme des figures spéculaires de l’auteur, se débattant avec la langue tant sur le plan de la diégèse (histoire du je-personnage) que sur le plan de la narration (aventure du récit) » (p. 156).
8A. Ernaux possède, elle aussi, un rapport décentré à l’écriture autobiographique. « Je ne pratique pas l’écriture de soi4 », déclare‑t‑elle dans un entretien avec Franck Lanot. Marquée par les travaux de la sociologie bourdieusienne, elle se montre particulièrement attentive à faire émerger un « je » collectif, dont l’identité est fortement déterminée par la pesée de l’habitus. La thèse d’A. Adler conforte dans un premier temps la vision courante de l’énonciation chez A. Ernaux : écriture « plate », minusculisation de la voix subjective, stylistique « ventriloque », etc. Passant du plan énonciatif au plan textuel, l’analyse d’A. Adler creuse ce constat et révèle avec force les enjeux auctoriaux qui minent cet apparent désaisissement de soi. Comme chez P. Bergounioux, la « paratopie » énonciative (entre affirmation et dissolution de soi) semble se doubler d’une « paratopie » spatiale relative à la qualification de l’œuvre (entre inscription dans le champ littéraire et marginalisation dans l’infra-littéraire). Cette tension, de l’ordre de la « place » littéraire à occuper, rejoint alors les découpes dans l’ordre de l’intime ; l’entre-deux de la voix auctoriale rejoue le clivage entre l’enfance prolétarienne et l’éthos bourgeois de l’écrivain. L’éclairage offert ici sur cette signature auctoriale bifrons est particulièrement stimulante. Même si A. Adler souligne que l’émiettement du sujet auctorial dans l’œuvre publiée a quelque chose de relatif — elle en voit la preuve dans l’affirmation forte de l’auteur dans son péritexte —, il n’empêche que son positionnement dans la « Littérature » conserve quelque chose d’indécis.
9Contrairement aux autres écrivains convoqués dans cette étude, les récits de Fr. Bon ne tirent pas leur valeur autobiographique de l’hybridation entre la biographie des ascendants et le récit de soi. C’est par la confrontation au « dire » déstabilisant du marginal que le témoignage de l’auteur va emprunter les voies indirectes de la confession. En effet, par réfraction, Fr. Bon est conduit à faire retour sur lui-même et à questionner sa légitimité d’auteur — et sa capacité à tenir un discours — dès lors que le monde qu’il aborde excède l’ordre traditionnel de ses représentations. A. Adler nous décrit alors la figure d’un auteur contemporain en errance, cherchant dans le « partage des voix » (la sienne propre ne servant qu’à ventriloquer celles, polyphoniques, des plus démunis) le meilleur moyen de ne pas s’inscrire en surplomb et de déjouer les prétentions de l’écrivain démiurgique. Texte à l’appui, on ne peut qu’être frappé par « l’ébranlement sémantique » — comme le dit justement A. Adler — qui affecte la notion d’auteur chez Fr. Bon5.
Les coups d’éclat
10L’enjeu de la dernière partie de cette étude semble quelque peu décroché du paradigme conceptuel (minuscule/marginal) qui régit les deux précédentes. En effet, elle paraît au premier coup d’œil dériver vers des constatations plus générales sur le procès d’épuisement qui est intenté à la littérature française actuelle et sur les formes de relance que pourraient incarner les œuvres du corpus envisagé. Cette intuition est vite dissipée et l’on comprend rapidement qu’A. Adler entend ici déplier le paradigme du minuscule et du marginal à l’aune d’une réflexion approfondie sur les pouvoirs de régénération d’une littérature à sujet dit « minuscule » et sur les stratégies auctoriales cherchant à tirer, des figures du minuscule et du marginal, une position majuscule et centrale dans le champ littéraire. Ce dernier moment du livre est particulièrement fécond et éclaire la logique interne d’un essai qui entend subtilement déplacer son interrogation des identités narratives (l’inscription thématique du personnage du minuscule) aux identités du narratif (la scénographie concertée et centripète de l’écrivain à la marge). L’auteur change une dernière fois de focalisation, nourrissant son analyse de travaux relatifs à la sociologie de l’écrivain (on apprécie notamment l’usage stimulant qui est fait des « scénographies auctoriales » développées par José‑Luis Diaz ou encore du « jeu littéraire » décrit par Bernard Lahire) et d’une réflexion plus élargie sur l’historiographie de la littérature de l’extrême contemporain. C’est donc ce désir d’illustration — cette volonté de « faire un éclat » (p. 19) — de l’écrivain travaillant depuis une matière narrative pauvre, qui se trouve ici réévaluée.
11Le premier moment de cette partie synthétise les discours relatifs à la « fin de la littérature » qui sont entonnés depuis une dizaine d’années, tant dans le champ de la critique (Tzvetan Todorov, William Marx) que dans le champ littéraire lui-même (Renaud Camus, Richard Millet, entre autres). Ce bulletin de (mauvaise) santé, réel ou imaginaire, pose que la multiplication des récits narrativement pauvres, habités par des personnages au statut évanescent et relayés par des voix auctoriales dubitatives quant à leur capacité à dire le monde, conduit à un appauvrissement du littéraire et à une diminution des pouvoirs de l’écrivain. À l’inverse, en réclamant une plus juste appréhension des œuvres, A. Adler postule que « les indices de la fin d’un monde, d’une certaine littérature, délivrent aussi le ferment d’une régénération » (p. 218). Exhumer les éclats du minuscule, témoigner de l’écaillement d’une communauté promise à l’enfouissement, ne reviendrait pas seulement à témoigner de leur disparition, mais servirait surtout à « convertir les traces modestes en outils de refondation » (ibid.). L’auteur s’attache alors à montrer comment chacun des écrivains retenus fait ressortir, idéologiquement et esthétiquement, une « résistance du littéraire dans un temps qui semble en résorber les valeurs » (p. 220). Premier chef d’accusation que ces écrivains assimilent et déplacent : la démocratisation des valeurs culturelles et la marchandisation du livre comme double affaissement du littéraire. Une analyse pointilleuse du discours péritextuel de P. Michon et une relecture attentive des Onze nous montrent combien cet écrivain est duplice face au « désenchantement » (R. Millet) qui peut saisir devant le nivellement des hiérarchies esthétiques. L’écriture de P. Michon est tour à tour dans le deuil des figures d’autorité et dans l’euphorie que génère le déboulonnement des figures statufiées. Sur le plan esthétique, on assiste à une tension créatrice entre la vénération de la Belle Langue — qu’incarnent les figures tutélaires de Racine, Hugo ou Faulkner — et le désamorçage ironique de celle-ci — que signale une prose volontairement héroï‑comique et une énonciation heurtée. Plus qu’une nostalgie stérilisante, son œuvre témoigne alors d’un double geste de reprise et de déprise des figures archétypales, qui l’inscrit dans une relance du littéraire. L’œuvre autobiographique de P. Bergounioux (ses Carnets de notes) trahit également un tiraillement entre les idéaux révolutionnaires d’hier (les utopies des années 1960-1970) et un retranchement élitiste à la marge. Cette prose « bifrons » (p. 239) ne cède pourtant aucunement à la contemption statique des valeurs actuelles ; elle instaure une forme de résistance par le creusement même des strates du temps qui vaut comme « une manière de s’opposer à la discontinuité du présent » (p. 247). Le deuxième chef d’accusation que ces écrivains détournent est celui de l’assèchement de la manière narrative, comme témoignage d’une impuissance à configurer le sens du présent. Les œuvres d’A. Ernaux et de Fr. Bon peuvent prêter le flanc à ce genre de critiques car, en faisant du rebut du réel la matière même de leurs récits, ils s’exposent à la platitude et à un travail littéraire marqué par la soustraction. L’argument d’A. Adler tend à prouver l’inverse :
Les formes parcellaires du récit […] sont au contraire les lieux d’un renouvellement esthétique et d’une résistance des fonctions critiques et politiques de la littérature. (p. 248)
12La relecture des Années ou de l’œuvre diariste d’A. Ernaux est ici particulièrement convaincante. Ce qui pourrait passer pour une agrégation arbitraire d’éclats et d’expressions refoulées du langage commun apparaît en fait comme une « spectrographie » concertée du langage (p. 252). Comme le souligne A. Adler, le fragment issu de la mémoire collective se retrouve au fondement de multiples interprétations (philologique, sociale, politique et poétique) qui attestent à chaque fois d’un effort de resémantisation du présent. Cette poétique de l’éclat — en tant que renouvellement formel du régime de l’écriture et interrogation souterraine portée sur la langue commune — témoignerait donc plutôt d’une bonne santé du régime de l’expression littéraire. De même, et de façon encore plus nette, Fr. Bon fait du désenchantement du monde l’un des moteurs de sa poétique. En faisant du partage des voix minuscules et marginales le sujet même de ses récits, il inverse l’argument qui voit en la démocratie la cause du déclin du littérature — thèse que défend notamment R. Millet — et « fait de la démocratie du langage l’arme esthétique et politique de ses textes » (p. 257). À la prolifération démocratique d’une parole ordinaire (assemblage des voix banales et saisie de la profusion du réel) s’ajoute chez Fr. Bon un décloisonnement démocratique des hiérarchies héritées, que vient illustrer une analyse de la transposition du Tragique dans la géographie des minuscules et des marginaux (p. 258‑269). Tout prouve chez lui que la parole des minuscules travaille à une majoration de la puissance du littéraire.
13Si ces récits à la matière a priori minuscule témoignent dans le détail d’une littérarité paradoxalement majuscule, qu’en est-il du devenir littéraire de leurs auteurs ? Leur inscription concertée en marge de la doxa et des réseaux de médiatisation littéraire ne veille‑t‑elle pas à leur rémunération symbolique en tant qu’Auteur (selon le principe bourdieusien) ? Le lien spéculaire noué avec les figures du marginal et du minuscule ne construit-il pas, par anamorphose, des « scénographies auctoriales » majuscules et centrales ? Ce sont là différents questionnements qu’envisage le dernier volet de cet essai. En creusant les processus d’auto-légitimation mis en place par chacun des auteurs dans son péritexte, A. Adler conserve son angle d’approche critique — du minuscule et du marginal et de ses liens avec le majuscule et le central — tout en se ménageant un espace de recul à partir duquel elle donne à lire les interrogations in vivo du spécialiste de la littérature actuelle. Qu’est-ce qui garantit la pérennité de l’objet d’étude ? Comment fonder la valeur d’un auteur que le temps oubliera peut-être ? Depuis quels lieux institutionnalisons-nous nos auteurs ? Comment l’auteur lui-même joue-t-il des processus de hiérarchisation du littéraire ? Autant de pistes ici partiellement traitées, mais judicieusement intégrées en clôture du travail. On y voit notamment révélée la posture marginale d’un P. Michon, jouant l’impétrant rebelle et obtenant de cette stratégie oxymorique la reconnaissance de l’institution universitaire, séduite par la convocation — quoique trouble — de filiations littérairement prestigieuses. A. Ernaux semble également en voie de classicisation dans le champ littéraire actuel. Cette majoration provient pour une grande part du métadiscours critique de l’auteur qui devance souvent la réception de ses œuvres ; en se positionnant en surplomb de ses livres (avec une hauteur que lui confère son statut de « professeur ») et en s’affiliant à une généalogie intellectuellement reconnue (Beauvoir, Bourdieu) qui crédite par là même son entreprise littéraire, elle tend en effet à capitaliser les valeurs symboliques. P. Bergounioux — également enseignant — tire de son magistère une érudition toujours plus grande des littératures du passé. Le repli dans la bibliothèque et l’inscription dans une confrérie d’auteurs élus, qui brosse indirectement le portrait de l’écrivain, disent à quel point le marginal est souvent porteur d’une vision majuscule chez Bergounioux. Cette quête permanente d’un héritage, plus que d’une voix originale, fragilise et renforce en même temps la stature auctoriale : P. Bergounioux s’affiche comme un « lettré », figure double par excellence, humble et subversive. Fr. Bon incarne quant à lui la « figure de l’auteur en chantier » (p. 298), comme le propose A. Adler. La métaphore renvoie autant aux thématiques architecturales des premières œuvres qu’aux entreprises de l’auteur, toujours en expansion, jouant à la fois de la simultanéité et de l’inachèvement. Cette poétique de la collecte (Fr. Bon assemble les signes et les traces laissés par les voix brisées de notre présent) et de la mise en réseau (Fr. Bon s’affiche volontiers comme un auteur « collaboratif », fortement connecté à l’Internet) contredit de façon concertée nos représentations habituelles de la fixité de l’œuvre. Au contraire, Fr. Bon semble réfuter le terme d’« œuvre », appliqué à l’ensemble de ses écrits, et miser davantage sur une plasticité de la figure auctoriale.
14La notion de « posture d’auteur », qui tient autant de l’approche discursive (posture construite par l’auteur lui-même dans son texte) que de l’approche sociologique (posture implicitement construite par le lecteur, mais aussi par l’écrivain selon son positionnent dans le champ littéraire), comme l’a montré Jérôme Meizoz6, se trouve ici bien exemplifiée à travers l’étude de quatre cas précis. L’exercice, bien que nécessairement partiel dans le cadre d’une recherche à la problématique plus large, se révèle au final riche en perspectives et en éclairages sur ce qui fait la littérature au présent.
***
15On l’aura compris, le paradigme conceptuel forgé par Aurélie Adler (minuscule/marginal) possède une force de résonance qui outrepasse la seule approche thématique des récits de vie de P. Bergounioux, Fr. Bon, A. Ernaux et P. Michon. En adoptant un parcours critique fortement cohérent, l’auteur nous montre combien ce doublon théorique informe autant les « identités narratives » (les personnages en tant que tels) que les « identités du narratif » (les énonciations auctoriales et les postures des écrivains dans le champ littéraire). Outre la validité de cet axe problématique, maintenu et affiné au fil des chapitres, on apprécie particulièrement la multiplicité des approches méthodologiques qui permettent de le déplier. L’interdisciplinarité sert ici avec justesse l’analyse d’une littérature française qui mue et qui se situe souvent à la frontière des discours extra-littéraires. Ainsi, tout en conservant un angle critique purement littéraire (les apports narratologiques, poétiques et stylistiques sont légion), A. Adler nourrit sa recherche par un dialogue — en profondeur — avec de nombreux travaux issus des sciences humaines. On y croise tout à la fois, et entre autres, les réflexions de Fernand Braudel, Michel Winock, François Cusset, François Dosse, Jacques Revel, Marc Augé, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Bernard Lahire, etc. Cette mise en regard est féconde car elle travaille à penser conjointement les grandes failles socio-historiques et leurs conséquences dans l’ordre des mentalités et des représentations littéraire et artistique. Enfin, les amateurs comme les spécialistes avertis y trouveront, à n’en pas douter, des clefs particulièrement précieuses pour penser à nouveaux frais les renouvellements d’ordre esthétique et sociologique propres à la littérature française au présent.

