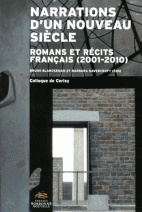
2001‑2010 : récits venus, récits à venir
1Actes du colloque éponyme qui s’est tenu au centre culturel et international de Cerisy‑la‑Salle du 16 au 23 août 20111, Narrations d’un nouveau siècle, romans et récits français (2001‑2010), sous la direction de Bruno Blanckeman et Barbara Havercroft, n’a pas pour ambition, ce que souligne l’introduction écrite par les deux éditeurs, d’établir un recensement exhaustif ou un palmarès de toutes les œuvres narratives publiées en France au cours de la dernière décennie. Il s’agit plutôt d’avancer un premier bilan d’un paysage littéraire mouvant, contradictoire et complexe, à travers plus d’une vingtaine d’articles.
Multiplicité des approches
2Un récent dossier paru dans Le Monde, « Quelle littérature enseigner aujourd’hui2 ? » proposait un débat sur la place à accorder — ou non — aux auteurs contemporains dans le secondaire, et sur leur possible cohabitation — ou non — avec les auteurs classiques. Si un consensus semblait se dégager des différents articles (les auteurs contemporains sont nourris des classiques, étudier les uns permettrait donc d’aborder les autres ; la littérature contemporaine et celle classique, choisies avec discernement, permettent tout autant de jeter un regard critique sur l’univers), la publication de ce dossier, et les débats qu’il suscitait, montre cependant les réticences persistantes autour de la légitimité à étudier la littérature parfois qualifiée « de l’extrême contemporain ». Depuis quelques décennies toutefois, cette dernière a connu la reconnaissance institutionnelle, notamment au sein de l’université, sous l’impulsion d’enseignants‑chercheurs dont les noms sont désormais associés à cette période de l’histoire littéraire : entre autres, en France, Dominique Viart (Université de Lille-III, membre de l’Institut universitaire de France), l’un des participants du dossier et qui a récemment co‑dirigé l’ouvrage Écrire le présent3, mais également Bruno Blanckeman, co‑directeur justement de Narrations d’un nouveau siècle. Néanmoins, si « [l]a littérature contemporaine n’est plus le parent pauvre qu’elle fut lorsque les étudiants découvraient dans les librairies des écrivains dont il n’était jamais question dans les cours ni les amphis4 », si la tenue d’un colloque à Cerisy‑la‑salle l’inscrit d’autant plus dans la reconnaissance officielle, son abord pertinent reste difficile, en ce que les études manquent nécessairement de recul face à une littérature encore en train de se définir, à l’orée d’un siècle encore en devenir. Cette difficulté semble constamment au centre des réflexions menées par le volume Narrations d’un nouveau siècle, qui s’est efforcé de s’intéresser non seulement aux œuvres contemporaines déjà consacrées, mais également « aux marges » (p. 9), et « de différer les prises hiérarchiques, d’ouvrir l’échelle des études afin de décrisper celle des valeurs qui double tout discours d’évaluation critique » (p. 9). La double direction, à cheval sur deux continents, en est un témoignage d’importance : Narrations d’un nouveau siècle est en effet le fruit de la collaboration entre le CERACC (Centre d’étude du roman des années Cinquante au Contemporain), de l’Université Sorbonne Nouvelle‑Paris 3, et du GRELFA (Groupe de recherche et d’étude sur la littérature française d’aujourd’hui), de l’Université de Toronto. De même, les auteurs des articles ne sont pas seulement français ou canadiens, mais sont également originaires de l’Allemagne, de l’Angleterre, des États‑Unis, de la Belgique… Ainsi, tout ethnocentrisme trop réducteur et tout triomphalisme franco-français sont d’emblée évités, permettant une multiplicité géographique des points de vue sur cette première décennie de littérature française au xxie siècle.
3Cette diversité géographique s’illustre dans le corpus de certains articles. L’article de Sabrinelle Bédrane (« Quelles communautés ? La fracture algérienne dans les récits choisis »), où l’attachement pour le pays d’origine nord‑africain est proclamé, même si cet attachement se traduit dans la langue française, et celui de Catherine Douzou (« La “légion étrangère” du roman français de la décennie ») permettent en effet d’attirer l’attention sur de nombreux auteurs francophones, rappelant combien la pratique de la langue française en littérature ne se limite pas à l’Hexagone. Enfin, l’article de S. Loucif, « Lectures d’aujourd’hui aux USA : les dessous du marché de la traduction » (p. 291‑307), situé à la fin du volume, sert à réévaluer, avec un peu d’humour semble‑t‑il, la production littéraire française à l’aune des États‑Unis. Si Christine Angot, Pierre Bergounioux ou Patrick Deville occupent depuis de longues années déjà les débats de la critique francophone, tant journalistique qu’universitaire, ils ne bénéficiaient pas encore, en 2011, d’une traduction américaine — mais, comme le souligne S. Loucif, n’avons‑nous pas également tendance en France à traduire davantage les œuvres de John Grisham que celles des auteurs américains « les plus “littéraires” » (p. 298) ?
4La volonté de ne pas réduire le volume à une approche trop unifiée s’illustre également dans la diversité des démarches choisies (historique, esthétique, culturelle), dans les formes mêmes des articles, alternant étude sur un seul auteur, sur plusieurs, synthèse d’une décennie, analyse détaillée d’une œuvre ou approche davantage théorique, enfin dans le choix des auteurs abordés. En effet, les écrivains déjà affirmés, et dont la dernière décennie a pu confirmer l’empreinte laissée sur la littérature française (Milan Kundera, Annie Ernaux, Michel Houellebecq, Pascal Quignard, Anne F. Garréta, Jean‑Philippe Toussaint, C. Angot, Camille Laurens et bien d’autres) sont présents dans le volume. Mais celui‑ci laisse place également à ceux dont la reconnaissance a commencé à s’ébaucher dans ces dernières années, avec un intérêt grandissant de la critique et des universitaires (Pierre Senges5, Chloé Delaume, Yves Ravey, Frédéric Werst…). Le volume tient également à mettre en lumière des auteurs encore trop restreints au « succès d’estime » (Nicole Caligaris, Éric Laurrent, Olivier Rohe, Arno Bertina, Mathieu Larnaudie…). Peut‑être aurait‑il été possible de se demander quelles sont les raisons de ce confinement — qui ne se limitent pas par ailleurs au xxie siècle : si des auteurs se jugent encore eux‑mêmes en plein développement et ne prétendent pas à une immédiate reconnaissance massive6, d’autres sont édités depuis longtemps dans des maisons d’édition qui ont vu naître nombre de grands succès littéraires, comme Éric Laurrent publié par les Éditions de Minuit et qui semble encore réservé aux « happy few », avant peut‑être que les futures décennies n’en redécouvrent en nombre la valeur. D’autres encore bénéficient depuis plusieurs années d’articles dans les journaux ou les ouvrages universitaires, à l’instar d’une Nicole Caligaris dont le portrait a été tracé dans plusieurs mensuels et hebdomadaires littéraires. Toutefois, le récent récit de cette dernière, Le Paradis entre les jambes (Verticales, 2013), centré autour de la figure effrayante d’Issei Sagawa, que N. Caligaris a connu lors de ses années d’étudiante, a récemment attiré l’attention du grand public sur cet auteur : la thématique de transgression, liée souvent au scandale, est‑elle encore aujourd’hui l’une des sources du succès littéraire, à une époque où internet permet d’accéder à nombre d’œuvres contournant la norme ou la morale7 ? Cette question, difficile à résoudre mais qui aurait mérité davantage d’approfondissements, trouve également un écho dans les articles de M. Dambre, B. Blanckeman et G. Prince, qui montrent comment se crée, trop souvent à partir de lectures biaisées, une affaire médiatique portant au centre de l’attention un Yannick Haenel ou un Michel Houellebecq. De la même façon, il aurait été possible de profiter davantage des différentes nationalités des chercheurs ici rassemblés pour se demander si les succès littéraires sont équivalents dans chaque pays francophone notamment ou si les canons universitaires français de la littérature contemporaine sont équivalents à l’étranger.
Renouvellements des lignes de force
5La fin du xxe siècle a vu l’émergence puis l’affirmation de genres et de thématiques, dont il convient de savoir s’ils ont montré ou non une permanence statique ou des renouvellements au cours de la dernière décennie.
6L’autofiction, abordée de façon directe ou indirecte dans près d’une demi‑douzaine d’articles du volume, montre ainsi la force de ce genre, qui fait son apparition en France à la fin des années 70. Y. Baudelle, dans « L’autofiction des années 2000 : un changement de régime ? » (p. 145‑155) s’intéresse aux évolutions de ce type d’écrit en ce début de siècle. Or, après avoir rappelé les caractéristiques premières de l’autofiction, (une autobiographie revue par la psychanalyse, impliquant de ce fait le refus de toute censure, une « aventure du langage », l’idée que toute image de soi est une construction plus ou moins fictive et la nécessité d’un accent d’authenticité), Y. Baudelle souligne la capacité du genre à devenir un « mode d’inspiration » (p. 145), aboutissant à la production de textes ne respectant pas certains principes fondamentaux (en particulier l’homonymat des instances) mais demeurant dans un « espace autofictif », pour reprendre l’expression de B. Havercroft8. Cette plasticité de l’autofiction a pu conduire, selon Y. Baudelle, à un profond changement, plutôt négatif, en une seule génération. Les œuvres concernées montrent un changement de sens (du métanarratif au déballage sans valeur critique), d’épistémologie (d’un texte‑manifeste à une expression sans idéologie et sans métadiscours), de lecteurs (des universitaires au grand public), d’écriture (du surcodage au non‑style). Ce constat inquiet laisse toutefois la porte ouverte à des réussites possibles du genre, qu’analysent davantage d’autres articles. Celui d’A. Roche (« Lignes occupées ») rappelle ainsi les différentes solutions employées par les auteurs pour problématiser la nouvelle écriture du je : le choix du fantastique (à travers l’exemple de Dans ma maison sous terre de C. Delaume), le goût du jeu formel (que peut illustrer Suite à l’hôtel Crystal d’O. Rolin) ou bien la transformation générique (à l’instar de L’amour comme on l’apprend à l’école hôtelière, qui de roman réaliste au premier abord se transforme en biographie où un Je s’insère de façon ponctuelle). Les articles de B. Havercroft (« Splendeurs et misères de la confession au féminin au xxie siècle ») et J. Papillon (« Écrire “le cadavre de l’amour” : du désamour dans l’œuvre de Camille Laurens ») montrent également les renouvellements possibles du genre, surtout de la part de femmes auteurs, à l’instar de C. Angot et Alina Reyes, qui jouent avec les codes de la confession, tout comme de C. Laurens, qui réfléchit à travers ses écrits à la sentimentalité et aux rapports qu’entretiennent femmes et hommes avec celle‑ci.
7La question de l’Histoire et de sa possible mise en récit — ou non — a également occupé une place importante dans la critique universitaire depuis les années 1980, où elle participait à la refondation d’une littérature alors jugée davantage transitive9. Narrations d’un nouveau siècle s’attache à illustrer, à travers différents articles, les démarches qu’ont pu adopter les auteurs de la dernière décennie pour travailler cette thématique. A. Roche note l’apparition d’un nouveau rapport à l’histoire : il y a à la fois une distance vis‑à‑vis de l’événement historique, « qui est d’une génération ou deux, pas davantage » (p. 17), et une implication par rapport à cet événement. Pour retranscrire ces événements, les formes elliptiques continuent de dominer, qu’il s’agisse des filigranes, des échos, des traces ou des fragments. Cette poétique est illustrée par l’article de M. Dambre (« Roman et histoire : errances, vérités ») s’intéressant entre autres au Jan Karski de Yannick Haenel (2009), où l’errance formelle et textuelle montre comment l’Histoire s’y écrit en marge de la littérature traditionnelle. L’étude de W. Asholt sur l’œuvre d’Yves Ravey (« Minimalisme ou écriture blanche ? L’œuvre d’Yves Ravey ») s’attache à analyser le traitement des souvenirs enfouis des événements passés. Tantôt Y. Ravey montre la difficulté sinon l’impossibilité à retrouver une mémoire perdue, et les conséquences de cette perte, tantôt il met en récit la subversion des discours par une Histoire enfouie profondément dans les mémoires mais qui laisse de faibles traces dans quelques noms. D’autres stratégies narratives apparaissent également au cours de cette décennie, comme dans Les Années d’A. Ernaux (2008), auquel s’intéresse M.‑P. Huglo qui en propose une analyse (« En vitesse : Histoire, mémoire et cinéma dans Les Années d’Annie Ernaux »). Le livre d’A. Ernaux souligne constamment la disjonction entre l’histoire nationale et l’histoire vécue, entre l’histoire individuelle et l’histoire officielle et montre comment la sédimentation historique et médiatique des événements s’efface devant l’histoire personnelle des lieux, des corps et des générations.
8Liée à la question de la mémoire, la thématique de l’archive trouve également une illustration dans le volume à travers l’article de M. Sheringham (« Quignard et l’archive : “une beauté de découpe” »). Rappelant le rapport étroit de la littérature narrative du dernier fin de siècle à la matière et aux pratiques de l’archive, M. Sheringham souligne les renouvellements opérés par P. Quignard dans son œuvre. L’écrivain, dont toute l’œuvre est marquée par une fascination pour ces traces écrites du passé, s’attache particulièrement aux archives du minuscule, dont il parvient à tirer une méditation sur le temps et l’identité, sans volonté pour autant d’un pesant didactisme, puisque cette plongée dans le passé n’aboutit à la mise en place d’aucun savoir chez l’auteur.
Émergences
9Si la décennie passée a donc vu le renouvellement, selon diverses stratégies, de modes littéraires apparues à la fin du siècle dernier, elle a également assisté à l’émergence de nouvelles narrations et de nouveaux modes de narrer. W. Motte (« Critique‑roman ») s’intéresse par exemple au genre introduit par Pierre Bayard à travers ses ouvrages, à partir de 1998 avec Qui a tué Roger Ackroyd (1998), le « critique‑roman »,
c’est‑à‑dire […] un ouvrage qui se présente comme un texte critique ou théorique, mais dont le fonctionnement suit les conventions romanesques (p. 211)
10Les « critiques‑romans » de P. Bayard sont alors capables de relier fiction et réalité, proposant de reprendre des intrigues ou de compléter des textes. Pierre Schoentjes (« Littérature et environnement : écrire la nature ») propose pour sa part un panorama aussi exhaustif que possible des écritures de la nature, composantes de la littérature environnementale. Implantée depuis longtemps aux États‑Unis, car constitutive d’une tradition littéraire, la thématique de la nature commence à avoir une présence de plus en plus affirmée en France, après des décennies où elle a été davantage boudée tant des auteurs que des lecteurs, tant des critiques que des universitaires10. Récits de promenades, fictions mettant en scène la nature sauvage où les questions écologiques, paroles de pasteur (l’un des genres les plus récents), essais sur les rapports entre l’homme et la nature occupent une place toujours grandissante, et le succès croissant d’un Sylvain Tesson par exemple témoigne d’un intérêt toujours plus vif pour ce type d’écriture.
11À ces nouveaux genres s’ajoutent également des écritures et des thématiques dont l’émergence est rendue possible par la société même où elles apparaissent. Internet et ses corollaires (blogs et forums), déjà présents dans les dernières années du siècle dernier mais régnant véritablement à partir des années 2000, appareils photo numériques ou MP3 ne sont pas seulement des objets décoratifs dans les intrigues, servant à de simples effets de réel, ils peuvent également participer à la poétique d’une œuvre, à la position d’un auteur. Ainsi, M.‑P. Huglo note, dans son analyse des Années d’A. Ernaux, la volonté de donner à lire une durée mobile et multiple, capable d’avaler dans sa course la discontinuité du récit, de donner à ressentir le passage des années, d’en faire éprouver la fuite et la complexité, montrant un récit conscient de s’écrire dans un milieu médiatique omniprésent, où les données s’enregistrent, s’échangent et s’effacent en quelques instants, créant de ce fait un dispositif formel inventif capable de constituer un jalon. S. Broussais et B. Gervais (« Du temps de cerveau disponible… Littérature et écran dans l’extrême contemporain ») s’attachent à démontrer comment des auteurs peuvent utiliser les supports médiatiques désormais traditionnels (télévision) mais également plus récents (internet et la blogosphère) comme autant de sources d’inspiration pour leurs œuvres, à l’instar de C. Delaume ou de François Bon, capables de dépasser la simple polarisation écran/texte, qui risque d’entraîner davantage une stérilité qu’une grandeur de la narration face aux nouveaux médias.
Nouvelles figures de l’auteur & du narrateur, nouveaux rôles du lecteur
12Le volume collectif est également attentif à retracer les portraits, même s’ils sont mouvants, des instances, réelles ou imaginaires, de production du récit (à travers les figures de l’auteur et/ou du narrateur) et de sa réception (avec le lecteur).
13L’auteur est ainsi analysé dans de nombreux articles, de façon détaillée ou de façon plus ponctuelle, suivant un constat général : le refus d’une posture d’autorité, l’abandon d’une mise en avant ostentatoire. Si l’auteur de la dernière décennie est encore susceptible de faire entendre sa réflexion personnelle sur la fiction, il le fera de façon indirecte, dans le domaine de la fiction et non dans la position valorisée du théoricien ou de l’essayiste, ce que démontre l’article de P. Riendeau (« Les essais des romanciers français (Kundera, Ernaux, Houellebecq) »), à travers les fictions de Kundera, A. Ernaux et M. Houellebecq. De même, B. Blanckeman (« L’écrivain impliqué : écrire (dans) la cité ») souligne le glissement de l’écrivain engagé à l’écrivain impliqué, signe d’un refus d’ostentation. Ce glissement s’illustre ici à travers l’étude des Samothraces de Nicole Caligaris (2000), proposant une poétique et une politique romanesque de la migration, dans la thématique comme dans l’écriture (dans une œuvre qui alterne théâtre, prose et poésie). Jan Karski de Y. Haenel, pose également la question de la transmission et montre une poétique du bricolage, susceptible de dénoncer le processus de récupération idéologique. À travers ces deux exemples, l’implication apparaît comme la volonté de restituer à l’événement son opacité, ôtant à l’écrivain toute illusion de maîtrise face à un sens qui reste dans un processus de reformulation permanente. M. Dambre aboutit également à cette conclusion, insistant sur l’impossibilité pour le romancier de constituer une vérité historique synonyme d’une orthodoxie ou d’un lieu commun. Il lui faut plutôt la concevoir comme un horizon qui se dérobe au fur et à mesure que l’on tente d’approcher. Ce refus de la domination consensuelle, tant sur le texte que dans la posture même de l’auteur, peut se retrouver dans l’article d’A. Adler (« Fictions de la communauté : effraction, reconstitution, altération »), dont l’analyse d’œuvres d’Olivier Rohe, Arno Bertina et Mathieu Larnaudie dégage une nouvelle approche de la notion de communauté : non pas la communauté du consensus et du figement, soudée par la mythologie de la pureté identitaire, mais au contraire la communauté comme assemblée de singularités quelconques, dans un rassemblement libre et sans cesse mouvant. Cette redéfinition de la communauté gagne alors les figures mêmes des auteurs ici étudiés puisque Rohe, Bertina et Larnaudie participent à la revue Inculte, promouvant une « écriture collective, qui fait la part belle aux imprévus suscités par l’intervention de l’autre » (p. 92), à la façon du collectif italien Wu Ming11. La figure de Pierre Senges, analysée dans l’article de L. Demanze (« Les fictions encyclopédiques de P. Senges »), participe également de cette soustraction de l’auteur à toute position de maîtrise absolue sur le texte, ici du côté de sa production. Les récits de P. Senges montrent en effet l’élaboration d’une œuvre travaillant à partir du déjà écrit, l’écrivain ne revendiquant plus le rôle du producteur original, mais se transformant en copiste ou en faussaire assumé puisque ces rôles permettent de renverser les valeurs traditionnelles, l’ignorance ou l’autodidactisme devenant des leviers formidables pour la production des textes. Enfin, on peut souligner combien l’article de G. Prince (« Les Particules élémentaires : autoportrait ») semble, dans sa construction même, participer de cette perte d’autorité de l’auteur, puisque le roman de M. Houellebecq est analysé à travers la voix du livre lui‑même, assez puissant pour évoquer, à travers une prosopopée en forme d’autoportrait, son écriture et ses thématiques, sans devoir passer par la personne de son « géniteur ».
14L’instance fictive de production, le narrateur, est également convoquée dans le volume à travers l’article à quatre mains de F. Fortier et A. Mercier (« L’autorité narrative pensée et revue par Anne F. Garréta »), qui s’intéresse à deux livres paradoxaux de A. F. Garréta, Éros mélancolique, écrit en collaboration avec Jacques Roubaud (2009), et Pas un jour (2002). Éros mélancolique montre la déconstruction de l’autorité narrative à travers la subordination de cette dernière à une série de transcodage, empêchant en outre de déterminer avec précision qui est le sujet énonciateur du récit à l’origine. Pas un jour introduit la même déconstruction en jouant des règles posées au début du livre, puisque la fin du récit révèle qu’elles n’ont pas été suivies. Certes, ce type de piège final existait déjà dans la célèbre nouvelle d’Alphonse Allais, « Un drame bien parisien » (1890), longuement analysée par Umberto Eco dans son Lector in fabula12, mais Pas un jour semble l’intensifier à travers la subversion du genre ici apparemment employée, la confession, qui est finalement parodiée et ironisée.
15Cette élaboration fictionnelle en forme de chausse‑trappe est bien sûr destinée à piéger le lecteur trop crédule, avide peut‑être de découvertes inédites au sujet de l’auteur et amené à devoir tenter vainement d’écarter la fiction du réel, puisque A. F. Garréta annonce à la fin de Pas un jour qu’un des textes n’est en rien un souvenir mais une invention, sans donner aucun indice pour déterminer lequel. De cette façon, la lecture est pensée « comme la quête d’une trace qui sans cesse se dérobe » (p. 249), refusant donc toute possibilité de maîtrise sur le texte également chez le lecteur. Une même activité incessante et pourtant sans victoire finale du lecteur se retrouve dans l’œuvre de P. Senges, étudiée par L. Demanze : cet auteur sollicite constamment les souvenirs textuels des destinataires de ses textes, en mettant même en récit le vagabondage intertextuel de leurs esprits, semble leur promettre une continuité narrative, mais pour mieux les décevoir, en les entraînant sans cesse dans une fiction aux pistes romanesques démultipliées. Le « roman‑critique » analysé par W. Motte insiste également sur l’activité propre au lecteur selon l’œuvre édifiée par P. Bayard. Le lecteur aurait en effet nécessairement un rôle à jouer dans tout texte de fiction, qui recèle par ailleurs quelque chose de nous avant même que nous ne l’abordions, faisant pour nous de chaque lecture un moment d’action dans le monde de la fiction. Mais cette activité est alors éminemment individuelle, empêchant dès lors tout discours officiel sur la narration. Si aucun article ne s’attache véritablement à la figure du lecteur dans la première décennie du xxie siècle, ce qui peut être regrettable, il est donc néanmoins possible d’en retracer un portrait à travers les différentes contributions, qui insistent sur son activité à la fois sans cesse frustrée mais aussi toujours relancée par les dispositifs textuels mis en place.
Confiance retrouvée du récit
16Narrations d’un nouveau siècle semble également permettre le dépassement d’un débat universitaire qui a pourtant occupé les champs de la critique à la fin du xxe et au début du xxie siècle, à savoir le désormais trop fameux « retour au récit », formule depuis délaissée pour la « refondation du récit ». En effet, les contributions ici rassemblées ne s’interrogent pas sur la validité ou non de la formulation, mais montrent avant tout les différentes illustrations d’une confiance renouvelée dans le récit, dont Ricœur, avec Temps et récit, s’était montré l’instigateur à partir de 1983, puisque le philosophe faisait du récit le gardien du temps. La dernière décennie semble ainsi avoir retrouvé une certaine pratique assumée du récit, non plus vécue sur le mode de la méfiance mais davantage de l’apaisement, voire de l’émerveillement. Certes, l’héritage de l’ère du soupçon et des jeux formels des décennies précédentes n’est pas pour autant effacé, ce dont témoignent par ailleurs les dispositifs textuels destinés à piéger le lecteur trop crédule ou la vérité impossible à atteindre, à la façon du fil de l’horizon, que nous avons précédemment évoqués. Mais la narration paraît néanmoins porteuse de possibles autrefois niés ou diminués par les romanciers eux‑mêmes et surtout emplie d’un potentiel d’émerveillement. C’est ce que semblent démontrer les analyses de L. Demanze et W. Motte : les textes de P. Senges et ceux de P. Bayard, mais également celui de Frédéric Werst (Ward ie‑iie siècle, 2011), étudié par M. Dambre, édifient en effet des mondes imaginaires à la puissance infinie, capables même d’établir, sur le mode du jeu, des ponts solides entre le monde de la fiction et celui du réel, permettant ainsi le goût retrouvé de l’aventure, celle que non seulement le lecteur dévore mais même élabore, « à plat ventre sur son lit », selon la formule de Pérec.
17Cette confiance retrouvée s’illustre également dans les capacités désormais renouvelées du récit à dire le monde, ce qu’avance l’article de N. Xanthos (« De Zahir à Pégase : poétique de l’intériorité dans le cycle de Marie de Jean‑Philippe Toussaint »), dont l’étude des récits de J.‑P. Toussaint montre certes la difficulté du sujet à saisir les événements, qui le dépassent sans cesse, mais aussi, simultanément, la capacité à donner sens au monde par le biais de la rêverie et de l’imaginaire. À travers l’histoire qu’il produit, le personnage de J.‑P. Toussaint devient capable de s’affirmer et d’investir le monde :
à la faveur des mutations de l’espace romanesque de ce début de xxie siècle le signe semble retrouver sa part de transparence, sa capacité à nous relier au monde et à nous permettre de lui donner sens. (p. 144)
18Cette même confiance accordée au récit peut se retrouver dans l’article que P. Michelucci consacre à Éric Laurrent (« Le parti de l’expression : le roman maniériste d’Éric Laurrent ») : les derniers romans de cet auteur à la langue particulièrement travaillée, plus précisément ceux publiés à partir de 2004, tels À la fin (2004), Clara Stern (2005) ou Renaissance italienne (2008), montrent des narrations apparentées à l’autofiction mais qui prennent avant tout conscience des capacités du dispositif romanesque, moyen pour l’auteur — et peut‑être le lecteur — de « saisir la différence de densité entre la vie vécue et la vie racontée » (p. 275). De cette façon, une foi renouvelée « en la possibilité de la littérature à dire le monde, mais aussi à affirmer les moyens dont elle dispose13 » est dite, sans crainte ni pudeur. Cette attirance pour les potentialités infinies du récit, même si elles restent en deçà des attentes de l’auteur, est perceptible également dans l’étude que Dolorès Lyotard fait des œuvres de Philippe Forrest (« Palinodie ») : ce dernier a tenté dans plusieurs récits, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, de mettre par écrit ce qui, par essence, ne peut se raconter, la mort d’un enfant. Chaque récit porte à la fois l’espoir et la déception du romancier, qui a pourtant renouvelé à plusieurs reprises ses tentatives, de L’enfant éternel (1997) à Tous les enfants sauf un (2007), le récit offrant à la fois sa frustration permanente et son potentiel infini.
Les rapports à la langue
19Enfin, il est possible de souligner les attentions du volume envers l’écriture même de ces récits de la première décennie du xxie siècle. Si certains auteurs gardent d’un siècle à un autre le même style, à l’instar de l’écriture blanche d’Y. Ravey, que W. Asholt définit et analyse avec précision, d’autres déploient une inventivité verbale continue, présente tout particulièrement dans Ward ie‑iie siècle de F. West, qui propose un lexique du wardwesân, langue inventée par l’auteur et pour les personnages de son œuvre. Les romans d’É. Laurrent, dont les œuvres sont parfois considérées comme étant écrites en « français langue étrangère », peuvent également illustrer ce souci d’une langue, qu’il ne s’agit pas ici d’inventer mais d’explorer à travers toutes ses possibilités trop souvent ignorées, mots rares, tournures recherchées, expressions et images oubliées. Le souci de nombreux auteurs de jouer autour d’expressions figées, de lieux communs, à l’instar de N. Caligaris qui, dans les Samothraces, joue sur la locution « sans domicile fixe », ou de C. Laurens, qui manipule les clichés de la sentimentalité pour voir ce qu’il peut y avoir derrière, témoigne également d’une volonté de ne pas rester dans les figements de la langue, mais de renouveler cette dernière. Autant que les narrations, la langue française du xxie siècle se renouvelle, ce qu’illustrent aussi les auteurs francophones analysés par S. Bédrane et C. Douzou : l’utilisation d’un parler autre que celui d’origine conduit bien souvent à la mise en place d’une tierce langue destinée à enrichir le pays choisi pour vivre et écrire.
***
20Le paysage littéraire français de ces dernières années est particulièrement riche, complexe et pluriel. Narrations d’un nouveau siècle, romans et récits français (2001‑2010) permet donc de saisir les premiers enjeux d’une décennie à peine achevée, et d’accéder ainsi à un bilan encore mouvant sur les récits déjà publiés. Mais ces récits peuvent déjà aussi tracer en partie les lignes de ceux encore à venir, tout comme les thématiques qui, en ce début du xxie siècle, inspirent les écrivains : l’Histoire, l’intime, l’engagement mais aussi le jeu autour de l’érudition ou l’interaction entre littérature et médias, dont un roman comme Les Années d’A. Ernaux, fréquemment cité dans le volume, serait particulièrement représentatif. La prochaine rentrée littéraire sera peut‑être l’occasion de voir confirmées ces tendances ou bien d’assister à de nouvelles émergences, dans un paysage littéraire français où le nombre de manuscrits soumis aux éditeurs n’a jamais été aussi important, à l’heure où chacun peut imprimer à compte d’auteur sa propre œuvre et où la présence de repères, même s’ils sont en constante redéfinition, tels que peut les offrir un volume comme Narrations d’un nouveau siècle, s’avère particulièrement utile pour mieux s’orienter et trouver un futur chemin.

