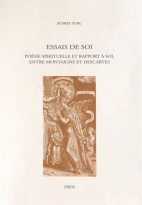
Le jeu de l’exemplarité ou la manière de me dire lorsque « je vis non point maintenant moi »
1Au tournant des xvie et xviie siècles, lorsque le « je » ne signifiait pas encore le « moi », c’est par une permanente stratégie de l’esquive que choisit de se dire l’être, comprenant que l’impossible distinction entre théophanie et anthropophanie, notamment révélée par cette activité poétique que l’on nomme justement « spirituelle » et qui engendre un rapport à soi toujours en dédoublement — selon l’énoncé programmatique de Ga 2, 20 : « je vis non point maintenant moi, mais Christ vit en moi » —, permet réellement au « je » de vivre détaché de la libre individuation morale que représentait la collection d’accidents chez Montaigne et de l’autonome individuation consciente que représentait la réflexivité égologique chez Descartes. L’ouvrage d’Audrey Duru, version remaniée d’une thèse de doctorat dirigée par Michèle Clément et soutenue à l’Université de Lyon en septembre 2008 — Dire « je » : augustinisme et rapport à soi dans la poésie spirituelle de langue française publiée entre Montaigne et Descartes (1580-1641) — s’attache à clarifier les enjeux de ce rapport à soi qui pourrait certes nous paraître bien inactuel. Dire en effet que l’on n’accède à l’altérité ni par l’événement ni par l’intellection mais par une plongée au plus intime de soi‑même, là où se tient du reste aussi le principe de l’écriture, suppose que l’on renonce à toute téléologie littéraire pour envisager la préhistoire de la subjectivité — au sens que lui donne Terence Cave :
Les pré-histoires que je voudrais reconstituer ne s’offrent pourtant pas comme des origines. Leur statut est plutôt celui d’une trace ambiguë, le « pré- » signifiant ici le stade d’avant la continuité d’une histoire : au commencement il n’y avait pas de récit, il n’y avait que la trace. Dans ces conditions, le mouvement en amont n’est permis que si l’on renonce à chaque moment à la tentation analeptique, même si la question (du moi, du scepticisme, du suspens, etc.) n’aurait pu être posée sans qu’il y eût un récit que nous avions l’habitude de nous raconter1.
2Il s’agit donc de ne pas projeter rétrospectivement sur la fin du xvie siècle et sur le début du xviie siècle l’effervescence du « moi » de notre modernité, d’effacer les traces du futur, de mesurer la singularité absolue de cette poésie spirituelle d’un genre nouveau qui est bien ici l’objet de l’étude. Or la superposition de deux voix, celle d’un « je » présent et celle de son reflet en Dieu, fait que toute poétique est ici simultanément une éthique : lorsque la sécularisation contemporaine du christianisme favorise une libre parole des laïcs, plusieurs formes de discours viennent librement s’y entrecroiser — théologie (péché, grâce, rédemption, béatitude), spiritualité (âme, désir, épreuve, exercice), morale (loi, faute, justification, pardon), rhétorique (figure, ethos, pathos, poésie) —, et un vaste principe de palinodie préside en fait à la constitution d’une écriture originale. On comprend la fécondité de ce genre éditorial, hors de tout esprit de système mais dans cette appropriation de la poésie destinée à la création même de sa mise à distance en un métalangage. Ce jeu à la puissance énonciative fascinante impose d’ailleurs définitivement le « je » en littérature.
L’expérience du langage
3Tout comme il convient d’étudier le « je » en faisant abstraction de sa constitution ultérieure dans l’histoire comme sujet autonome, il s’agit de l’envisager hors de cette catégorie du « lyrisme » qui n’existe que dans le vaste mouvement de relecture de l’histoire qu’impose le tournant des xviiie et xixe siècles en Allemagne — l’énoncé selon lequel la poésie chrétienne est une poésie lyrique n’existe en effet pas ailleurs que dans l’esprit de Hegel puisque le christianisme semble bien au contraire avoir fondé le lyrisme : c’est là consentir à oublier une pensée commune de l’anticipation et de la préfiguration pour s’élancer vers une pensée exigeante de l’écart et de la différence. Voilà bien le projet d’A. Duru :
Nous proposons donc de nous déprendre en partie de l’emprise de l’expérience cognitive cartésienne pour poser non pas que le soi est découvert par un exercice de réflexivité — dit cogito —, mais qu’il fait l’objet d’une fabrication pratique, sous la forme d’énoncés de normes et d’exercices : c’est ce que l’éthique contemporaine nomme « rapport pratique à soi ». L’approche pragmatique anglo-saxonne permet d’envisager l’élaboration de soi, telle que l’exercice dévot et spirituel la permet, mais aussi telle qu’elle est en partie symbolique, strictement langagière : c’est alors qu’une étude littéraire, poétique et non pas philosophique, est pertinente. (p. 17)
4Examiner en somme le discours poétique à la première personne du singulier indépendamment de toute grille de lecture prédéterminée, comprendre le « dire je » de façon pluridisciplinaire, exclure le retrait du monde pour établir la pragmatique littéraire comme seule herméneutique possible. Ainsi, lorsqu’un poème place le « je » en position de sujet grammatical de verbes performatifs, différents actes illocutoires demeurent possibles : élancée vers l’autre que soi (« je demande pardon ») et simultanément orientée vers l’expérience de soi (« je sens »), la parole se diffracte alors en toute forme du pronom réfléchi de première personne, de l’ego (méditation : « Chacque heure, chacque point de ceste foible vie, / Ostant l’homme à soy-mesme au tombeau le convie ») à l’alter ego (élévation : « Oste moy de moy mesme »)2. C’est même le brouillage de ces deux sens qui peut présider à l’élaboration de la parole, lorsque le « je » troublé par l’« esmoy » qui vaut étrangeté à soi‑même aspire à l’« en moy » qui vaut étrangeté en soi‑même (« Dieu change, en moy venant, en joye mon esmoy3 »). Il est ici patent que le rapport à soi ne s’établit qu’à travers le refus d’être un moi, lorsque la poésie n’a plus rien en commun avec un simple texte normatif. La poésie spirituelle comme exercice se donne donc comme le genre par excellence d’une approche non réifiante de soi, entre un « je » affectif, un « en moi » unifié, et un être double permettant la saisie de « soi-même comme un autre ». Loin de tout prisme psychologique, l’expérience s’accomplit bien ici à travers l’acte de langage.
L’expérience de l’imagination
5Il s’agit dès lors de problématiser la pratique littéraire de la méditation en comprenant qu’elle permet l’avènement d’un monde imaginaire nouveau. Loin de toute entreprise biographique mais attentive à l’épaisseur énonciative et à son intertextualité, l’étude rappelle ici les travaux de M. Clément, inspirateurs du présent travail et défenseurs de l’homologie de structure entre discours mystique et baroque poétique — le baroque se doit d’être interprété à partir de la mystique puisque le poème spirituel fonde le rapport pratique à soi, rapport qui fonde à son tour le « je » et permet enfin l’énonciation de ce « je » antérieurement à toute signification d’un « je » énonciateur. Si la production du temps s’empare ainsi de formes existantes pour mieux les déformer, par interaction de la métaphore, de l’hypotypose et de l’ellipse, un singulier dynamisme énonciatif voit alors le jour pour restituer une parole cordiale, elle‑même reflet et expression du Verbe mental déposé dans l’être. C’est à ce titre que peuvent s’enlacer parole sacrée et parole profane et que peut naître une sur-parole musicale : « le je est donc montré non seulement comme un locuteur, mais comme une parole, voire le texte d’un livre, comme un clair‑obscur » (p. 429). Face au monde, l’expérience de soi comme lieu de la connaissance de Dieu fait alors advenir une rhétorique de la personnalité, lorsque la maîtrise de l’écriture vaut maîtrise de soi en vertu du modèle paulinien :
Reflet du monde, copie d’une réalité qui cherche à augmenter encore le trouble perceptif, le poème spirituel offre en premier lieu une vision « en miroir », en énigme : « Car nous voyons maintenant par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. » [1 Co 13, 12]
En second lieu, A. Mage paraît trouver […] ce qui justifie l’hypotypose de soi‑même : « Mais pour cette cause miséricorde m’a esté faite, afin que Jesus Christ montrast en moi le premier toute clemence, pour un exemplaire à ceux qui voudront à croire en luy à vie éternelle. » [1 Tm 1, 16] (p. 428)
6L’allégorie et l’hypotypose demeurent naturellement les deux procédés rhétoriques capitaux qui font de la poétique naissante le lieu d’une authentique expérience :
Selon une version faible, les poètes s’approprient les motifs humanistes relatifs à la poésie comme pédagogie : l’écriture est alors le moyen d’un apprentissage. Selon une version forte, l’écriture est une forme de parole génésique jaillie de l’état d’anéantissement. (p. 429)
7Le pacte de lecture ascétique que propose ainsi la forme littéraire constitue « non pas une piété par l’imitation du Christ, mais une pratique éthique, dont le point de départ est la connaissance de soi » (ibid.). Notons qu’il s’agit pourtant de se singulariser sans jamais se séparer du corps social, ce qui n’est certes possible que si l’angle de lecture proposé demeure résolument esthétique :
La poésie spirituelle de la fin du siècle systématise cette poétique des passions en une poétique ascétique et mystique. La lecture ou l’audition du poème spirituel sont disposées comme des épreuves sensibles et intellectuelles. Par l’hypotypose, le poème mobilise les sens intérieurs et l’imagination. Par les figures de la contradiction et les apories logiques, il peut dérouter l’âme, d’une manière dionysienne et cusanienne, pour lui suggérer la « scène de l’Autre ». Cette poétique ne recherche donc pas la représentation mimétique. Il serait inexact de la qualifier seulement de poétique expressive. Par l’expression, c’est l’effet sur le destinataire qui est recherché. Il s’agit également de transmettre une parole qui fasse parler à son tour le destinataire. (p. 439)
L’expérience de soi
8Le plan de l’étude s’organise donc logiquement selon le double versant d’une poétique de soi — la poésie spirituelle fait naître une utopie langagière en lutte contre l’insignifiance mondaine (1), façonne une expression simultanément éthique et pathétique en coulant son invention dans les psaumes de pénitence (2), recrée la figure de l’artiste dans l’énonciation même d’une subjectivité naissante (3) et élabore une rhétorique de la méditation qui pourra ultérieurement comprendre le rapport réflexif à soi (4) — et d’une politique de soi — il y a spiritualité de l’épreuve lorsqu’on se situe en régime calviniste avec André Mage de Fiefmelin (5), spiritualité mystique lorsqu’on se situe en un régime d’abstraction avec Pierre de Croix (6), spiritualité de la communion lorsqu’on se situe en régime catholique face au pouvoir royal avec Claude Hopil (7) et spiritualité de l’assujettissement lorsqu’on se situe sous le régime théologico-politique contraignant du mécénat royal en fin de période (84). Une annexe fournit très heureusement, en fin d’ouvrage, neuf poèmes des Œuvres chrestiennes de Claude Hopil, associés à leurs hypotextes latins respectifs et ouverts sur une enquête génétique rigoureuse. L’étude d’A. Duru se révèle ainsi fort stimulante en son invitation à comprendre les « essais de soi » hors des sentiers déjà balisés par Montaigne et Descartes en une double articulation historique et littéraire. Le principe de la micro‑lecture permet naturellement de rendre compte des multiples interactions verbales dont traite le sujet de l’enquête et de nous faire connaître de multiples minores auxquels nous n’aurions sans doute jamais pensé. Mais si le mouvement d’exitus et de reditus présidant à la compréhension de l’être au tournant des xvie et xviie siècles présente le « je » comme enjeu d’une perpétuelle tension entre « la force naturelle qui meut l’homme » et la grâce par laquelle « les éléments sont attirés vers leur lieu propre » (p. 352), dire « je » se confrontant donc toujours à une indépassable finitude, celle‑ci fût‑elle une chance et une possibilité pour l’être d’être révélé à soi‑même, on pourrait se demander si la ressaisie de cette notion n’aurait pas mérité un traitement plus phénoménologique encore. Or en refusant de penser le « baroque » pour ne penser que l’augustinisme à la suite de Philippe Sellier5, l’ouvrage semble légèrement quitter l’horizon pragmatique qu’il prétendait vouloir suivre, gagner une ligne plus intellectuelle ou plus érudite qui n’est pourtant pas toujours celle de ses auteurs, et se couper d’une histoire des arts dont la littérature est pourtant intimement solidaire. Si le pathos de la finitude se déploie par exemple de façon très manifeste chez Chassignet en un véritable ethos du réel mondain – les quatre éléments se trouvant forés dans le sonnet de 1594 « Qu'est‑ce de notre vie ? » (Le Mépris de la Vie et la Consolation contre la Mort), on aurait peut‑être pu lui réserver ici une minutieuse analyse de type bachelardien pour entendre que l’invention s’en tient toujours d’abord au seul horizon mondain pour seulement penser ensuite un retour de l’être, à partir de sa finitude, vers la transcendance qui l’ouvre bien de toujours à toujours. En ce sens, nous ne voyons guère qu’il faille nécessairement abandonner la catégorie de baroque pour penser le siècle de manière éclairée. On pourrait encore se demander, dans la même ligne problématique, ce que devient exactement le « je » dans une poésie réformée prétendant s’adresser à tous mais sachant pertinemment que tous ne sont pas sauvés : devant quelle finitude devons‑nous alors nous arrêter pour simultanément penser un être‑là tantôt sauvé et tantôt damné ? Suffit-il de dire que « les motifs de la vanité, de l’illusion et de la démystification, bien identifiés par la critique du baroque, sont en fait doublés d’une rhétorique de l’énigme et du secret » ou que « la poésie spirituelle œuvre à l’intérieur d’une crise de la symbolisation » (p. 104) ? Là encore, l’étude risque de se convertir à l’abstraction et de quitter la chair même du monde. Mais telle est peut-être la rançon de l’immense et passionnante érudition déployée au fil de nos pages. Indiquons néanmoins que l’esthétique théologique de Hans Urs von Balthasar pourrait permettre de résoudre ce léger embarras. La beauté y est établie, en l’écriture, comme ce transcendantal absolu qui peut se dire lui‑même face à Dieu et, simultanément, dire Dieu lui‑même. Lorsque tout devient en effet figure, tout devient alors aussi enjeu de révélation. Or n’est‑ce pas l’objet propre de l’essai de soi, notamment en cette poésie spirituelle qui voit le « je » advenir à l’expression ?

