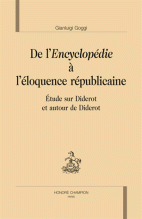
Le revers de la toile. Le travail de l’intertexte dans la philosophie politique du dernier Diderot
1Le foisonnement d’ouvrages et de colloques sur Diderot pour le tricentenaire de la naissance du philosophe langrois en 2013 témoigne de l’attention que cet écrivain à la personnalité et aux intérêts polyédriques a su susciter ces dernières années. Pendant longtemps en effet Diderot a souffert d’une double exclusion : exclusion de la part des littéraires, car ses textes présentaient des traits trop proches de la philosophie, et exclusion de la part des philosophes, car ses démarches argumentatives paraissaient trop teintées d’intuition et trop peu systématiques pour relever de l’esprit rigoureux qui se voulait celui de la philosophie1. Et pourtant, en dépit de ce renouveau de curiosité pour la pensée et les écrits du philosophe et de la publication d’études nombreuses et méticuleuses, l’édition des œuvres complètes de Diderot est loin d’être achevée, et les replis de sa pensée loin d’être éclaircis. Gianluigi Goggi est certainement à inscrire au nombre des chercheurs qui ont contribué à combler cette lacune. Les spécialistes (et même les non-spécialistes) le connaissent bien : professeur de littérature française à l’Université de Pise, spécialiste de l’abbé Raynal, G. Goggi est membre du comité d’édition des Œuvres complètes de Diderot chez Hermann et a dédié ses dernières trente années d’étude à la pensée philosophique du dernier Diderot. Il a également établi le texte des contributions de Diderot à l’Histoire des deux Indes à travers une minutieuse recherche sur les fonds Vandeul2.
2Dans son livre paru l’été dernier chez Honoré Champion, G. Goggi a rassemblé une série d’études publiées précédemment dans des revues et des ouvrages collectifs. Il fournit ainsi au lecteur un parcours de recherche qui, à partir d’une réflexion sur les problèmes éthiques soulevés dans Le Neveu de Rameau, éclaire la pensée politique du dernier Diderot et parvient à conjuguer ces deux dimensions de l’œuvre de Diderot grâce à une méthodologie philologique rigoureuse qui saisit les moindres nuances de la pensée du philosophe et analyse en détail le procès de son devenir. Dans les lignes qui suivent, nous aimerions proposer une lecture possible de cet ouvrage et proposer des points de discussion « sur et autour » — pour reprendre le syntagme para-textuel du volume — de la pensée de Diderot et de la synthèse de G. Goggi.
Les « réclames », ou le travail de l’intertexte
3La structure du livre est quadripartite et dessine l’évolution de la pensée politique diderotienne depuis la fin des années 1760 jusqu’à la collaboration à la troisième édition (1780) de l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal. Dans la première partie, « Après la crise de l’Encyclopédie », l’auteur retrouve, dans des ouvrages qui ne sont pas stricto sensu politiques, les racines d’une réflexion éthique qui ira de plus en plus vers le versant politique de toute philosophie morale : l’investissement du philosophe dans l’actualité sociale, économique et politique du monde qui l’entoure. Ainsi, dans les trois chapitres qui composent cette première partie du livre, et qui portent respectivement sur Le Neveu de Rameau, sur le Supplément au Voyage de Bougainville et sur quelques pages du Salon de 1767, l’auteur montre à quel point certaines des positions politiques tardives du philosophe sont déjà présentes, en germe, dans les années qui suivent l’arrêt de l’entreprise encyclopédique. À travers ces analyses G. Goggi fait émerger la dissémination d’une série d’images, ou d’icônes, les « réclames », qui, parsemées dans l’œuvre entière du philosophe et partagées par d’autres ouvrages de la même époque, permettent de retracer un système d’échanges et de correspondances, un réseau d’intertextualité reconstituant les débats de l’époque et les influences réciproques entre un penseur et les autres et entre la dimension de la pensée et le devenir changeant de l’Histoire de cette période.
4La « réclame », instrument conceptuel indispensable pour comprendre l’approche critique du livre, relève à la fois de l’analyse du processus de l’écriture et de l’esthétique de la réception et étaye ainsi le réseau d’intertextes que G. Goggi se propose de faire émerger. Diderot utilise le mot de « réclame » dans ses Mémoires pour Catherine II :
J’ai sur mon bureau un grand papier sur lequel je jette un mot de réclame de mes pensées, sans ordre, en tumulte, comme elles me viennent. […] Cela fait, je reprends ces réclames d’idées tumultueuses et décousues et je les ordonnes, quelquefois en les chiffrant3.
5Or, à l’époque, le terme « réclame » peut avoir différents sens, qui recoupent en tout ou en partie celui, aujourd’hui presque désuet, de devise à l’usage de la publicité ou de la propagande politique. Au féminin, le terme appartient au vocabulaire de l’imprimerie et indique « le mot qui est imprimé en dessous de la dernière page d’un cahier ou feuille d’impression pour annoncer le premier mot de la page suivante4 », mais aussi le « dernier mot d’une tirade ou d’un couplet qui indique, au théâtre, au partenaire que c’est à lui de donner la réplique5 » ; au masculin, en revanche, il signifie, dans le langage de la chasse, tout objet utilisé pour produire un son afin de réclamer les oiseaux ou d’autres animaux6.
6La fonction du ou de la réclame est donc de réclamer, de rappeler, de rapprocher : de créer une proximité. C’est dans un sens qui réunit tous ceux qu’on vient de mentionner que l’auteur semble interpréter ces mots-réclames ou signes-réclames qu’utilise Diderot. En effet, écrit G. Goggi, le philosophe s’en sert dans sa propre écriture, comme « des mots ou des signes qui lui servent de mémento ou d’aide-mémoire, et qui condensent donc une argumentation dans son ensemble, rappelant à la mémoire ou résumant cette argumentation au moyen d’une image suggestive » (p. 23) et qui deviennent, ajoute-t-il, « des vrai “hiéroglyphes” capables d’exprimer de façon adéquate le “tableau mouvant de l’âme” » (ibid.). En même temps, ces signes-réclames affectent une deuxième dimension, celle de la « relation avec le lecteur virtuel auquel s’adresse Diderot », car « [l]’écriture par signes-réclames fait confiance, ou repose sur l’aptitude du lecteur à s’insérer dans des circuits linguistiques bien particuliers […], à saisir sans difficulté les allusions et les connexions qui renvoient aux contextes véhiculés par chacune des “réclames” » (ibid.).
7En ce sens, le langage de Diderot, tel que G. Goggi le définit, en reprenant un article de Starobinski7, est un « langage de réemploi, qui reprend et réutilise, de manière elliptique et abrégée, signes et symboles de l’imaginaire social auquel il participe » (p. 23‑24). Mais ces signes et symboles s’enrichissent de valeurs nouvelles : le processus de transformation, écrit encore G. Goggi, est un processus d’« hyper-codification » qui ne renvoie pas tant aux rapports entre les signes et leurs référents qu’à une série de rapports entre les signes, à des échos et des dialogues entre les textes :
En renvoyant ou en faisant allusion à un texte, le signe diderotien est souvent surdéterminé par la médiation d’un second texte qui fait office d’interprétant8 du premier.
8Le livre bénéficie des apports de cette approche méthodologique. Trois de ces réclames, récurrentes dans la pensée du philosophe, nous semblent particulièrement révélatrices de la démarche de la pensée de Diderot et du processus de formation de son langage.
« La sagesse de Salomon » & la philosophie de Diogène
9Le problème de fond du Neveu de Rameau est un problème éthique sur la possibilité d’un avenir porteur d’espoir, dans lequel la conciliation du « bonheur » et de la « vertu » serait in fine possible (p. 18). G. Goggi parvient à cette lecture par l’analyse détaillée de deux images à la fois opposées et complémentaires : celles de la sagesse de Salomon et de l’autosuffisance prêchée par Diogène. La référence à Salomon, au dix‑huitième siècle, est très répandue et pose des problèmes exégétiques ; dans un passage du Neveu, celui‑ci en fait un éloge en ces termes :
Tenez, vive la philosophie ; vive la sagesse de Salomon : boire de bon vin, se gorger de mets délicats ; se rouler sur de jolies femmes ; se reposer dans des lits mollets. Excepté cela, le reste n’est que vanité. (p. 22)9
10Par‑delà la référence à l’Ecclésiaste, la locution paraîtrait être utilisée par Diderot (et par ses contemporains) pour indiquer un style de vie hédonistique visant exclusivement à la recherche du bonheur présent. En l’occurrence l’image, que Diderot utilise également ailleurs dans son œuvre10, passe par un interprétant qui est, argumente G. Goggi, le Voltaire du Mondain11 et de la Défense du Mondain12. Présente dans la conclusion de ce dernier poème voltairien, la louange de la sagesse de Salomon instaure un réseau de référents qui réinsère le Neveu de Rameau non seulement dans le débat fort animé — et auquel Diderot ne négligea pas de prendre part — sur le luxe, mais aussi dans une forme de polémique contre Mandeville et sa célèbre et controversée théorie du « private vices, public virtues », énoncée dans The Fable of the Bees en 1714.
11En effet, à la sagesse de Salomon prêchée par le Neveu — et qui est aussi celle du mondain Voltaire et de la noblesse qui avait dans un premier temps paru soutenir l’entreprise encyclopédique (p. 38)13 —, Moi oppose la figure de Diogène, le philosophe qui, afin de ne pas devoir participer à la « pantomime des gueux14 », de ceux qui se laissent pousser par les besoins et l’avidité titillés par la société du luxe, réduit, voire élimine toute forme de besoin et décide, délibérément, de sortir de cette pantomime sociale ne se dédiant plus qu’à la philosophie15. Il est aisé de reconnaître, dans la figure de Diogène, une « référence oblique, mais précise16 » au Rousseau des Discours (p. 57), chantre d’une vertu austère aux antipodes des positions voltairiennes et d’un parcours de réforme et opposition à la société du luxe et du commerce qui distinguerait le philosophe des « gueux ».
12La présence de la figure de Diogène, attestée dans plusieurs endroits de l’œuvre de Diderot17, prend du relief si regardée sur la toile de fond de la société telle que Mandeville l’avait peinte : dans son schéma fonctionnaliste de représentation du social, ou les vices et les vertus de chacun jouent un rôle dans l’économie générale de la chaîne des êtres (rapprochée de la chaîne alimentaire), Mandeville justifiait les excès du luxe (les vices privés) par les bienfaits qui en dérivaient pour la société. Il existait, dans le processus de la consommation, une forme de compensation qui n’était que la restitution permise par le luxe et la circulation des biens qu’il promeut. Or Diderot, en proposant un schéma antagoniste à celui-ci par la voix de Moi, instaure une pensée dialogique et une réflexion qui se poursuivra dans les années à venir. Cependant, jamais les positions de Diderot ne deviennent tranchantes et les deux voix de Moi et du Neveu poursuivent et mettent en scène un discours qui procède par antithèses et qui, de ce fait, semble relativiser toute affirmation trop péremptoire. Rousseau et Voltaire sont aux extrêmes et nous ne pouvons toutefois pas dire que Diderot soit à mi-chemin entre eux. Comme l’a écrit Starobinski, la participation de Diderot au monde consiste à sentir le dehors du dedans. Moi et le Neveu retraduisent un discours qui était lui-même une traduction : le discours du dehors traduit (littéralement, trans-fero, trans-duco) vers l’intérieur et retraduit vers l’extérieur.
13Ce dialogisme interne de la pensée de Diderot est bien connu par les lecteurs et les spécialistes du philosophe. Le dialogisme du dehors se reflète dans l’œuvre à travers ce double passage de la traduction vers l’intérieur et de la retraduction vers l’extérieur ; la pensée chez Diderot se configure comme le lieu où les débats publics se transforment en voix du for intérieur. Néanmoins, le travail de Diderot ne saurait se réduire à la simple traduction. Il est bien plus positif, car il apporte toute son énergie à cette opération de remise en dialogue des discours sociaux et politiques de son temps : le philosophe pousse les limites de la structure aporétique et reconstruit, à partir des fragments de son éclatement, une pensée dynamique qui est toujours dialogue et dépassement.
Polyphème & les compagnons d’Ulysse
14Le travail que Diderot accomplit sur cette nouvelle série de discours qu’est l’économie politique est exemplaire à cet égard. Diderot converse à distance avec Locke et Hobbes autant qu’avec l’abbé Galiani, son ami, ou avec Jean-Jacques Rousseau, son frère-ennemi, et le fait en réutilisant de manière originale et personnelle des images qui sont monnaie courante pour le lecteur de l’époque. Telle est l’image odysséenne de Polyphème qui, dans son antre, mange un par un les compagnons d’Ulysse, au livre IX de l’Odyssée. Cette image métaphorique qui assume « une connotation politique (ou éthico-politique) » (p. 125) apparaît trois fois dans le corpus : dans un passage du Salon de 176718, dans la Réfutation d’Helvétius19, dans une lettre à Hume du 22 février 176820. Elle nous aide donc à saisir les préoccupations qui occupent l’esprit du philosophe à la fin des années 1760 et qui atteindront leur maturité pendant la décennie suivante (p. 123).
15La présence de cette réclame de Polyphème mangeant les compagnons d’Ulysse revient à maintes reprises dans le livre de G. Goggi (aux chapitres 3, « Sur quelques pages du Salon de 1767 » et 12 « Spinoza et la révolution anglaise », qui l’analysent de près) car elle paraît permettre de synthétiser la démarche progressive qui conduit le philosophe de la méditation sur le luxe et le bonheur jusqu’à l’usage d’une éloquence politique prônant la régénération du corps social à travers une révolution violente. Cette pensée caractérise le dernier Diderot ; elle est le point de départ du livre et sera elle aussi condensée dans une image, celle de Médée dépeçant Éson. Dans la « Promenade Vernet », Diderot emploie la réclame des compagnons d’Ulysse dans le cadre d’une réflexion sur les fondements de la morale où l’égalité anthropologico-politique entre les hommes et la solidarité qui en découle reposent sur une égalité plus essentielle, l’égalité physiologique (ce sont les années de la composition du Rêve de d’Alembert) :
Mais Polyphème qui n’eut presque rien de commun dans son organisation avec les compagnons d’Ulysse, ne fut donc pas plus atroce, en mangeant les compagnons d’Ulysse, que les compagnons d’Ulysse en mangeant un lièvre ou un lapin ? Mais les rois, mais Dieu qui est seul de son espèce ?21
16Ce qui intéresse ici Diderot (et qui l’intéressera aussi dans la lettre à Hume où la réclame réapparaît), est que la bienfaisance ou la sympathie morale existent entre des êtres relevant de la même « organisation » physiologique. La métaphore, écrit G. Goggi (p. 126), ne peut être saisie à défaut d’une compréhension plus approfondie du contexte qui la génère : quoique de manière elliptique, Diderot vise ici, dans la figure de Polyphème, les monarques absolus (et le fondement de leur autorité, la divinité considérée sous forme d’un être unique dans son genre)22. L’image appartient à la littérature politique et ce sont l’usage qu’en fait Locke et la relecture qu’en propose le Baron d’Holbach qui constituent les « interprétants » entre le texte homérique et le réemploi chez Diderot : la source explicite — l’Odyssée d’Homère — ne couvre pas l’étendue polysémique qui justifie l’assimilation mise en place par Diderot entre Polyphème dans la scène odysséenne et les monarques du dix-huitième siècle.
17Locke l’emploie, dans le Second Traité23, de façon polémique contre les théoriciens de la monarchie absolue et de l’obéissance passive des sujets, passivité à laquelle il oppose le droit de résistance des peuples. Dans son argumentation en faveur d’une limitation de toute autorité, fût-elle celle du monarque le plus éclairé, le philosophe anglais compare la paix des sujets qui ne sauraient se révolter à la condition des compagnons d’Ulysse dans l’antre de Polyphème, attendant « avec quiétude qu’on les dévorât24 ». La fortune de ce paragraphe, autant que le sens que les contemporains lui attribuent, sont attestés par un passage du Système social du baron d’Holbach, où celui-ci relie étroitement la condition des compagnons d’Ulysse à la paix que procure le despotisme. Partant de cette lecture de Locke proposée par d’Holbach, Diderot arrivera à reconsidérer la philosophie lockéenne. Le chapitre 12, « Spinoza et la révolution anglaise », analyse la lecture par Diderot25 du même texte lockéen, lecture qui diverge de celle de d’Holbach en ceci que Diderot accentue l’aspect politique du rapport entre le monarque et ses sujets, jugeant qu’en aucun cas ceux-ci ne devraient laisser leur roi décider du bonheur public contre la volonté générale (p. 414‑421). L’idée se dessine ici, qui ira se raffermissant dans la décennie suivante (dans la Réfutation d’Helvétius, par exemple), que la volonté générale pourrait constituer un barrage contre les éventuels abus de la part du pouvoir royal, ou, en d’autres termes, que le pouvoir monarchique ne devrait pas être absolu, une forme de contrôle de la part des sujets (mais peut-être serait-il permis de dire : les citoyens) étant souhaitable, voire nécessaire à la bonne santé du corps social.
La pensée & l’Histoire : Médée dépeçant le vieil Éson
18La métaphore physiologique du « corps » de l’état est connue dans la littérature politique et Diderot l’a à l’esprit lorsqu’il se sert de la figure de Médée dépeçant le vieil Éson.
19Si la dimension métaphorique permet de saisir le développement de la pensée politique du philosophe, G. Goggi ne néglige pas l’impact de l’Histoire sur la réflexion qui conduit Diderot de la méditation éthique de la polémique sur le luxe jusqu’à celle sur l’éloquence politique qui se déploie dans certaines pages de l’Histoire des deux Indes. Les écritures historiographiques contemporaines de la révolution anglaise et les débats qui en découlent jouent un rôle également fondamental sur la formation de la position politique du dernier Diderot. Nombre de sources sont retrouvées par G. Goggi grâce à l’emploi de la notion d’interprétant, en ne perdant jamais de vue le dialogisme foncier de la pensée du philosophe dans la deuxième et la troisième partie du livre, respectivement intitulées « Sur quelques philosophes et positions philosophiques » et « Le pour et le contre sur le modèle anglais : Raynal, Galiani, Diderot et quelques autres ». L’auteur y analyse la présence de l’actualité anglaise dans les discussions entre le philosophe et ses amis et parvient ainsi à retrouver cette dimension de l’intertextualité que définit bien Roland Barthes lorsqu’il écrit que « [é]pistémologiquement, le concept d’intertexte est ce qui apporte à la théorie du texte le volume de la socialité […] non selon la voie d’une filiation repérable, d’une imitation volontaire, mais selon celle d’une dissémination »26.
20Si « La référence à l’Angleterre est constante durant tout le xviiie siècle » (p. 524), G. Goggi explique que « le modèle anglais qui prédomine pendant une bonne partie du siècle est bien différent de celui qui intéresse le dernier Diderot […] » (p. 524‑525), car celui‑ci adopte des « lunettes »27 différentes de celles de ses contemporains : « [l]e regard qui est […] généralement porté sur le cycle révolutionnaire anglais du xviie siècle se focalise sur son point d’arrivée. Par conséquent, il dissocie l’acte final du cycle de ses phases précédentes » (p. 525), tandis que Diderot s’intéresse justement aux phases intermédiaires (et donc prend en compte non seulement la Glorious Revolution, mais aussi la première révolution anglaise, et le mythe de Cromwell qui se répandait en France à l’époque et que G. Goggi discute au chapitre 16, « Diderot et Cromwell »).
21Cet intérêt se matérialise dans la plus significative des réclames du livre, celle de Médée dépeçant le vieil Éson, symbole de l’absolue nécessité du passage à travers une phase de total bouleversement de la structure sociale afin de la renouveler dans ses fondements. Son importance dans l’interprétation de G. Goggi est mise en évidence par la structure même du texte : la quatrième et dernière partie du livre est titrée « Diderot et la révolution-régénération : Médée et le vieil Éson ». La figure de Médée magicienne et guérisseuse est tirée des Métamorphoses d’Ovide, que Diderot connaît et chérit (p. 468). G. Goggi cite en entier le texte d’Ovide dans l’annexe au chapitre 14, « Diderot et Médée dépeçant le vieil Éson » (p. 479‑480). Mais, dans le poème ovidien, il n’est en réalité nullement question de dépecer le vieil Éson, qui est le père de Médée : la personne qui est dépecée est le vieux Pélias, roi de la Thessalie qui en a chassé Jason. Déchiqueté par ses filles qui, ayant entendu parler des vertus magiques et médicales de Médée, lui demandent de pratiquer sur leur père l’opération qu’elle a si bien accomplie sur le sien, Pélias est tué par Médée souhaitant venger son époux. La magicienne thessalienne incite les filles du roi à dépecer leur père afin de le rajeunir après l’avoir fait bouillir dans l’eau et les imprudentes jeunes filles ne se rendront compte qu’elles ont été dupées que quand il sera trop tard pour réparer leur méfait. Diderot, qui cite souvent par cœur lorsqu’il s’agit des anciens, se trompe ici. G. Goggi veut lire cette erreur comme une réinterprétation du mythe de la part de Diderot à l’aune du langage politique et particulièrement de la théorie hobbesienne de la dissolution de l’État : Diderot ne retient, de l’histoire, que l’opération de dépeçage, le démembrement du vieux corps (le corps en dissolution) et la superposition d’images Éson/Pélias pourrait être chargée de sens. Ici comme ailleurs la parole de Diderot passe par la « parole des autres » et révèle des profondeurs inattendues.
22La source moderne de l’image, et l’interprétant éristique de Diderot, est le philosophe de l’état absolu : Hobbes se sert de la métaphore, dans le De cive28, pour stigmatiser la « stultitia[m] et eloquentia[m] » qui concourent à la subversion de l’état ; la stupidité parce que, comme les filles de Pélias, leurrée par des ambitieux éloquents (Médée est donc la force de l’éloquence), déchiquète le corps social sans toutefois jamais parvenir à le reformer, l’éloquence, naturellement, en raison de sa capacité d’enflammer les peuples et de les conduire aux excès révolutionnaires. Diderot, qui semble s’éloigner de son admiration pour Hobbes des années de l’Encyclopédie, inverse radicalement je jugement de valeur que prononce le philosophe anglais sur les révolutions : tout en gardant le sens que l’image de Médée incarnait pour celui‑ci, Diderot y retrouve la phase initiale d’un processus de renouvellement radical de la société et de rajeunissement du corps social désormais corrompu. Or, le terme corrompu29 a pour Diderot deux sens : d’un côté, un sens médico-biologique et non moral : corruption recoupe l’air sémantique de gangrène, putréfaction (p. 459) ; de l’autre, un sens politique qui remonte à Machiavel et qui entrevoit la corruption d’un état dans la dissociation entre intérêts particuliers et intérêts de la collectivité, dont le luxe est un « phénomène symptomatique » (p. 460) et dont Diderot paraîtrait avoir pris conscience après l’échec de l’administration de Turgot. Cet état de choses (l’extrême corruption d’un peuple) ne peut que conduire à la dissolution du corps social, c’est‑à‑dire à l’anarchie et à la guerre civile qui, pour Hobbes, marquerait le retour à un état de nature de tous contre tous, de violence et d’empire de la force, alors que pour Diderot — et c’est là le tournant important de sa dernière pensée politique — constituerait l’étape indispensable à la reconstitution d’un état sain.
23La réclame de Médée dépeçant Éson est présente trois fois dans le corpus diderotien des années 1770 : dans une lettre à John Wilkes du 14 novembre 177130, dans un passage de la Réfutation d’Helvétius et dans un des passages de l’édition de 1780 de l’Histoire des deux Indes. En regardant de plus près ces extraits, dans l’annexe des pages 478‑480, la parabole qui conduit l’idée de la « révolution-régénération » du statut de commentaire sur l’actualité politique à celui de position politique délibéré, réfléchie et cohérente devient évidente : si, parmi les trois textes, la lettre à Wilkes est certainement l’extrait plus incisif, car Diderot y emploie l’image en l’expliquant sans détours :
On me demandait un jour comment on rendait la vigueur à une nation qui l’avait perdue. Je répondis : « Comme Médée rendit la jeunesse à son père, en le dépeçant et le faisant bouillir »31,
24c’est la réapparition de l’image dans le passage de l’Histoire des deux Indes qui nous montre l’ampleur du rôle que cette conception quasi médicale de la révolution déclenchée par l’éloquence joue chez le dernier Diderot :
Une nation ne se régénère que dans un bain de sang. C’est l’image du vieil Æson, à qui Médée ne rendit la jeunesse qu’en le dépeçant et en le faisant bouillir. Quand elle est déchue, il n’appartient pas à un homme de la relever. Il semble que ce soit l’ouvrage d’une longue suite de révolutions […]32.
25Il a bien sûr fallu passer par la déception à l’égard du despotisme illuminé pour en arriver là, traverser la prise de conscience de ce que, même éclairé, un souverain demeure un despote en puissance et qu’il ne reste, pour le philosophe, que le retour à la politique des anciens, à l’éloquence « républicaine » qui rendait les sujets des vrais citoyens et que méprisait Hobbes, y voyant la source des malheurs de l’état (p. 473).
26« La vraie éloquence est républicaine » (p. 475), conclut l’auteur en s’appuyant sur un passage de l’Essai sur la vie de Sénèque avant d’achever le livre sur le chapitre qui reconduit encore cette réhabilitation de l’éloquence politique chez le dernier Diderot à la réflexion sur l’actualité contemporaine (p. 595) et donc sur la parole du dehors :
On arrive donc à la conclusion tout à fait vraisemblable que ce fut comme lecteur des gazettes que Diderot arriva à l’appréciation positive de l’éloquence de Wilkes (ou de toute façon à interpréter en termes de cet instrument ancien qu’est l’éloquence des aspects significatifs du « Wilkes and liberty »). […] Le cas Wilkes montrait quelle était l’emprise sociale de l’éloquence et comment, en s’adressant au peuple, elle pouvait se mettre au service de la cause de la liberté (et plus généralement de la « philosophie »).
27La réflexion s’alimente des événements extérieurs, mais ceux‑ci sont relus à travers la grille cognitive du système des réclames, qui permet à Diderot de rester à la fois constamment ancré dans la société qui l’entoure, d’en introjecter la voix et de la rendre, muée, comme une voix propre. S’accomplit ainsi le processus magistralement décrit par Jean Starobinski, pour qui, chez Diderot :
[n]ous sommes donc pris à revers ; le monde extérieur est présent là même où nous avions cru pouvoir nous en tenir à couvert. Le dehors est si bien triomphant que nous pouvons nous sentir participer, du dedans, à la grande vie du monde. Si toute parole est celle de l’autre, elle en devient aussi bien la nôtre : toute différence s’efface entre l’intérieur et l’extérieur.33
28La position du philosophe, dans ce processus de transfert de la parole, est une position d’interprète et de « maître »34 : il a lu, il a écouté, il a interprété le dehors et sait donc énoncer, en sage, la parole du vrai et la règle à suivre. Nous pourrons donc affirmer, en guise de conclusion, que cette parabole que le livre de Gianluigi Goggi décrit, montrant le parcours de la pensée de Diderot dès la crise de l’Encyclopédie jusqu’à la mort du philosophe nous aide à mieux saisir non seulement la formation des idées politiques du dernier Diderot mais aussi la maturation de sa conception de la tâche du philosophe, qui, conformément aux enseignements des Anciens, si importants pour l’élève des jésuites, est celle d’agir en guide, d’énoncer une parole éloquente qui incite et émeut, parce qu’elle a su écouter et se faire le lieux de passage de toute parole extérieure. Ainsi, à plus de deux siècles de distance, cette parole sait encore nous parler ; elle constitue un appel fait à la philosophie pour qu’elle n’oublie jamais son rôle de guide éthique et son essence de pensée dialogique et non dogmatique.

