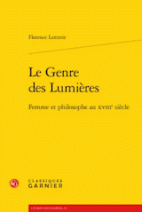
Le genre des Lumières
1Longtemps après les études de P. Fauchery sur La Destinée féminine dans le roman du xviiie siècle et de P. Hoffmann sur La Femme dans la pensée des Lumières, ce livre ouvre à nouveau le chantier des représentations de la femme au xviiiesiècle, en se focalisant sur la figure de la femme philosophe, et plus généralement de la femme de lettres, de la femme de savoir. Il s’agit moins pour Florence Lotterie d’évoquer de manière systématique les figures célèbres de femmes réelles ayant participé à la vie des lettres et des sciences à l’époque des Lumières — même si des personnalités aussi éminentes que Mme du Châtelet ou Mme de Staël sont évidemment au cœur de la réflexion — que d’interroger en termes de représentations, de constructions discursives et d’imaginaire, et dans une logique foucaldienne, les images qui associent la femme à la question de la pensée, des ouvrages de l’esprit, et de la vie intellectuelle. Il s’agit aussi d’envisager, par une inflexion subtilement bakhtinienne, la femme dite philosophe « comme une production dialogique où se “parle” une façon de penser et de vivre la différence des sexes, mais aussi toute une mémoire intertextuelle » (p. 19). Dans cette double optique, plusieurs principes d’opposition (entre fiction et non-fiction, littérature et textes non littéraires, chefs-d’œuvre universellement reconnus et tout-venant de la production du temps) sont non pas annulés mais suspendus au bénéfice de la pensée rigoureuse, exigeante et parfois légitimement tendue de Fl. Lotterie. Tendue — et, disons-le tout de suite, cette tension est un des éléments qui rend cet ouvrage non seulement utile dans une perspective d’histoire des idées, mais intellectuellement stimulant par la participation ardente même si elle est en sourdine de l’auteur à un objet qui n’est pas froidement cantonné dans son historicité — car le panorama qu’elle dresse des représentations de la femme au xviiiesiècle est globalement affligeant. Loin de tout fantasme de « progrès » dans le domaine, le livre évoque bien quelques repères majeurs dans l’optique d’un difficile arrachement de la femme aux rôles dans lesquels elle a été historiquement enfermée pour ne pas dire ensevelie — de Poulain de la Barre à Germaine de Staël et à la figure très ambivalente sur ce point de la Juliette sadienne — mais, au-delà de l’intérêt intellectuel et historique, c’est la nausée qui attend bien souvent le lecteur de cette impressionnante enquête.
2Premier constat : la langue elle‑même, conglomérat de clichés et de représentations figées, semble faire obstacle à l’émergence d’une idée sérieuse de la femme comme productrice de savoir et de pensée. L’utilisation obstinée du masculin grammatical comme prétendu « neutre » crée un effet de discordance lorsque des mots comme « auteur » ou « philosophe » sont associés à la femme et placent d’emblée l’idée (et le syntagme) de « femme philosophe » sous le signe d’un carnavalesque langagier. Lorsque les mots sont féminisés (par exemple avec « philosophesse »), ils le sont presque toujours de manière ironique, comme pour intégrer dans leur énonciation l’impossibilité référentielle sérieuse de ce qu’ils désignent et faire de la « femme philosophe » une sorte de chimère grotesque ou une manifestation des ridicules du temps. Les dictionnaires de « femmes célèbres » qui fleurissent alors proposent des défilés mythologiques dérisoires, images d’Épinal d’un savoir au féminin qui se conjugue souvent avec l’absence de toute œuvre, et les modèles antiques de femmes philosophes, brillant par leur absence de legs en la matière, sont réduits à un imaginaire stéréotypé qui laisse totalement intacte la « pureté masculine » de l’idée de philosophe. Emblématique de cette tendance, un célèbre opuscule attribué à Dumarsais de 1743, Le Philosophe, qui contribue à cristalliser et à condenser dans quelques idées simples l’image adulte et moderne du philosophe des Lumières, s’écrit de bout en bout au masculin, excluant tout à la fois grammaticalement et socialement la femme du modèle humain qu’il prétend célébrer. L’inconscient collectif de la langue est ainsi affecté d’une misogynie aussi profonde que reptilienne et on ne peut s’étonner dans ce contexte que les images de « Femmes savantes », toujours informées par le modèle moliéresque, soient, dans les romans ou sur la scène, traitées comme une déviance ridicule par rapport à ce que la femme est censée être — modeste, sensible, préoccupée de son « ménage », confortablement installée dans la certitude rassurante de sa propre infériorité — et comme un motif comique. Le salon, lieu où les femmes et le savoir sont appelés à se rencontrer, à se retrouver, est la cible régulière d’attaques qui fustigent la futilité d’un savoir qui « pactise » avec le féminin, et la femme ne peut dans cet imaginaire, lorsqu’elle prétend devenir philosophe, que singer ou travestir en les dégradant les signes constitutifs de la vraie philosophie, celle des hommes. La femme philosophe est donc — exactement comme l’homme qui se travestit — une figure socialement discréditée qui suscite un rire méprisant. Son essence étant l’extériorité séductrice et non la méditation et le raisonnement, la femme-philosophe ne peut offrir que les signes extérieurs de la philosophie, « carnavalisés » par leur association avec le féminin et vidés de tout contenu réel. Il aurait été intéressant sur ce point d’approfondir le motif de la femme savante respectable par sa discrétion : ainsi, chez Saint-Simon, qui admire sincèrement et avec un enthousiasme qui perce le papier des femmes de savoir comme Mme de Castries ou Mme Dacier, un des éléments topiques de l’éloge est que ces femmes dissimulent délicatement leur science et semblent ne rien savoir d’autre que « parler français », bref que le ridicule est évité par l’effacement pur et simple de la « pantomime » savante et la discrétion du savoir au féminin. Ces représentations plus ou moins subtilement méprisantes ou condescendantes culminent dans la pensée profondément misogyne de Rousseau, qui voit dans le féminin un danger pour une communauté idéalement masculine de la vertu, de la pensée et du savoir et interdit complètement à la femme toute pensée conceptuelle en l’enfermant dans les domaines du savoir pratique et de la sensibilité : c’est la « saisissante formule », comme le dit Fl. Lotterie (p. 57) de l’homme qui « dit ce qu’il sait » et de la femme qui « dit ce qui plaît ». On pourrait ici articuler les travaux de Christine Hammann à ceux de Fl. Lotterie, car « déplaire au public », si c’est bien ce qu’a assumé Rousseau, c’est rejeter la séduction propre au féminin dans cet imaginaire des sexes et sortir de la culture de la sociabilité marquée par un dialogue apparemment relativement équilibré et serein des sexes, pour affirmer de manière particulièrement crispée la dimension exclusivement masculine, virile de la vérité. C’est aussi, dans la tradition rhétorique qui distingue docere, movere et placere, abandonner le dernier terme au féminin, et faire du premier, du moins dans ses incarnations sérieuses, un domaine exclusivement « viril ». J’ai moi-même étudié à propos de plusieurs auteurs d’Ancien Régime ces fantasmes d’articulation entre virilité et vérité, liés de manière profonde à l’association symétrique et obsessionnelle du féminin et du faux, notamment dans un article sur Monluc : quand on lit Fl. Lotterie, il saute aux yeux que, sur ce point qui est loin d’être un détail, le plus grand penseur du xviiiesiècle n’est pas plus avancé que le vieux et pathétique capitaine à la misogynie caricaturale et tourmentée qui a écrit, deux siècles auparavant, les Commentaires.
3Cette question de la réduction de la femme à des postures de séduction laissant aux hommes la totalité du territoire de la pensée sérieuse est posée de manière particulièrement intéressante par le cartésianisme et ses héritiers immédiats des premières Lumières : le cogito semble pouvoir de manière asexuée, comme le futur sujet d’énonciation de Benveniste, s’actualiser indifféremment dans une pensée au féminin ou au masculin. Et un des héritiers de Descartes qui suscite depuis quelques années le plus d’intérêt, Poulain de La Barre, semble effectivement exprimer un possible particulièrement courageux et même aventureux de la pensée cartésienne en matière de distribution des rôles sexués : les pages que Fl. Lotterie, prudente mais, on le sent, chaleureuse, consacre à cet écrivain, rendent perceptible ce que possède à la fois de fondateur et de fragile une première authentique pensée de l’égalité des sexes, remontant à une origine mythique parfaitement égalitaire et tentant de comprendre la genèse de la domination historique du masculin. Malgré tout, le plus célèbre des cartésiens des premières Lumières réduit cette égalité à un subtil simulacre : dans ses célèbres Entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle intègre bien la femme à un des premiers grands dialogues philosophiques des Lumières, mais plutôt comme destinataire du discours du philosophe que comme productrice de savoir et de pensée. La femme oblige le discours du philosophe à se parer de séduction, à se sociabiliser, à s’arracher à l’austérité de la scolastique aux formes les plus arides et purement conceptuelles de la philosophie, elle amène la philosophie à se parer d’atours langagiers plaisants et à s’approprier la culture de l’esprit mondain qui domine les élites masculines et féminines de la période, et, si l’on se réfère à l’imaginaire du temps, elle suscite donc de manière dialogique une féminisation formelle du discours philosophique. Mais cette « féminisation » ne fait que subtilement confirmer que le véritable détenteur du savoir et de la pensée, c’est l’homme. Comme le montre aussi le traitement par la postérité de la correspondance entre Descartes et Élisabeth de Bohême, la femme est figée par le cartésianisme des premières Lumières dans une posture d’élève qu’il faut conquérir en rendant la philosophie « aimable » : elle est un levier pour que la philosophie touche un vaste public, sorte des écoles, et gagne en pouvoir de rayonnement social. Mais, et je cite ici Fl. Lotterie (p. 79), ce n’en est pas moins « [...] au philosophe mâle que reste dévolue la maîtrise de ce processus : c’est lui qui produit la philosophie et c’est lui qui orchestre, en tant que producteur, les conditions de sa circulation dans le dialogue fictif ». J’ajouterai que ce qui est vrai pour la philosophie l’est également pour l’histoire, autre domaine traditionnellement réservé aux hommes sous l’Ancien Régime : on connaît le cliché sexué qui fait des femmes des lectrices de romans et des hommes des lecteurs de cette discipline « virile » qu’est prétendument l’histoire. En écrivant l’histoire pour un destinataire féminin, le cardinal de Retz « féminise » le discours historiographique comme Fontenelle « féminise » le discours philosophique, et cela va avec une entreprise délibérée de séduction, où l’homme est à la fois celui qui sait et qui séduit, et la femme celle qui « reçoit l’offrande » tout en ayant le tact de ne rien produire. Les choses auront tout de même considérablement bougé avec Voltaire : alors qu’il écrit lui aussi l’histoire pour une femme du point de vue de la « scénographie » de son discours avec un Essai sur les mœurs officiellement adressé à Émilie du Châtelet, on observe que la destinataire féminine n’est plus le prétexte à un badinage séducteur de l’historien, et apparaît tout au contraire comme imposant à l’auteur une sorte d’ascèse historiographique, avec un interdit implicite sur toute séduction langagière oiseuse, et même une contrainte de réduction à l’essentiel imposée par l’esprit scientifique de celle — la célébrissime destinataire — qui ne se gêne pas le moins du monde pour penser et pour produire effectivement.
4Le roman-Mémoires, clé de voûte de la production fictionnelle « à la première personne » qui participe de manière essentielle à la création du sujet moderne et qui donne si souvent la parole à des femmes dans des créations aussi brillantes que La Vie de Marianne de Marivaux, cette année au programme de l’Agrégation, ou le chef-d’œuvre de Daniel Defoe Moll Flanders, est-il un lieu d’émergence plus convaincant d’une figure de la femme philosophe envisagée sérieusement ? Dans la Vie de Marianne, le refrain des excuses de l’énonciatrice quant aux digressions sur des sujets moraux ou sociaux qui émaillent son récit et la proclamation du statut de « femme qui pense » de la narratrice attirent particulièrement l’attention sur un possible « féminisme » de l’écrivain, et Fl. Lotterie traque d’ailleurs dans le célèbre portrait de Mme Dorsin les signes d’échos possibles de la pensée de Poulain de La Barre dans l’œuvre de Marivaux. Malgré tout, l’analyse très fine qu’elle propose de la mise en scène par le romancier de cette voix féminine montre qu’elle cristallise bien des éléments traditionnels du discours sur la femme, sa « philosophie », si elle en a une, étant sous le signe de la coquetterie, du vagabondage, de l’improvisation, du caprice, de l’instabilité et au fond d’une absence structurelle d’ambition et de sérieux. Il s’agit davantage d’utiliser une voix féminine pour dénigrer les formes habituelles, rigides et pesamment logiques, de la philosophie « masculine », travail déjà entamé par le Marivaux des Journaux, que de créer une figure de femme véritablement « philosophe », et ces limites se retrouvent avec des variantes dans d’autres œuvres moins connues de la période. En fin de compte, la Vie de Marianne n’est peut-être pas d’un féminisme plus profond que La Colonie, où les femmes, après avoir pris le pouvoir à titre expérimental, finissent par retrouver le « droit chemin » de la soumission en réinvestissant leurs rôles traditionnels.
5Voltaire offre à Fl. Lotterie un cas plus complexe encore de représentation du féminin par la reconnaissance incontestable à laquelle il a participé de la figure de la femme philosophe, non comme topos ridicule, mais comme réalité sérieuse et incarnée socialement dans des figures aussi exceptionnelles que Mme du Châtelet et Mme du Deffand : même si Mme du Châtelet fut, de manière on le sait fort tourmentée et instable, la maîtresse de Voltaire, ces deux femmes attirent l’attention sur la possibilité pour l’amitié entre hommes et femmes — lien qui n’a rien d’évident sous l’Ancien Régime (et qui aujourd’hui encore n’est pas évident pour tout le monde) — de fonctionner comme le lieu de création d’une égalité qui n’est pas un modèle théorique mais une réalité vécue : particulièrement significative est la juste méfiance de Voltaire quant à la place des « lieux communs de la galanterie » dans l’articulation entre femme et philosophie, même s’il en joue parfois dans un badinage qui n’est nullement le terminus de sa pensée sur la question. L’admiration profonde et évidente de Voltaire pour Mme du Châtelet passe cependant par une masculinisation obstinée de sa figure (c’est le « grand homme qui portait des jupes » d’une lettre de 1749 à Frédéric II). Pour Voltaire, la femme a donc toute sa place dans le combat des Lumières, et joue jeu égal avec les hommes pour combattre l’Infâme, mais c’est parfois au prix d’une sorte de déni de féminité (qui d’une certaine manière est aussi un refus de confondre la femme avec ce qui fonde culturellement les représentations topiques du « féminin » : tout cela est vraiment compliqué, et Voltaire est au moins à mille lieues de toute représentation carnavalesque de la femme philosophe : nul n’a lutté plus que lui contre cette image méprisante et méprisable). Voltaire est donc aussi féministe qu’il peut l’être, retrouvant occasionnellement le sentiment quasi inconscient d’une supériorité masculine malgré tout, et trébuchant parfois dans son parcours du combattant pré-féministe. On se permettra de signaler ici un texte saisissant de 1765 sur le rapport de Voltaire à la féminité, « Les ignorances », inclus alors dans un volume de Mélanges, qui suggère dans sa violence inouïe une peur en réalité très profonde du féminin.
6Chez Diderot, auquel Fl. Lotterie consacre un chapitre lumineux, le rapprochement asymptotique de la pensée avec une véritable reconnaissance de la figure de la femme philosophe paraît plus vertigineux encore, le « reste » de sentiment de supériorité masculin qui n’en existe peut-être pas moins étant d’autant plus troublant et difficile à saisir. Dans les Bijoux indiscrets, qui sont l’objet d’une analyse très fine, le motif carnavalesque de la femme philosophe est retourné en son contraire :
On n’est pas ici dans le ridicule de la « femme docteur » mais dans la carnavalisation du docteur par la femme — ainsi que de toutes les autorités du royaume, politique et religieuse. (p. 121)
7La femme est le vecteur d’une déconstruction du pouvoir et de l’autorité. Dans les dialogues où des femmes figurent comme personnages essentiels, comme Le Rêve de d’Alembert et l’Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de ***, le modèle fontenellien est en partie dépassé du fait notamment de l’absence — notable aussi dans le Neveu de Rameau entre les deux personnages masculins — de relation de hiérarchisation de la parole féminine et de la parole masculine dans les dialogues et du rejet du modèle didactique du dialogue platonicien, du fait aussi et surtout d’un matérialisme assumé dont une des conséquences est la remise en question radicale de l’opposition binaire des sexes, qu’on retrouvera avec Sade plus loin dans l’ouvrage de Fl. Lotterie. La voix féminine est d’ailleurs chargée dans Le Rêve de d’Alembert de la réflexion cruciale sur l’hermaphrodite, et le dialogue met en scène ce que Fl. Lotterie appelle le « portrait original d’une femme “esprit fort” », et d’« une philosophe athée ». La pensée matérialiste athée semble donc plus qu’aucune autre être le cadre philosophique possible de la reconnaissance accomplie de la femme philosophe, dont Sade produira bientôt une figure plus complète et plus énergique encore : il serait intéressant d’aller voir en amont, du côté de Meslier et de La Mettrie (d’ailleurs cité par Fl. Lotterie), ce qu’il en est chez eux de la femme, et de la femme philosophe.
8Dans la seconde partie de son livre, Fl. Lotterie explore l’imaginaire de la femme philosophe dans les fictions narratives de l’époque des Lumières, un premier chapitre observant plus exactement la place donnée à la femme dans des romans dont les personnages principaux sont des hommes plus ou moins « philosophes ». Dans le cas de Cleveland, le rapport d’un narrateur « indigne de confiance » (au sens de Booth) à la philosophie et aux femmes est des plus ambigus : élevé par une femme qui n’a pas su être mère du fait de trop se croire philosophe, Cleveland, fils bâtard de Cromwell, est un mélancolique plaisamment décrit par Fl. Lotterie (pastichant Racine) comme « tout entier à la proie de l’esprit de sérieux attaché ». Dans l’univers de ce narrateur d’exception, un des plus profonds et fascinants de tout le genre du roman-Mémoires au xviiie siècle, la femme apparaît comme une menace pour le sérieux du philosophe masculin et est brutalement « exclue du seul monde qui ait de la valeur — celui, précisément, de la philosophie ». Le roman met donc en scène, mais avec un degré de complicité de l’auteur difficile à évaluer, un énonciateur masculin protégeant autant que possible le monde de sa « philosophie » de tout envahissement par les femmes. Dans Thérèse philosophe, le titre s’avère en partie un leurre, et la découverte jubilatoire de son corps par la narratrice n’empêche pas que dans son parcours ce sont les hommes qui tiennent un discours philosophique et assurent son éducation, dans une réactualisation libertine du modèle de Fontenelle : Fl. Lotterie refuse donc avec raison de voir dans cette admirable autobiographie érotique fictive un ouvrage d’inspiration féministe. La Julie de Rousseau malgré toute sa sublimité est encore plus soigneusement écartée que les personnages féminins des œuvres précédentes de toute philosophie. Même si certaines « lettres-dissertations » du roman lui sont attribuées, le roman l’amène progressivement à coïncider avec les fonctions sociales de la femme que Rousseau décrira dans l’Émile et à être « femme et mère », en bonne maîtresse de maison et éducatrice de ses enfants. Le culte qui l’entoure est celui d’une femme « selon le cœur de Rousseau », c’est-à-dire, on l’a compris, tout sauf philosophe. Les représentations de la Nouvelle Héloïse ne sont donc pas en contradiction avec la rigide répartition des rôles sexués dans l’Émile. Le roman-mémoires de Prévost, les Mémoires fictifs libertins de Thérèse et le grand roman épistolaire de Rousseau, sur des bases philosophiques pourtant on ne peut plus différentes, se rejoignent donc dans l’exclusion manifeste de la femme de la sphère de la philosophie.
9Dans un tel contexte, on ne pouvait qu’attendre avec impatience la lecture par Fl. Lotterie du tourbillon polyphonique fascinant des Lettres persanes où la femme a, on le sait, par la voix de Roxane, le dernier mot — et ce, d’autant plus que l’« espèce de roman » de Montesquieu a été tout aussi bien l’objet de lectures féministes mettant à distance le despotisme viril d’Usbek que de lectures plus prudentes, tant il est vrai aussi que la femme, et plus spécialement la femme française, est un objet de satire constant dans les Lettres persanes. Enfin, l’attitude de Montesquieu atteint un sommet d’ambigüité dans la lettre comique où une femme russe se plaint de ne pas être suffisamment battue par son mari. Mais revenons à l’analyse de Fl. Lotterie : elle se concentre d’abord sur le personnage peu remarqué jusqu’à un article récent de J.-P. Schneider, de Zélis, celle des favorites d’Usbek qui entretient avec lui la correspondance la plus profonde et la plus pensée, celle qui manifeste le plus de lucidité sur la question de la sexualité, sur celle du pouvoir, et sur leurs liens, celle qui, dans une lettre sur la question de l’éducation, parle en philosophe avec un degré d’acuité qui l’égale momentanément aux personnages-philosophes masculins du roman, y compris Usbek, alors que Roxane reste, au moins apparemment, et comme l’a brillamment montré Catherine Ramond, cantonnée dans le style du pastiche racinien. La femme est subtilement décrite comme la proie d’un despotisme masculin qui nie la nature et le désir, installe le sérail dans un temps immobile où toute éducation est en réalité impossible, et prétend imposer sa loi monstrueuse à la réalité des corps. Ce discours « philosophique » féminin de Zélis est donc la trace forcément résiduelle d’un monde qui a rendu par principe l’accès de la femme à la philosophie radicalement impossible, idée résumée par Fl. Lotterie dans la formule percutante de « complexe de Zélis ». Tout cela peut-être pensé à partir de la lecture du roman de Montesquieu, mais si l’on se demande ce que pense Montesquieu lui-même, les choses redeviennent assez troubles. Je serai un peu plus rapide sur des pages pleines d’humour que Fl. Lotterie consacre juste après à Diderot et à son rapport à sa fille Angélique, en le montrant tiraillé entre sa modernité de père philosophe matérialiste soucieux de faire échapper sa fille aux normes de l’éducation féminine du temps et un fond de conformisme bourgeois qui semble malgré tout veiller à ce que la belle Angélique reste dans le moule. Je passerai aussi rapidement, ce compte-rendu ne pouvant être aussi long que le livre de Fl. Lotterie, sur l’analyse qu’elle propose d’un des chefs-d’œuvre essentiels de Prévost, l’Histoire d’une grecque moderne, lu comme la mise en scène ironique d’un échec du masculin à dominer une femme qui lui échappe de fait aussi bien sur le plan des idées que sur le plan sexuel. À propos de la Religieuse de Diderot, qui est aussi mentionnée dans ces parages, il aurait été intéressant de revenir sur la question souvent abordée par la critique de la responsabilité de la narratrice dans les dissertations philosophiques qui lui sont plus ou moins attribuées, avec quelques accrocs qui intriguent, remarqués notamment par Christophe Martin dans son étude du roman: Diderot semble avoir hésité à prêter à son personnage féminin un discours philosophique, ce qui suscite de bizarres contradictions énonciatives. Passons encore sur de belles pages sur Rétif pour en arriver à la mise en scène par le roman et plus généralement la littérature du xviiie siècle de voix féminines plus libres, et s’affirmant de manière plus complète et plus radicale comme femmes et comme philosophes. Dans le dernier chapitre de cette seconde partie et dans toute la troisième, deux voix vont dominer la réflexion, et apparaître comme des points d’aboutissement historique de la pensée de Fl. Lotterie et du parcours de surplomb en regard d’aigle qu’elle nous propose : celle de Germaine de Staël et celle du marquis de Sade. Je cesserai ici de prendre le livre dans l’ordre pour dire ce qui m’est apparu comme le plus important sur ces deux écrivains majeurs de l’articulation des xviiieet xixesiècles.
10Commençons donc par Mme de Staël, qui est à la fête, de manière parfaitement justifiée, en héroïne de la féminité, dans la dernière partie de cet ouvrage, au risque d’apparaître comme une sorte de happy end d’un voyage dans l’image de la femme philosophe au xviiiesiècle qui a pu se lire jusque là comme une immense déception : c’est surtout son face-à-face avec Mme de Genlis, et, à travers leurs figures, le combat entre deux conceptions de la femme et de son rapport à la pensée et au savoir, qui attirent l’attention de Fl. Lotterie. Mme de Genlis, de manière paradoxale puisqu’elle est un écrivain, et un auteur célèbre, assume tous les clichés que nous avons passés en revue dans ce compte-rendu en se donnant pour l’ennemie d’une dépravation du féminin liée à son égarement dans des fonctions qui ne lui conviennent pas. La femme philosophe et la femme auteur sont ses cibles, et Mme de Staël, concentrant idéalement l’ambition intellectuelle et créatrice de la femme, devient pour elle une sorte de bête noire, dans une réduction systématique de la modernité héroïque de l’auteur de Delphine à un immoralisme aux relents libertins. En contraste avec la défense frénétique par Mme de Genlis de l’image traditionnelle de la femme, Mme de Staël confère au modèle d’une femme philosophe une espèce de dignité sublime aussi bien dans les personnages de fiction de ses romans que dans sa propre existence historique.
11Venons-en à Sade, qui présente un cas pour le moins beaucoup plus ambigu de célébration du féminin, et nous retiendra plus longuement : Fl. Lotterie s’intéresse d’abord à la figure de Léonore dans Aline et Valcour, doublement valorisée par le contraste qu’elle offre avec sa pleurnicharde et vertueuse sœur Aline et avec son amant Sainville dont le récit, symétrique du sien, paraît moins flamboyant et moins marquant sur le plan précisément philosophique, Léonore apparaissant beaucoup plus nettement comme un esprit fort, maître de son destin et affranchi de tous les carcans de la condition féminine et de la morale, de la religion et de la famille. Son autobiographie fictive est incontestablement le moment le plus fort de ce vaste roman très inégal et coïncide idéalement avec la sublimation d’une figure de femme qui ne cesse de s’affirmer, comme femme et comme philosophe, en tant qu’esprit libre, c’est-à-dire aussi, dans une logique sadienne aisément repérable même si ce roman fait partie de ce que Michel Delon appelle la partie exotérique de l’œuvre de Sade, comme esprit tourné vers le mal. Ensuite, c’est naturellement à l’autre grande narratrice libertine de Sade, dont Léonore n’est d’ailleurs que la pâle préfiguration de même qu’Isabelle de Bavière n’en sera beaucoup plus tard que la copie frelatée, je pense évidemment à Juliette, que s’intéresse Fl. Lotterie : elle montre d’abord que Juliette est le résultat d’une éducation libertine et philosophique qui se fait, dans la fiction sadienne, de femme en femme, les principaux « formateurs » de Juliette étant des figures féminines : il faudrait tout de même nuancer ce constat en rappelant l’importance dans l’itinéraire de Juliette de Noirceuil et de Saint-Fond, qui ne sont pas complètement oubliés dans l’analyse, mais un peu minorés : l’analyse, pour les besoins de sa cause, les évince légèrement et évite aussi un peu trop de rappeler leurs tirades violemment misogynes. Fl. Lotterie exalte ensuite à juste titre la sublime insolence de Juliette attaquant frontalement rois et papes et lâchant une prodigieuse dissertation contre la papauté qui récupère tout un fond voltairien que Sade connaît par cœur, ainsi que les diatribes de Meslier ou de d’Holbach sur le sujet. Ces pages sont, il est vrai, parmi les plus admirables de Sade, qui élèvent Juliette à un rang poétique absolu dans l’ordre de ces « héros dans le mal » dont rêvait en son temps La Rochefoucauld, dans la manière dont elle oblige les Lumières à aller, en quelque sorte, jusqu’au bout d’elles-mêmes. Et Fl. Lotterie est également convaincante en faisant de Juliette l’anti-Julie de Rousseau et de Sade l’auteur de la réponse la plus cinglante et la plus magistrale du Siècle des Lumières finissant à l’auteur de la Nouvelle Héloïse, cette « âme de feu » qu’il admire pourtant, comme en témoigne un éloquent passage de l’Idée sur les romans. Contentons-nous de remarquer pour l’instant que Juliette ne représente cependant pas une « norme » sadienne, que dans la Philosophie dans le boudoir, c’est bien le modèle fontenellien du philosophe masculin déniaisant son élève féminine que nous retrouvons dans un ultime avatar débridé et magnifiquement audacieux, et que dans les différentes version de l’histoire de Justine, la pauvre fille est l’éternelle destinataire de « philosophes » presque tous masculins qui ne réussissent jamais à la faire avancer d’un pouce sur le plan des idées, et d’ailleurs ne s’en soucient guère, trop pressés de l’écraser pour songer à l’éduquer sérieusement. Plus loin, dans la troisième partie du livre de Fl. Lotterie, Juliette devient encore autre chose : contre Cabanis (et contre Rousseau) elle oppose à la différenciation radicale des sexes une image brouillée de l’identité sexuelle, brouillage plus qu’implicitement valorisé par Fl. Lotterie contre la rigidité des rôles sexués du penseur de l’Émile et du romancier de La Nouvelle Héloïse. Ajoutons que Fl. Lotterie sait que la question du rapport de Sade à la femme est compliquée et qu’elle marche sur des œufs, et prend donc autant de précautions que possible dans sa promotion du marquis comme antidote de Rousseau. Insistons enfin sur le fait que l’auteur de ce compte rendu ne se reconnaît nullement dans les attaques parfois insupportables de Michel Onfray contre les lectures féministes de Sade, d’Apollinaire à Gilbert Lely et au-delà, et encore moins dans l’hystérie anti-sadienne de ce philosophe masculin. Malgré tout, un malaise subsiste : ne parlons même pas du Sade en prison qui accable sa femme d’une série presque infinie de lettres certes magnifiques, mais qui sur le plan de la place qu’il réserve à chacun des sexes ne laissent aucun doute sur l’arrogance de sa masculinité et le « naturel » avec lequel il considère son épouse comme un être qui lui est comme naturellement asservi. Mais comment peut-on oublier le discours terrifiant proféré par le duc Blangis au début des 120 Journées de Sodome, adressé aux seules esclaves femmes, et dont les esclaves hommes sont épargnés ? Jamais le mépris de la masculinité pour la féminité n’a été exprimé de manière plus absolue et plus atroce, et même si Sade est un grand maître de l’humour noir, cela n’atténue en rien l’idée qu’il exprime ici un fantasme de domination sans recul qui passe, non par le brouillage des sexes, mais bien par leur séparation radicale, plus radicale et plus disciplinaire encore, en un autre genre, que chez Rousseau. Dans les différentes versions de Justine et même dans Juliette, les discours de mépris absolu pour le féminin qui donnent la nausée sont légion, au point qu’il n’est même pas impossible de soutenir que Sade est l’écrivain masculin le plus atrocement misogyne qui ait jamais existé, ce que fait d’ailleurs Michel Onfray dans son petit pamphlet virulent, clinquant et peu informé. Qui a tort ? Qui a raison ? Juliette est-elle la femme libre encensée par Gilbert Lely et, plus prudemment et de manière moins lyrique, par Fl. Lotterie ? Est‑elle le monstre féminin prétexte qui laisse par ailleurs la haine ou le mépris de Sade pour le féminin se libérer totalement ? La persévérance étonnante de Sade à la fois dans la promotion de figures féminines héroïsées et dotées d’une formidable énergie de pensée et dans l’accablement épouvantable de la féminité en général est un mystère dont l’auteur de ce compte rendu ne prétend pas détenir la clé, et le grand écart de l’œuvre sadienne sur ce point laisse pantois.
***
12Ce livre de Florence Lotterie est absolument essentiel pour les dix-huitièmistes et passionnant pour tous ceux qui prendront la peine de le lire et qui s’intéressent à l’histoire de l’imaginaire européen sur la question des genres. Il témoigne d’une connaissance impressionnante du xviiiesiècle français dans la plupart de ses dimensions. Il pose une question essentielle avec une ténacité et un engagement discret mais réel qui ne retirent jamais rien à la qualité de l’information et à l’éminente dignité scientifique du travail proposé. Irréprochable sur le plan de la rigueur analytique et du surplomb synthétique, on sent à chaque page que ce livre est tout aussi constamment nécessaire à son auteur sur le plan personnel, intellectuel et humain, articulation qui est à mon sens la marque certaine d’un authentique travail de recherche, dans tous les sens du terme. Un des rares regrets qu’on puisse formuler est que l’étude ne soit pas un peu plus longue : on aurait aimé que l’auteur, éprise de densité et préoccupée d’aller toujours à l’essentiel, s’attarde un peu plus sur tel ou tel texte, et varie un peu plus le rythme de la démonstration. On aimerait lire plus souvent des livres qui suscitent de tels reproches.

