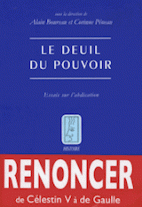
L’abdication, théâtre de la souveraineté
1Les cinq études réunies par Alain Boureau et Corinne Péneau prolongent et commentent le livre que Jacques Le Brun a consacré à l’abdication et publié en 20091. Elles pourraient au reste lui emprunter son titre, Le Pouvoir d’abdiquer, tant l’acte souverain est étudié comme une manifestation éclatante de la souveraineté, au moment où son détenteur s’en dépouille, dans un sacrifice ostentatoire et ritualisé. Ne sont en effet envisagés que des textes et des contextes où le renoncement au pouvoir est volontaire, par opposition aux destitutions imposées par les circonstances. Du Moyen Âge central à l’époque contemporaine, l’abdication permet d’observer « l’état pur de la volonté dans la sphère politique et religieuse » (p. 11). C’était déjà la démonstration magistrale du Pouvoir d’abdiquer. Spécialiste de la littérature mystique de l’âge classique, Jacques Le Brun a, le premier, mis en évidence la souveraineté absolue de la destitution volontaire, au cours d’un long xviie siècle, moment de forte affirmation du pouvoir royal. L’introduction d’A. Boureau et de C. Péneau (p. 11‑19) souligne la dette des contributeurs envers ce livre déjà classique, en particulier dans son analyse de la rencontre entre religion et politique : le modèle par excellence du sacrifice du pouvoir est le Christ de l’Ecce homo, qui renonce à toute gloire, pour aller à la mort dans un corps fragile d’homme. Ainsi, comme dans l’ouvrage de Le Brun, les exemples développés appartiennent à l’Europe chrétienne, et même catholique.
2De prime abord, le volume est un complément d’enquête au Pouvoir d’abdiquer, sur un arc chronologique plus ample. J. Le Brun concluait à la « modernité » de la déchéance volontaire, inspirée de canons antiques et indissociable de la mystique classique. A. Boureau et C. Péneau ajoutent à ce raisonnement le chaînon manquant du Moyen Âge (on y reviendra). Mais, bien plus qu’un élargissement chronologique, le volume propose de déplacer la clé de lecture principale de l’abdication, de la « dévotion » et de l’« abnégation » — les deux maîtres mots de l’analyse de J. Le Brun — à la quintessence de la souveraineté. Le « pouvoir » dont se dépouillent les souverains se colore en effet de manière sensiblement différente que dans l’ouvrage de 2009. Dans la plupart des cas analysés ici, la mystique du service et le don de soi s’accommodent de la stratégie. Or, ce calcul politique ne se limite pas à la personne du prince déchu, selon une acception plate du machiavélisme au pouvoir : il engage la définition de la souveraineté, destinée à lui survivre.
3Quand l’abdication ne semble avoir d’autre horizon que le délitement du corps du souverain destitué et la mort, cette série d’essais montre avec une grande acuité sa perpétuelle tension vers l’avenir du pouvoir, pour soi ou pour un autre désigné comme héritier.
Figures de l’abdication
4Les cinq chapitres du recueil et son épilogue sont des études de cas. Comme le souligne Jacques Le Brun en épilogue, l’examen historique de l’abdication en considère des « figures disparates » (p. 147), dont la liste n’est évidemment par close par l’ouvrage : Célestin V en 1294, la figure du supérieur jésuite moderne, Christine de Suède en 1654, le général de Gaulle en 1946 et en 1969, le roi Lear, et jusqu’au pape du film Habemus Papam de Nanni Moretti, sorti en 2011. Des parallèles sont possibles entre ces personnages, mais chacun est une « figure » rare, exceptionnelle, irréductible à tout autre. On reconnaît le parti adopté par Jacques Le Brun dans le Pouvoir d’abdiquer, qui suppose une attention minutieuse aux circonstances des événements. Il n’existe pas une manière d’abdiquer réglée par le droit, mais des pratiques qui résistent à toute généralisation. Surtout, la « figure » étudiée est autant l’acteur politique que l’effet de discours (commentaires à chaud, chroniques, analyses divergentes), imputables au souverain lui-même, à ses contemporains ou à la postérité. Le souverain qui abdique est d’emblée une figure d’écriture, au même titre que les grandes figures fictionnelles de l’abdication.
5En fonction de leur terrain de prédilection, dans chacun des chapitres du recueil, les auteurs privilégient un type de sources : 1° des sources canoniques, lues par A. Boureau, spécialiste de la scolastique médiévale ; 2° des sources normatives, les Constitutions de la compagnie de Jésus, dans la contribution de Pierre‑Antoine Fabre ; 3° des chroniques, lettres et actes juridiques, étudiés par C. Péneau, spécialiste des pratiques électives médiévales en Suède, 4° les mémoires d’un chef d’État (de Gaulle), lus de près par le philosophe Jean‑Michel Rey, enfin 5° deux œuvres de fiction (une pièce de théâtre et un film), dans l’épilogue de Jacques Le Brun. De la sorte, le recueil prolonge la recherche du Pouvoir d’abdiquer sur l’efflorescence d’écrits autour de l’abdication, et sur la conjonction cruciale entre action politique et écriture dans le renoncement au pouvoir.
Deuil du pouvoir ou triomphe de la souveraineté ?
6L’abdication anéantissant la souveraineté attachée au prince, elle est communément associée à la lassitude du pouvoir et assimilée à une forme de suicide. C’est une tout autre figure du souverain abdicataire qui ressort des études. Dans deux contextes bien différents, Christine de Suède et le général de Gaulle revendiquent résolument l’exercice de la souveraineté absolue en abdiquant. C. Péneau propose une lecture lumineuse de l’abdication de Christine en 1654 (chapitre III, p. 79‑109), dans un article passionnant qui est aussi une merveilleuse démonstration de la fécondité interprétative des cas extraordinaires. L’exemple suédois conforte l’hypothèse, formulée dans Le Pouvoir d’abdiquer, d’un développement conjoint de l’abdication et de l’absolutisme au xviie siècle. L’événement de 1654 est sans précédents : l’histoire médiévale suédoise (dont C. Péneau est spécialiste) est jalonnée de dépositions de rois, mais jamais un souverain n’a renoncé de lui-même au pouvoir. Quand la monarchie élective suédoise conçoit le royaume sans roi, Christine, première femme à gouverner le pays, est le premier souverain à penser le roi sans le royaume. Sans mari ni couronne, celle qui reste reine de Suède après 1654 s’installe à Rome, où elle forme une cour extraterritoriale elle aussi singulière. Extraordinaire, extravagante, même, à rebours de tous les usages, l’abdication de Christine n’a pourtant rien d’une fuite inconsidérée, et C. Péneau insiste sur sa portée majeure pour l’histoire politique de la Suède. La transformation de la monarchie est en effet une condition nécessaire à son renoncement au pouvoir. L’abdication est le dernier acte d’un processus de renforcement de l’autorité royale : une transition historique majeure s’engage sous le règne de Christine, du système contractuel médiéval vers l’absolutisme. Pour abdiquer dans les conditions idéales qu’elle détermine, pour obtenir un statut privilégié de reine sans couronne, défini par l’acte d’abdication, et donner la plénitude de son pouvoir à son cousin Charles Gustave, Christine doit endosser pleinement son rôle de reine, mater l’opposition du Riksdag (Parlement) et du conseil, réduire les courants favorables à une république aristocratique. Elle est à coup sûr une reine seule, singulière, « sans égale », mais bientôt ses successeurs revendiquent sa liberté dans l’exercice même du pouvoir, son affranchissement des règles ordinaires et du consentement des états.
7C’est aussi une conception absolue de la souveraineté qui sous-tend l’abdication du général de Gaulle en 1946, étudiée par J.‑M. Rey dans le chapitre IV (p. 111‑146). Son départ du gouvernement provisoire de la France est le point d’aboutissement des Mémoires de guerre, publiés pour la première fois en 1954, pendant sa « traversée du désert ». La démission de 1946 y est donnée comme totalement volontaire, dissociée des contingences et des luttes politiques du moment. Elle emprunte à la rhétorique de l’abdication, c’est‑à‑dire, selon la logique paradoxale de l’anéantissement volontaire, de la vocation au pouvoir. C’est par le renoncement pur et sans tache de 1946 que de Gaulle affirme dès 1954 son aptitude à regagner le pouvoir. Cette conviction est énoncée dans les Mémoires sans que la source de la souveraineté promise soit désignée : « Dans le chef tenu à l’écart, on continuait de voir une sorte de détenteur désigné de la souveraineté, un recours choisi d’avance » (cité p. 143 — c’est moi qui souligne). La nation pressent sa stature de souverain, passée et à venir, sans être encore parvenue à une conscience nette de sa vocation. Le retour annoncé du général doit avoir lieu dans un avenir plus ou moins proche, par un « appel muet » de la nation, comme en juin 1940. L’interprétation des événements de 1946 dans les Mémoires de guerre doit évidemment jouer en faveur de ce retour providentiel, en plaçant de Gaulle dans la position messianique du sauveur, qui lui a été assignée par le passé, et qui doit lui revenir à nouveau, à la faveur d’une nouvelle crise. Pour ce faire, de Gaulle doit abdiquer, et non démissionner. L’écriture des mémoires tient un rôle crucial dans la démonstration de ce que son départ a été un acte de pure souveraineté.
Renoncer pour avoir plus : du calcul à l’invention politique
8En somme, comme Christine de Suède, le général de Gaulle conçoit et raconte son abdication comme un « nouveau commencement » (p. 141). La reine de Suède échange le pouvoir présent contre un statut privilégié âprement négocié, de Gaulle, « le monde des politiques » contre la dignité solitaire de chef providentiel en devenir. Dans les deux cas, le sacrifice et le dépouillement de toute fonction ou dignité ne se conçoivent pas sans une juste rétribution en retour. On est donc loin du « pur amour » désintéressé, analysé par Jacques Le Brun comme le cœur du dépouillement du pouvoir. L’exemple du roi Lear, présenté parJ. LeBrun en épilogue (p. 147‑164), offre un miroir grossissant aux échanges escomptés par le souverain dans l’abdication. Lear se dépouille de son pouvoir au profit de ses filles, pour savoir qu’il est aimé d’elles, et surtout de sa cadette Cordelia. Cette abdication en trompe-l’œil prétend aussi retenir le nom de roi et l’autorité qui lui est attachée. En réalité, Lear n’abdique pas, parce qu’il n’agit pas en homme public, mais selon un calcul rationnel qui engage ses passions d’homme privé (inceste, colère, vengeance). Cette « abdication mercantile » ouvre une période d’indécision, politique et intime, et fait peu à peu sombrer Lear dans la folie. Seule la mort peut résoudre la situation politique inextricable ouverte par son geste intéressé.
9Mais l’échange qu’opère l’abdication ne s’arrête pas toujours au profit personnel du souverain. C’est sur le plan du devenir du pouvoir qu’il faut lire avec attention la contribution d’A. Boureau (chapitre I, p. 11‑59),consacrée à la réflexion canonique de la fin du xiiie siècle. On a déjà observé, à propos des cas de Christine et du général de Gaulle, que le renoncement a pour enjeu l’invention d’une nouvelle souveraineté. Or, si ces transformations sont le plus souvent lisibles en acte, dans les faits et leur narration — J. Le Brun a souligné la grande réticence des théoriciens politiques modernes à penser l’abdication —, la renonciation de Célestin V en 1294 a été l’occasion de plusieurs démonstrations canoniques majeures. Le rôle trouble tenu par Boniface VIII dans la retraite de son prédécesseur a souvent été mis en avant pour contester la légitimité de cette retraite, dès le manifeste de Lunghezza, rédigé à l’instigation des Colonna, ennemis du nouveau pape Caetani : s’agit-il d’un acte libre de volonté ou d’une destitution déguisée, ourdie par Boniface ?
10Au‑delà des graves conflits suscités par l’interprétation des faits, deux défenses de l’abdication de Célestin, composées par Gilles de Rome et Pierre de Jean Olivi, raisonnent sur le cœur de la difficulté théorique de l’abdication, sa possibilité même : si la production du pouvoir pontifical advient ex opere operato, sans coopération des hommes, comment la destruction de ce pouvoir est‑elle possible par la volonté humaine ? Tel est, comme l’a bien souligné Jacques Le Brun, l’impensé de l’abdication, y compris pour une souveraineté laïque. Pour ce faire, il leur faut distinguer entre, d’une part, la condition sacerdotale, permanente et soustraite à la volonté, en vertu d’un signe sacramentel indélébile (le character), et égale pour tout prêtre, et, d’autre part, les formes multiples du gouvernement, changeantes et vouées à la succession (p. 43‑44). Seule la mobilité des positions, y compris celle de pape, rend possible la « désolidarisation » de la personne et de la fonction (p. 51) : on reconnaît là l’esquisse de la fameuse théorie des deux corps du roi, mise en évidence par Ernst Kantorowicz pour une période plus tardive et dans le domaine laïc2. Or, Gilles de Rome et Pierre de Jean Olivi sont loin de tirer les mêmes conclusions politiques de ces ingrédients théoriques (les deux corps du pape, la mobilité des fonctions) : l’un défend le renforcement du pouvoir pontifical, éventuellement tempéré par le pouvoir collégial des cardinaux, le second est le tenant d’une Église irréductible à l’institution, lieu du rassemblement des volontés. Précisément, l’abdication permet cette ouverture théorique et politique. Les textes ne sont pas réductibles à des options politiques tranchées : « Rien de tout cela ne conduit à une évolution nécessaire, dans un sens ni dans l’autre ; ce sont simplement des possibles qui se construisaient » (p. 56).
11L’abdication de Célestin V n’est donc pas seulement la lutte de pouvoir à laquelle on la réduit le plus souvent. Laboratoire de la théorie des deux corps du roi, les écrits des canonistes élargissent la portée de la crise de 1294 à une réflexion sur la mobilité et la nouveauté dans le gouvernement de l’Église : condamnable si profane et irréligieuse, la novitas est possible, nous dit Olivi, si elle est le déploiement (explicatio) de principes présents « virtuellement » dans l’ancienne loi ou dans l’esprit de Dieu (p. 52). Pour Olivi, qui va plus loin que Gilles de Rome, l’abdication n’est pas seulement le fait d’un pape faible, insuffisant à diriger l’Église, selon l’explication officielle, mais un signe de vigueur de l’Église : « Le Célestin de notre temps a pu nouvellement dérouler et démontrer en acte par une cause rationnelle que le pape peut renoncer à la papauté » (cité p. 53).
Et la « dévotion » ?
12Fil rouge du Pouvoir d’abdiquer, la « dévotion » du souverain démissionnaire tient une place beaucoup plus effacée dans ce collectif, sauf dans l’étude de Pierre‑Antoine Fabre (chapitre II, p. 61‑77). Il n’est pas fortuit que ce chapitre soit le seul du recueil à ne pas porter sur un cas historique d’abdication (pour lequel la pure abnégation du souverain déchu résiste rarement à l’examen des faits), mais sur la définition théorique d’un possible lieu de l’abdication, au sein de la compagnie de Jésus. L’étude de P.‑A. Fabre porte sur le collatéral, défini par les Constitutions jésuites comme un conseiller, adjoint à un supérieur (provincial ou recteur de collège) sans lui devoir obéissance. Sa charge est de l’assister par ses conseils, même quand le supérieur ne lui demande pas, d’agir comme un « ange de paix » entre le supérieur et la communauté dont il a la charge, afin de renforcer l’obéissance et la révérence qui lui sont dues. Bref, Ignace de Loyola a tenu à inscrire dans les Constitutions une institution qui n’en est pas une, et qui soulève une série de contradictions et de tensions. Dissocié de la chaîne hiérarchique, le collatéral n’est pas tenu à l’obéissance. Sa nomination ne revient pas à une entité bien définie. Or, pour renforcer l’ordre suspendu par sa présence, le collatéral doit faire le choix volontaire de la soumission. Inversement, le supérieur doit faire preuve d’une patience angélique pour souffrir la présence d’un individu qui ne lui doit rien et le conseille sans qu’il ait requis son assistance. De fait, la Compagnie préfère limiter les prérogatives du collatéral à des questions spécifiques, ou bien nommer des surintendants, qui sont, eux, tenus à obéir aux supérieurs. Mais peut‑on s’arrêter à ce niveau de lecture, qui oppose théorie et pratique, idéalisme du fondateur et réalité des dissensions entre les hommes ?
13La portée du « collatéral » jésuite s’apprécie sur le plan de la dévotion angélique à laquelle il se réfère, et sur lequel P.‑A. Fabre prolonge la réflexion de J. Le Brun. Ce point des Constitutions appartient, par principe, à un espace utopique. Il imagine deux figures idéales, un supérieur et un collatéral en mesure d’abdiquer tous deux leur pouvoir : obligation d’écouter le conseil pour l’un (à temps et à contre‑temps), adhésion volontaire à la soumission pour le second. Au final, la décision n’appartient à aucun des deux, elle est comme détachée de leur volonté et de leurs passions humaines. Point de rencontre entre deux abdications, la « collatéralité » tend vers la « dévotion sans larmes des anges » (p. 75). En toute rigueur, le collatéral reste une « figure textuelle » (p. 76) : elle est attestée seulement par les difficultés que sa mise en œuvre suscite. Pourtant, l’ordre jésuite a un « non‑lieu » (Certeau) comme soubassement mystérieux, qui est niché dans les arcanes des Constitutions et apporte contradiction à la chaîne hiérarchique régie par l’obéissance : « l’abdication au pouvoir » (p. 76).
Sorties de scène
14Le dernier fil à suivre dans ce beau livre concerne la théâtralité de l’abdication, qui résume les pistes évoquées jusqu’à présent. Le cérémonial minutieux qui accompagne la dépossession n’est pas un artifice destiné dissimuler la réalité du pouvoir aux regards du commun, mais au contraire le lieu d’une révélation de la nature de la souveraineté. C’est ainsi que la destitution de Christine de Suède se déroule comme le rebours exact de la cérémonie de couronnement de 1650, en signe patent de ce que l’abdication rejoue l’acte par lequel elle est devenue reine : l’anéantissement du pouvoir touche de près à sa consécration. Par plusieurs exemples, le recueil montre que le souverain se destitue volontairement, lorsqu’il maîtrise le rôle à la perfection, en endossant alors tous les atours de sa souveraineté. Les scènes d’abdication révèlent le pouvoir parvenu à son point de perfection. À nouveau, la fiction nous permet « d’éprouver [cet] aspect dramatique de l’acte d’abdiquer » (p. 163), analysé par J. Le Brun : le théâtre shakespearien, on l’a dit, mais aussi le film récent de Nanni Moretti, Habemus Papam, où le théâtre tient une place centrale. Le décor du Vatican, la scène grandiose du balcon de Saint-Pierre, la vocation manquée du héros élu pape pour le théâtre, et jusqu’à l’acteur choisi pour l’incarner, Michel Piccoli : tout renvoie dans le film à l’espace scénique. Or, le héros abdique quand il accepte de jouer le rôle du pape, de se présenter avec solennité au balcon de Saint‑Pierre, et non pendant sa fuite éperdue, qui correspond au temps de suspension du film. Incarnant la souveraineté pontificale (la métaphore christique se mêlant à celle du théâtre), il peut enfin abdiquer dans les habits du pape. Une question laissée ouverte par le recueil porte sur la longue persistance de cette incarnation scénique du pouvoir, et sur son progressif délitement. Ne reste‑t‑il pas une part d’abdication dans la démission contemporaine, qui régule la transmission du pouvoir sans plus aucune mystique du pouvoir ? Le cas des abdications du général de Gaulle le suggère, encore qu’une histoire gaullienne se plaise à le représenter comme le dernier souverain à avoir « incarné » l’État.
***
15Enfin, quelle place assigner au public dans ce drame, depuis les représentants des états de Suède en larmes à l’abdication de Christine jusqu’aux fidèles inquiets massés sur la place Saint‑Pierre ? Au nombre des « possibles » de l’abdication, l’attitude de la salle est cruciale. Elle permet de savoir si l’opération est manquée ou réussie, si le peuple ou la nation a vu le spectacle qu’on lui a représenté. En portant rapidement jusqu’à l’actualité immédiate des abdications de Béatrix des Pays‑Bas et de Benoît XVI, en un rare télescopage entre la réflexion spéculative et son contexte d’élaboration, l’ouvrage invite à une telle réflexion, pour les événements directement présents à notre mémoire, qu’il s’agisse des faits de 2013 ou d’abdications un peu plus anciennes : « Ceux d’entre nous qui ont vécu ces événements, ou certains d’entre eux, que peuvent‑ils faire de leurs souvenirs ? » (J.‑M. Rey, p. 146). Un nouveau livre, peut‑être. Les apports majeurs des deux premières livraisons sur l’abdication nous font espérer le lancement d’une telle entreprise.

