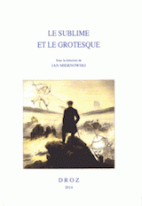
Au‑delà de la « Préface de Cromwell », le sublime & le grotesque de l’Antiquité à Amélie Nothomb
1L’ouvrage collectif dirigé par Jan Miernowski s’intéresse au couple formé par le sublime et le grotesque, deux catégories esthétiques qu’à priori tout sépare et pourtant devenues indissociables depuis que Victor Hugo les a réunies dans sa fameuse « Préface de Cromwell » de 1827 pour définir le drame romantique. L’entreprise aurait pu s’avérer banale, ou tout du moins attendue, si elle s’était tenue au contexte romantique qui est par défaut le sien et que la sobriété affichée par le titre du volume ne semble pas bousculer. Ce n’est pourtant — et heureusement — pas le cas. L’intérêt de l’approche adoptée par J. Miernowski et ses comparses est précisément de faire exploser les cadres en explorant la généalogie de ce couple phare de la littérature occidentale tant en amont qu’en aval de sa consécration hugolienne. Partant, la démarche permet à la fois d’envisager les deux notions dans leur historicité et de considérer les spécificités de leur conjugaison dans des situations données. La réflexion développée dans les onze chapitres qui composent le volume s’étend ainsi du ier siècle jusqu’à nos jours, traverse les domaines français, anglais et allemand, et couvre des champs — outre celui de la littérature — aussi divers que ceux de la philosophie, du ballet de cours et de l’horticulture. Si elle présente l’avantage de la variété, cette vue d’ensemble tout azimut se montre dans le même temps fidèle à l’esprit de la « Préface de Cromwell » où Hugo retraçait l’évolution des genres littéraires dans le temps et dans l’espace, depuis leurs origines jusqu’à la supputation de leur devenir. Cela ne saurait non plus surprendre dans la mesure où c’est précisément le propre du sublime et du grotesque que de se définir par le dépassement des limites établies. Là se trouve en effet le socle commun à ces notions qui trouvent également toutes deux leurs racines dans le premier siècle de notre ère.
Excavation notionnelle
2Comme ne manque pas de le rappeler l’ensemble des contributions avec plus ou moins de détails en fonction des besoins de leur propos, le sublime et le grotesque sont deux catégories esthétiques uniques en leur genre en ce qu’elles présentent l’avantage de permettre de penser ce qui excède la réalité dans des directions diamétralement opposées. Tandis que le sublime désigne ce qui est plus grand que tout et dépasse ainsi la limite par en haut (sub‑limis), le grotesque signale une aberration s’écartant de la norme par en bas. Les deux catégories ne relèvent pas non plus des mêmes domaines. Le sublime est en premier lieu un phénomène rhétorique dont les spécificités ont été détaillées dans un traité rédigé au début du ier siècle après J.‑C. par un auteur grec que la tradition continue à tort d’identifier à Cassius Longin (celui-ci étant « postérieur de deux siècles » (p. 23), comme le note J. Miernowski) et traduit par Nicolas Boileau sous le titre de Traité du sublime en 1674. La notion connut par la suite la postérité et l’évolution que l’on sait, notamment aux mains de Burke, Diderot et Kant qui en firent un processus cognitif élevant l’âme du fait de l’exposition aux dangers naturels tout en en étant protégé, ainsi qu’à leur représentation artistique. Au xxe siècle, la notion fut d’abord réutilisée par la psychanalyse pour forger le concept de sublimation, puis par le postmodernisme (notamment par la voix de Jean‑François Lyotard) qui la rendit capable de présenter l’imprésentable.
3Dans sa contribution qui pose bien les bases théoriques de la discussion, et qui constitue par là logiquement le deuxième chapitre du volume, Baldine Saint Girons, éminente spécialiste du sublime, rappelle ainsi que « le sublime antique appartenait à la sphère du discours poétique et rhétorique, alors que le sublime classique tendait, de la Renaissance à la fin du xviie siècle, à caractériser les arts visuels et les grands phénomènes de la nature » (p. 45). En regard,
4« le grotesque (das Grotesque), lui, n’est pas une catégorie de la rhétorique antique ; et il n’a été reconnu comme catégorie esthétique, distinguée du comique, qu’assez lentement. Il ne se confond pas avec “la grotesque” (die Grotesque), pris comme genre esthétique déterminé à partir de la Renaissance. » (p. 45)
5Le nom grotesque, d’abord orthographié « crotesque » ainsi que le note Michel Magnien dans son chapitre « “Crotesque” et sublime dans Les Essais », fut originellement formé pour désigner les représentations ornant les voûtes de la Domus Aurea que Néron fit construire à Rome dans la seconde moitié du ier siècle après J.‑C. et qui fut redécouverte à la fin du xve siècle. Ces représentations aux traits déliés découvertes dans ce qui se présenta comme une grotte associaient librement les éléments humains, animaliers, naturels et abstraits pour former de surprenantes figures imaginaires. Le grotesque concerne donc d’abord le visuel avant que de s’orienter vers le comique. Il désigne également des représentations qui relèvent par essence de l’impossible, ce qui le rapproche en cela encore du sublime comme le rappelle de manière pertinente Hans Adler dans sa contribution sur « Le Grotesque et le sublime : deux aspects de l’impossible au xviiie siècle » qui pousse l’analyse de Platon à Kafka. Si le grotesque défie la réalité, le sublime permet lui de la transcender.
Enquête sur un couple mieux assorti qu’il n’y paraît
6Les similitudes qui motivent le rapprochement des deux notions sont donc plus nombreuses qu’il n’y paraît. Outre celles précédemment mentionnées, Baldine Saint Girons en recense cinq autres : la difficulté à les définir, leur rapport à la nature leur octroyant un pouvoir de révélation, leur élaboration artistique, leur caractère performatif, et, pour finir, leur capacité à surgir indépendamment l’une de l’autre (p. 48‑50). Ces affinités expliquent que le sublime et le grotesque aient ainsi été associés bien avant que Hugo ne décrète leur complémentarité. Le présent volume choisit d’examiner leur conjonction à différents points de l’histoire culturelle européenne faisant office d’étapes chronologiques dans la généalogie des deux notions. Après un chapitre introductif de J. Miernowski offrant une vue d’ensemble sur l’ouvrage et la question et la contribution de Baldine Saint Girons cadrant la discussion en en considérant les applications d’une part chez Homère et Sophocle (avec les sorts respectifs d’Ulysse et d’Ajax), de l’autre chez Balzac (Le Lys dans la vallée) et Flaubert (Madame Bovary), le jeu de la conjugaison des notions est étudié comme suit : chez Montaigne, où le mot grotesque est pour la première fois utilisé à propos de la littérature et non plus des arts visuels afin de désigner la composition hétéroclite des Essais (Michel Magnien) ; dans l’exubérance des tragédies sanglantes du théâtre du xviie siècle anglais (Christian Biet) ; comme outil politique à propos des fastueux ballets de cours donnés à Versailles dans les premières années du règne de Louis XIV (Michel Jeanneret) ; chez Racine et Chateaubriand afin de reposer la question de la distinction entre baroque, classicisme et romantisme (Richard Goodkin) ; en rapport avec le raisonnement philosophique sur le statut de l’homme et de l’animal dans les textes de Diderot (Anne Vila) ; en relation avec la problématique de l’impossible dans le contexte de l’émergence du romantisme allemand (Hans Adler) ; en dialogue avec les motifs de l’arabesque et de l’escarboucle dans les récits de Hoffmann et Novalis (Dominique Peyrache‑Leborgne) ; pour penser la bêtise et le rapport au savoir avec Flaubert dans Bouvard et Pécuchet (Florence Vatan) ; et, pour finir, afin de débusquer la beauté malgré sa mort annoncée par le siècle dernier grâce aux romans de Céline et d’Amélie Nothomb (J. Miernowski).
7Ce parcours chronologique et thématique a pour intérêt de mettre en évidence la persistance de l’association des deux notions tout comme la variété des problématiques qu’elles permettent d’aborder : artistiques, mais également esthétique, philosophique, ontologique et politique. L’approche comparatiste adoptée par la plupart des contributions, associée à la pluridisciplinarité affichée du volume (philosophie, théâtre, esthétique, danse, musique, architecture, romans, peinture, critique littéraire, science des jardins, etc.), souligne également la variété des domaines culturels et des disciplines pour lesquels l’analyse s’avère utile et pertinente. Ce travail d’enquête mené tant dans le temps et l’espace que dans des champs du savoir variés établit donc que les deux notions étudiées forment un couple à la fois bien mieux assorti et bien plus opérant que leur apparent antagonisme ne pourrait le laisser penser. Cette opérativité est cependant présentée comme un pis‑aller face à la disparition de la beauté que J. Miernowski déplore tant dans son chapitre introductif que dans sa contribution sur le roman moderne sur laquelle s’achève l’étude.
À la recherche de la beauté perdue
8Le postulat de départ justifiant l’analyse proposée dans le volume est en effet la mort du beau que le siècle dernier, « après avoir hautement proclamé la mort de Dieu et celle de l’homme », aurait « oublié de mentionner » (p. 9), ainsi que l’écrit J. Miernowski dans les premières lignes de son chapitre introductif. Le beau n’étant plus, il conviendrait alors de « prospecter l’obscurité caverneuse et dévisager l’éblouissement lumineux, surtout lorsque ces fulgurations d’ombre et de lumière s’entrepénètrent et se superposent » (p. 9) afin de retrouver un peu de cette beauté disparue. Convenant toutefois que « ces impressions proviennent des confins opposés de la beauté » (p. 10), qu’il s’agisse des « grimaces ridicules et troublantes du grotesque » ou du « ravissement fulgurant du sublime » (p. 10), le directeur du volume assigne cependant à celui‑ci comme mission de chercher à savoir ce qu’il advient « lorsque les termes de cette alternative se confondent, lorsque les extrêmes opposés se rejoignent, bref, lorsque le sublime et le grotesque se rencontrent » (p. 10). À la question de savoir si cela constituerait « un moyen de retrouver la trace du beau », il « hésite à l’affirmer » mais espère tout de même que la « quête esthétique » proposée au lecteur « aide à retrouver la beauté, même si celle‑ci doit être recherchée au‑delà de ses limites » (p. 10). La logique du propos est ici quelque peu retorse : si le beau n’est plus, pourquoi allez le chercher au‑delà de lui‑même, autrement dit là où il n’est pas, et non pas là où il fut et où l’on est donc certain de le trouver ? C’est dans cette tournure du raisonnement que se trouve l’aspect le moins convaincant de l’ouvrage dont la richesse et la diversité auraient mérité d’être mieux présentées. Les raisons ayant présidé au choix des œuvres et des auteurs qui font l’objet de l’analyse, si ceux‑ci ne manquent pas de constituer des exemples intéressants pour traiter de cette question, auraient également gagné à être rendues plus explicites afin de mieux faire apparaître tant la cohérence que la pertinence d’une telle sélection. Malgré ces réserves d’ensemble, ce volume porte un regard à la fois novateur et éclairant sur une problématique qui a trop longtemps souffert de rester cantonnée au seul domaine du drame romantique alors qu’elle permet de mieux comprendre certaines contradictions apparentes ou complexités présentées par les arts et la littérature à d’autres moments de l’histoire.

