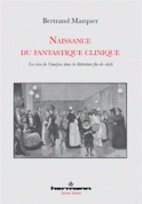
La clinique du fantastique
Savoir voir
1L’ouvrage de Bertrand Marquer propose de faire l’archéologie d’un oxymoron littéraire : le fantastique clinique. Comment l’indécision vertigineuse, que suscite cet entremêlement du réel et du surnaturel propre au fantastique1, peut-elle se nouer à une observation aguerrie des faits liée à la clinique médicale, dont Michel Foucault a raconté la naissance au tournant des xviiie siècle et xixe siècles2 ? Si un tel monstre a pu naître dans la littérature fin-de-siècle, c’est que la clinique a fourni une nouvelle structure optique à un genre fantastique issu d’Edgar Poe, qui se sépare alors définitivement des romantiques — de Nodier ou Gautier.
2La clinique propose en effet une manière de regarder le monde qui, au début du xixe siècle, est synonyme d’accroissement des connaissances. En médecine, la pratique prend alors le pas sur la théorie que privilégiait encore l’approche nosologique du xviiie siècle : c’est dans l’expérience que s’accumule désormais un savoir positif, par-delà les nomenclatures auparavant figées. Le modèle d’une clinique déchiffrant le monde est repris par Balzac, Flaubert, Goncourt ou encore Zola : l’observation s’institue ainsi à la fois comme « métaphore de l’art du romancier et vecteur du savoir à l’œuvre » (p. 9), proposant un regard dont l’acuité pénétrerait les mystères du monde, en restreignant la part d’inconnu.
3Un tel modèle scientifique a pu régir le fantastique dans la seconde moitié du xixe siècle parce que celui-ci s’ancre pour sa part dans un réalisme devenu certes incontournable avec le positivisme ambiant. Les plumes fantastiques n’explorent plus les vacillements ontologiques du surnaturel romantique : elles plongent désormais dans l’encre du continent intérieur, dans ce moi dont on perçoit qu’il est convulsionné sans pour autant réussir à en éclairer l’obscurité. Encouragée par les observations intimes de l’aliéniste Moreau de Tours, la littérature clinique s’attèle en effet à l’exécution d’autopsies du moi : et son narrateur apparaît comme tiraillé entre un « savoir regarder qui le conduit, au sein d’un réel familier, à déceler un spectacle inédit menaçant sa raison, et sa capacité à se regarder penser, gage d’un recul analytique » (p. 20). Le récit, dès lors, narre surtout un cas particulier s’exposant par lui‑même — comme dans le journal du Horla de Maupassant. Le fantastique fin-de-siècle ne porte donc plus sur le monde observé, mais sur l’observateur. Et c’est la clinique qui lui fournit sa structure : son regard pénétrant.
Une clinique littéraire
4L’ouvrage de B. Marquer a le bienfait de proposer, lui aussi, une optique renouvelée sur des textes fantastiques trop souvent banalisés par la critique. Ceux-ci gagnent en effet à être passés au crible d’une clinique littéraire qui, en refusant d’opposer réalisme et fantastique, les envisage au contraire comme émanant ensemble « d’un socle imaginaire dépassant les clivages esthétiques » (p. 9). Le fantastique n’apparaît dès lors plus tant comme un genre littéraire recensé par les manuels scolaires que comme une méthode d’investigation du réel, partageant avec le réalisme un même cadre épistémique. Et si le critique réussit à apporter ce nouvel éclairage sur un fantastique pourtant abondamment commenté, c’est qu’il est sensible à une approche entremêlant littérature et médecine. Mais loin de se contenter de délimiter des thèmes communs ou des emprunts textuels, B. Marquer met à jour l’articulation des deux champs pour montrer comment cette écriture fin-de-siècle, tout en empruntant son modèle à la clinique, le met en péril.
5Car ces œuvres fantastiques ne transmettent pas un savoir sur le moi chancelant qu’elles observent : elles témoignent au contraire d’un vertige intérieur qui demeure irrésolu, même pour le positivisme psychophysiologique. En effet, l’impossibilité de trouver des lésions organiques aux troubles mentaux et la découverte, grâce à l’hypnose, de forces antagonistes intérieures révèlent que le réel psychique, quoiqu’éprouvé, demeure indescriptible :
L’œil fantastique consacre donc dans le même mouvement de dévoilement la victoire d’une méthode (une manière de voir pour faire exister) et la défaite de sa visée épistémologique (l’anatomo-clinique comme moyen d’assigner le réel, et de lui faire rendre raison). (p. 20‑21)
6B. Marquer met en lumière ce désarroi du fantastique clinique, obligé d’explorer le réel tout en reconnaissant son insaisissabilité. Et il en renouvelle l’étude en l’envisageant comme une « forme-sens » irréductible à des thèmes (morbides, décadents, surnaturalistes — même s’ils le sont volontiers) ou à des personnages (médecin, halluciné, névrosé — même si le couple médecin-aliéné est un paradigme privilégié). Son parcours montre d’abord comment les cas cliniques deviennent eux-mêmes des merveilles pathologiques suite à une continuité postulée entre le normal et le pathologique. Puis, il explore le déploiement de la clinique de l’esprit et notamment la figure narrative de l’« halluciné raisonnant », avant de décrire la matérialisation de la métaphore du « regard pénétrant ». Le parcours procède à partir de l’analyse tantôt rapprochée d’extraits de textes, tantôt de motifs récurrents dans la littérature fin-de-siècle, dont sont abordés tant des auteurs canoniques (tels Maupassant ou Villiers de l’Isle-Adam) que des plumes plus méconnues aujourd’hui. Mais la force majeure de la thèse est la précision avec laquelle le savoir médical alimente la compréhension des textes littéraires.
La familière étrangeté
7B. Marquer montre avec justesse comment le principe de Broussais, qui établit une continuité entre le normal et le pathologique, constitue un pilier fondamental du regard fantastique. En effet, il implique que la monstruosité morbide soit en fait déjà là, au plus proche de celui qui se croit sain :
L’extraordinaire n’y prend pas la forme d’une altérité radicale, mais découle du sentiment d’une familiarité inattendue entre l’autre et le même, entre le « cas » et la règle générale, entre l’écart et la norme. (p. 37‑38)
8Le fantastique fin-de-siècle ne consisterait donc pas tant en une hésitation entre naturel et surnaturel, comme l’a théorisé Todorov, qu’en une concomitance entre la norme et l’écart, entre dégoût et attirance vers le morbide — particulièrement incarnée par La Chevelure de Maupassant. Si le fantastique romantique marque l’irruption du surnaturel, c’est désormais le maladif qui prend le relais :
Le trouble n’a donc plus pour fondement une hésitation sur la nature des phénomènes, mais la découverte de leur fondamentale similitude, en vertu d’un principe de continuité. (p. 48)
9Il n’est pas question de découvrir la rupture d’un monde, mais de prendre conscience que normal et pathologique ne s’excluent pas et, qu’étant liés, ils ne sont qu’une affaire de point de vue.
10Le récit de cas fantastique va alors peut-être à l’encontre de la généralité des cas, mais il ne s’oppose pas à la nature envisagée dans sa totalité. En s’ancrant dans le réel, il montre un inconcevable monstrueux qui convertit la chimère romantique en prodige médical et la banalise de ce fait : « Le fantastique traque désormais par la physiologie (l’étude de la nature) un merveilleux devenu clinique » (p. 64). Le fantastique clinique inscrit donc dans le corps ce que le surnaturel cantonnait dans la sphère rassurante d’une altérité de l’au-delà. Désormais, si l’on sait voir, toutes les déviances peuvent surgir du corps, même s’il se croit sain.
11Au troublant principe de Broussais, qui love en nous l’altérité, se noue un autre principe cher à la psychiatrie du xixe siècle : celui de Baillarger, qui attribue le primat à l’involontaire dans les phénomènes d’aliénation. La clinique ouvre ainsi la porte au surgissement du réflexe, de l’automatique, à ce qui demeure fondamentalement obscur dans le corps et pour la conscience qui l’anime. Elle montre que l’homme demeure étranger à soi-même, et que comme le malade n’est pas si éloigné que cela de l’individu sain, l’involontaire altérité peut se réveiller chez tout le monde. Ainsi revient, motivée par la psychiatrie fin-de-siècle, la mythique figure de l’homme double — mais sous un avatar physiologique.
12Car dans la continuité des réflexions sur la pluralité du moi menées par Taine et Ribot, « le double objectivé peut dès lors devenir explicitement l’allégorie d’un dédoublement subjectif » (p. 96). La suggestion, qui passionne la fin-de-siècle, met particulièrement en avant la dépossession possible du sujet, puisqu’elle prouve qu’une volonté étrangère peut le faire agir à son insu — voire le pousser au crime, comme le narrent La Bête humaine de Zola ou Suggestion de Rodenbach. Ces récits jouent alors des « potentialités de la suggestion littéraire : l’acte de lecture semble reproduire le mécanisme de la suggestion décrit dans le récit, et valider par une forme de métalepse le pouvoir de la fiction illustré au niveau diégétique » (p. 107). Le lecteur devient ainsi, lui aussi, victime du pouvoir suggestif des mots. La forme du journal ou de la confession si souvent adoptée par le fantastique fin-de-siècle facilite certainement une telle contagion, puisque l’usage du « je » invite à l’identification. Dès lors, à la suite du personnage, le lecteur découvre que son identité est problématique, et que son sein abrite une inquiétante étrangeté.
13Se dévoile ainsi toute la tension au cœur du fantastique clinique : en effet, la capacité d’analyse requise par le modèle médical aboutit au discernement d’une identité en miettes. En reconnaissant la continuité entre le normal et le pathologique ; en ressentant la prévalence des automatismes involontaires dans le moi, le récit fantastique fin-de-siècle assume à la fois le délire propre à la maladie (objet de la narration), et l’analyse (grâce à un narrateur qui maintient, malgré tout, son récit à la première personne). Et c’est précisément de cette posture oxymorique que surgit le sentiment premier du fantastique clinique : la peur. Celle-ci naît en effet de la fusion de l’état morbide et de son analyse clinique par une seule instance d’énonciation, écartelée de la sorte entre logos et pathos. La figure de « l’halluciné raisonnant », incarnée emblématiquement par le narrateur du Horla, adopte donc tant le point de vue du délirant que celui du clinicien, afin de se regarder penser dans une posture essentiellement dramatique. Tenir le récit ; continuer malgré l’aliénation envahissante à raconter le tiraillement intérieur, est dès lors une question de vie ou de mort. Car cesser de parler, c’est laisser l’autre triompher définitivement en nous.
Autopsies de l’âme
14Le fantastique apparaît ainsi comme une autoscopie, comme une contemplation directe de l’esprit par lui-même — mais une contemplation qui en explore la faille. Loin de sauvegarder une distance morale comme celle que le médecin maintiendrait avec le patient, l’halluciné raisonnant est à la fois victime de soi-même et analyste du combat intérieur. C’est cette confluence paradoxale qui distingue pour le coup clairement les récits fantastiques des naturalistes. Ces derniers conservent un point de vue surplombant, et endossent de ce fait une posture de savoir : ils témoignent d’une maîtrise narrative capable de contrebalancer les désordres exposés. Dans l’écriture fantastique au contraire, personne, pas même le narrateur, n’est garant d’une vérité quelconque.
15L’optique clinique procède ainsi à une auto-psie, à une expérimentation de l’involontaire immanent dont le sujet ne peut ressortir qu’épouvanté. Héritier d’Edgar Poe qui examinait l’âme tel un anatomiste, le fantastique clinique transforme toutefois l’esprit scientifique en un scalpel à double tranchant. En effet, le « démon de l’examen » qui s’empare des personnages retourne l’analyse contre elle-même : loin de demeurer un principe heuristique reculant les limites de la connaissance, elle devient une force de désagrégation. Le résultat obtenu ne met dès lors pas en lumière une vérité psychophysiologique, mais il dévoile la perversité de l’expérimentation : car l’analyse consacre le règne du morbide et convertit le regard clinique en instrument de mort.
16B. Marquer montre en effet comment le fantastique fin-de-siècle réactive la métaphore de l’« anatomie de l’âme » en matérialisant l’idéal d’un regard clinique à la pénétration si aiguë qu’il pourrait lire dans la pensée. Ce fantasme, qui était celui d’Esquirol et de Pinel dans la première psychiatrie, est poussé dans ses derniers retranchements, car c’est du cœur de la folie que le regard devient scalpel et déchiffrement de la pensée. Dans Les Fous de Lermina, l’observation tranchante se littéralise en une trépanation finale où l’expérimentateur est néanmoins sujet de l’expérience : le regard clinique devient ainsi nécromancie. La psychologie expérimentale se pervertit, reconduisant « par l’analyse clinique, un mystère cérébral désormais ramené à sa viscérale matérialité » (p. 169).
17En fait le matérialisme triomphant à la fin du xixe siècle devient matière à fantastique. Le rêve de disséquer la pensée, déjà présent chez Balzac, se réalise dramatiquement aussi dans « Le disséqué » de Jean Richepin, où le personnage s’anatomise vivant avant de se suicider de douleur. La libido sciendi devient ainsi « pulsion de mort », et l’examen — monstruosité (p. 174). Cet idéal d’une anatomie vivante se retrouve également dans l’intérêt alors ravivé pour le débat sur la possible survivance de la conscience après la décapitation, puisque la guillotine semble permettre une dissection de la vie, comme le met en scène Villiers de l’Isle-Adam dans les Contes cruels. Mais les expérimentations menées sur les suppliciés montrent que l’épouvante est en fait passée du côté du savoir :
L’anatomie de l’âme espérée ne révèle, finalement, que la folie d’une ambition clinique portée par un « démon de l’examen » proprement diabolique (le diable est, étymologiquement, « celui qui sépare ») : sous l’action de la guillotine, l’homo duplex se trouve réduit à un corps coupé en deux, ou ramené au dédoublement pathologique du praticien. (p. 196-197)
***
18En définitive, alors que l’optique clinique était auparavant un vecteur positif de savoir, elle devient un cauchemar effroyable dans le fantastique. L’ouvrage de Bertrand Marquer montre ainsi comment la littérature emprunte le modèle médical pour narrer la « crise de l’analyse » qui secoue la fin du xixe siècle : à partir du croisement des principes de Baillarger et de Broussais, la conscience apparaît comme intimement divisée, devenue étrangère à elle-même. De plus, si l’aliénation se réalise dans la figure oxymorique de l’halluciné raisonnant, il n’en demeure pas moins que l’anatomiste est également en proie à l’étrangement, car le corps cartographié demeure toujours inconnu et fragmenté, échappant inlassablement à une saisie totalisante et heuristique. B. Marquer révèle ainsi l’importance du schème de la dissection, métaphorique ou réelle, qui impose toujours la violence de la mise à nu de l’intimité – et son insaisissabilité épistémologique. Naissance du fantastique clinique montre dès lors avec justesse que si cette « forme-sens » s’est intimement inspirée du savoir médical de son époque, elle a néanmoins mis en scène une étrange familiarité et une peur de ce que nous sommes qui, née à la fin du xixe siècle, continue encore à nous étrangler.

