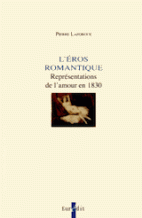
Érotisme, monstres & société : la France de 1830 au prisme de ses marges
1S’appuyant sur le constat que paraît, autour des années 1830, une série de romans et nouvelles mettant en scène des amours « bizarres », l’ouvrage de P. Laforgue cherche à cerner les raisons de cette production qui n’est ni pornographique ni libertine ni inspirée d’un même fait divers ou d’une œuvre maîtresse antérieure. Ces textes, peu nombreux, sont d’une singularité remarquable au regard des normes romanesques de l’époque. Leur portée scandaleuse a pu alors passer inaperçue, mais leur sujet est brûlant d’actualité, renvoyant, de manière plus ou moins évidente, à la société de la fin de la Restauration et de la Monarchie de Juillet par un procédé commun de transposition historique et symbolique. Si les écrivains choisissent alors de représenter des amours impossibles ou perverses, et non le seul et traditionnel adultère, c’est qu’ils y conçoivent le moyen d’interroger la société par ses marges, élevées au rang d’exceptions révélatrices.
2L’ouvrage se compose de deux parties, de longueur inégale. La première, intitulée « Société, imaginaire et symbolique en 1830 », se veut une réflexion générale sur l’érotisme romantique et sa capacité à interroger les mœurs contemporaines. La seconde, appelée « Huit études sur l’éros romantique », s’organise autour de l’analyse successive de textes dont les rapports à l’histoire et à la société sont l’application même des remarques précédentes : Armance de Stendhal, Fragoletta de Latouche, Aloys de Custine, Sarrasine, Une passion dans le désert et La Fille aux yeux d’or de Balzac, Claude Gueux de Hugo et Mademoiselle de Maupin de Gautier ont été retenus.
Le fantasme & la fiction
3P. Laforgue entame la première partie de son ouvrage en rappelant de façon convaincante la portée critique des textes qu’il soumet à étude. Derrière leur récit, ceux-ci visent en réalité une société oscillant entre la fin d’un monde vain, celui d’avant 1789 que d’aucuns se refusent à avouer révolu, et l’avènement d’un autre, celui d’après les Trois Glorieuses qui ne vaut guère mieux parce qu’il est miné par les ravages de l’argent et la course aux intérêts particuliers. À ce titre, la société dépeinte n’existe pas en elle-même, et l’auteur préfère, avec nuance, parler de « socialité » afin de décrire les rapports qui sous-tendent cette société et qui relèvent le plus souvent d’effets de texte. Ici s’opère un revirement : les œuvres analysées présentent finalement moins des exceptions qu’un traitement exemplaire des réalités sociales par la fiction romanesque. Ici surgit aussi la figure du monstre, fantasmé ou mythique, qui permet, par sa singularité scandaleuse et le désordre naturel et social qu’il présuppose, de mettre en cause les travers de la communauté : le rejet de celui qui est jugé fondamentalement autre montre au grand jour l’illusion de ceux qui pensent être unis dans un simulacre de normalité.
4Il ne saurait pour autant s’agir de n’importe quel monstre. Le choix est arrêté sur la créature érotique, c’est-à-dire foncièrement sociale davantage que physiologique ou métaphysique. En outre, même si l’ouvrage recourt ensuite au modèle de Quasimodo, cette créature ne relève en aucun cas d’un exhibitionnisme provocateur ou d’un pittoresque fantasmagorique, mais plutôt d’une monstruosité suggérée, tenue secrète dans la discrétion narrative qui caractérise les textes étudiés : c’est un impuissant, un castrat, un(e) homosexuel(le), un zoophile dont la déviance amoureuse n’est jamais clairement établie. La critique entreprise par leur intermédiaire se veut modérée et même discrète, tant par le jeu des conventions de l’époque que par les visées du récit, et il y a mérite à souligner la part informulable de ce monstrueux quand on ne retient habituellement du romantisme que ses monstres les plus flagrants, au premier chef hugoliens.
5Dans un second chapitre, l’ouvrage de P. Laforgue met en avant les spécificités de l’éros romantique par opposition au libertinage du xviiie siècle. Alors que ce dernier consistait en un jeu entre nobles, pour se perdre, dont l’objectif n’était nullement la remise en cause de la société, l’érotisme romantique au contraire ne prend plus sens par rapport à un groupe restreint d’individus de la même caste, mais par rapport au corps social tout entier. En effet, entre le temps, le Code civil a institutionnalisé pour de bon la séparation de l’amour et du mariage et établit la propriété de l’homme sur la femme, devenant une référence avec laquelle l’éros doit dorénavant composer — se recomposer. En mythe ou une utopie de l’amour absolu se développe alors, qui entend répondre à cette inégalité foncière tandis que, dépassant le seul cadre de la fiction, les écrivains s’appuient sur leurs propres monstres littéraires pour dénoncer la société du passé comme celle du présent. Tel est par exemple le rôle de Sade, déjà plus lu qu’on ne le dit, dont la plume s’oppose justement à celle d’un Laclos frémissant et qui, en tant que figure de l’Autre, sert à remettre radicalement en cause la société comme les normes d’écriture ; tel est encore celui de Sand, l’auteur androgyne, symbole aux yeux d’un Chateaubriand plaisamment réactionnaire, des dévoiements matérialistes de la littérature et d’une société qui a renoncé à toute morale.
6Le troisième chapitre est consacré, pour finir, à l’écriture romantique elle-même et au lien qu’elle instaure entre réalité et fiction. Caractérisée par un usage récurrent de la métaphore et du symbole, l’écriture romantique n’aborde pas le réel directement. La transposition s’effectue par le biais d’une anamorphose littéraire, où l’image est déformée sous le coup de l’écriture romanesque, la réalité textualisée ne coïncidant pas avec le réel, même si elle est décrite suivant une mimèsis. L’essentiel réside ainsi dans la distorsion de l’image, dont naît un mystère certain. Loin d’être simple représentation, l’image signale la limite d’une esthétique du représentable.
7P. Laforgue opère sa démonstration par le détour de deux types d’œuvres faisant office de modèles généralisables : Notre-Dame de Paris et le roman historique. Le livre de Hugo permet en effet de démontrer la matérialité du romantisme, où le symbole, ignorant la médiation du langage avec la pensée, étant lui-même une pensée devenue matière, revêt une importance fondamentale. S’appuyant sur cette conception, P. Laforgue postule que chaque monument architectural est une image immédiate de l’idée. La façade de la cathédrale de Paris est proche du hiéroglyphe et Quasimodo, tout entier corps brut, dont la présentation repose sur un rapport métonymique avec l’édifice qu’il hante, en est l’illustration vivante. Mais au-delà de la figure du bossu sonneur de cloches, P. Laforgue voit ici une tendance générale de l’écriture romanesque de cette époque, où le symbolique pourrait servir de clef de voûte interprétative. En témoigne également le roman historique, dont l’allégorisation de l’histoire repose sur une série de déplacements du passé au présent — ceux-là même des huit œuvres étudiées par P. Laforgue —, faisant en sorte qu’on le lit moins pour son intérêt documentaire sur un siècle qui n’est plus, que pour ce qu’il peut nous apprendre du monde dans lequel on vit. Derrière les Louis XI, Charles IX, Louis XIII et autres se cache en réalité Charles X ; derrière la révolte matée des truands se trouve l’insurrection des révolutionnaires de l’après 1830. Allant même plus loin, du fait d’un écart romanesque omniprésent par rapport à la réalité passée, il est loisible de conclure que pour le romantisme, le roman est le principe d’intelligibilité de l’histoire et de la société puisque le rapport à la réalité n’existe que dans l’ordre du fantasme et de la fiction. Place centrale du symbole dans la poétique romanesque de l’époque, nécessité de la fiction pour traiter avec justesse du réel : telles sont les deux conclusions que P. Laforgue propose d’appliquer aux huit textes dont il a entrepris l’étude.
8Si cette analyse est parfaitement fondée, sans doute peut-on la compléter en précisant que ce mode de lecture est aussi motivé par la simple existence du monstre, composite ou non. Sans forcément remonter à l’étymologie qui fait de lui un avertissement envoyé aux hommes pour déchiffrer les événements présents, on se bornera à rappeler que la tentation a toujours été forte de lier son apparition comme sa nature problématique aux difficultés d’une époque ou d’une nation, autrement dit de faire de son corps individuel le symbole du corps social dont il est précisément exclu. Cela est particulièrement vrai en période de grands troubles, et le cycle révolutionnaire du début du xixe siècle reproduit à ce titre de mêmes réflexes de pensée et de mêmes procédés littéraires que lors des guerres civiles romaines ou des guerres de religion, pour ne prendre que ces exemples1. Le monstre traduit une inquiétude sur la cohésion de la communauté, le refus d’une situation donnée, tous deux présents dans le romantisme. Le fait que le monstre soit érotique et non métaphysique indique seulement des préoccupations plus sociales que religieuses. Le livre de P. Laforgue le montre bien, et ces quelques remarques ne font qu’en proposer un prolongement.
De Stendhal à Gautier : les troubles d’une époque
9On peut certes émettre la réserve que le plan adopté par P. Laforgue dans son ouvrage, soit une analyse théorique suivie d’exemples précis, entraîne nécessairement quelques redites. Néanmoins, les huit textes abordés successivement en deuxième partie permettent un approfondissement et un passage essentiel au concret après les remarques générales.
10Tous ces textes présentent en effet des êtres qualifiables de monstrueux par leur physique ou leur passion — non sans encourir le risque d’une lecture excessive puisque, signe de l’évolution des mentalités, leur déviance amoureuse, commentée aujourd’hui, ne fut pas toujours repérée par les lecteurs d’alors. Quoiqu’il en soit, ces êtres singuliers, si secrets, restent des énigmes à décoder ; ils ont des amours problématiques, d’autant plus problématiques par leur statut de personnage principal ou éponyme du roman, parfois les deux à la fois. On peut en entreprendre le classement selon qu’ils constituent des figures du manque (un impuissant, un castrat), de la confusion (un hermaphrodite, un androgyne), de la déviance (un(e) homosexuel(le), un zoophile, un fiancé secrètement amoureux de la mère de sa promise).
11Ces textes font tous également évoluer l’action en des temps ou des espaces propices à la transposition. Éloignés du pays de 1830, ils n’en sont pas tout à fait coupés pour autant : ils gardent des liens assez forts pour s’y référer implicitement, mais instaurent aussi la distance nécessaire à toute entreprise critique. C’est la France du xviie siècle, de 1799, du Premier Empire, de 1815 ; ce sont des lieux isolés, clos ou non, situés toujours en périphérie de la civilisation, comme la prison de Clairvaux, l’hôtel de San-Réal fermé et dédié au plaisir en plein Paris, le désert africain où s’aventurent les troupes napoléoniennes, un monastère dans les montagnes italiennes, Naples et la République parthénopéenne.
12Tous ces textes, enfin, portent un jugement sur la véritable nature des autres hommes. L’étrange érotisme de leurs personnages permet un dialogue avec l’histoire et la société au sein de la fiction romanesque. Si le monstre vit exclu, son exclusion lui confère un regard lucide sur ses contemporains. S’il vit au contraire en société, s’il en est un des acteurs, il en sape de l’intérieur les fondements en en montrant les contradictions. Dans tous les cas, il met en exergue les travers et les vices répandus dans le monde. Ces textes donc dénoncent tour à tour la duplicité, la violence, la jalousie, la laideur, auxquels ils opposent la noblesse d’âme, la passion, la gratuité, la tendresse, la beauté. Or ils le font selon des modalités qui ne sont jamais les mêmes. Le choix des déviances, la manière dont leur symbolisme véhicule la critique et les conclusions qu’il autorise à établir divergent foncièrement, permettant d’éviter toute monotonie à leur étude. Ainsi, Armance porte l’accent sur la critique de l’aristocratie et sur l’impression diffuse d’un manque généralisé. Personnage mélancolique doublé de misanthropie, Octave de Malivert s’oppose par ses aspirations éthiques aux bassesses de la noblesse à laquelle il appartient et que les ravages de l’argent ont défigurée : le sentiment que la réalité de son milieu souffre d’une vacuité dramatique entraîne chez lui un défaut d’énergie qui se symbolise par une absence érotique — l’impuissance — et le fait se tourner vers le passé d’un lointain ancêtre pour retrouver une grandeur d’âme perdue. À ce défaut d’énergie s’ajoute un défaut de parole, la monstruosité d’Octave étant évidemment passée sous silence.
13Le roman Fragoletta aborde, quant à lui, un des mythes romantiques fondamentaux : celui de l’androgyne. Si ce type de personnage échappe en soi à la nature et à la temporalité humaine, il permet d’interroger le devenir de la société ; personnage esthétique et érotique, il prouve aussi que l’art détient une vérité supérieure sur le réel. Le roman de Latouche apparaît alors comme un lieu privilégié pour éclairer les événements historiques à la lumière de la fiction. Son personnage éponyme, à la présence fragmentée au fil des épisodes, et à la nature sexuelle défiant le sens, semble le plus à même d’interroger l’accumulation de catastrophes qui se produisent entre la Calabre et la France. Même si Fragoletta n’est pas un castrat, la suppression brutale des libertés coïncide avec la mutilation qu’elle semble porter en elle. Ce n’est plus, comme chez Stendhal, la dégradation des valeurs des hommes que le monstre interroge, mais bien l’absence de cohérence de leur destinée collective.
14Ce mythe de l’androgyne, Gautier le fait aussi sien dans Mademoiselle de Maupin, dans une perspective plus philosophique qu’historique, qui le conduit à poser la question du rapport au Beau — question qui relie la célèbre préface au roman, la première se contentant de dénoncer l’utilitarisme de la société tandis que le second étale la difficulté de l’artiste à créer et à atteindre son idéal. D’Albert, qui cherche celui-ci parmi les plus belles femmes, le trouve finalement dans la Maupin. Il atteint alors la contemplation esthétique pure et s’accomplit en tant que poète en même temps qu’il vérifie la rupture que le christianisme a introduite en art par rapport à l’art antique. Quant au castrat, Sarrasine de Balzac offre le récit de son évolution : à la castration physique de la Zambinella, dernier vestige d’une pratique révolue du xviiie siècle, succède celle, métaphorique, d’un artiste empêché d’aimer et plus proche à ce titre de la génération de 1830. L’art érotique se fait encore une fois révélateur : c’est un tableau de jeunesse de la Zambinella en Adonis qui permet de développer l’histoire du castrat et de lever en même temps le voile sur la mystérieuse beauté de ses descendants et leur aisance matérielle.
15D’une tout autre manière, Aloys de Custine possède une forte dimension autobiographique, jusque dans le nom qui en constitue le titre. Toutefois, la fiction modifie profondément les données de la vie de l’auteur, conférant à ses vicissitudes la forme d’une destinée tragique mais cohérente. Si de Custine a bien rompu un mariage des années avant l’écriture de son roman, ce n’était pas en raison d’un quelconque amour pour la mère de sa fiancée, mais à cause de son homosexualité alors divulguée au grand jour. La fiction permet ainsi un travail de libération sur le réel ; elle ne sert pas à cacher la vérité d’un être, mais à mieux la cerner. En imaginant un amour œdipien impossible, de Custine progressait dans la compréhension de son homosexualité, plus loin qu’il n’y serait parvenu par d’autres voies, explique P. Laforgue. La symbolique du labyrinthe cachant le monstre, disséminée à travers le roman, est l’indice de cette lecture à laquelle l’arrière-plan historique donne son épaisseur, en inscrivant le personnage principal dans un temps de catastrophes. L’homosexualité ne sert d’ailleurs pas seulement à établir la vérité, mais aussi à fonder paradoxalement un idéal. Dans Claude Gueux, loin d’être présentée comme une dépravation, elle permet au contraire de mettre en avant un contre-modèle fondé sur l’amour et justifie la pratique de la bonté au sein de la prison de Clairvaux.Ici, l’érotisme sert pleinement la réflexion sur le social. Le partage de l’amour et du pain entre deux voleurs homosexuels devient le symbole d’une communauté rêvée, par-là le cynisme de la société réelle qui tolère et entretient la pauvreté et la violence.
16Les deux textes restants sont encore bien différents. La problématique d’Une passion dans le désert repose principalement sur le cadre géographique de son action : les immensités dépeuplées du désert saharien deviennent le lieu de plénitude et de fixité nécessaire pour interroger la société, qui est quant à elle associée au mouvement continu et excessif. En situant son action en plein Paris, Balzac propose une variante de ce texte dans La Fille aux yeux d’or, où il oppose, cette fois-ci dans le même ouvrage, l’aventure romanesque à la typologie de la société parisienne. La population de la capitale est laide parce qu’agitée seulement par la recherche de l’or et du plaisir. S’il existe en elle quelques rares êtres d’exception qui se préoccupent de beauté, la fiction va évidemment s’en emparer pour formuler sa critique. Paquita, la fille aux yeux d’or, offre en elle une autre vision bien plus noble de la richesse et du plaisir, et c’est dans ses bras seulement que de Marsay prend conscience des dépravations véritables de Paris, débouchant vers une réflexion politique qui va faire du personnage le fin cynique qu’il doit devenir.
***
17Sans doute pourrait‑on trouver d’autres exemples tout aussi révélateurs — on pense bien sûr à Séraphîta de Balzac, publié dans ces mêmes années —, mais, en vérité, ceux-ci suffisent. Loin de tomber dans la répétition, l’ouvrage de Pierre Laforgue montre brillamment que ce que ces œuvres ont en commun — des amours monstrueuses comme expression privilégiée d’une critique sociale — n’exclut nullement la souplesse et la variété de leur traitement. C’est même là ce qui fait la force de la thèse de P. Laforgue, et son ouvrage y trouve assurément sa complétude.

