Existences numériques : vivant, art et technologie
Introduction
1Pour les sciences humaines et sociales, la perception du monde est un problème qui a intéressé particulièrement la phénoménologie. Suivant ce courant, le sujet sensible est en principe un être vivant doté d’un corps et d’un système sensoriel. Ainsi, Edmund Husserl a utilisé la notion de « Lebenswelt » pour faire référence au monde perçu par le corps et ses propriétés sensori-motrices. Pour lui, un être perceptible est délimité par ses capacités sensorielles et, par conséquent, la compréhension du monde naturel correspond à ses possibilités sensibles. Dès lors, bien que l’espèce humaine caractérise typiquement le sujet capable de percevoir, elle est en contact et affecte d’autres entités dans son agir et son existence.
2Dans ce texte, nous nous intéressons aux interactions à différentes échelles entre les espèces. Notre idée est d’adopter une posture pluridisciplinaire afin d’approcher les études en biologie et en informatique des sciences de l’information et de la communication. Cet effort permet d’apprécier, par exemple, la manière dont d’autres espèces vivantes et non-vivantes expérimentent le monde et comment elles sont affectées par les actions humaines. L’importance de cette initiative fait écho non seulement aux préoccupations écologiques qui grandissent depuis que les humains ont conscience de leurs impacts dans le monde et encore plus encore depuis l’avènement de l’anthropocène, mais elle nous offre des pistes pour structurer les interactions multi-espèces et multi-entités.
1. Existences numériques
3La notion d’existence numérique est proposée ici à partir de la théorie sémiotique du parcours génératif de l’expression (Fontanille 2015, 2017). En complément de la pensée phénoménologique évoquée plus haut, la sémiotique permet de situer l’analyse à un niveau large, comme celui des formes de vie, pour penser les attitudes et les expressions symboliques partagées par un ensemble de collectivités, humaines ou non. Sur le plan du contenu, ces agencements renvoient à la considération qu’ils sont porteurs des valeurs et des configurations modales, thématiques, figuratives, narratives et passionnelles. Autrement dit, ils relèvent du « vivre ensemble ». Cela inclut, par exemple, les affirmations d’identité sociale et culturelle. En parallèle, suivant l’optique du plan de l’expression, les formes de vie partagent un trait qui est commun aux existences non-humaines dans le sens où, précisément, elles « existent ensemble ». Que cela soit de nature humaine, animale, végétale, minérale, technologique, ou collective (micro ou macro), les entités peuvent, selon Fontanille, donner forme à des assemblages résultant d’une série de fonctions et de pratiques.
4Dans d’autres études, nous avons déjà associé cette théorie sémiotique à l’univers des objets techniques numériques (Reyes 2017 ; 2019). Nous considérons qu’elle est pertinente pour structurer et analyser les différents niveaux de matérialités et leurs interactions. Ces agencements, par exemple, sont basés principalement sur des supports informatiques et cela se comprend à deux niveaux. En premier lieu, il s’agit du matériel technique qui constitue les circuits électriques, microprocesseurs et périphériques des ordinateurs et des dispositifs informatiques. Deuxièmement, en considérant les dispositifs d’affichage comme sémiotique-objet, nous considérons que les agencements de pixels à l’écran sont les entités qui donnent matière aux images numériques et donnent forme aux interfaces graphiques, aux logiciels et, en général, à tout ce qui est affiché à l’écran. Ainsi, le premier niveau se rapproche du domaine du « hardware » et des champs comme la conception électronique, tandis que le deuxième niveau se saisit comme le domaine du « software » et des champs comme le design d’interface et l’ingénierie logiciel. Nous soulignons que, dans une situation pratique, même si ces deux niveaux peuvent s’étudier de manière séparée, ils agissent ensemble et s’affectent mutuellement.
5Un cas d’existence numérique collective peut s’illustrer avec les agencements des pixels à l’écran. En effet, la disposition originale des pixels est basée sur le modèle d’une grille (ou « raster grid ») à deux dimensions, avec une largeur et une hauteur délimitées. La forme de cette surface est l’état actuel de l’objet-écran, résultat d’une série d’évolutions techniques, sociales et économiques (Cubitt 2014, Reyes 2020). Dans cet univers bidimensionnel les pixels existent ensemble, chacun avec ses propriétés chromatiques et ses variations dynamiques selon le taux de rafraîchissement de l’écran (généralement 60 Hz par seconde). Si l’on imagine une grille monochromatique de 3 x 3 pixels (donc 9 pixels au total), on pourrait dire que n’importe quelle variation de couleurs noirs et blancs affichée serait une manière d’exister ensemble (figure 1).
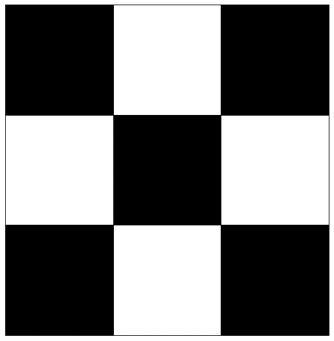
Figure 1. Une grille de 3 x 3 pixels.
© Everardo Reyes, 2022.
6Néanmoins, si l’on ajoute des règles d’interaction à cet assemblage, nous sommes maintenant en mesure de comprendre une réalisation informatique comme le jeu de la vie (« Game of Life »), conçu par le mathématicien John Conway en 1970. Les règles de jeu sont : 1) un pixel affiché en noir représente la vie, ou la valeur 1. 2) Un pixel affiché en blanc serait le vide, ou zéro, ou la mort. 3) Lorsqu’un pixel noir ou blanc se trouve entouré d’une autre couleur sur ses trois côtés, il survit (il y a une reproduction de vie ou une génération de vie). 4) Lorsqu’un pixel a un seul voisin ou, au contraire, plus de quatre, on dit qu’il meurt (dans le sens sous-population ou surpopulation) (figure 2).
Figure 2. Adaptation des règles du Jeu de la vie (1970).
© Everardo Reyes, 2022.
7La pratique qui consiste à concevoir des comportements artificiels dont la manière d’exister ensemble des entités trouve son inspiration dans des procédés biologiques et organiques nous semble une manière de penser ces entités comme une forme de « vivre ensemble »1. Pour évoquer d’un autre exemple, nous faisons référence à un algorithme largement connu en informatique visuelle : le Perlin Noise. Son créateur, le professeur en informatique Ken Perlin, avait introduit en 1983 une méthode efficace pour simuler la texture de surfaces de trois dimensions : de l’eau, du bois, du métal, des pierres, des tissus. Au lieu de créer un objet 3D, cette technique apportait l’avantage d’économiser des ressources informatiques en simulant en objet 3D en forme d’image 2D. Pour générer les textures, Perlin avait pensé à une manière de rendre les valeurs aléatoires de son algorithme plus organiques. Ceci a été accompli grâce à la production de valeurs plus proches entre chaque itération, c’est-à-dire, pour simplifier, au lieu d’afficher 1 ou 0 à chaque changement, il était possible maintenant d’utiliser des valeurs comme 0.07, 0.006, 0.05. Actuellement, la technique de Ken Perlin reste très répandue dans le domaine de l’informatique graphique et sa contribution lui a mérité en 1997 un prix de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences de réalisation technique.
2. Terrains d’exploration
8À part la manifestation des pixels à l’écran, nous avons mentionné plus haut que les assemblages numériques se trouvent aussi au niveau des composants et des matériels informatiques. À ce niveau, les instruments se situent dans un espace physique qui entre en contact avec d’autres entités, naturelles et artificielles. Pour aborder les interactions entre des espèces à différentes échelles, dans cette section nous nous tournons vers une ligne de recherche qui nous fournit des cas riches et exemplaires. Cette ligne débute avec le champ nommé « cybernétique », introduit par le mathématicien américain Norbert Wiener en 1948.
9Fruit de ses collaborations avec le physiologue mexicain Arturo Rosenblueth depuis le milieu des années 1930, Wiener pensait la cybernétique comme un champ qui traite des mécanismes de contrôle au sein de tout type de systèmes, composés des entités similaires, variées et hybrides. Ces mécanismes de contrôle sont compris en termes de relations entre les composants et le type d’énergie et d’information qu’ils échangent. Pour Wiener, un aspect important à prendre en compte dans ce processus était de rendre compte du contexte externe des systèmes, une influence qui vient directement de la physiologie. Afin de mettre en pratique ses théories, en 1949 Wiener avait collaboré avec le professeur en ingénierie électrique Jerome Wiesner au MIT et l’ingénieur H. Singleton pour construire le robot « Palomilla » (qui peut se traduire de l’espagnol comme « papillon de nuit »). Cette machine agissait à la lumière. Lorsque ses photo-senseurs détectaient une source lumineuse, le corps de la palomilla se dirigeait vers la source. Mais lorsqu’il n’y avait plus de stimulus, la machine arrêtait son mouvement. Les idées originales de Wiener ont été de grande influence interdisciplinaire principalement entre les années 1950s et la fin des années 1960s, de l’informatique à la sociologie, en passant par la psychologie, la philosophie et les sciences de la nature. Ensuite, d’autres chercheurs comme Heinz von Foerster ont initié un deuxième ordre de la cybernétique.
10Plus tard, dans les années 1980, un autre domaine est apparu, qu’il nous semble pertinent d’aborder : la vie artificielle. Notion introduite par l’informaticien Christopher Langton lors de l’organisation d’un séminaire en 1989, il a été l’une des premières personnes à s’intéresser à la compréhension du comportement des systèmes naturels par leur synthèse sous forme de média artificiel. En résonance au jeu de la vie de Conway, les défis de la vie artificielle concernaient une interrogation sur l’origine de la vie, sa puissance évolutive et la relation entre la vie, l’esprit et la culture. La manière dont la pensée avait été formalisée est venue, accompagnée, elle aussi, d’une série de réalisations matérielles et techniques. Pour citer quelques travaux précurseurs en vie artificielle, nous avons : le logiciel « The Blind Watchmaker Evolution Simulation » de Richard Dawkins en 1986 ; la simulation du comportement d’un troupeau avec des oiseaux artificiels de Craig Reynolds en 1987 ; le simulateur d’évolution « Tierra » de Thomas S. Ray en 1991 ; les travaux de Karl Sims en images génétiques (1991) et le jeu « SimLife » (1993) ; et, enfin, l’installation interactive d’art informatique « A-Volve » de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau en 1994.
11Dans les années 2000, la notion de « bio art » s’est ajoutée à la notre ligne d’investigation de terrains d’exploration. L’artiste et scientifique Eduardo Kac avait déjà initié la collaboration avec des laboratoires spécialisés pour créer GFP Bunny en 2000, un lapin transgénique qui avait été traité avec des protéines d’espèces fluorescentes. L’intention de Kac, et d’autres artistes proches, était d’orienter l’art contemporain vers la manipulation des processus de la vie. Trois principaux centres intérêt gravitent autour de ces ambitions : 1) la mise en forme des matériaux biologiques dans des formes ou comportements inertes spécifiques ; 2) l’utilisation inhabituelle ou subversive d’outils et de méthodes biotechnologiques ; et, 3) l’invention ou la transformation d’organismes vivants avec ou sans intégration sociale ou environnementale (Kac, 2005). Plus récemment, en 2022, l’artiste, théoricien et ancien directeur du ZKM à Karlsruhe en Allemagne, Peter Weibel, a organisé l’exposition BioMedia afin d’interroger la notion même de bio-média introduite par le philosophe américain Eugene Thacker en 2004. Pour Weibel, au lieu de créer une œuvre d’art en utilisant de la matière bio-organique, les média-bio explorent les possibilités et les comportements organiques des matières non-vivantes, artificielles et numériques (Weibel, 2023).
3. Formes de vie et culture numérique
12Le vivant en relation avec les médias et technologies numériques a donné lieu à des approches théoriques pour comprendre leurs relations et interactions. Dès 1985, la chercheuse Donna Haraway, par exemple, avait introduit le terme « cyborg » pour définir un organisme cybernétique, c’est-à-dire une espèce hybride, composée de matière organique et de machine, dotée d’une réalité sociale et fictionnelle (1991). L’aspect social a toujours été d’un intérêt majeur pour Haraway2 et il est placé au centre des interactions avec d’autres systèmes, naturels et artificiels. Une ligne similaire est suivie par le chercheur Matthew Fuller qui élucidait une « écologie des médias » (2005) pour saisir le réseau émergent et complexe des processus, instruments, acteurs, objets et motifs, mis en relation par les technologies d’information et communication. De cette manière, on voit que les médias sont pensés au-delà leurs propriétés perceptibles ; ils sont aussi des abstractions de forces et de techniques. C’est grâce à cette représentation que le chercheur Jussi Parikka conçoit les insectes comme des travailleurs, constructeurs ou mathématiciens. Il se concentre sur leurs mouvements, leurs actions et leurs modes de perception afin de les traiter comme des médias. Dans le sens inverse, les médias peuvent aussi s’étudier sous l’angle des insectes, de leur comportement, leur anatomie et leurs mythologies, ce qui inclut les notions d’essaim, toiles, métamorphoses et multiplicité (Parikka, 2010).
13Suivant ces propos, nous comprenons ici les existences numériques comme une forme de vie de culture numérique. L’intérêt opératoire de cette démarche consiste à identifier les constituants d’un modèle d’analyse pour aborder la complexité des couches de signification sous-jacentes des objets informatiques. De fait, nous considérons qu’un regard plus minutieux porté sur les sciences informatiques ouvre la voie à une typologie plus fine de formes de vie de la culture numérique. Pour ce faire, le champ qui nous paraît le plus adéquat est celui de systèmes d’information, qui réunit une collection de personnes, procédures et équipements conçus pour supporter quatre tâches essentielles : collecter, stocker, traiter et transmettre de l’information. Dans la littérature technique, il est accepté de dire que ces systèmes existaient bien avant les ordinateurs (Sage, 1968). Réciproquement, ces tâches essentielles n’ont pas été inaperçues par les chercheurs de sciences humaines et sociales. Nous pouvons mentionner que l’idée du sémioticien russe Juri Lotman sur la notion d’information était déjà d’inspiration cybernétique, tout comme la pensée de Gilbert Simondon, Abraham Moles et Bernard Stiegler. Plus directement, le philosophe Michel Serres (2007) avait identifié quatre fonctions communes partagées par les êtres vivants, les objets inanimés et les collectivités : ils sont tous capables de stocker, traiter, émettre et recevoir de l’information. Serres s’alignait aussi sur la théorie mathématique de la communication élaborée en parallèle par Norbert Wiener et Claude Shannon.
14Dans la pratique, nous observons ces quatre fonctions sous forme de configurations au sein des systèmes d’information. Nous y trouvons : 1) les fonctions génériques, qui sont celles, typiquement attendues, des environnements informatiques (sauvegarder, exporter, ouvrir, copier, coller) ; 2) les actions spécialisées, qui essaient de répondre ponctuellement à un ou plusieurs usages (scientifiques, éducatifs, artistiques) ; 3) de nouvelles actions qui émergent une fois que le système est dans le circuit social et qui n’auraient pas été anticipées au départ (hacking, remix, ingénierie inverse) ; 4) la résistance à la pratique numérique, c’est-à-dire ne pas vouloir utiliser un système ni simuler ses actions avec des procédés notamment analogiques. Prises ensemble, ces quatre configurations nous laissent devant les processus d’« accommodation » propres au plan d’immanence des stratégies (Fontanille, 2015). Nous considérons que la notion de culture numérique prise sous l’angle des formes de vie s’entend ainsi comme un rassemblement de stratégies de quatre types : d’informatique à usage général, d’informatique à usage de spécialité, d’informatique exploratoire et de résistance contre/anti-informatique. Elle offre également un cadre opératoire valable dans le contexte contemporain car elle est ouverte à l’évolution et aux changements d’ordre stratégique et pratique.
4. Un terrain analytique
15Pour étudier la complexité des couches de signification des objets techniques numériques en général, nous utilisons les propriétés des objets et celles des pratiques comme deux axes qui nous permettent de dessiner un terrain analytique de notre modèle d’analyse. Sur l’axe horizontal, nous allons des pratiques aux usages, c’est-à-dire d’un niveau d’expertise faible à un haut degré de connaissances des fonctions du système d’information de la part d’un utilisateur — que cela soit humain ou technique (comme les robots et les « crawlers »). En complément, sur l’axe vertical, nous positionnons une échelle de configurations modales, thématiques et figuratives provenant des disciplines et des domaines qui participent à la construction des objets. Sommairement, l’échelle va d’une faible reconnaissance des domaines ou de l’adéquation culturelle à une grande ouverture au dialogue multidisciplinaire et multiculturel. Comme on le voit, une direction met l’accent sur la réception, l’interprétation et l’adoption (axe horizontal), tandis que l’autre agit autour de l’émission, de la production et de la création (axe vertical).
16Nous pouvons à présent positionner sur le terrain analytique les quatre configurations des fonctions que nous avons présentées plus haut : 1) Plus un système répond aux attentes fonctionnelles et plus il est cohérent avec la tradition culturelle : nous sommes devant un système proche de l’informatique à usage général. 2) Mais si le système fonctionne de manière solide avec un langage propre à une communauté experte, le système est alors proche d’un usage de spécialité. 3) De manière complémentaire, plus un système est attentif aux traditions culturelles et invite à la découverte de ses fonctions de manière intuitive, nous sommes face à un système d’informatique expérimentale et exploratoire. 4) Enfin, si l’approche culturelle du système est floue et si ses fonctions ne sont pas clairement repérables — au moins par rapport aux autres systèmes coexistant dans le même environnement —, alors nous sommes dans la région d’acteurs et de systèmes qui refusent ou résistent, de manière consciente ou non, aux fonctions d’un système d’information. La figure 3 visualise de manière graphique les deux axes du terrain analytique.
Figure 3. Terrain analytique à deux axes.
© Everardo Reyes, 2022.
5. Vivant, art et technologie
17Les types d’existences numériques que nous abordons dans cet article peuvent être analysées selon notre modèle et terrain analytique. Une première caractéristique que l’on trouve est que les créations inspirées de phénomènes biologiques et naturels sont de nature composite. En effet, à l’occasion du colloque « Existences collectives : perspectives sémiotiques sur la sociabilité animale et humaine »3 nous avons discuté nos expériences à partir du projet « hydrologie des médias », que nous avons porté pendant deux ans au sein de l’EUR ArTeC. En mettant l’accent sur la matérialité et les représentations symboliques de l’eau, nous avons proposé des interventions directes sur les instruments et les méthodes scientifiques. Notre objectif était de provoquer des expériences esthétiques capables de promouvoir une conscience hydrologique et de représenter l’eau à des échelles invisibles à l’œil humain, mais tout de même nécessaires à prendre en compte.
18Un cas d’étude est l’œuvre « Fiber Optic Ocean » (2016) de l’artiste-chercheuse Özge Samanci, partenaire de notre projet « hydrologie des médias ». Avec une installation qui comprend deux sculptures de squelettes de requin de taille réelle, Özge interroge les conséquences de l’invasion des océans par la technologie. Sa pièce traite le phénomène des requins qui mordent des câbles sous-marins car ils peuvent détecter des champs électromagnétiques à travers leurs pores remplis de gelée sur leur museau appelés ampoules de Lorenzini (Márquez, 2020). L’œuvre est dynamique car elle reçoit en temps réel les incidents causés par les morsures et génère une musique synthétique accompagnée d’un changement de lumière des câbles LED, représentant ceux de fibre optique. La complexité de l’installation inclut des composants issus de l’informatique spécialisée, comme les protocoles de communication électronique, mais d’autres qui proviennent de l’informatique expérimentale car ils laissent imaginer au public que la sculpture est vivante et que les visiteurs assistent aux événements en direct. Toutes ces pièces techniques sont réunies pour « vivre ensemble » et soutenir un argument de critique écologique et environnementale.
19Dans notre pratique pédagogique, nous mobilisons l’approche des existences numériques pour aborder les objets, les acteurs, les processus et les espèces comme des entités séparées, susceptibles de s’organiser et de représenter une perspective subjective d’un phénomène naturel. Par exemple, les participants à nos ateliers sont invités à interroger leurs outils de travail du quotidien (les logiciels qu’ils utilisent le plus souvent) en mettant au cœur les sujets hydrologiques. De manière complémentaire, les participants peuvent aussi découvrir des méthodes et outils qui leur sont inconnus mais qui permettent d’utiliser leurs propres formats de travail habituels (textes, images, vidéos)4.
Conclusion
20À l’heure actuelle, les développements informatiques continuent de se diversifier en termes de types d’interaction. Le modèle classique d’humain-machine s’est élargi. Désormais, il prend en compte les dispositifs et leurs composants ; l’environnement et les espèces vivantes et non-vivantes. Le paradigme d’interaction tactile d’une interface graphique, est augmenté de commandes vocales, gestuelles et cognitives. Bien que ces interactions soient données pour acquises au niveau des ordinateurs et des téléphones portables, elles sont aussi présentes dans les objets de toutes les tailles, dans les transports, dans les villes et, de plus en plus, dans l’environnement naturel. Face à ces changements, il nous semble important d’élargir notre échelle d’observation afin de maintenir à l’esprit que ces avancements reposent sur une couche d’infrastructure technologique qui est souvent imperceptible. Signaux, ondes, entrepôts des données, câbles de fibre optique, satellites... ces entités nous sont souvent invisibles, tout comme les microbes et les virus, mais elles déterminent les fonctionnements et les significations qui permettent une coexistence collective.



