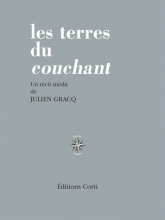
Compte rendu publié dans le dossier critique d'Acta fabula "La bibliothèque des textes fantômes" (novembre 2014, Vol. 15, n°9) : "Le retour d’un fantôme : Les Terres du couchant de Gracq, ou le chaînon manquant entre Jünger & Tolkien" par Alain Corbellari.
***
Julien Gracq, Les Terres du couchant
Postface de Bernhild Boie
Paris : José Corti, 2014.
EAN 9782714311337
264 p.
Présentation de l'éditeur :
En 1953 Gracq entreprend un roman qui se situe comme Le Rivage des Syrtes dans cette zone rêveuse où Histoire et mythe, imaginaire collectif et destins individuels s’entrelacent. Il y travaille pendant trois étés. Travail difficile, hésitant qu’il abandonne en 1956 pour écrire Un balcon en forêt et dont témoignent les quelque 500 pages manuscrites du fonds Gracq à la BnF. Le récit que nous publions est très proche d’une version définitive, même si pour l’auteur il n’a pas trouvé sa forme dernière.
C’est dans ce dossier que Gracq a prélevé les 25 pages de La Route. Le roman se situe à une époque la fois historique et hors de l’histoire – quelque part aux limites d’un Moyen Age barbare. Il se développe autour d’une ville assiégée aux lointaines frontières d’un Royaume finissant. De loin en loin, la place forte reçoit le renfort de quelques volontaires qui, secouant l’inertie mortelle du Royaume, prennent clandestinement la route pour lui apporter quelque secours.
C’est parmi eux que se trouve le narrateur, qui évoque tout d’abord les préparatifs du voyage, les incidents et périls de la marche, les haltes, les rencontres et, surtout, les paysages traversés. La deuxième partie s’organise autour de la vie dans la ville assiégée, avec ses plaisirs et divertissements, toujours précaires face aux signes évidents d’un imminent cataclysme : « Une ville murée pour le néant ».
Mais la substance poétique du récit naît de la description des paysages à la lumière changeante des heures. Du haut des remparts, le narrateur regarde « la steppe rousse » aux pieds de la muraille, plus loin « le lac et ses rives de paille » et au-dessus, « pareils à un rêve de neige flotté sur un aveuglant regard bleu, les linges glacés, glorieux, éblouis » de la Haute Montagne. Un royaume sur le point d’être envahi par les barbares et qui refuse obstinément d’envisager le pire, une forteresse en flammes, « l’herbe froide et poissée » d’un champ de bataille: tout comme le Rivage des Syrtes la fiction subrepticement nous ramène à notre temps, mais c’est ici le « poète noir », qui donne le ton.
La pesante « montée de l’orage » des années d’avant-guerre, se résout enfin « en pluie de sang ». On est toujours tenté de présenter la publication posthume d’une oeuvre comme une découverte sensationnelle, qui change l’image établie d’un écrivain. Pourtant, ce récit ne bouleverse pas la vision que nous pouvons avoir de l'oeuvre de Julien Gracq. Mais il la complète d’une manière significative et nécessaire.
Il conduit à une compréhension plus intime, plus précise, de l’écrivain, des chemins qu’il emprunte, de son regard sur le monde et de son imaginaire. Et, enfin, on sait désormais quel est le paysage romanesque que traverse La Route. Surtout, ce grand récit nous offre le cadeau inattendu d’un pur plaisir de lecture. Bernhild Boie (Postface).
***
Sébastien Baudoin a fait parvenir à Fabula cette note de lecture à propos de ce livre :
Les Terres du couchant de Julien Gracq ou l’impossible inachèvement.
Lorsqu’on achève la lecture des Terres du couchant, récit inédit et posthume de Julien Gracq, l’on est saisi par l’impression d’achèvement que produit cette œuvre, pourtant laissée à l’abandon par l’auteur déjà happé par d’autres récits plus impérieux.
Ce sentiment est peut-être dû au fait que, chez Julien Gracq, les récits ne se terminent véritablement jamais : ils cheminent toujours comme une quête inaboutie dans l’esprit du lecteur mais demeurent surtout à jamais ouverts, de la béance merveilleuse des fins ouvertes où l’on n’ose et l’on ne peut poser le point final. Sans doute aussi parce que Gracq n’a pas relu et nettoyé ce texte de ces éventuelles scories – l’on est saisi par la récurrence, la densité plus forte qu’à l’accoutumée – du vocabulaire typiquement gracquien : « se silhouetter », « claquemuré », « corseté »… Pourtant – geste expert du grand romancier rompu à la discipline rétive de la phrase ? – le récit s’offre à vous dans la coulée verdoyante et sans accroc des images. Il chemine et ondule entre les massifs de poésie brute qui surgissent sans coup férir et vous happent d’émerveillement. L’inachèvement du texte paraît si peu évident à l’œil du lecteur que l’on ne peut parier que sur une lassitude de l’auteur ou sur un rejet d’exigence, Gracq estimant sans doute que ce récit – pourtant ô combien infiniment supérieur à ce qui se produit de nos jours – ne pouvait figurer en bonne place dans le panthéon de son œuvre…
Le vocabulaire gracquien résonne toujours, si formidable aux oreilles averties du lecteur initié, rompu aux parcours de mystères et d’ombres qui peuplent son œuvre. On y trouve la quintessence de l’univers de Gracq : « claquemuré », imaginaire du repli, de l’attente fiévreuse, de l’intimité entrée en rébellion contre le monde extérieur, la forteresse et la carapace architecturale des édifices gracquiens, toujours apparentés à un médiévalisme retrempé dans les eaux de Tolkien. Les mots révèlent les contours d’une fascination profonde. « Se silhouetter », c’est le fantassin posté sur le rempart, c’est l’édifice au loin qui se dessine en ombre chinoise, c’est l’ennemi invisible et obscur qui ne vient jamais, c’est l’être qui se devine mais ne se dit pas, tapi dans son ombre. Acmé poétique de ce champ lexical : « corseté ». S’y lit la contrainte et l’étouffement d’une oppression, d’une attente angoissée, l’étroitesse malséante d’une vie engoncée qui trahit le malaise si fécond sous la plume de l’auteur. Ses récits – Les terres du couchant au premier chef – se tissent comme une toile autour de ces malaises diffus qui garnissent le fond ténébreux d’une attente lumineuse. La tension qui s’opère joue alors à plein, dans la plus pure tradition du magnétisme hérité de Breton, convertie en machine poétique d’une efficacité redoutable.
La première partie livre le héros aux hasards du chemin, d’une route « fossile » à un parcours « ensauvagé » : s’y devine la symbolique d’un retour à la vie après la lente léthargie d’une mort qui ne dit pas son nom. Point de départ de la quête, « Bréga-Vieil », avatar poétique du lieu d’écriture – Saint-Florent-le-Vieil – témoigne du pouvoir de transfiguration imaginaire de l’onomastique gracquienne. Se déploie une géographie fabuleuse, à mi-chemin entre les Terres du Milieu de Tolkien et l’univers vaporeux de Sur les Falaises de Marbre de Jünger. Pris dans la nébuleuse de ce monde parallèle, le héros chemine dans les limbes d’un Moyen Âge fabuleux, où le Graal ne vient pas à lui - tradition du récit gracquien – peut-être parce que son secret le plus ultime se révèle à chaque pas esquissé par l’étrange promeneur, aimanté par l’horizon fascinant de la guerre.
Si la première partie parcourt la géographie merveilleuse d’un héros mené jusqu’aux Grèves de Lilia, lieu de mort de Lero, camarade malheureux de cette errance empoisonné par des marais enfiévrés, la seconde partie est immobile, rivée aux remparts de la Commanderie, mais d’une immobilité active, comme souvent chez Gracq. Promeneur happé vers l’horizon dans la première partie de l’œuvre, ce couchant obsédant promesse de mort et de renouveau, le héros devient observateur du mouvement ennemi. La tension électrique se recharge et se transmue, elle passe de la marche au regard. L’on pense bien sûr au Balcon en forêt, au Désert des Tartares de Buzzati, mais aussi et surtout au Rivage des Syrtes qui accomplit la promesse avortée de ce roman-paysage inachevé.
Même dans ses abandons et ses renoncements, Julien Gracq reste sublime, tant l’inachèvement est au fond, chez lui, la forme la plus ultime de sa poétique.
Sébastien Baudoin.