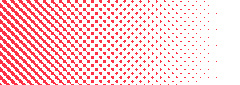D’après mémoire. Les proses fantômes de Jacques Roubaud
et chacun de vous se retourne sur son Eurydice de fumée
qui du regard même se brouille évanouissante sans surseoir
ne reste que la licorne du soir fouillant dans le tuf du soir
et son œil gros d'escarboucle tourne câlin de gêne embrumé
[…]
Jacques Roubaud, ∈, GO 301
1Jacques Roubaud, qui se dit affecté de « bibliothécomanie2 », se définit dans ‘le grand incendie de londres’ par le néologisme homo bibliothecus. La bibliothèque roubaldienne est immense, polyglotte et polymorphe. Telle qu’elle s’inscrit dans son œuvre, elle est aussi, le plus souvent, insaisissable : si les livres qu’il a lus affleurent partout, dans tous ses textes – essais, poésies, théâtre, fictions, proses de mémoire – c’est la plupart du temps de manière instable et comme brouillée, les références d’ « origine » se perdant constamment dans des effets de réécriture, de diffraction et de recyclage où le lecteur perçoit la présence insistante d’autres textes (y compris ceux de Roubaud lui-même) sans pouvoir pleinement la saisir. Cette pratique d’une intertextualité à la fois obsessionnelle et désinvolte provoque, à la lecture, une impression de « déjà-lu » qui fait vaciller le texte lu3, le rendant comme absent à lui-même pour être constamment hanté par d’autres. Mais l’ « effet de spectralité »– pour reprendre l’expression derridienne4 – qui caractérise l’œuvre de Roubaud ne se résume pas à la présence-absence d’une intertextualité évanescente, aussi obsédante soit-elle. Il se fonde d’abord sur la théorie et la mise en œuvre d’une poétique mémorielle, où ce qui a disparu (ou qui est envisagé comme tel) est systématiquement réélaboré d’après mémoire. Cette réélaboration, nous le verrons, suit des principes qui empruntent en grande partie à la memoria médiévale et à la conception augustinienne du fantôme comme double. En s’attachant essentiellement aux textes roubaldiens en prose, nous voudrions ici identifier quelques lignes de crête de cette entreprise littéraire singulière, qui non seulement travaille avec les fantômes (pour eux et contre eux), mais aussi les suscite, dans le jeu, la mélancolie et la résistance.
***
1. Lire/écrire avec les fantômes
1-1 Bibliothèques spectrales
2Homo bibliothecus : cette définition rencontre immédiatement, lorsqu’elle apparaît, une thématique qui se trouve chez Roubaud obsessionnellement associée à la bibliothèque et aux livres qu’elle contient, celle de la disparition : « je suis un spécimen de l’homo bibliothecus, écrit-il, dont on nous annonce la disparition, sous les assauts de la “réalité virtuelle” ; l’homo lisens comme l’homo bibliothecus, l’une de ses races, devant rejoindre l’homo neandertalis dans le cimetière des espèces5. » Cette disparition annoncée du livre et du lecteur serait banale si elle ne se trouvait pas associée à une réflexion d’une portée plus large et plus profonde sur la bibliothèque comme lieu d’accueil privilégié des fantômes et de leur mode de présence particulier : une présence en absence, incertaine, évanescente ou mieux encore évanouissante, pour employer un néologisme cher à l’auteur. Les diverses descriptions – insistantes et répétées – qu’il fait des bibliothèques qui ont compté dans sa vie, dont il lui arrive de dresser des listes (toujours incomplètes), déclinent systématiquement les variantes de cette présence spectrale.
3S’il arrive aux livres des bibliothèques évoquées par Roubaud d’être présents – mais alors le plaisir suscité par leur lecture vaut surtout par « le sentiment de la précarité [de leur] possession […], quelques heures de jour, pendant quelques jours » (gril, p. 1412) – leur principale caractéristique, longuement développée dans plusieurs textes de l’auteur, est de faire défaut au lecteur. Les livres de la British Library – première bibliothèque décrite dans le ‘grand incendie’ – sont « de plus en plus inaccessibles », les volumes momifiés finalement ramenés au jour, au terme d’un parcours dans la « North Library » qui évoque l’approche d’un tombeau égyptien, apparaissant comme des revenants incongrus, littéralement anachroniques6 :
[…] je me rends, par des couloirs labyrinthiques, vers ces régions encore plus profondes, murmurantes, privées, où le crayon seul (murmure de la notation) est utilisé. Et j’ouvre, par exemple :
Finances et thresor de la plume françoise de Estienne du Tronchet, secrétaire de la Royne, Paris, Nicolas du Chemin, 1572 cote Britlib c 109 ff 25
ou encore :Alphabet anatomic, auquel est contenue l’explication exacte des parties du corps humain, et réduite en tables selon l’ordre de dissection ordinaire par Barthelemy Cabrol, anatomiste de l’université de Montpellier
Tournon, Claude Michel et Guillaume Linocier cote Britlib 548 h 17.
4Les livres de l’Arsenal que Roubaud mentionne dans Lire, écrire ou comment je suis devenu collectionneur de bibliothèques deviennent introuvables après la disparition des anciens catalogues manuscrits qui les répertoriaient par époques et par catégories. Mais ce sont les ouvrages de l’ancienne BN – à laquelle Jacques Roubaud consacre un chapitre hilarant de La Belle Hortense sobrement intitulé « La Bibliothèque » – qui déploient avec le plus de virtuosité les stratégies utilisées par les fantômes pour échapper à qui prétend les saisir : dissimulations diverses (cotes mensongères, erronées ou obsolètes), manipulations d’identité (un livre usurpant le titre d’un autre, ou le lecteur d’un autre), dérobades retorses destinées à repousser, au gré d’une variation toujours renouvelée de la « différance » derridienne, l’apparition effective du livre désiré :
Vous receviez […] votre bulletin de commande, généralement chiffonné, portant l’indication “manque en place”. Le lendemain, vous redemandiez l’ouvrage : la réponse était cette fois : “cote à revoir”. Le troisième jour c’était : “à la reliure”, et enfin le quatrième, par un raffinement de cruauté dont on appréciera toute la saveur : “communiqué à vous-même le …”, et suivait alors la date de votre première demande. C’était le degré ultime de l’escalade […]8.
5Inactuels, habitant un futur indéterminé ou un passé impossible, les livres des bibliothèques roubaldiennes évoluent dans le temps et l’espace inassignables des fantômes. Ils sont là sans y être. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que ces mêmes bibliothèques soient également hantées par des ouvrages qui n’y sont pas tout en y étant.
6L’exemple le plus manifeste de ce cas d’absence en présence se trouve dans Graal fiction, où Roubaud fonde sa résolution de l’énigme de la généalogie des Rois Pêcheurs sur une série de textes fantômes, dont l’un est même pourvu d’une cote à la Bibliothèque Nationale fournie en note, la cote 4°H 8349. Les ouvrages qu’il cite à l’appui de sa solution sont, dans l’ordre, des notes prises par Gaston Paris pour le troisième tome de son édition du Merlin ; le dernier cours donné par la médiéviste Gertrude Schoepperle Loomis au printemps 1926 à Bennington College, recopié et publié par Rose Peebles, l’une de ses élèves, dans le volume d’hommage qui lui a été consacré, et enfin l’ « article définitif, exact et lumineux » d’un certain Père S. Risolnus, recueilli dans les « Analecta Sacri Ordinis Cisterciensi (sic), vol XXXI, 1973, p. 14-101 »10. Tous les textes ici mentionnés par Roubaud existent ou presque : l’édition du Merlin élaborée par Gaston Paris ne comprend que deux tomes, l’article qui occupe les pages indiquées dans le volume dédié à la mémoire de Gertrude Loomis est d’Ernst Brugger et n’a rien à voir avec un dernier cours dispensé par la médiéviste (de même que celui de Rose Peebles, qui figure ailleurs dans le même ouvrage), et si le volume XXXI des Analecta Cisterciensis est effectivement consultable à la cote obligeamment fournie, il ne contient aucun article signé par le Père Risolnus. On relèvera que ces textes fantômes, dont Roubaud se plaît tout particulièrement à commenter les lacunes et les vacillements (biffures, hésitations, censures), sont essentiellement attribués à des auteurs fantômes, qui n’existent pas ou presque : le « Père Risolnus » est l’anagramme de Pierre Lusson ; Gertrude Loomis, à l’époque où Roubaud lui fait dispenser son dernier cours, est morte depuis cinq ans (et Bennington College n’a pas encore ouvert ses portes).
7« Ou presque » : les ouvrages, les auteurs et les lieux ici convoqués ont pour point commun de ne jamais coïncider tout à fait avec le présent de leur apparition dans le texte de Roubaud, soit parce qu’ils ne sont pas (encore) venus à l’existence (le troisième tome du Merlin, Bennington College), soit parce qu’ils ont cessé d’exister (Gertrude Schoepperle Loomis), soit parce qu’ils existent autrement ou ailleurs (Le Père Risolnus, les articles du volume de Mélanges). Il n’est bien sûr pas indifférent que ce soit un texte intitulé Graal fiction qui accueille ces fantômes en défaut d’existence, en leur ouvrant le monde possible que toute fiction, fût-elle « théorique », comme celles que Roubaud élabore dans cet ouvrage, ménage à ses habitants.
1-2 Théâtres de mémoire
8Si les livres qui hantent la bibliothèque roubaldienne ont un mode de présence fantomatique, c’est aussi qu’ils relèvent, avant tout, d’un paysage mémoriel qui, pour être immense, est aussi instable et lacunaire. L’analogie de la bibliothèque avec un « théâtre de mémoire » court dans de nombreux textes de Roubaud11. Elle y est toujours couplée à une évocation de la perte, que celle-ci soit délibérée ou, plus classiquement, subie. Dans ‘le grand incendie de londres’, le « théâtre de mémoire » que représente pour l’auteur la British Library l’aide à accomplir le « programme de destruction » qu’il s’est fixé à travers cet ouvrage – et sur lequel nous reviendrons (cf. gril p. 326). Pour « Jacobus Robaldus », l’un des avatars de l’auteur dans Nous, les moins que rien, fils aînés de personne, la bibliothèque, « théâtre de mémoire » intérieur, épouse les contours d’un Atlas dont les zones blanches, Terra Incognita dont les toponymes s’effacent peu à peu, ne cessent de s’étendre au lieu de se raréfier12.
9La conjonction qui se cristallise ici entre la mémoire, la bibliothèque et l’atlas, tous trois à la fois totalisants et incomplets, fait immédiatement surgir à l’esprit du lecteur l’image de la bibliothèque de Warburg, placée comme on le sait sous le signe de Mnémosyne et prolongée par un atlas mobile et inachevé. Cette présence en creux de la bibliothèque de Warburg dans Nous les moins-que-rien … est significative de son mode d’existence dans l’ensemble de l’œuvre roubaldienne. Affleurant souvent à la conscience du lecteur, plusieurs fois directement mentionnée, elle ne figure pourtant dans aucune des listes des bibliothèques que Roubaud affirme collectionner – au premier rang desquelles la British Library, la Bibliothèque Nationale et la Bibliothèque de la Sorbonne. Et si elle donne son titre à la cinquième branche du ‘grand incendie de londres’, elle y est évoquée de seconde main, pour ne pas appartenir à l’expérience personnelle de l’auteur. Roubaud rapporte en effet, curieusement, avoir fait demi-tour avant de s’y engager alors même qu’il avait résolu d’interroger « l’esprit de Warburg qui règne en ce lieu, qui plane […] sur chaque livre choisi par lui13 » (gril, p. 1789). Cette séance de spiritisme manquée précède immédiatement – et, peut-on penser, suscite – la révélation de la trame du Roman envisagé alors par l’auteur : en rebroussant chemin lui vient l’idée d’un récit organisé autour d’une « secte pythagorique vouée au savoir » dont le lieu de rencontre serait précisément la salle de lecture de la bibliothèque de Warburg. Cette obscure intrigue, évoquée dans le texte au conditionnel, temps de la fiction par excellence (« cela serait »), relève en fait, au moment de la narration, de l’irréel du passé, puisqu’elle n’aura jamais été mise en œuvre.
10Le mode de présence en absence de la bibliothèque de Warburg se donne ainsi comme le négatif de celui des textes fantômes qui hantent les livres de Roubaud : si ces textes n’existent pas dans le monde réel, ils auront cependant pu être grâce à l’existence fictive qu’il leur donne ; la bibliothèque de Warburg existe bien quant à elle, mais n’aura pas été présente dans son œuvre. C’est précisément cette présence négative, deuil d’une existence possible, qui fait de la bibliothèque de Warburg et de son Atlas – que son concepteur présentait comme une « histoire de fantômes pour grandes personnes14 » – le spectre familier qui hante avec insistance l’ensemble de cet immense édifice à courants d’air qu’est ‘le grand incendie de londres’.
1-3Le texte survivant
11Le rapport entre le projet warburgien et l’entreprise poursuivie par Roubaud est esquissé succinctement et avec réticence, sur le mode de la défense :
Ce que j’en ai retenu pour être dit ici [i.e. de la biographie intellectuelle de Warburg rédigée par Gombrich] n’a rien à voir avec le contenu et les nobles et imposantes intentions de l’entreprise warburgienne elle-même. J’en ai fait, tout bêtement, une sorte de transposition qui était destinée à servir de modèle à mon propre Projet, alors approchant de sa phase préparatoire finale. Je vis, en une vision intérieure très géométrisée, le projet de ‘Mnemosyne’ comme un art de mémoire à double entrée : la mise en représentation spatiale de tout le mouvement de la mémoire propre de l’homme Warburg et, dans le même moment, de la mémoire de l’art comme étant (l’art) mémoire de soi-même dans ses rapports au monde. […] On s’étonnera peut-être du fait que je me sois contenté d’un livre, et de deux images dans ce livre, pour parvenir à des conclusions programmatiques aussi péremptoires. Je plaiderai, bien sûr, l’irresponsabilité […]. Il était naturel […] que le mot ‘Mnemosyne’ m’attire, naturel que je mette le rêve warburgien en parallèle avec la tradition des Arts de mémoire. (gril, p. 1787-1788)
12À la lecture, ‘le grand incendie de londres’ révèle des analogies de structure avec l’entreprise de Warburg plus importantes que l’auteur veut bien l’avouer15. Mais c’est d’abord par son objet même, à savoir le récit de l’abandon d’un projet d’écriture détruit avant que d’être mis en œuvre, que cette « prose de mémoire », comme l’appelle Roubaud, relève de la démarche warburgienne. Elle s’organise en effet tout entière autour de la survivance16 d’une forme qui, même longtemps après sa disparition, ne cesse de faire retour dans les milliers de pages qui composent le ‘grand incendie’, fût-ce d’une manière lacunaire, déformée et délibérément obscurcie.17
13La première branche, intitulée « Destruction » présente progressivement ‘le grand incendie de londres’ – le récit que nous lisons – comme une survivance au cube, le texte constituant la troisième tentative pour développer le récit d’une vaste entreprise elle-même trois fois réélaborée avant d’être finalement abandonnée, laquelle devait associer un mystérieux Projet de Poésie et de Mathématique à un Roman dont le titre aurait été Le Grand Incendie de Londres. ‘le grand incendie de londres’, citation sans majuscules et sans italiques du titre du Roman disparu, se donne ainsi à lire comme le lieu de survivance ultime et appauvrie (le lieu de « chute », dit Roubaud18) d’un double fantomatique qui n’appartient ni vraiment au passé (puisqu’il n’a jamais existé) ni au futur (il ne sera jamais réalisé), mais à un futur antérieur nié (il n’aura pas été) dont porte témoignage ce nom même de « Projet » que Roubaud continue à employer longtemps après avoir constaté l’échec de son entreprise et y avoir définitivement renoncé19.
14Ce processus de survivances successives, où l’ambition littéraire première se survit de plus en plus faiblement à elle-même, est donné à comprendre au fil d’une narration fluctuante, qui, de réajustements en variations, se dérobe constamment à la saisie du lecteur. Ce phénomène est particulièrement sensible dans la genèse du Projet et du Roman qui devait l’accompagner. Le point de départ est un rêve : « Au début, qui m’apparaît maintenant si lointain, il y a un rêve » (gril, p. 134). Le bref récit de ce rêve, qui apparaît tardivement dans la branche I, se termine par la prise de conscience du roman à venir : « En m’éveillant, j’ai su que j’écrirais un roman, dont le titre serait Le Grand Incendie de Londres, et que je conserverais ce rêve le plus longtemps possible, intact ». La fin du texte précise : « Je le note ici pour la première fois. C’était il y a dix-neuf ans. » (Ibid.). Mais la suite du ‘grand incendie’ se charge immédiatement de faire vaciller l’assise de cette dernière assertion. On apprend d’abord que cette « première fois » n’en est pas une : elle ne correspond pas au temps de la rédaction du récit que nous lisons, mais à l’une de ses versions antérieures, rédigée en 1980 puis détruite par l’auteur après avoir été « rendue caduque par la mort » (gril, p. 134). Une vingtaine de pages plus loin, on comprend aussi que cette première version détruite n’était en fait pas la première, mais la seconde, qui en différait par une variante apparemment minime – l’omission du « lieu du rêve » – qui apparaîtra en fait comme cruciale dans la suite du récit.
15Se répète ici, comme on le voit, le principe des survivances emboîtées dont procède toute l’entreprise du ‘grand incendie’ : le récit du rêve où s’enracine Le Grand Incendie de Londres (c’est-à-dire ce qui survit du souvenir du rêve dans l’écriture) constitue le fragment d’une rédaction du rêve qui, elle-même, n’est qu’une survivance (approximative) d’une version antérieure dont tout le reste a disparu. À l’image du « lieu du rêve », l’espace d’inscription première du Roman dont ‘le grand incendie’ est une survivance déchue se révèle négativement, par son absence ou plus précisément par son évanescence, en l’occurrence par sa faculté à se dérober à la saisie de l’écriture comme de la lecture. Et comme tous les spectres, la force de la hantise qu’il exerce sur le texte et sur son lecteur est, paradoxalement, directement proportionnelle à son défaut d’être (d’inscription et d’actualisation). On pourrait reconduire cette analyse à tous les niveaux de la composition de la prose de mémoire, dont l’écriture se donne comme le lieu d’enregistrement, ou d’orchestration, du défaut d’être de ce qui survit à sa disparition.
1-4 Disparitions – « TOUT : rien »
16Si ‘le grand incendie’ se présente comme le récit labyrinthique d’un double projet d’écriture et de son progressif renoncement, ce Projet programmait avant tout une série de livres à écrire qui auraient constitué un ensemble cohérent, le grand œuvre roubaldien20. Cet ensemble textuel hante toute l’œuvre de Roubaud comme une véritable bibliothèque fantôme. Les livres publiés par l’auteur sont d’ailleurs présentés comme les concrétisations, partielles et parcellaires, de cette bibliothèque fantasmée, des « sous-objets » (gril, p. 1986), les maillons de « chaînes », écrit encore Roubaud. Bien sûr, l’organisation de cette bibliothèque imaginaire serait régie par des lois mathématiques, et notamment par une « FIGURE-NOMBRE21 », assignant à chacun des livres envisagés une place précise sur des rayonnages virtuels : à la liste des modèles possibles d’organisation de la bibliothèque recensés par Georges Perec pourrait venir s’ajouter ce modèle mental22.
17Le « catalogue » de la bibliothèque fantôme des œuvres de Roubaud est néanmoins partiellement accessible : un cahier des charges du Projet a fait naguère l’objet d’une publication confidentielle23 et l’histoire de la rédaction de son plan est racontée en deux endroits stratégiques du ‘grand incendie’ : la première branche s’ouvre sur le récit de sa programmation, intitulé « description du Projet », et dans la cinquième branche (La Bibliothèque de Warburg), le chapitre 7, intitulé « TOUT : rien », revient sur les circonstances de son élaboration et sur son abandon. En bref, dans les cinq branches du cycle publiées en 2009 en un seul volume, l’évocation de cette bibliothèque fantôme ouvre et ferme le livre de 2000 pages (1999 + 1 verso blanc) : autant dire qu’elle le tient.
18Ce serre-livre fantôme qui encadre le livre réel qu’est ‘le grand incendie’ est aussi remarquable, dans le double récit des faits, pour la récurrence d’un autre motif : celui du sommeil et du rêve. Dès le début, on l’a vu, la prose du ‘grand incendie’ nous est présentée comme émanant d’un rêve énigmatique, soigneusement, quoiqu’obscurément rapporté : ce rêve, lu comme prophétique par l’auteur, encode tout le projet d’écriture. À la toute fin, lors du récit de l’abandon, le sommeil revient comme un élément tout aussi fondamental, même si Roubaud ne nous dit pas alors avoir rêvé :
Dans la nuit, un peu avant dix heures du soir, je prends la chemise contenant le plan du Projet. Allongé sur mon lit, je relis le tout une dernière fois, avec soin. Il y a bien TOUT.
Je me lève, déchire le plan en beaucoup de morceaux, jette les morceaux dans la corbeille à papier.
Je me recouche.
Sur le moment, il me semble, j’ai un sentiment d’accomplissement. Je me dis quelque chose, avant de m’endormir, un peu tard, mais tranquillement, comme, « Et v’là l’travail ! » C’est le lendemain matin, il me semble aussi, que je comprends que j‘ai renoncé au Projet. (gril, p. 1999)
19Cette page rend précisément compte de la transformation d’une bibliothèque de livres possibles (celle du Projet), en bibliothèque-fantôme. Le caractère spectral de la bibliothèque projetée paraît lié à deux événements essentiels : le black out subjectif, qui précède l’instant de la destruction du Projet, ou plutôt le blanc out (typographiquement marqué par un grand blanc sur la page), et le sommeil qui suivit. Ce sommeil sans rêve sert de temps d’incubation à la saisie du renoncement, comme le rêve avait en ses débuts servi à la saisie de la naissance du « Projet » : d’une façon ou d’une autre, les livres fantômes naissent donc du sommeil, nous y reviendrons.
20Dans cette dramaturgie parfaitement concertée, Jacques Roubaud nous fait ainsi sentir toute la différence entre livres fantômes et livres possibles : les premiers ne viennent pas nécessairement du passé, mais, travaillés par la mélancolie, ils sont programmés pour être perdus et viennent hanter de leur désir d’existence les seconds, qui en seront comme les doubles, parfois réalisés sous la forme d’un livre réel, comme ‘le grand incendie’, mais toujours suspendus à la possibilité d’une reprise et à l’impossibilité d’un achèvement – d’où les minuscules. Dans l’œuvre de Roubaud, le livre réel est toujours un livre second, dans tous les sens du terme24.
2. Revenances médiévales : théories et poétiques du fantôme
2-1 Le livre mémoriel et ses mains d’écriture
21Comme on va le voir, le modèle de cette conception fantomatique du livre et de l’écriture est à plus d’un titre médiéval. En sa composition entrelacée, ‘le grand incendie’ emprunte sa forme à deux grands modèles : les six branches rappellent la structure de la sextine, également utilisée de façon cryptée pour composer les romans de La Belle Hortense25 ; les avancées de la prose redoublent la conjointure du Lancelot en prose, cycle conçu comme une « prose de mémoire » entrelacée26. Mais du Moyen Âge et de son lien à la mémoire, l’auteur a d’abord retenu que le livre écrit était toujours comme le double d’un autre, dynamique et mental : comme chez les médiévaux, l’écriture succède à ce que Roubaud graphie dans Churchill 40, éQrire, ou l’eccrit27 pour noter son instabilité fondamentale. Le texte roubaldien, comme le texte médiéval, est mouvant parce qu’il est d’abord mémoriel, en poésie mais aussi en prose : « Tout doit se passer, se passe et se sera passé dans la tête », précise Roubaud28.
22Au Moyen Âge, l’espace mémoriel est souvent appréhendé comme un livre mental29, et les arts de mémoire, qui permettaient de retenir des livres en quantité, étaient aussi utilisés pour écrire. Non seulement le livre lu avait une existence flottante dans la mémoire de ses lecteurs, mais la page mémorielle pouvait servir de support à la composition du texte, qui était d’abord mental et palimpseste. Chez Roubaud également, cette exploitation extrêmement élaborée (et quotidiennement entretenue) de la mémoire a non seulement servi à mémoriser des textes entiers, mais aussi à écrire, la poésie comme la prose. Dans l’ensemble des arts de mémoire qu’il a consultés et examinés en détail, l’auteur contemporain a finalement privilégié un « art de mémoire de poche », celui des « mains mnémoniques ». Il en a trouvé le principe dans l’ouvrage d’un théologien de la fin du Moyen Âge, le Rosetum deMauburnus, qu’il a adapté à ses propres besoins :
[…] il s’agit […] d’un art de mémoire de poche, d’une variante sophistiquée du « nœud à mon mouchoir ». Dans la paume d’une main ouverte, fictive, mentale, bien éclairée des lumières de l’esprit, de taille raisonnable, disposer, dans un ordre choisi, immuable, des lieux de mémoire, plus ou moins nombreux, numérotés, les nombres permettant de suivre le parcours voulu par le mnémoniste. En chaque lieu placer, par la pensée, un fragment de ce dont on veut se souvenir. Passer et repasser en chaque lieu de la main mnémonique, selon l’ordre, et graver dans sa mémoire ce qui doit s’y trouver et retrouver. Quand l’heure vient, ouvrir la main, mentale bien entendu, bien l’éclairer de son attente et relire ce qui s’y trouve30.
23Dans le sillage des mnémonistes médiévaux, Jacques Roubaud a non seulement retenu des textes devenus fantômes dans sa mémoire, mais il s’est aussi servi de ces mains mnémoniques pour composer d’autres textes, à partir de ceux qu’il a mémorisés, fragmentés et « manipulés31 », ou bien à partir de ses propres écrits, devenus fantômes de sa mémoire. Comme nous le révèle notamment la toute dernière branche du grand incendie, la plus grande partie de l’écriture ducycle en prose, de la branche I au début de la branche V32, a été en effet conditionnée et contrainte par l’usage de ces mains mémorielles, doubles des mains réelles du prosateur. Le procédé d’écriture, sa réinvention et son histoire, ainsi que son protocole d’utilisation sont décrits avec précision sur plusieurs chapitres de La Dissolution.
24On retiendra ici de cette longue et complexe méthode d’écriture de la prose que la main mnémonique est un prolongement de la mémoire, articulé : chaque détail de la main a ses lieux, qui définissent des parcours possibles (multiples, grâce aux croisements des lignes), et permettent à la fois de mémoriser, de réutiliser, de reformuler un texte et d’en composer un autre, souvent en décalage spatio-temporel avec le moment réel d’écriture. Main gauche et main droite servent toutes deux de support mémoriel : le fantôme roubaldien est ambidextre, mais l’utilisation de l’une ou de l’autre main est aussi rigoureusement conditionnée. Non seulement la différence de dessin entre chaque main permet de multiplier les parcours, mais à chaque côté est assignée une tâche différente dans l’activité d’écriture de la prose :
[…] pour chaque couple de moments-prose consécutifs j’ai prévu deux mains mnémoniques : l’une pour la phase de récapitulation, l’autre pour la préfiguration.33
25Autrement dit, et contrairement à ce qu’une première lecture des branches du ‘grand incendie’ pourrait laisser croire, la prose de mémoire, qui s’écrit sans repentir et suivant un principe strict de véridicité, n’est pas simplement composée au fil de la plume à des heures fixes (très matinales) du jour : chaque moment d’écriture est préparé par une « préfiguration » mentale (sur main droite), qui orientera la pensée du jour, et donnera lieu, après avoir été déployé dans l’écriture, à un nouveau condensé mental (sur main gauche) qui permet au prosateur de composer avec en tête un double fantomatique du moment de prose précédent34. Le présent de l’écriture est ainsi comme à la croisée complexe d’un passé et d’un futur conçus comme fantomatiques et qui se « donnent la main35 ». En somme, le texte écrit, dans son existence figeante, passe toujours au second plan par rapport à « la vie de la lettre » dans sa réalité mémorielle : ‘le grand incendie’ est prose de mémoire dans les deux sens que l’on peut donner au complément du nom.
26Tout au long du cycle, les mains fantomatiques qui ont présidé à la naissance de la prose la marquent aussi définitivement de leur signature. L’usage des mains mnémoniques n’est en effet pas seulement un auxiliaire virtuel qui ne laisserait aucune trace dans le texte réel roubaldien36. Au contraire, les mains ambidextres sont aussi utilisées, à partir de la branche II du cycle (et rétroactivement) pour différencier des styles : « Les mains mnémoniques sont aussi des feuilles de style37 », précise une contrainte. En s’inspirant de tonalités répertoriées dans la poésie médiévale japonaise, Roubaud a défini pour sa propre écriture dix styles (plus un « non-style »), auxquels il a associé autant de mains mnémoniques, qui se sont partagé rigoureusement tous les moments de prose. Autant dire que toute la poétique de la prose du ‘grand incendie’ procède de cette réactivation oulipienne et subjective des arts de mémoire médiévaux38.
27En ce sens, le texte écrit, prose ou poésie, accompagné de son double mental, est toujours enté à lui, hanté par lui. On parlera donc ici de texte fantôme comme de membre fantôme : défini comme une présence-absence, il se manifeste sans se laisser circonscrire, et revient, comme une hantise, sous une forme fragmentaire et décalée, mais toujours signée. Chez Roubaud, cette hantise permet de régler, comme en musique, la composition improvisée au fil des jours. Plus largement, cette conception de l’écriture oblige à enrichir la notion d’intertextualité d’une catégorie, que l’on pourrait nommer l’intertextualité hors-texte. Cette catégorie prendrait en compte la pratique textuelle de la reprise sous un régime bien particulier fonctionnant sur le mode de l’emprise mémorielle : revenance d’un livre sans support, sans corps fixe, néanmoins toujours susceptible d’être convoqué dans la composition d’autres textes, d’autres poèmes, d’autres livres, le livre fantôme agit comme de « troisième main », comme la main mnémonique du Rosetum, reprogrammée par Roubaud pour écrire en/à sa place. Car c’est aussi la figure de l’auteur ici qui se dédouble, se fragmente en plusieurs « mains » collaboratives, ne trouve sens que dans la multiplicité et le trouble des voix.
2-2 Réversibilité du texte fantôme
28Cette conception de l’écriture fait aussi la spécificité de la poétique des textes médiévaux en langues vernaculaires à laquelle Jacques Roubaud a été sensible : leur « mouvance », associée à ce que Daniel Poirion a appelé leur « manuscriture39 », n’est pas seulement liée à des contextes et à des conditions de production qui font du texte écrit une actualisation toujours partielle d’une « œuvre » idéale, une version parmi d’autres, susceptible de continuations, de variations, ou de métamorphoses plus radicales. La littérature médiévale vernaculaire, prose et poésie, narrative ou strophique, valorise pour elles-mêmes la multiplicité et la mobilité du texte littéraire. Dans ses textes en prose, qui prolifèrent en multiples versions concurrentes, Roubaud reprend explicitement cette poétique de l’instabilité, dont il détaille lui-même les ressorts essentiels (« enchâssements, […], empiètements, […], effacements et leurs doubles, les substitutions ; récits abandonnés ; récits venant ‘à la place’ d’une phrase, d’une proposition, d’un mot, d’une lettre, du miroir d’une lettre. Récits rayés », gril, p. 181). Cette multiplicité, qui déjoue toute tentative d’interprétation claire et univoque du récit, parallèlement aux lacunes délibérées qui y sont ménagées (non-dits revendiqués40, cryptages41, approximations lexicales42), le met à distance de son origine, posée comme énigmatique et inaccessible.
29Dans les romans médiévaux qui ont explicitement servi de modèle à l’auteur contemporain, le topos du « mirage des sources » joue un rôle majeur pour comprendre la poétique associée à cette instabilité textuelle43. Non seulement la mention, au seuil des récits de fiction, d’un Ur-text introuvable, donne au roman une légitimité en créant une énigme auctoriale promotionnelle, mais ces dispositifs rhétoriques mettent surtout au jour, chez les premiers romanciers en français, une réflexion sur le propre de la fiction, au moment même où celle-ci conquiert ses lettres de noblesse.Dans les romans du Graal, la fiction du livre secret, inaccessible, comme celle, inaugurée par le Roman de la rose, du rêve retransposé dans l’écriture, inscrivent au cœur du récit médiéval cette poétique du dédoublement qui caractérise le fonctionnement fantomatique des œuvres. En posant son origine pour la projeter dans un oubli, une perte qui ne se saisira que dans la prolifération des avatars, des tentatives de reprises, des contaminations, des continuations, etc., le récit de fiction médiéval réfléchit son impossible accès à la sourcecomme son impossible achèvement : il fait de l’œuvre textuelle elle-même une réalisation toujours spectrale, le double d’une autre, passée ou à venir, qui lui prête ses propriétés fantomatiques.
30Cette réversibilité du fantôme, liée à l’écriture littéraire, est chez Roubaud longuement méditée et théorisée, selon des modalités que l’on ne peut pas détailler ici44. Pour notre propos, on remarquera simplement qu’une importante réflexion théologique sur les fantômes soutient cette définition réversible du fantôme textuel. Une théorie, initiée par saint Augustin, a cours pendant tout le Moyen Âge et pense le fantôme non comme l’ombre d’un mort, mais comme la production fantasmatique (phantasma) d’une image, double d’un sujet ou objectivation de son désir45. Chez les sujets atteints, la création du double est toujours liée, prévient saint Augustin, à des états de conscience amoindrie : torpeur, sommeil ou demi-sommeil. Et cette faculté de dédoublement fait l’objet d’une tentative de théorisation d’autant plus sérieuse qu’elle est chez le théologien liée aux puissances diaboliques, capables d’inventer des ombres (umbras), venant perturber et tenter les vivants. Comme l’a montré Jean-Claude Schmitt, la théorie augustinienne du fantôme a eu un retentissement important pendant tout le Moyen Âge46. On la retrouve aussi dans les textes en langue vernaculaire ; ombre et fantôme ont souvent en ancien français une valeur augustinienne : dans le lai de Narcisse, le héros, se réfléchissant dans la fontaine, contemple son « fantôme », ou son « ombre »47; le motif de l’insomnie fantasmatique est récurrent dans les récits du xiie et du xiiie siècles, et le récit-cadre qu’est le rêve érotique peut s’interpréter à la lumière de cette association entre fantôme, fantasme et fiction48.
31La réflexion engagée par Roubaud sur la poétique du double et sur la spécificité de l’espace littéraire peut être aussi lue, nous semble-t-il, à la lumière de ces conceptions médiévales du livre et du fantôme. Le rêve qui enfante le Projet et le sommeil qui en accompagne le renoncement sont les indices de cette résonance médiévale, qui transforme chez l’auteur contemporain l’expérience biographique en fiction théorique. Dans ‘le grand incendie’, les livres imprimés, « le réel du papier rempli », sont ainsi explicitement posés comme des « fantômes », l’« ombre portée » du grand Projet (gril, p. 138 et 158). Ce dernier syntagme renvoie, dans le vocabulaire roubaldien, autant à la propriété de la lumière qu’à un concept métaphysique49, transposé dans le lexique littéraire : spectre lumineux et fantôme théologique se complètent ici pour faire du texte écrit un objet lui-même fantomatique, une ombre instable et insistante, profondément marquée par les propriétés du modèle onirique ou mental qui la porte.
32Chez Roubaud, cette réflexion trouve dans les textes en prose des prolongements narratifs qui fondent une véritable poétique du texte fantôme, et proposent ce que l’on pourrait appeler un art de l’oubli sur lequel nous nous attarderons pour finir.
2-3 « fantômer » : l’invention d’Éros mélancolique
33En 2009, Jacques Roubaud publie en collaboration avec Anne Garréta un roman oulipien intitulé Éros mélancolique50. Les chapitres liminaires justifient l’existence de ce texte à plusieurs voix en recourant à la fiction du manuscrit trouvé. Dans une préface de tonalité « réaliste », Anne Garréta précise avoir reçu une nuit un message électronique de Jacques Roubaud, lui demandant de lui téléphoner « d’urgence ». Suit l’accès à une page web (reproduite dans le livre, et bien évidemment fictive51), contenant un fichier « pdf » intitulé Éros mélancolique : « une fois téléchargé et devenu vôtre, il disparaîtra de cette page », précise le texte qui apparaît sur l’écran. Le roman adapte à notre nouveau monde digital un vieux topos rhétorique et s’amuse à multiplier les intermédiaires qui éloignent de son origine un récit de fiction :
C’est curieux, a répondu Jacques Roubaud. C’est une histoire de manuscrit trouvé
À Saragosse ?
Non à Édimbourg. Dans une boîte, on a trouvé des microfilms.
Des microfilms du dix-huitième ?
Non, d’une histoire des années soixante, un truc tapé à la machine.
Et ça a échoué sur le web comment ?
Le texte a dû passer entre plusieurs mains avant de tomber dans les nôtres. Quelqu’un prétend avoir découvert les microfilms et les avoir scannés et numérisés. Un autre raconte avoir retrouvé le fichier sur un ordinateur d’occasion dont le disque dur avait été mal effacé. En tout cas, au fil des copies, au fil des transferts, des lacunes, des blancs ont surgi.52
34Le roman rapporte « l’histoire d’un jeune homme qui s’appelle Goodman, ghostwritée, on dirait, par un autre qui se nomme Clifford. […] Ceux qui ont numérisé, mis sur le web, n’ont pas de nom53. » Dans le premier chapitre, un premier narrateur anonyme révèle les circonstances mystérieuses qui l’ont conduit à trouver un fichier parasite dans un ordinateur, acheté sur e-bay. Ce fichier est issu de la numérisation d’un microfilm, trouvé par un autre narrateur dans un appareil photo d’occasion acheté à Édimbourg et restitué à l’aide d’un scanner.
35Comme on le voit, le dispositif décrit par les auteurs permet aussi de saisir le mode de fonctionnement propre au livre fantôme. De fait, le titre du premier chapitre, « l’archive fantôme la mémoire digitale », entre crochets et sans ponctuation, rend ambigu le statut du terme même de « fantôme », qui pourrait aussi bien être ici un néologisme verbal inventé pour exprimer ce processus de hantise : la machine du narrateur anonyme est « infectée, possédée » par une pièce jointe, « toute une archive invisible qui vient hanter, trouer mes projets, dit-il, s’attacher à mes envois. Tout ce que j’inscris ou sauvegarde en mémoire devient palimpseste. Des fragments affleurent54. » Numérique ou mentale, la mémoire fonctionne donc selon les mêmes procédés de contaminations et de survivances, qui viennent hanter ce qui s’écrit au présent, sur ordinateur ou sur papier.
36La mise en page du texte lui-même, dans le livre imprimé, reproduit les lacunes arbitraires qui auraient été engendrées au hasard des transmissions de fichiers : des blancs typographiques occultent sur certaines pages une grande partie du texte, rendu illisible55. Certains passages font remonter à la surface de ce roman des fragments de textes dont on retrouve des versions, à la fois littérales et partielles, dans d’autres textes de Roubaud, notamment dans la prose du ‘grand incendie’56. Caviardé par son propre auteur (aidé de sa co-équipière, figure oulipienne du « ghostwriter »), le texte roubaldien se répète, se dissémine, lacunaire et transformé. Ce caviardage prémédité (et techniquement, sans doute, difficile à reproduire !) rend aussi visuellement compte de la spectralité à l’œuvre dans la lecture/l’écriture littéraire : le texte se présente comme la version corrompue d’un double vacillant (même à qui identifie son origine ailleurs, car la comparaison des textes fait apparaître de troublantes coïncidences, sans permettre des superpositions termes à termes entre les versions). Un manque et un désir de complétude surgissent à la lecture de ces pages lacunaires, reflets typographiques de « l’éros mélancolique » que thématise le récit lui-même57.
37Des fragments textuels qui reviennent dans le récit en cours, l’un exprime le moteur de l’intrigue et prévient que l’histoire sera aussi celle d’une rencontre avec un fantôme littéraire :
Son visage me fuit sans fin. Son visage me hante évanoui. Je ne cesse de la perdre de vue, même quand elle est là, non loin de moi. Rien n’arrête sa fuite, ne couvre la distance qui me sépare de son lointain58.
38Ce fantôme féminin est ici aussi bien antique que médiéval. Le protagoniste, Goodman, chercheur en chimie qui laisse (lui aussi59 !) tomber un Projet d’écriture au profit d’un projet photographique inabouti dont on suit l’élaboration et l’échec au fil du roman, retrouve et perd une jeune femme qu’il associe à Eurydice et qui se laisse regarder sans permettre qu’on la touche60. Cette relation amoureuse entretenue à distance est surtout rapprochée de « l’amour de loin » de Jaufre Rudel61, qui nourrit une partie de la réflexion de Roubaud sur l’essence de la poésie : dans la mythologie roubaldienne, Jaufre remplace Orphée. Les personnages fantomatiques du roman sont dès lors les indices mémoriels de livres (multiples) de Jacques Roubaud. Si le nom du protagoniste signe la poétique de la prose dans l’œuvre de Roubaud, le titre du livre, Éros mélancolique, pour s’en tenir à lui, renvoie explicitement à la réflexion qui clôt la première partie de la Fleur inverse, essai sur l’art formel des troubadours62. L’histoire de Goodman et son dispositif en sont ainsi comme la manifestation romanesque, nouvelle « chute » fantôme de ce qui représente pour Roubaud l’essence même de la poésie, art de mémoire et d’oubli du trobar, justement présenté dans la conclusion de l’essai comme un « spectre », qui « hante la poésie » :
Le paradoxe de leur présence-absence [i.e. des troubadours] tient à la question de la langue : presque morte et pas morte, presque tuée, la langue d’oc, le provençal, le « lemozi » s’entend encore […]. La langue perdue crée une distance exceptionnelle. Comme nulle part ailleurs l’amour de la langue, s’il tente de s’approprier cette poésie, dont le moteur unique est l’amour, se trouve devant elle comme devant un amour de loin63.
39Dans la prose d’Éros mélancolique, cet art de l’oubli a sa couleur de prédilection, proche du blanc (couleur du fantôme) : le gris, qui donne à voir son processus d’effacement. « We fade to gray », selon le dernier chapitre du livre. Les auteurs restituent l’oubli dans sa dynamique, lui associent une poétique, qui relie étroitement expérience de la langue et expérience amoureuse, fantasme et fiction. Le processus de hantise, valorisé, est assimilé à un don, réciproque … :
Vous héritez d’une histoire. Ce n’est pas la vôtre.
L’histoire, est-ce jamais la vôtre ?
Toujours celle d’un autre, celle d’autres.
Elle vient trancher le fil de vos pensées, traverser vos labyrinthes amoureux. Elle s’offre à vous hanter64.
40… autant qu’à un deuil, constitutif, qui fait toujours revenir les « vrais » fantômes, ceux des êtres qu’on a aimés et perdus :
Au fond des tiroirs, des meubles à secret, entre des draps, dans des enveloppes, des coffres, des valises, dorment les traces d’un deuil, d’un exil, d’un abandon qu’un deuil, un exil, un abandon, un naufrage dans la mer du temps rejettent aux bords où vos fuites vous laissent. Traces fantômes, encore pâles, interférences de la lumière dans les boîtes noires, chambres, rues nocturnes. Ombre double que portent les corps exposés à l’histoire. Et tout ce qui sombre, brûle, se désagrège, épars65.
41L’autre monde de la fiction rejoint alors le réel – ou plutôt : cet art de l’oubli permet aux disparus de se survivre dans les choses, de la nature ou de l’art. Dans Éros mélancolique, cette concrétisation de l’oubli est illustrée par le projet photographique du personnage, qui fabrique ses propres non-lieux66 de mémoire. Elle s’achève de façon minimaliste, à la dernière ligne du livre, sur le lent devenir-gris de quatre objets naturels : « we fade to gray, lumière, encre, corps, sel » : dégradation rythmique qui se clôt sur un monosyllabe désignant ce qui, par la dissémination, résiste au temps et donne du goût aux choses.
2-4 Tombeau de la prose
42Une grande partie de l’œuvre de Jacques Roubaud s’écrit dans l’ombre portée de la perte et du deuil. Si c’est avec le décès d’Alix Cléo que la mort fait son entrée la plus manifeste dans son œuvre, où elle marque une rupture radicale, la disparition, qu’elle se dise clairement ou obscurément, est au centre de la plupart des textes de l’auteur. Le grand empan chronologique du ‘grand incendie’, qui embrasse jusqu’au temps de l’ « avant-vie » de Roubaud, permet de prendre la mesure de la place qu’occupe du deuil dans l’ensemble de son œuvre. Une place constitutive, puisqu’elle est à la racine du Projet et du Roman qu’il a portés pendant une vingtaine d’années, double édifice ruiné dont le ‘grand incendie’, rédigé symétriquement sur plus de vingt ans67, manifeste et entretient, on l’a dit, la survivance fantomatique.
43 Avant d’être abandonnée, la double entreprise du Projet de Poésie et du Roman a constitué, pour l’auteur, le « projet d’une existence », comme « alternative à la disparition volontaire » (gril, p. 13). Formule ambiguë, où le sujet de la disparition, qui n’est pas précisé, peut être tout autant l’auteur lui-même que son frère, dont on apprendra beaucoup plus tard, dans la branche V, que son suicide a précédé le rêve fondateur de ce projet d’existence68. Au fil des méandres de la prose de mémoire du ‘grand incendie de londres’ se confirme et se précise le rôle qu’il devait jouer, à savoir celui d’une « décision de survie » (gril, p. 1371), autrement dit encore, d’un deuil :
Il me fallait faire de la poésie plutôt que rien, faire de la mathématique, plutôt que rien ; qu’il y ait cela dans ma vie plutôt que rien ; mais sans promesses d’aucune sorte, ni d’accomplissement, ni de bonheur […]. (gril, p. 1365)
44Et :
Il faut que le projet de Poésie soit un isolant conte les insinuations de la douleur. […] Je n’ai pas compris ma douleur de la mort de mon frère, je n’ai pas compris le pourquoi de sa mort, ni l’à-quoi-bon, mais je me suis obstiné dans l’établissement d’une forme personnelle de poésie. (p. 1385).
45Dans ce qui reste de ce Projet de Poésie dans la prose déchue du ‘grand incendie’, les morts se manifestent essentiellement à la faveur de lacunes narratives, trous dans le texte ou blancs dans la suite des images-mémoire, selon un modèle hérité que Roubaud désigne d’abord comme familial :
J’ai hérité d’une double tradition, de silence et de deuil, où les morts, après vingt ans, trente, ou cinquante, omniprésents encore, n’apparaissent pourtant que dans les creux d’un mutisme, conservant une existence violente de trous noirs contournés par les paroles, mais s’y manifestant, soulignés par quelque timbre, quelque vibration, quelque déplacement dans la trajectoire d’un récit : places absentes dans des pages d’albums, images perpétuellement comme en train de brûler mais pas assez complètement pour que l’ombre, l’odeur ne se fassent encore sentir. (gril, p. 99)
46À la lecture précise du texte, la dette se révèle aussi médiévale. L’ensemble de la branche II – sur laquelle reviendra Parc Sauvage, publié vingt-cinq ans plus tard – gravite ainsi autour d’une image manquante obsédante associée à un arbre, « l’If aux fourmis », qui s’élevait dans le parc abandonné d’un domaine des Corbières où Roubaud passait ses vacances étant enfant, dans les années 1940. L’aveu de la rétention de cette image apparaît de manière différée, au gré d’une incise à la fois dense et elliptique où l’image occultée entre en résonance avec une autre image, médiévale cette fois, qui met en scène Perceval échouant à retenir l’attention d’un enfant, qui disparaît sans lui répondre dans les branches d’un arbre. L’incise n’apporte aucune lumière sur l’association de « l’If aux fourmis » avec « l’arbre à l’enfant », qui demeurera le point aveugle de cette élucidation obscure. L’analogie entre l’image non dite et l’image médiévale ne s’établit qu’autour du silence observé par l’auteur, à la faveur d’un « saut » par lequel on passe de la scène de l’arbre à l’enfant à celle du cortège du Graal, où Perceval échoue, comme on sait, à interroger ce qu’il voit : « Je suis resté silencieux, moi aussi », écrit Roubaud. Et il précise : « J’ai laissé muette, non dite, dans la scène au pied des ifs une autre image. Et une autre encore […]. » (gril, p. 664). Les raisons de cette occultation resteront, elles aussi, non dites. Comme nous l’avons montré ailleurs69, cette image soustraite à l’écriture, que la figure de Perceval révèle en négatif, n’est pas la seule à hanter La Boucle. Plus obscurément encore – car elle reste totalement implicite – une autre vient marquer le texte de sa présence en absence : il s’agit de la scène célèbre où le Perceval de Chrétien contemple trois gouttes de sang tombées sur la neige. La Boucle, qui s’ouvre sur une neige d’enfance, se ferme sur la vision des déportés de retour à l’hôtel Lutetia et sur les champs de neige ensanglantés de la guerre qui viennent, a posteriori, se superposer au blanc immaculé du début de la branche. De l’image montrée et escamotée de l’arbre à l’enfant à l’image latente du sang sur la neige, Perceval est ici le signe paradoxal d’une scène manquante, soustraite à l’écriture, qui montre – sans les dire – le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et la tragédie de ceux qu’elle aura fait disparaître.
47Plusieurs raisons peuvent expliquer que Perceval soit le héros négatif de ces deux images spectrales : comme l’avance immédiatement Roubaud lui-même, il est le personnage par excellence de la parole défaillante et de la quête inaccomplie. Il est aussi, dans les trois scènes médiévales qu’appelle implicitement ou explicitement la deuxième branche du ‘grand incendie’ (la scène de l’enfant dans l’arbre, celle du Graal, celle des gouttes de sang), le spectateur fasciné d’une image ou d’une représentation qui se dérobe littéralement à lui. Il est enfin un personnage médiéval : les caractéristiques qui lui sont propres entrent en consonance étroite avec la matière médiévale, matière immédiatement lacunaire et mouvante, non seulement accueillante aux fantômes, mais aussi créatrice de survivances fantomatiques – à l’instar, exactement, de toutes les proses de mémoire roubaldiennes.
48‘Le grand incendie de londres’, qui occupe le centre rayonnant de ces proses de mémoire, n’est en effet pas seulement le récit affaibli de la survivance d’une architecture ruinée. Il se veut aussi lui-même, comme l’affirme vigoureusement son auteur à plusieurs reprises, une entreprise de démolition, où l’écriture de mémoire œuvre à sa disparition. Cette visée s’affirme dans les deux branches de seuil, respectivement intitulées « Destruction » et « La Dissolution », mais aussi dans le titre de l’ouvrage, qui a d’abord été celui de la première branche lorsqu’elle était encore unique :
[…] ‘le grand incendie de londres’ actuel, cette branche unique, est quelque chose comme The Great Fire of London : Londres étant le lieu de ma mémoire, en ses souvenirs ; ses maisons, mes souvenirs ; et le feu, ma mémoire qui les détruit.
Car je ne recherche pas les traces du temps pour, les rejouant devant mes propres yeux, rentrer, au moins le temps d’un récit, dans la jouissance d’une possession perdue, je les atteins pour les détruire, pour les abolir. (gril, p. 380)
49La mise en prose de la mémoire engendre dès lors des fantômes, au sens augustinien du terme : des doubles secondaires qui hantent le texte, qui sont là « quelque part » sans y être vraiment :
Mais le souvenir, si je l’interroge maintenant, à l’occasion de sa description, ou simplement en y pensant, est désormais immobile ; et c’est lui maintenant qui est second, qui est le fantôme, le simulacre. Je l’ai perdu, et perdu sans l’avoir même oublié. Car, bien sûr, il est en même temps devenu inoubliable, puisque je peux y avoir accès à tout instant, si je le veux, comme un savoir que je commande. Il est là, quelque part dans la prose. Il est là, il est ; et il est mort. (gril, p. 231)
50Si la prose du ‘grand incendie’ consiste bien à « dompter les démons », selon le style ancien du « rakki tai » revendiqué par Roubaud, ce travail de mise à distance se fait ici radical, puisqu’il tend à annihiler la mémoire en même temps que les démons qui l’habitent. Mais il s’agit bien sûr d’une visée à la fois inatteignable et contradictoire. Inatteignable, parce qu’il est vain d’espérer conjurer des dibbouks rebelles à toute tentative de pacification70. Contradictoire, puisque le récit du ‘grand incendie’ élève un tombeau « inoubliable » – pour l’auteur mais aussi pour ses lecteurs – à cela même qu’il veut détruire. Par cette entreprise paradoxale, la prose roubaldienne rejoint, à sa mesure brutale et imparfaite, la voie de la poésie négative de Raimbaut d’Orange que Roubaud a notamment célébrée dans la Fleur inverse, où le chant poétique s’élève depuis la négation de ce qui, habituellement, le suscite (la douceur de l’aube, le renouveau printanier, l’amour). Dans cette composition inversée, la disharmonie et l’obscurité du vers renchérissent sur l’hiver amoureux tout en laissant résonner, spectralement mais aussi pour toujours, l’écho de ce qui a été perdu :
[…] dans le désert du gel fleurit une fleur paradoxale, dans son silence résonne une insistante disharmonie, et de cette floraison ‘hirsute’, comme de cette atonalité polaire, renaissent, à l’évocation vibratoire du vers, simultanément la musique heureuse et sa disparition désespérée. (gril, p. 407).
51.