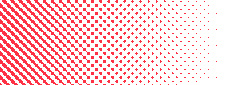Théories littéraires féministes des années 1970 : situer et engager l’écrit
1Les mouvements de libération des femmes des années 1970 sont à la fois marqués par leur radicalité révolutionnaire et par leur créativité : chansons, tracts, revues, livres, films, œuvres d’art diverses se multiplient, car il s’agit de permettre aux femmes de prendre leur place sur la scène culturelle et d’y créer de nouveaux discours, artistiques et politiques — les femmes doivent se rendre visibles, elles, leurs créations et leurs idées1. Il s’agit aussi pour les féministes de théoriser ce qui est en train de se passer et ce qui doit encore advenir : qu’est‑ce que le féminisme ? Que devrait être une révolution des femmes, quelles formes pourrait‑elle prendre et quelles directions choisir ? Certaines placent prioritairement leur énergie dans la création littéraire ou dans la pratique artistique, d’autres dans les manifestations, groupes de parole et tractages — d’autres encore, dans la rédaction de textes de réflexion donnant sens au mouvement. Cet article voudrait s’intéresser à ces décalages et à la manière dont on arrive, ces années‑là, à penser le mouvement des femmes tout en rejetant « la théorie ». Ce rejet les incite à imaginer de nouveaux modes de discours et d’écriture, à formuler de nouvelles idées venant bouleverser les normes épistémologiques courantes. Nous tenterons ainsi de montrer au fil de l’article comment s’installent progressivement, pendant ces années cruciales du féminisme, les bases de nouvelles pratiques et théories littéraires et de nouvelles épistémologies.
2Les féministes françaises des années 1970 manifestent un malaise certain face à ce qu’elles nomment « la théorie » : « la théorie » est selon elles un mode de discours à la fois monopolisé par les hommes et misogyne. Très souvent, elle correspond dans leurs textes à des discours philosophiques ou psychanalytiques : c’est le cas chez Hélène Cixous, Annie Leclerc2, Luce Irigaray3, Benoîte Groult4. Dans d’autres cas, le terme de théorie connote à la fois la psychanalyse et le féminisme : « on ne connaît [...] sur la planète Terre aucune théorie du lit du genre féminin », explique par exemple Évelyne le Garrec avant d’entamer sa propre étude féministe sur le « lit à soi » des femmes5 — à la fois geste de rejet de la théorie psychanalytique et geste de fondation d’un nouveau type de discours. Dans les textes de ces femmes, quand ce n’est la psychanalyse que désigne « la théorie », c’est le marxisme, ou d’une manière générale les idées de la gauche révolutionnaire masculine, car « sous leurs théories pseudo‑révolutionnaires et pseudo‑modernes, ils perpétuent fidèlement » les vieilles idées qui oppriment les femmes6. En effet la plupart des féministes des années 1970 viennent des luttes de la gauche. Elles ont lutté auprès des hommes pour les mêmes causes qu’eux : le dialogue du féminisme avec les pensées marxistes est permanent ; nous verrons qu’il est particulièrement déterminant dans l’élaboration progressive d’une nouvelle compréhension des discours et épistémologies féministes. Mais le féminisme dit de la seconde vague est né aussi du malaise que ces femmes ont ressenti à ce moment‑là : leurs problèmes spécifiques n’étaient pas suffisamment pris au sérieux par ces hommes, même révolutionnaires — ni leur parole, ni leurs reproches. Pire, cette négligence envers la condition des femmes confinait à une faute de raisonnement politique : selon les féministes, une analyse du capitalisme est incomplète quand elle ne s’articule pas à une analyse du patriarcat. Ainsi, quand les féministes détachent leur lutte de celle des hommes — certaines d’entre elles du moins —, c’est également du goût marxiste pour la théorie qu’elles se séparent avec dédain : « elles n’ont pas de système politique à proposer ni de théories ni de schéma linéaire. Seulement des rêves, mais qui ne sonnent pas le creux7 ».
3En même temps, il apparaît clairement à toutes qu’il y a de la théorie qui est en train d’être créée. Cette théorie englobe dans leurs discours tout ce qui est formulé comme critiques du patriarcat : on peut par exemple parfois parler de manière précise de « la théorie d’après laquelle les femmes ne sont violées qu’avec la complicité de tous les hommes8 », ou parfois d’une manière plus générale désigner les idées féministes, quand des femmes envisagent par exemple de « mettre leur vie privée en accord avec leur théorie9 ». Parfois on prend ensemble « théorie » et « pratiques », considérant que ce sont les deux faces d’un même travail politique féministe : « Revendiquons le droit à la théorie, à la mise en place des pratiques10 ». Mais justement : pour certaines des femmes du mouvement, ce fait qu’il y a de la théorie en train d’être élaborée pose problème. Cela signifie pour elles qu’au lieu de se libérer, les femmes s’enchaînent un peu plus encore dans une forme de culture jugée pourtant délétère. Pour certaines, notamment pour celles qui sont le plus intéressées par des questions de création littéraire, il faut alors « passer de la théorie à ce que l’on nomme fiction11 » ; il faut quitter ce mode de discours sérieux et « phallocentrique12 » pour ouvrir à plus de parole libre et créative : « toute théorie peut être jasée, c’est une question de style13 ». Hélène Cixous a ainsi souvent affirmé son refus absolu de la théorie, du savoir stable, et préfère proposer des réflexions poétiques, fondées sur des glissements sémantiques qui, perpétuellement, viennent faire dérailler le « logos14 ». D’autres femmes voient un autre problème à la construction de nouvelles théories féministes : celles‑ci instaurent de nouveaux types de dissymétries, voire de nouveaux rapports de domination au sein même du mouvement des femmes. À la fin de la décennie, c’est par exemple ce que Monique Wittig formule comme critique — et avec elle les féministes matérialistes, Colette Guillaumin en particulier — à certaines féministes trop influencées, à ses yeux, par les théories psychanalytiques et par l’écriture du « féminin »15, quand elle leur reproche d’essentialiser les « différences » au lieu d’y réfléchir politiquement.
4Le mouvement des femmes s’oppose donc dans l’ensemble, de l’extérieur, à la théorie des hommes ; dans ce cas la théorie est pensée à la fois comme le résultat et comme l’outil du patriarcat — il faut l’évacuer. De l’intérieur en revanche, certaines femmes reconstruisent d’autres théories, et leurs manières de les définir dessinent les grands nœuds du mouvement, parfois ses ruptures — en somme, son histoire. Dans cet article visant à « situer la théorie », nous nous concentrerons sur les cas d’Hélène Cixous et de Monique Wittig. Elles représentent toutes les deux des pôles importants du mouvement, mais ont des manières différentes de travailler leurs positionnements théoriques — c’est-à-dire par rapport à « la théorie » hégémonique, à leur propre littérature et à la manière dont elles l’articulent à leur pensée politique. C’est au moment de définir ce que « l’écriture féminine […] fera16 » qu’Hélène Cixous formule un refus net de « la théorie ». Chez Monique Wittig aussi, et bien qu’elle se situe à certains égards à l’opposé d’Hélène Cixous sur la carte des positionnements féministes de l’époque17, c’est au moment de réfléchir sur la littérature que les idées s’entrechoquent et produisent un effet d’attraction-répulsion par rapport à la théorie. Le présent travail tient donc ensemble plusieurs enjeux : comprendre comment les écrivaines féministes de la période, Hélène Cixous et Monique Wittig en particulier, car ce sont elles qui ont formulé le plus de théorie littéraire, se sont positionnées par rapport à « la théorie » — comment elles l’ont comprise et critiquée, ce qu’elles en font, comment elles la transforment dans leurs propres travaux — ; puis mettre en relation leurs pensées politiques et littéraires en évaluant les interconnexions et les échanges possibles.
« L’écriture féminine » : en tant que femmes, le refus de la théorie
5Hélène Cixous est la première à avoir donné un nom à « l’écriture féminine », même si elle n’en a pas à proprement parler dressé la « théorie » (puisqu’elle rejette absolument ce terme). « L’écriture féminine » est initiée comme un mouvement ouvert vers l’avenir, comme un souhait. L’expression apparaît pour la première fois dans l’ouvrage La Jeune née, recueil d’entretiens menés avec Catherine Clément et publié en 197518. La même année, Hélène Cixous reprend ses propos dans « Le Rire de la Méduse » pour les y prolonger : « Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera19. » Parler, donc, plutôt que théoriser. Comme « la femme » qui prend la parole devant un large auditoire, « [s]on discours, même “théorique” ou politique, n’est jamais simple ou linéaire, ou “objectivé” généralisé : elle entraîne dans l’histoire son histoire20. » C’est-à-dire, selon H. Cixous, que le discours entretient un rapport étroit avec le corps : il s’engage dans la prise de parole, il « signifie », de la pensée est matérialisée « charnellement ». Le discours a aussi à voir alors avec la « pulsion » et l’« indisciplinable » qui détermine la parole quand celle-ci part du corps. En tout cas il ne s’agit ni de théorie, ni de poétique, ni d’objectivité. Quelques pages plus loin, Hélène Cixous le redit en italique :
Impossible de définir une pratique féminine de l’écriture, [...] impossibilité qui se maintiendra car on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l’enfermer, la coder [...]. Mais elle excédera toujours le discours que régit le système phallocentrique ; elle a et aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnés à la domination philosophique-théorique21.
6Deux pôles : d’un côté les entreprises de théorisation, pensées comme « discours » et « définition » ; de l’autre la « pratique » de l’écriture féminine qui « a et aura lieu » et « excédera » le discours. Il y a dans ces formulations une légère prétérition : dans ce texte, Hélène Cixous pose des définitions alors qu’elle suggère qu’il ne le faudrait pas — la théorie est bien définie comme une « domination » liée au système « phallocentrique » et l’écriture féminine, en creux, comme une subversion ou une libération. Plus loin dans le texte, le ton se libère cependant de cette contradiction. Rejetant fermement « les défenseurs de la “théorie”, les béni-oui-oui du Concept22 », Cixous passe à un mode de discours plus affranchi des normes d’un certain discours théorique pour avertir ses lectrices des obstacles qu’elles rencontreront en cherchant à écrire au « féminin » :
Soit qu’aujourd’hui sortant de leur période infans, elles se voient soudain assaillies par les bâtisseurs de l’empire analytique, et, dès qu’elles formulent le nouveau désir, nu, sans nom, et tout gai d’apparaître, les voilà prises au bain par les nouveaux vieillards, et hop ! oblique, fringué de modernité le démon de l’interprétation leur vend sous clinquants signifiants les mêmes menottes et autres enchaînantes breloques : deuxième version, l’“éclairée”, de leur pudique abaissement. Quelle castration tu préfères ? Lequel tu aimes mieux, celui du père ou celui de la mère ? Ô les zolis zyeux, tiens, zolie petite fille, achète-moi mes lunettes et tu verras la Vérité-Moi-Je te dire tout ce que tu devras croire. [...] Les nouvelles arrivantes, si elles osent créer à l’écart du théorique, sont interpellées par les flics du Signifiant, fichées, rappelées à l’ordre qu’elles sont supposées savoir [...] Amie, garde-toi du signifiant qui veut te reconduire à l’autorité d’un signifié23 !
7Le programme que propose Cixous est alors tenu : beaucoup d’éléments viennent dans cet extrait enrayer la tentation théoricienne — incises, exclamations et onomatopées, jeux de mots, interpellations… Il s’agit en réalité d’un avertissement : le principal écueil que les écrivaines rencontreront sera la tentation de produire de la théorie. Hélène Cixous établit clairement une proposition axiologique : d’un côté se trouve « le nouveau désir [...] tout gai », positivement connoté, de l’autre « la théorie », assimilée à une invasion impérialiste (« assaillies », « empire », « enchaînantes ») ou policière (« menottes », « les flics du Signifiant »), à un conservatisme ringard (« vieillards ») et au ridicule (« clinquants », « breloques »). Cixous semble ainsi proposer l’idée que le mieux serait, pour les femmes, d’en rester au stade du désir « nu, sans nom », et d’éviter de produire du texte sur le désir. « [C]réer à l’écart du théorique » devient alors le rôle et le défi de « l’écriture féminine » : il s’agit d’un projet quasi-utopique que les textes de Cixous rêvent souvent, où les femmes s’autorisent à parler, écrire, et enclenchent ainsi un mouvement de création révolutionnaire.
8Il faut en effet remarquer que c’est aux femmes qu’Hélène Cixous s’adresse : bien qu’elle affirme dans le texte que « l’écriture féminine » ne concerne pas seulement les femmes, c’est bien d’« elles » et à « elles » qu’elle parle, des femmes qui avant d’écrire sont « infans » et « petites filles » ; en face, des « ils » constituent le discours de l’ordre. Quoiqu’elle soit destinée à terme à libérer également l’écriture des hommes et ne désigne pas seulement, en principe, une différence sexuée dans le rapport à l’écriture — il s’agit précisément de déconstruire les définitions figées du « féminin » —, « l’écriture féminine » est ainsi posée avant tout comme une affaire de femmes, et c’est donc en tant que femmes que les écrivaines doivent se garder de la théorie, emblème d’un système dont elles veulent sortir. Dans La Jeune née ce rejet s’étend au discours sur l’enseignement — là aussi, une différenciation est nettement posée entre les femmes et les hommes. En tant que professeure, Hélène Cixous refuse, dit-elle, d’emprunter le discours de maîtrise de ceux qui dominent ; elle préfère ouvrir sa parole et accueillir une multiplicité de discours différents.
il y aura des milliers d'autres types de parole féminine, et puis il y aura le code de communication générale, le discours philosophique, [...] mais avec, en plus et tout à fait ailleurs, une quantité de discours subversifs24.
9L’insistance sur la multiplicité des discours « subversifs » est une manière, pour Hélène Cixous, de suggérer le leurre que représentent les notions d’objectivité et de savoir telles qu’on les définit traditionnellement. C’est aussi pour elle une manière de garantir une possibilité d’expression depuis tous les points de départ possibles et imaginables de la pensée. Dans ses textes, Hélène Cixous ne désigne pas seulement son identité de femme comme étant à l’origine d’un rapport empêché à la langue et à la culture hégémoniques : elle évoque aussi très régulièrement — et en même temps — son identité de femme juive, ou ce que son rapport à sa mère a fait à la construction de son identité, ou encore de ce que la forme de son nom — « Cixous » — génère comme malaise dans son propre rapport à son identité et au langage. Les sources du malaise sont multiples et indémêlables ; garantir la multiplicité des discours, la possibilité de l’explosion des discours stables, est une manière de prendre en compte cet indéchiffrable et de le transposer en littérature.
10L’enseignement pose un problème pratique à cet égard : comment transmettre l’instabilité ? Hélène Cixous continue : les enseignantes, selon elle, travaillent plus les « manques » et les « non-savoirs25 » de leurs cours que leurs collègues masculins. D’abord parce que le « non-savoir » est la place qu’on leur a toujours réservée dans l’histoire, mais aussi selon Cixous parce que c’est la place que les femmes doivent préserver pour elles-mêmes — quand on cherche à maîtriser des concepts, explique‑t‑elle, on risque toujours de se mettre à exercer des violences. Ainsi, dans ses textes de 1975, Hélène Cixous propose que les femmes se mettent à parler plus, mais qu’elles se concentrent sur un type de discours créatif, qui fonctionne sur le mode du symbole et refuse de devenir théorie ou savoir. En tant qu’elle est enseignante à l’université, et fondatrice de l’un des centres de recherche sur l’histoire des femmes les plus importants en France, il faut sans doute voir dans cette proposition un paradoxe fondateur : professeure qui refuse les discours théoriques et les savoirs qui inclinent trop au dogme, elle maintient sa pratique dans un mouvement paradoxal de critique et d’ouverture.
Monique Wittig : le début d’un (lesbian) feminist standpoint
11Monique Wittig et Hélène Cixous ont en partage une méfiance envers la théorie et les dominations qu’elle semble créer, et un sentiment d’urgence à parler depuis un autre « lieu ». Wittig se dresse quant à elle contre un discours théorique précis, qu’elle nomme « pensée straight »26, c’est‑à‑dire un « ensemble de mythes hétérosexuels […] un système de signes27 » qui déterminent la place de chacun·e dans la société et ses possibilités d’existence, en fonction d’un « contrat social » qui coïncide avec une norme d’hétérosexualité28. « La pensée straight » est donc selon elle non seulement un discours, « système de signes » « phallocentrique » comme celui que critique Cixous — le titre de sa communication est une allusion à La Pensée sauvage (1962) de Claude Lévi-Strauss, régulièrement critiqué à l’époque pour la misogynie qui se révèle dans ses études29 —, mais aussi un discours « hétérosexuel » et une forme d’« oppression matérielle » bien réelle « des individus par les discours30 » . Par rapport à « la théorie » désignée par Cixous, il y a donc un déplacement : alors que Cixous s’oppose en général au logos, quel que soit au fond son contenu, à partir du moment où il décrète et stabilise un sens et cherche à l’imposer, Wittig s’oppose à un type de discours défini par ce qu’il dit : Wittig désigne « les mythes hétérosexuels » comme sources de domination et cherche à formuler une politisation « matérielle » de sa critique. Les deux démarches, on le constate, ont un certain nombre de points communs : elles s’intéressent au mythe, à la fiction qui structure le réel, depuis leurs positions d’écrivaines ; il s’agit aussi pour elles deux de sortir des « catégories31 », soit en les dépassant, soit en les démontant.
12Pour Wittig, le problème de la théorie ne tient pas seulement à ce qu’elle monopolise l’espace et fait taire « les opprimés », mais aussi au fait qu’elle les empêche même de penser :
L’ensemble de ces discours effectue un brouillage — du bruit et de la confusion — pour les opprimés, qui leur fait perdre de vue la cause matérielle de leur oppression et les plonge dans une sorte de vacuum a-historique32.
13Dans ce sens, Wittig explique que le discours a un pouvoir « matériel » sur les individus. « La pensée straight » les enferme dans un système théorique qui les empêche radicalement d’agir, parce qu’elle pose les dominations comme naturelles et vides de sens historique. Les mots que « la pensée straight » emploie pour parler des rapports entre individus sont « du bruit et de la confusion » ; ce discours théorique précis monopolise tout le champ de la signification en empêchant la pensée critique de se former.
Ces discours parlent de nous et prétendent dire la vérité sur nous dans un champ a-politique comme si rien de ce qui signifie pouvait échapper au politique et comme s’il pouvait exister en ce qui nous concerne des signes politiquement insignifiants33.
14Autrement dit, la « pensée straight » est un mensonge : un discours qui prétend posséder intégralement le sens et l’imposer à tou·tes, qui le naturalise et nie qu’il est une forme de pouvoir politique pris sur les individus. Comme à Hélène Cixous, il apparaît à Monique Wittig qu’il faut lutter et faire entendre autre chose ; mais chez Wittig il n’y a pas refus de toute théorie stabilisée ou de toute formation de savoir, fondé sur un paradoxe, il y a plutôt le souhait d’élaborer une nouvelle philosophie de la connaissance. Celle-ci se construit par rapport à des préalables théoriques qui appartiennent, eux, à une culture qui n’est pas féministe — en particulier au marxisme et aux philosophies du langage34.
Cet ensemble de mythes hétérosexuels, c’est un système de signes qui utilise des figures de discours et donc il peut être étudié politiquement depuis la science de notre oppression [...] dynamique qui introduit la diachronie de l’histoire dans le discours figé des sciences éternelles. Ce travail devrait être en quelque sorte une sémiologie politique35.
15La solution proposée par M. Wittig est double. D’une part, politique et discours sont pris ensemble dans l’étude des signes qui traversent et déterminent les rapports de domination, qui les structurent, les perpétuent ou les déplacent chaque jour dans les discours ; en ce sens, analyses politique et littérature, par l’attention qu’elles porteront au langage, pourront joindre leurs forces pour combattre la pensée straight. D’autre part, il faut parler « depuis la science de notre oppression » : sur ce point, Monique Wittig reprend l’épistémologie marxiste selon laquelle personne n’est plus apte à comprendre le système que celles et ceux qui se trouvent opprimé·es par lui et qui réfléchissent collectivement à cette oppression — soit les prolétaires pour Marx, et les lesbiennes pour M. Wittig, par rapport au système hétéropatriarcal (straight). Plus tard, en 1983, Nancy Hartsock deviendra la référence internationale d’une telle idée en adaptant la théorie marxiste au féminisme, en redéfinissant aussi les bases d’un « Feminist Standpoint » sur l’idée d’inspiration marxiste que les personnes opprimées occupent un point de vue épistémologiquement privilégié sur le monde36. Réfléchir « depuis la science de notre oppression » n’est pas une évidence à l’époque : comme le remarquent Éléonore Lépinard et Marylène Lieber, la pensée des féministes matérialistes françaises, dont fait partie M. Wittig, forme les prémices des futures épistémologies féministes37.
16Si l’on reprend la citation donnée plus haut, on constate que Monique Wittig se trouve face à un dilemme : d’un côté, les dominant·es refusent l’idée que des opprimé·es minoritaires (en l’occurrence, des femmes ou des lesbiennes) puissent avoir un point de vue depuis lequel énoncer des vérités sur la société en général — on les renvoie au particulier et au marginal — ; de l’autre, certaines des femmes en lutte refusent elles-mêmes qu’une « science » soit nécessaire pour politiser le combat — c’est sur ce point que Wittig se trouve en opposition par rapport aux choix de Cixous.
17M. Wittig critique régulièrement, dans le mouvement de libération des femmes, le pas que prennent les discussions sur l’action de groupe concrète, ainsi que les démarches d’autocritique qui entraînent selon elle un piétinement du mouvement et une ambiance de tribunal populaire38 : tout cela entraîne un resserrement des questions féministes sur les cas individuels, plutôt que cela n’engage une libération collective. Ces groupes sont, selon M. Wittig comme selon la théorie épistémologique et politique marxiste traditionnelle, la condition nécessaire mais non suffisante d’une authentique prise de conscience par l’individu de sa situation de classe opprimée et d’individu opprimé. C’est dans ce sens, pour M. Wittig, qu’une « science de l’oppression » doit naître dès que les femmes deviennent « des sujets dans le sens de sujets cognitifs39 » ; elle consiste en
[la] totale réorganisation conceptuelle [du monde social] à partir de nouveaux concepts développés du point de vue de l’oppression. C’est ce que j’appellerais la science de l’oppression, la science par les opprimé(e)s. Cette opération de compréhension de la réalité doit être entreprise par chacune de nous : on peut l’appeler une pratique subjective, cognitive. Cette pratique s’accomplit à travers le langage, de même que le mouvement de va-et-vient entre deux niveaux de la réalité sociale (la réalité conceptuelle et la réalité matérielle de l’oppression)40.
18Il n’y a donc pas de rejet du travail de théorisation chez Monique Wittig — au contraire elle revalorise le rôle du langage et des concepts —, mais un appel à la dé-structuration de la « pensée straight » et à la fondation d’un nouveau type de connaissance, fondé à la fois sur la prise en compte politique des points de vue situés des minoritaires et sur une circulation permanente entre savoirs théoriques et savoirs pratiques. La littérature se trouve à l’intersection des deux domaines et propose le travail sur la langue nécessaire à une refondation des bases de la pensée. C’est aussi dans ce sens que Wittig affirme qu’« être une lesbienne, se tenir aux avant-postes de l’humain ou de l’humanité représente historiquement et paradoxalement le point de vue le plus humain41. » Parmi les femmes, les lesbiennes sont selon Wittig les seules qui vivent une situation pratique et théorique qui se tienne (en partie) hors du système hétéropatriarcal, elles sont ainsi les personnes qui occupent la meilleure position pour accomplir ce programme de refondation des connaissances :
c’est ce que les lesbiennes disent un peu partout dans ce pays sinon avec des théories du moins par leur pratique sociale [...] Qu’est-ce que la-femme ? [...] Franchement c’est un problème que les lesbiennes n’ont pas, simple changement de perspective, [...] la-femme n’a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes42.
19Le point de vue offert par les lesbiennes sur le monde social ne tient pas seulement de la théorie selon Wittig, mais aussi et avant tout d’une « pratique sociale » qui permet ce « va-et-vient », et lui-même garantit la pertinence de la connaissance. Cela dit, selon M. Wittig, cette position « lesbienne » non plus ne doit pas être réifiée, sans quoi une forme d’assignation violente peut réapparaître : le travail de théorisation est pensé comme acceptable à la seule condition qu’il reste une dynamique, en féminisme comme en lesbianisme.
Sur le plan théorique, le lesbianisme et le féminisme articulent leurs positions de telle manière que l’un interroge toujours l’autre. Le féminisme rappelle au lesbianisme qu’il doit compter avec son inclusion dans la classe des femmes. Le lesbianisme alerte le féminisme sur sa tendance à traiter de simples catégories physiques comme des essences immuables et déterminantes. [...] le lesbianisme est historiquement la culture grâce à laquelle nous pouvons questionner politiquement la société hétérosexuelle et ses catégories sexuelles43.
20On voit que Wittig théorise : elle travaille des oppositions, définit un « lesbianisme » — presque encore un néologisme à l’époque —, établit un programme de « signification ». Mais sa théorie est un processus critique, un questionnement permanent que les deux pôles politiques du féminisme et du lesbianisme doivent sans cesse remettre en route.
21C’est là qu’intervient, chez Wittig, la littérature : « investie d’une fonction utopique, si ce n’est rédemptrice, la littérature apparaît à la fois comme le lieu privilégié de la critique sociale et comme celui de l’émergence du sujet44. » Le « Cheval de Troie »45 wittigien — d’ailleurs publié à la fois dans l’ouvrage de réflexion politique La Pensée straight et dans l’ouvrage de théorie littéraire Le Chantier littéraire — développe l’idée d’un point de vue situé, qu’elle traduit comme « machine de guerre46 » littéraire. Il consiste à partir d’un point de vue le plus particulier possible pour finalement travailler à atteindre un « universel47 ».
L’entreprise la plus essentielle et la plus stratégique du travail de tout écrivain consiste à universaliser ce point de vue. [...] Plus un point de vue est particulier, plus l’entreprise d’universalisation exige une attention soutenue aux éléments formels qui sont susceptibles d’être ouverts à l’histoire tels que les thèmes, les sujets du récit en même temps que la forme globale du travail. C’est finalement par l’entreprise d’universalisation qu’une œuvre littéraire peut se transformer en une machine de guerre48.
22Cette démarche d’« universalisation » prend plusieurs sens. D’abord, en lien avec les théories politiques de M. Wittig, un sens épistémologique : c’est bien l’inflation du « particulier », à condition qu’elle soit alliée au remodelage politique et littéraire de la langue, qui permet d’exprimer une authentique vision du monde. Elle s’appuie sur l’exemple de Proust, qu’elle choisit de manière à la fois assez prévisible (le point de vue homosexuel de l’auteur l’intéresse) et un peu étonnante (nul point de vue lesbien n’est vraiment proposé dans la narration de la Recherche)49 : selon elle, c’est précisément parce que Proust a pris le point de vue très précis de l’expérience homosexuelle masculine de la haute bourgeoisie au début du xxe siècle (en développant le personnage de Charlus, mais aussi en développant un propos général sur l’homosexualité de plus en plus marqué au fil de la Recherche), qu’il est parvenu à exprimer une société tout entière. En littérature, cette recherche de l’universel prend en outre un autre sens, linguistique et discursif : pour pouvoir s’approprier la langue, l’écrivain doit d’abord dépouiller les mots et les groupes de mots de toute la « gangue » de discours qui les entoure ; c’est seulement une fois qu’il ou elle a récupéré le mot à l’état brut, « diamant pur50 », qu’il ou elle peut prétendre atteindre à l’« universel ». Enfin, cette démarche d’universalisation a aussi un sens pratique — par opposition à un sens théorique. Comme en politique, en littérature Wittig refuse de figer les sens et préfère circuler entre ces deux pôles :
il ne s’agit pas d’un problème éthique mais d’un problème pratique. [...] Mon sujet ici, c’est l’hétérogénéité des phénomènes sociaux qui impliquent le langage tels que l’histoire, l’art, l’idéologie, la politique. [...] Ainsi assemblés, ils tendent à s’annuler les uns les autres. [...] Ce qui est au centre de l’histoire et de la politique c’est le corps social, constitué par des individus. Ce qui est au cœur de la littérature ce sont des formes constituées par des œuvres. Naturellement les individus et les formes ne sont pas du tout interchangeables. L’histoire met en relation des individus, la littérature met en relation des formes51.
23À ce moment-là de sa réflexion, M. Wittig s’oppose à la « littérature engagée52, qui mélangerait sans y réfléchir suffisamment les plans sociaux et littéraires. Pour elle, la littérature est une pratique avant tout discursive et formelle ; si l’on veut lui donner une puissance politique, il faut d’abord la considérer pour elle-même, dans sa forme. Selon Wittig, les théories politiques n’ont pas de place telles quelles en littérature : on peut les situer par rapport à ses effets, mais elles n’ont, selon M. Wittig, rien à faire avec le travail de conception littéraire. Ainsi M. Wittig se méfie‑t‑elle de « la théorie » à double titre : sur le plan politique, elle se tient à distance des discours normatifs qui produisent ou reconduisent des dominations, sur le plan littéraire elle se garde de gâcher son travail linguistique et esthétique par l’annexion de celui-ci à un discours d’idées qui lui serait hétérogène. Théoricienne elle-même, elle n’accepte le discours théorique qu’à la condition qu’il soit fermement ancré dans la pratique et dans une réflexion sur la matérialité des vies et des mots.
De différents usages de la théorisation des points de vue situés : lesbianisme vs bisexualité
24On a l’habitude d’opposer frontalement les figures d’Hélène Cixous et de Monique Wittig, qui font toutes les deux partie des écrivaines les plus connues du mouvement de libération des femmes en France : d’un point de vue politique elles appartenaient effectivement à des tendances distinctes du féminisme de la fin des années 1970. D’un point de vue littéraire aussi, on sait que Wittig ne portait pas en grande estime l’idée de l’écriture féminine — elle en critiquait les tendances qu’elle jugeait essentialistes et dépolitisantes53. Force est de constater pourtant que les écritures de Monique Wittig et d’Hélène Cixous ont certains points communs importants, quant à leur style comme quant à la manière dont ils sont pensés. Cela se comprend aux moments mêmes où Wittig formule ses reproches :
L’action du langage sur le corps est continue. Cette plastie du corps au langage n’est pas représentable. [...] quand on écrit, il y a une intervention du corps mais c’est en tant qu’il produit un travail matériel (non en tant qu’il « secrèterait » une écriture comme si c’était un flux biologique comme dans l’expression malvenue de l’« écriture féminine »)54.
25Pour Wittig le travail sur la langue doit être premier et acharné : elle ne peut que s’opposer à une théorie littéraire qui se contente — telle qu’elle la présente ici — d’une compréhension analogique du rapport des corps aux mots et d’une écriture abandonnée au flux des mots et des associations. Dans les textes d’Hélène Cixous, on trouve l’idée qu’une écriture qui laisse place au corps des femmes, lieu a priori le plus manifeste d’une « différence », et qui travaille à l’analyser, est susceptible de révéler des vérités inédites jusque-là. Mais Monique Wittig elle aussi, même si elle pose les termes de cette réflexion différemment, tente de penser un rapport spécifique du corps à l’écriture. Quand elle affirme ci-dessus que le travail littéraire doit faire passer du plus particulier au plus universel, le corps — de l’auteur·e, du lecteur ou de la lectrice — est impliqué : « L’action du langage sur le corps est continue ». Alors l’identification des femmes à leur corps, opérée selon Wittig par les autrices de l’écriture féminine, n’est peut-être pas très différente après tout de l’idée wittigienne du point de vue « particulier », dans la mesure où il est corporellement situé lui aussi.
26La différence entre leurs positions tient finalement plutôt à la manière dont elles acceptent ou non de recréer de la théorie. Hélène Cixous refuse de produire une forme de savoir stable et officiellement reconnue comme telle ; Monique Wittig l’accepte — quoique ses textes restent toujours ouverts, dans un certain état d’indétermination du sens —, mais cherche à refonder les bases épistémologiques de la production de ce savoir, afin de s’assurer qu’il ne conduise pas à reproduire des effets de dominations. De manière assez frappante, c’est notamment à travers l’utilisation que Cixous et Wittig font respectivement des idées de « bisexualité » et de « lesbianisme » que cette différence dans la manière de situer leurs discours théoriques respectifs se lit le mieux. Toutes deux veulent voir advenir un monde a-patriarcal et y œuvrent à travers l’écriture littéraire ; toutes deux souhaitent faire exploser la théorie, soit par son dépassement et le refus de cadres normatifs, soit par son analyse et la critique politique ; toutes deux rejettent les normes de genre et de sexualité posées par la société patriarcale, et proposent d’inventer par la littérature de nouvelles manières d’exister au monde et de l’exprimer. Mais, chez Wittig, c’est le point de vue particulier et finement situé de femmes à l’existence réelle et politiquement engagée, qui sert de point de départ pour refonder les catégories de la société. Dans ses livres, Les Guérillères (1969), Le Corps lesbien (1973), le Brouillon pour un dictionnaire des amantes (1976, avec Sande Zeig), comme dans ses articles théoriques, elle construit son propos à partir de figures de lesbiennes, questionne fermement la société, ses symboles, ses rouages, et mène un travail de construction utopique et collective d’autre chose — liant fermement ensemble utopie, existence réelle des lesbiennes, sociabilité et lutte politique lesbiennes. Elle-même lesbienne, entourée d’amies et d’amantes lesbiennes, Wittig part d’une situation sociale qu’elle connaît de manière précise, qu’elle vit elle-même et dont elle a l’habitude de parler politiquement — la figure théorique, littéraire et utopique de la lesbienne a ainsi des racines repérables dans le réel. Chez Cixous, le motif équivalent qui lui permet de penser un monde a-patriarcal et utopique est celui de l’« autre bisexualité » ; au contraire de Wittig, Cixous fait le choix d’une catégorie englobante, sans frontières — en partant de l’idée abstraite d’une fusion des identités sexuelles55.
Bisexualité, c’est à dire repérage en soi, individuellement, de la présence, diversement manifeste et insistante selon chaque un ou une, des deux sexes, non-exclusion de la différence ni d’un sexe, et à partir de cette « permission » que l’on se donne, multiplication des effets d’inscription du désir, sur toutes les parties de mon corps et de l’autre corps.
Or cette bisexualité en transes qui n’annule pas les différences, mais les anime, les poursuit, les ajoute, il se trouve qu’à présent, pour des raisons historico-culturelles, c’est la femme qui s’y ouvre et en bénéficie : d’une certaine façon « la femme est bisexuelle ». L’homme, ce n’est un secret pour personne, étant dressé à viser la glorieuse monosexualité phallique56.
27Hélène Cixous crée ce concept au moment de refuser le modèle de la bisexualité freudienne, parce qu’elle refuse « la théorie » phallocentrique. Elle propose sa propre définition de l’« autre » bisexualité, en en faisant quelque chose de féminin — c’est-à-dire construit socialement comme féminin puisque non « dressé » à la « monosexualité phallique ». Dans ce texte qui fonctionne presque comme une définition théorique de la bisexualité — quoique instable —, Hélène Cixous refuse une « bisexualité » qui serait catégorie « effaçante57 » (des femmes), mais propose une autre sorte de catégorie englobante — l’« autre bisexualité » étant ainsi définie dans son texte comme un « univers érotique » et le choix de laisser la « présence » en soi « des deux sexes », de laisser s’exprimer son « désir ». L’utopie bisexuelle rejoint l’utopie de l’écriture féminine : l’exploration du féminin est perçue comme une porte d’entrée vers une déstabilisation radicale de toutes les catégories. Cixous développe aussi la figure de la bisexuelle dans ses récits — Tombe (1973)58, Prénoms de personne (1974)59, Souffles (1975). Mais cette figure, la plupart du temps, renvoie à la narratrice elle-même : on ne trouve pas de questionnement collectif ou politique comme à travers la figure de la lesbienne chez Wittig, mais l’interrogation d’un rapport de soi à soi. La convocation de cette image de « l’autre bisexualité » est une abstraction : une ouverture sur un nouveau possible, inattendu et flou — une attente. « L’autre bisexualité » devient presque une utopie à valeur universelle : Cixous l’adopte pour nommer et particulariser le moins possible, mythifiant un rapport « féminin » au monde, ne prenant pas en charge la singularité des points de vue à l’intérieur de ce « féminin ».
28On peut interpréter cela comme une ouverture maximale à toutes les singularités possibles ; mais cette forme d’abstraction peut aussi ressembler à une forme de gommage universalisant. La fin de la décennie 1970 a de fait été marquée par l’éclatement du féminisme français : certaines femmes du mouvement de libération, notamment les militantes lesbiennes, ont reproché à d’autres d’avoir privilégié des approches abstraites de l’identité et de la sexualité des femmes, en réalité hétérocentrées et coercitives. Wittig en particulier, nous l’évoquions en introduction, souligne l’incohérence qu’il y a à critiquer une forme de théorie, tout en reproduisant de l’abstraction par le fait même de s’engager dans une littérature « féminine » : celles qui prônent l’abstrait se remettent à théoriser depuis des positions dominantes. « Cela nous mène à développer avec complaisance de “nouvelles” théories sur notre spécificité60 », explique-t-elle. Finalement, c’est aussi le refus proclamé de « la théorie », chez certaines, qui attire la critique de Monique Wittig : si « la théorie » est rejetée parce qu’elle est jugée oppressive dans son phallocentrisme, elle est paradoxalement, selon Wittig, redéployée dans un féminisme hétérocentré aveugle aux vrais besoins — politiques et littéraires, épistémologiques et esthétiques — de la lutte des femmes.
Conclusion. Situer les littératures féministes ?
29Au sein de l’« espace de la cause des femmes61 » dans les années 1970, les écrivaines se méfient de « la théorie ». Quelles que soient leurs manières de s’impliquer en politique et de comprendre les luttes féministes, elles estiment dans l’ensemble que « la théorie » correspond à un discours masculin, que les hommes s’arrogent le droit de porter sur la société, aux dépens des femmes notamment. Les théories d’Hélène Cixous et Monique Wittig, si différentes qu’elles soient par ailleurs, sont très proches sur deux points fondamentaux. Premièrement, elles sont d’accord sur l’idée qu’il y a un « point de vue » de départ, féminin ou lesbien, corporel et social dans les deux cas, qui détermine ce que va devenir l’écriture et le sens que prendra son engagement. Deuxièmement, elles sont d’accord sur l’idée que ce « point de vue » est généralement nié et invalidé par « la théorie » dominante. Chez Cixous, le refus de la théorie est alors net et proclamé, quand bien même elle produit elle-même des textes réflexifs sur l’écriture et occupe des situations de pouvoir dans le champ des savoirs. Chez Wittig le refus d’une démarche de théorisation est exprimé de manière moins nette, mais la théorie qu’elle recrée est associée à une claire refondation épistémologique des cadres qui lui permettent d’exister. Chez Cixous, la nouvelle théorie de « l’écriture féminine » est associée à la valorisation d’un « point de vue » féminin, pensé comme point de départ d’une toute nouvelle forme d’expression par opposition au prétendu « point de vue » neutre, en fait masculin, de « la théorie » traditionnelle ; ce point de vue, même s’il est proposé comme un dépassement des catégories de genre, est fondé sur un féminin abstrait. Chez Wittig, la théorisation du point de vue « particulier » n’est pas associée particulièrement au féminin, mais au minoritaire (femme, homosexuel homme dans son exemple proustien, lesbienne) ; ce point de vue particulier a de la valeur en tant qu’il permet de sortir des « catégories » et d’atteindre grâce au travail d’écriture à un sens humain authentique — non à un prétendu universel en réalité masculin et straight. Ainsi, Monique Wittig et Hélène Cixous théorisent à partir d’un ou plusieurs points de vue de femmes, revendiqués comme politiquement et littérairement pertinents : le refus des discours qu’elles nomment « phallocentriques » ou « straight » — « la théorie » qu’elles critiquent en particulier chacune comme oppressive — débouche, chez elles deux, sur une forme de refondation de l’écriture, de la connaissance, et de la manière de penser comment le sujet peut s’y engager.