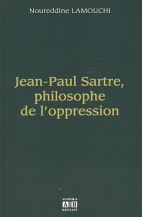
Sartre, retour de Postcolonie
1Quand ce n’est pas par le biais des littératures en langue française produites par les colonisés ou ex-colonisés, c’est généralement par celui des penseurs français ou francophones liés d’une façon ou d’une autre à la période coloniale et à la décolonisation que les chercheurs maghrébins approchent les problématiques dites postcoloniales. En témoigne au premier chef l’inflation persistante des études camusiennes, mais aussi, dans une moindre mesure, l’importance accordée à Sartre, Fanon, Memmi, Foucault, Derrida, voire, récemment à Amin Maalouf. Le centenaire de la naissance de Sartre a suscité l’année dernière en Tunisie plusieurs colloques internationaux, dont les actes sont à paraître, mais une considérable activité sartrienne s’y poursuit depuis longtemps autour, en particulier, de Noureddine Lamouchi, dont nous regroupons ici trois publications récentes pour une commune recension.
2N’étant ni francisant ni sartrien en ce sens, je m’attacherai relativement peu au débat sur la pensée critique et philosophique de Sartre en tant que telle ; ce qui m’intéressera au premier chef dans ces divers travaux, c’est leur méthode, ce qui semble les motiver et la position qu’ils impliquent de la part du chercheur francisant maghrébin vis-à-vis de la théorie, de l’Histoire et de la littérature postcoloniale en général. Ma propre lecture de ces diverses lectures tiendra donc largement de l’analyse indicielle de discours et relèvera principalement de l’esprit d’une « situation ».
Une philosophie de l’oppression est-elle possible ?
3Telle est la question qu’on ne peut manquer de se poser, en s’arrêtant innocemment interloqué par l’ambiguïté du titre « JPS, philosophe de l’oppression » et en le comparant avec la qualité de « philosophe de la libération » qu’on pourrait reconnaître à Marcuse, par excellence. On se demande aussitôt non sans quelque inquiétude si Sartre, vu sous cet angle, ne serait pas, en tout cas, contrairement à Bloch ou à l’École de Francfort, et plus proche d’Ariès ou de Cioran que de Morin ou de Barthes, un pessimiste invétéré, un penseur de l’impossible humain ou de l’inhumain de l’homme —sans recours possible au divin ou même au spirituel, comme Friedmann ou Levinas. Or c’est précisément une telle vision que combat efficacement et succinctement N. Lamouchi à travers une étude qui suit l’évolution de la théorie de l’oppression chez Sartre de L’Être et le néant à la Critique de la raison dialectique en passant par les Cahiers pour une morale. Il la valorise comme un parcours inachevé mais globalement positif : « cette nouvelle attitude de Sartre à l’égard du problème de l’oppression, ne refusant pas l’acquis marxiste, constitue un progrès sensible par rapport au pessimisme sans concession de l’Être et le Néant et des Cahiers. » (Jean-Paul Sartre, philosophe de l’oppression1, p. 93) Parmi les explications de ce changement figurent, d’une part, une nouvelle « croyance à l’intelligibilité de l’Histoire », et, d’autre part, une réflexion et un engagement concrets concernant la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Les mots « croyance » et « histoire » reviennent plusieurs fois, sans qu’on sache au juste si, pour Sartre, l’histoire était finalement une série événementielle ordonnée par des lois immanentes, un récit déterminé par la double exigence d’intérêt et de cohérence narrative, un ensemble d’expériences que la mémoire collective sélectionne en fonction des visées de la communauté ou de l’espèce, ou autre chose encore ; il est toutefois précisé en note que « cette croyance à l’histoire et au progrès n’est nullement une conversion totale au marxisme [...] puisque Sartre reste très réticent envers le “déterminisme marxiste”, auquel il reproche de figer la lutte des classes [...] » (JPSPO, ibid. N. 50) Tout se passe donc comme si a) une véritable théorie de l’oppression n’était possible ni dans le cadre d’une ontologie existentielle — trop individuelle et trop abstraite —, ni dans celui d’une doctrine trop déterministe, voire mécaniste, et b) comme si une adhésion, une croyance (une foi ?), un enthousiasme même lui étaient nécessaires, ce qui implique une dépendance de la pensée vis-à-vis du réalisme d’une « vraie lutte où des hommes, en chair et en os, sont partie prenante. » (JPSPO, p. 93) On reconnaît le thème qui oppose Mathieu à Brunet dans Les Chemins de la liberté. Une « réintériorisation » va de pair avec un passage virtuel (voire actuel) à l’acte. Dans la dernière théorisation sartrienne, l’oppression coloniale et l’escalade « répressive » et « contre-répressive » sur laquelle elle débouche par fusion en solidarité de groupe des sérialités dispersées d’altérités que la colonisation avait produites et entretenues, deviennent décidément des exemples privilégiés (les plus lisibles et les plus pertinents dans le présent) de l’oppression en général, qu’elle soit ou non appariée à et motivée par une exploitation plus ou moins rationnelle ou une surexploitation rationalisée.
4Il semblerait que Sartre, ayant fini par comprendre l’oppression dans sa dimension transhistorique par la médiation de l’oppression coloniale —et spécifiquement des affaires algériennes— associant oppression à exploitation, n’ait pu renoncer à poursuivre le parallèle avec la situation capitaliste plus loin qu’il n’aurait dû, « occultant leurs différences spécifiques, que d’ailleurs il ne nie aucunement » (JPSPO, p. 59). Il en résulterait que le processus révolutionnaire des luttes de libération coloniale serait lui aussi saisi comme un processus et une praxis essentiellement ou, disons du moins, structuralement analogues à ceux d’une révolution prolétarienne.
5En bref, il est (modérément) reproché à Sartre, en prenant le colonialisme comme modèle d’oppression, de ne pas assez singulariser le phénomène. On pourrait observer en sens inverse que la théorie postcoloniale, en faisant du phénomène colonial le centre de son interprétation, parfois manichéenne, de l’Histoire, passe aisément de cette singularisation initiale — assez semblable à celle qui avait porté au xixe siècle sur l’esclavage moderne — à la valorisation des autres situations et dynamiques d’oppression et de libération (exclusion des femmes, discriminations ethniques, exploitation capitaliste ou pré-capitaliste de la main d’œuvre salariée ou des producteurs artisanaux) en fonction de leur seule similarité avec l’oppression coloniale. Pourtant, comme le montre très bien, par exemple Robert J.C. Young dans sa somme magistrale Postcolonialism : an Historical Introduction (2001), la pensée de Marx, qui aurait été indispensable à Sartre pour interpréter sérieusement l’oppression coloniale, ne s’est guère intéressée à celle-ci en tant que telle mais seulement à ce qu’elle permettait d’apprendre sur la dynamique et les processus de l’économie industrielle européenne. L’appropriation et la transposition éventuellement brutale d’un marxisme plus économiste que culturaliste ou même anthropologique par de très nombreux théoriciens et militants postcoloniaux, avec les équivoques qu’elles entraînent, permettraient comparativement d’approfondir la théorie sartrienne de l’oppression en montrant comment elle a pu dépasser certaines de ses apories grâce à son intrication avec la pensée de Fanon et à la réintroduction subtile de structures symboliques freudiennes, humanisantes, dans le système. L’exposé, d’une grande clarté, de N. Lamouchi souffre tout de même un peu de sa concentration sur les binômes existentialisme/marxisme et capitalisme/colonialisme, et d’une certaine étroitesse de contextualisation. En sens inverse, la longue préface de Pierre-Victor Verstraeten, sous prétexte de complexifier, tend à brouiller des pistes bien tracées par l’auteur de l’ouvrage : la « disqualification du désir comme forme dévoyée de la liberté [...] au profit [du] besoin comme expression légitime de l’ontologie de la liberté ou praxis » (JPSPO, p. 23) risque ainsi d’être fort mal interprétée en isolant Sartre du moment de pensée dans lequel, avant même l’émergence de Lacan et de Foucault, une poussée sémiologique commençait déjà à altérer les théories dominantes de la valeur (dont celle fournie par le marxisme orthodoxe). Au sujet de l’oppression comme à bien d’autres, ce qui est le plus appréciable chez Sartre, c’est sans doute un décloisonnement de la méthode, un flottement, un jeu de transversalité que l’on retrouvera aussi bien dans son écriture littéraire que dans le meilleur de la théorie postcoloniale et de la théorie de la mondialisation.
Appropriation & économie préfacielle
6Le deuxième ouvrage (chronologiquement premier) dont je veux rendre compte, celui sur les préfaces tiers-mondistes, est une étude beaucoup plus fouillée et plus technique conçue en bonne partie comme une contribution à la génologie de la préface et dont les principaux outils sont l’analyse stylistique, rhétorique et idéologique du discours et une approche intertextuelle. C’est précisément dans ces cadres rigoureux que N. Lamouchi dégage trois structures fonctionnelles « fondamentales, caractéristiques de la préface sartrienne : l’acte d’autorisation et de parrainage (ou le discours de présentation), l’activité critique et théorisante, et enfin l’acte d’intervention politique. » (Un maître-préfacier, Jean-Paul Sartre et l’autre colonisé2, p. 194) Après une brève et efficace partie introductive sur « Préface et engagement », six textes de Sartre « sur le Tiers-Monde » sont passés systématiquement en revue, parmi lesquels le célèbre « Orphée noir » de 1948, la préface au Portrait du colonisé de Memmi et celle aux Damnés de la terre de Fanon. Les deux premiers portent sur des productions littéraires noires, les quatre autres sur des essais, témoignages et discours entrant dans la fâcheuse catégorie de la « littérature d’idées », fâcheuse en ce qu’elle suggère à la fois que le reste de la littérature ne pense pas et que celle qui pense est une catégorie à part. Or, si une préface, dès qu’elle n’est pas purement anecdotique, ce qui est au reste assez rare, surtout parmi les allographes, relève nécessairement de cette classe malencontreuse, ce n’est pas du tout obligatoirement le cas de l’œuvre dont elle annonce et commente la disance. D’où à la fois une différence marquée entre les préfaces du premier et celles du second type, dans la mesure où elles tendent toutes à se modeler plus ou moins mimétiquement ou empathiquement sur leurs objets textuels, et une distance ou un décalage très variable entre le texte préfaciel et le texte préfacé.
7La préface d’une anthologie poétique ne saurait être aussi poétique que cette dernière, par contre celle d’un manifeste peut être au moins aussi polémique que celui-ci, N. Lamouchi le montre fort bien dans ses analyses. En revanche, le glissement bidirectionnel, à plusieurs reprises, entre expressivité ou subjectivation et esthétique, ne recoupant ni le parrainage ni l’activité critique, témoigne plus de l’ambiguïté, voire de la duplicité de la pensée du littéraire chez Sartre que d’une difficulté à situer et à évaluer la composante esthétique des préfaces et des œuvres préfacées : « l’originalité de la préface sartrienne serait peut-être à chercher dans le triple investissement théorique, esthétique et idéologique dont elle fait l’objet. » (UMP, p. 198) Ainsi le terme d’esthétique n’est employé comme titulation qu’à propos de la Négritude et de ce qui confirme, dans une perspective censée être celle de Mallarmé, Bataille et Blanchot, l’idée d’autodestruction du langage, et c’est seulement dans « Orphée noir » que « le mythe », au sens classique du terme « revêt une importance capitale. » (UMP, p. 98) Au contraire, « la préface de Sartre à Lumumba [1963] est un texte prosaïque, où l’auteur ne fait pas preuve d’une grande ingéniosité littéraire, sans doute à cause de sa nature explicitement historique et politique. » (UMP, p. 191) On notera cependant que ce prosaïsme croissant des préfaces coïncide avec la radicalisation des positions politiques de Sartre et avec ses velléités clamées de plus en plus haut d’adieu à la littérature.
8Plusieurs questions restent posées, qui nous intéressent parce qu’elles visent en parallèle la mauvaise conscience et l’idéal du moi sartriens, d’une part, et la critique et la théorie postcoloniales, de l’autre. Dans ces deux domaines du marché symbolique des biens culturels, l’un minuscule mais emblématique en Occident et surtout en France, l’autre immense mais dont l’Occident et surtout la France mesurent mal les enjeux, on assiste, par étapes du milieu du xixe siècle au début du xxie siècle, à un effondrement de la littérature tel que le concept s’en était constitué de la Renaissance au Romantisme ; point n’est besoin d’insister sur l’engrenage de ce phénomène bien connu, mais il ne serait pas inutile de remarquer que Sartre, à la façon des surréalistes, peut encore, en 1948, tirer profit d’un rôle de parrain de la poésie négro-africaine, tandis que, dix ou quinze ans plus tard, sa visibilité est autrement assurée par une préface à Fanon ou à Lumumba qu’elle ne l’eût été par la promotion préfacielle de Kateb, de Chraïbi ou de Sembene. Dans l’échange de bons procédés que représente le contrat de préface, il y a des déterminations qui sont loin d’être circonstancielles. Dans les modalités et les objets de l’appropriation même que forgent les actes de langage préfaciels, se révèlent des faits de l’histoire humaine du long terme qui dépassent, on peut s’en rendre compte aujourd’hui, les représentations liées aux conflits violents d’intérêts économiques et entre classes et projets de société.
9La marxisation progressive de la pensée sartrienne à cette époque, accompagnée d’un transfert sur les colonisés du projet de révolution socialiste mondiale, serait de la sorte beaucoup moins interprétable comme prise de conscience ou comme opportunisme de certains intellectuels occidentaux que comme le fruit tout à fait involontaire des deux vagues de fond qui marquent de plus en plus l’histoire humaine au long du siècle passé : la montée du tout-économique et la mondialisation. Avec les meilleures intentions du monde, Sartre, en se faisant le médiateur des militants du Tiers-Monde vis-à-vis d’un lecteur présumé européen et puissant et en les instruisant sur la marche à suivre ou en les encourageant dans la bonne voie, ne fait inévitablement que reproduire des schémas de domination qui continuent de régner après les indépendances et même en dehors de tout néocolonialisme organisé. De même la théorie postcoloniale qui a pris le relais du tiers-mondisme ces trente dernières années fait-elle le jeu de l’impérialisme pancapitaliste américain en se détournant de plus en plus de l’analyse du travail symbolique et esthétique par lequel les écrivains et les artistes innovants des cultures dominées déploient une résistance vitale à l’économisme de profit qui tue leurs cultures. Tirer une telle leçon des pièges de l’engagement sartrien, de ses erreurs et de ses échecs comme de ses temporaires succès de promotion idéologique contribuerait à rendre à Sartre son importance historique, ce à quoi des analyses discursives, génériques et communicationnelles de la qualité de celles de N. Lamouchi sont certainement indispensables.
Une critique de la critique est-elle l’écriture d’une lecture ?
10Malgré les limitations que regrette d’ailleurs implicitement son coordinateur, le volume des Actes du premier colloque sartrien de Gabès — un autre a eu lieu fin 2005 — peut apporter quelques réponses à la problématique de l’indirection ou de la secondarité des discours qui apparaît comme une constante des travaux de N. Lamouchi sur Sartre. L’organisateur, dans son avant-propos, déclare que
même si plusieurs interventions ont croisé, à un moment ou à un autre, la question de l’écriture critique sartrienne [...], elle n’a pas fait l’objet d’une investigation approfondie qui aurait souligné la part de création et d’invention au sein même de l’œuvre critique. (Jean-Paul Sartre : critique et création littéraire3, p. 12)
11En dépit de ce jugement globalement justifié, quelques contributions vont heureusement dans ce sens. Je citerai notamment celle de Helge Vidar Holm, « Sartre lecteur de Madame Bovary ».
12À propos d’une déclaration de Sartre sur sa récente lecture de Bakhtine, en 1971, déniant toute utilité à ces recherches qu’il taxe de néo-formalistes, Todorov fait la remarque « plaisante » que « lorsque [...] Sartre prend connaissance du livre de Bakhtine, il ne reconnaît pas sa propre pensée, préoccupé comme il est de réfuter le “formalisme”. » (cité dans CCL, p. 65) Si ce n’est heureusement le cas de l’auteur qui utilise cette citation pour boucler sa communication, on pourrait dire de beaucoup de lecteurs de la critique sartrienne ce que Todorov disait de la lecture de Bakhtine par Sartre : la critique de la critique est en effet, comme tout auteur de recensions dans Fabula peut en faire l’expérience, un exercice périlleux qui force d’autant plus à garder des yeux ouverts dans toutes les directions — notamment sur soi‑même — qu’il est source de désaccords aveuglants, avec soi-même au premier chef (que dire, comme dans le cas présent, de la critique de la critique de la critique ?) Toujours est-il que Sartre, dans ses notes pour le projet d’analyse de Madame Bovary qu’il n’a pu finalement mener à bien, utilise le concept bakhtinien de polyphonie de façon inattendue, en l’attachant au personnage plutôt qu’au texte romanesque. Il constate alors qu’Emma serait « un personnage sans voix propre » (CCL, p. 55), ce qui est exactement le mode d’être aphasique du « subalterne », lequel pourrait précisément se définir comme celui « à travers qui tous les autres discours [...] parlent. » (Ibid., p. 56)
13Dans sa propre contribution, « J.‑P. Sartre critique poétique : Francis Ponge comme exemple », N. Lamouchi s’engage courageusement sur l’un des terrains les plus minés de la littérarité sartrienne : Sartre, polygraphe de choc, serait de nécessité hermétique au langage poétique, qu’il n’a d’ailleurs pas lui-même pratiqué, il ne saurait donc se comporter que de façon très obtuse face à la poésie d’autrui. Quand P.‑V. Verstraeten, dans un autre article du même volume, ne demande plus compte à Sartre que de sa lecture de la philosophie de Ponge (« Simplement, ce que Sartre n’acceptera pas chez Ponge, c’est le recours à la science pour fonder en dernière instance ce matérialisme purificateur... » CCL, p. 159) il donne certainement l’impression que Sartre est barré de toute intellection poétique tour à tour par des aprioris métaphysiques, épistémologiques et éthiques. Par contre, quoiqu’il transparaisse aussi à travers l’analyse de N. Lamouchi que Sartre rejette chez Ponge ce qui constitue à ses yeux une « vision mécaniste », « un monde du solide où tout est voué à la pétrification, » (CCL, p. 97) la qualité de poéticien reste reconnue à Sartre parce qu’il entrevoit que la « double déshumanisation », celle des mots et celle des choses, relève pour le poète d’une nécessité expressive. Cependant, ni l’un ni l’autre sartrien ne me semblent prendre de distance suffisante à l’égard de leur objet/médiateur pour faire entièrement droit, chez lui ou ailleurs, à ce qui est irréductiblement constitutif d’une poétique : la construction d’un objet verbal dans son autonomie structurale, sonore, rythmique, dans cette altérité matérielle, quasi corporelle, qui lui permet précisément parfois, à côté de l’entremêlement au vécu situationnel, d’en être une objectivation, donc une expression et une critique, une action aussi sur des vécus à venir. L’article de Serge Zenkine sur « Sartre et le sacré », placé en fin de volume, nous aide pour sa part à comprendre l’ambivalence du philosophe face à la poésie ; c’est certainement dans la mesure où celle-ci, chez les poètes négro-africains, bien sûr, mais même, par une réaction sans subtilité chez Ponge, est facilement confondue avec le lyrisme et demeure romantiquement conçue comme appartenant à la sphère du sacré, s’y engouffre avec le besoin de valoriser l’imaginaire, que la poésie, comme le sacré, « suscite l’attraction de même que la répulsion. » (CCL, p. 163)
***
14En bref, on se rend compte qu’une critique de la critique, par son détour ou son grand écart, en tant qu’elle n’est pas et ne peut pas être l’écriture d’une lecture, qu’elle tourne même le dos à l’immédiateté de la lecture en se faisant diversion, digression théorisante, peut avoir le mérite de défamiliariser l’œuvre qu’elle contourne de loin. L’un des intérêts majeurs des travaux de Noureddine Lamouchi sur Sartre réside donc moins dans sa position de critique périphérique, « ex-colonisé », que dans la stratégie de distanciation qu’il adopte pour pallier les inconvénients de sa propre fascination pour le regard de Sartre sur le système colonial et le principe d’oppression que celui-ci manifeste comme solution désastreuse apportée par l’inconscient au trauma de l’altérité. Une dernière question, la plus inquiétante, persiste alors : la démarche théorique par laquelle le « que faire » sartrien dans le rapport à l’autre opprimé est à son tour abstrait dans des catégories proches de celles du matérialisme dialectique, cette démarche ne serait-elle pas (comme la théorie postcoloniale qu’elle préfigure) une défense aussi efficace qu’aveuglante contre l’effet de présence irréductible du nègre paumé dont le grand corps traîne obscènement dans les rues de la fiction ? À son retour de postcolonie, Sartre s’échappe encore une fois à lui-même — défaut de maîtrise, fragilité de sa littérature d’idées qui, à mon sens, lui rend toute sa dignité.

