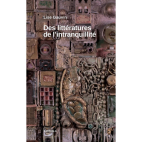
Écrire (dans) l’intranquille frémissement des langues ou l’invention de nouvelles formes romanesques dans les littératures francophones contemporaines
1Des littératures de l’intranquillité est le dernier essai de Lise Gauvin, écrivaine, critique littéraire, essayiste, professeure émérite de l’Université de Montréal et spécialiste des rapports entre littératures et langues. L’ouvrage rassemble et approfondit ses réflexions récentes autour de la « surconscience linguistique » des écrivains francophones, la notion d’« intranquillité » et la dimension métadiscursive des romans contemporains de langue française. Elle poursuit les interrogations qui furent les siennes dans L’Écrivain francophone à la croisée des langues (Paris : Karthala, 2006), Écrire pour qui ? L’écrivain francophone et ses publics (Paris : Karthala, 2007) ou encore Le Roman comme atelier. La scène de l’écriture dans le roman francophone contemporain (Paris : Karthala, 2019), et fournit de nombreuses pistes de lecture et d’analyse des œuvres fictionnelles soumises à l’étude dans le présent essai, à travers une approche sans cesse renouvelée sur le traitement des langues et l’élaboration de la fiction. En fondant son étude sur une pluralité de romans issus de diverses aires géographiques et culturelles, Lise Gauvin interroge le « penser de la langue » et « l’imaginaire des langues » qui travaillent en profondeur l’écriture des auteurs francophones, dont la pratique langagière, selon elle, est « fondamentalement une pratique du soupçon » (p. 13). Elle montre ainsi que les langues agissent sur le texte littéraire et l’informent à divers niveaux : celui du paratexte ou des seuils, définis par Gérard Genette comme l’ensemble des productions verbales ou non verbales qui entourent le texte « précisément pour le présenter, au sens habituel de ce verbe, mais aussi […] pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa “réception” et sa consommation, sous la forme, aujourd’hui du moins, d’un livre » (p. 7) ; celui du récit fictionnel qui intègre la pluralité des langues et des niveaux de langue ; celui de l’auto-réflexivité, qui joue avec les codes du récit romanesque et avec ceux du langage.
2Comment écrire, pour qui écrire et pourquoi écrire ? Ces interrogations traversent le propos de l’essai et mettent au jour l’inconfort linguistique des écrivains francophones, en situation de bilinguisme ou de plurilinguisme. La brève introduction de l’ouvrage revient rapidement sur la définition de la « francophonie » et sur les débats qu’elle a suscités, notamment en 2006-2007 avec la publication du Manifeste « Pour une littérature-monde en français » qui mettait en cause l’utilisation du terme « francophone » et devait en marquer « l’acte de décès1 ». Elle rappelle ainsi que le terme, qui a connu depuis le milieu du xxe siècle ses détracteurs comme ses défenseurs, oscille « entre le culturel et le politique » (p. 7), et que, quel que soit l’usage que nous en faisons, il demeure lacunaire, problématique, insatisfaisant. Lise Gauvin maintient cependant l’emploi du terme, tout en énumérant les nombreuses difficultés qui se dressent dès lors que l’on tente de l’appliquer aux pratiques littéraires. C’est donc pour interroger « cet ensemble flou » (p. 8) et déterminer quelques points de convergence qu’elle entreprend d’analyser un large corpus de romans. En effet, elle situe leur spécificité du côté de la langue d’écriture et de la réception. Les auteurs francophones, écrit-elle, « ont en commun de se situer “à la croisée des langues”, dans un contexte de relations conflictuelles — ou tout au moins concurrentielles — entre le français et d’autres langues de proximité » (p. 11-12). Par ailleurs, ils partagent « le fait de s’adresser à divers publics, séparés par des acquis culturels et langagiers différents » (p. 12). L’ouvrage travaille ainsi à montrer que les traits communs aux littératures francophones s’inscrivent dans la diversité de leurs contextes d’apparition, de leurs auteurs et de leurs publics.
3La composition de l’essai repose en partie sur les trois questions énoncées : les trois premiers chapitres, réunis sous le titre « Penser/parler la langue », déplient un ensemble de concepts liés aux situations de plurilinguisme en écriture : littérature mineure, littératures de l’intranquillité, surconscience linguistique, langagement, polyphonie, traduction. Les deuxième et troisième parties, respectivement intitulées « Écrire, pour qui ? Frontières de langues et frontières du récit » et « Écrire, pourquoi ? Le roman comme atelier » comportent huit chapitres consacrés à des études de cas (Yves Beauchemin, Axel Gauvin, Raphaël Confiant, Ahmadou Kourouma, Réjean Ducharme, Patrick Chamoiseau, Dany Laferrière, Assia Djebar, Marie-Claire Blais, Titaua Peu) auxquels s’ajoute une annexe dédiée à L’Influence d’un livre de l’écrivain québécois Philippe Aubert de Gaspé fils. Le propos de Lise Gauvin se construit à partir d’un corpus presque exclusivement romanesque, ce qui révèle, en creux, l’absence récurrente des genres dramatiques et poétiques au sein des études francophones. Toutefois, le choix du romanesque est clairement justifié dans cet ouvrage par l’analyse conjointe du fictionnel et du linguistique.
L’intranquillité ou le trouble dans la langue : inconfort et « intégration festive » des langues dans les littératures francophones
4Afin d’exposer les outils théoriques qui sont les siens et de situer précisément sa pensée, Lise Gauvin procède, dans le premier chapitre de l’ouvrage, à l’explicitation de plusieurs concepts associés à la question linguistique, dont elle se distancie ou qu’elle reprend au contraire pour nourrir sa réflexion. Elle prend notamment ses distances avec la « littérature mineure », introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari pour désigner la littérature « qu’une minorité fait dans une langue majeure2 » et dont la figure de Franz Kafka, « écrivain juif vivant à Prague » (p. 18) qui écrit en allemand, serait représentative. En effet, la notion de « littérature mineure » a été reprise par les deux penseurs à partir d’une traduction abusive du Journal de Franz Kafka proposée par Marthe Robert3. Kafka parle de « petites littératures » pour évoquer la littérature juive en yiddish de Varsovie et la littérature écrite en tchèque, et non pas pour désigner sa propre situation linguistique et littéraire (celle d’un écrivain tchèque et juif écrivant en allemand). La notion de « littérature mineure » a aussi le désavantage, selon Lise Gauvin, de « faire l’impasse sur la douleur et l’angoisse liées à la condition du mineur » (p. 18), ce dernier terme devant s’entendre comme celui qui est soumis à une forme de domination culturelle, politique, linguistique qui le marginalise. À partir de cette première distinction, Lise Gauvin aborde successivement les réappropriations dont ces notions ont fait l’objet : les « littératures des petites nations » proposées par Milan Kundera, les « littératures de l’exiguïté » de François Paré, les « littératures liminaires » forgées par Michel Biron, et d’autres pensées qui ont rejeté ou non ces variations autour du « mineur » tels Aimé Césaire, Raphaël Confiant, Édouard Glissant ou Gregory Jusdanis. En choisissant d’employer le terme d’« intranquillité », Lise Gauvin cherche à montrer l’inconfort, les doutes et incertitudes qui sous-tendent les pratiques littéraires d’auteurs issus d’espaces socio-culturels où les langues entrent dans un rapport conflictuel. L’intranquillité, reprise à la traduction du journal de Fernando Pessoa4, désigne ici des littératures « inquiète[s] » (p. 38) de leur statut, « pour lesquelles rien n’est acquis au départ. Elles doivent tout inventer. L’écrivain doit inventer sa langue d’écriture dans un contexte toujours multilingue […]. Il doit inventer aussi les conditions de son apparition au monde5 ». Cette inquiétude prend sa source dans une longue histoire de domination linguistique et culturelle, imposée depuis la France, qui, comme le souligne Pascale Casanova, n’a « cessé d’exercer et de faire subir, notamment dans [ses] entreprises coloniales, mais aussi dans [ses] relations internationales, un “impérialisme de l’universel6” » véhiculé dans la diffusion de la langue française. Situés « à la croisée des langues », dans des contextes familiaux et socio-historiques plurilingues, les écrivains francophones, pour Lise Gauvin, sont « condamné[s] à penser la langue7 » et leurs textes sont sous-tendus par ce qu’elle nomme une « surconscience linguistique ». Cette dernière
renvoie à une conscience de la langue comme d’un vaste laboratoire de possibles. Si chaque écrivain doit jusqu’à un certain point réinventer la langue, la situation des écrivains francophones a ceci de particulier que le français n’est pas pour eux un acquis, mais plutôt le lieu et l’occasion de constantes mutations et modifications. L’écrivain francophone doit créer sa propre langue d’écriture dans un contexte de relations conflictuelles ou concurrentielles entre plusieurs langues ou niveaux de langue8.
5Cet inconfort linguistique caractéristique des littératures francophones, souligné par d’autres chercheurs comme Marc Gontard dans le cas du Maghreb9, Jean-Marie Klinkenberg10 pour la Belgique entre autres, Jean-Marc Moura11 ou Yves Clavaron12, est convoqué par de nombreux écrivains, dans leurs entretiens mais aussi dans leurs œuvres littéraires. Langue imposée ou langue choisie, l’usage du français ne semble jamais être une évidence. Si, selon Marcel Proust, « chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son “son13” », et si « [l]es beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère14 », Lise Gauvin estime que les auteurs francophones ont ceci de particulier et de commun de « négocier [leur] rapport à la langue française » (p. 43)15. Elle montre que cette négociation peut passer par l’invention d’une langue propre, chez Réjean Ducharme créant le bérénicien ou Ahmadou Kourouma qui « traduit le malinké en français, en cassant le français pour trouver et restituer le rythme africain16 » ; par la thématisation de la langue dans le récit fictionnel — c’est le cas de la diglossie entre créole et français dans les romans d’Axel Gauvin — ; ou par la portée manifestaire de certains écrits, tels ceux de l’autrice tahitienne Titaua Peu, étudiés dans le chapitre 11. « Stratégies de détour » (p. 12), ces différents procédés permettent aux écrivains de se frayer un chemin dans le concert des langues qui frémissent en eux et autour d’eux. Lise Gauvin observe que, chez nombre d’entre d’eux, la « langue symptôme et cicatrice » se transforme en « langue laboratoire et transgression » (p. 49). Ce glissement de la souffrance à l’invention est marqué par une dimension festive qu’elle rapproche de l’esthétique baroque et du carnavalesque tel que le définit Mikhaïl Bakhtine :
[le carnaval,] c’était le triomphe d’une sorte d’affranchissement provisoire de la vérité dominante et du régime existant, d’abolition provisoire de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. C’était l’authentique fête du temps, celle du devenir, des alternances et des renouveaux. Elle s’opposait à toute perpétuation, à tout parachèvement et terme17.
6C’est ainsi que Lise Gauvin souligne la « rupture de l’illusion réaliste » et le « transfert des codes qui se fait à l’avantage de la culture et de la langue populaires » (p. 64) dans le théâtre de Michel Tremblay, la « mise en œuvre de l’hétérogène » (p. 68) dans Texaco de Patrick Chamoiseau et la création de nouvelles formes de récit et de rapports entre narrateurs dans les romans d’Ahmadou Kourouma, dont la langue se démarque par l’usage de rythmes inédits et de néologismes. La figure de l’écrivain en « chiffonnier », en « collectionneur de mots » (p. 140), que l’on retrouve chez Réjean Ducharme, illustre quant à elle la confection d’un « musée imaginaire » où « les mots convoqués par le romancier sont utilisés sans hiérarchie, du plus noble au plus vulgaire, du plus banal au plus nouveau » (p. 145). Lise Gauvin offre ainsi, à travers l’étude d’un vaste répertoire de textes littéraires, une approche nuancée, précise et détaillée des faits et des effets de langue par lesquels les écrivains francophones orchestrent et édifient leurs récits. Certaines références complémentaires auraient pu enrichir ici la réflexion, comme la notion d’« hétérolinguisme » dont Myriam Suchet a proposé une analyse approfondie dans son ouvrage L’Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues (Paris : Classiques Garnier, 2014) et que Rainier Grutman explicite en ces termes : « la présence dans un texte d’idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soir, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale18 ». En effet, plusieurs procédés littéraires et linguistiques relevés par Lise Gauvin, entrent en écho avec les dispositifs textuels étudiés par Myriam Suchet, comme le recours au glossaire, la glose intertextuelle, l’usage de notes de bas de page, autant d’opérations visant à composer avec la pluralité linguistique. Ces opérations révèlent la constante négociation dont font preuve les écrivains francophones, à la fois dans l’élaboration de leur texte et dans leur rapport au(x) destinataire(s).
Quand un lectorat en cache un autre : double destinataire et posture auctoriale
7La réflexion de Lise Gauvin met particulièrement en valeur les « seuils » et les discours métatextuels insérés dans le corps du texte, qui permettent à un auteur d’assurer la lisibilité de son œuvre auprès du public visé. Dans le cas des littératures francophones, l’autrice interroge à la fois le rôle qu’occupent ces procédés au sein du récit de fiction et la manière dont ils révèlent la présence d’un double destinataire. À la croisée des langues, les écrivains sont aussi situés à la croisée des publics.
8Le chapitre 4, qui ouvre la deuxième partie, porte sur le statut de la note de bas de page, dont les interrogations préliminaires posent les enjeux : « que nous apprend sur la forme même du roman la note infrapaginale et en quoi cette pratique affecte-t-elle et transforme-t-elle la poétique romanesque ? Quelles en sont les fonctions ? Peut-on établir une typologie ? » (p. 81). Le propos s’appuie sur plusieurs exemples, parmi lesquels Yves Beauchemin, Axel Gauvin ou encore Réjean Ducharme (au chapitre 7). Lise Gauvin ne propose en fait aucune « typologie » permettant de caractériser les différents types de notes, mais elle fournit une étude minutieuse de leur usage dans plusieurs romans. En ce sens, elle distingue la note explicative et informative, visant à clarifier le sens d’un terme ou d’une expression, de la note ludique, qui ne prend pas son rôle au sérieux. Elle montre que ces deux tendances ne sont ni exclusives, ni, parfois, clairement identifiées. C’est le cas dans Hiver de force de Réjean Ducharme, dont elle souligne « le système insolite créé par la présence des notes », « produit », en apparence, « pour expliquer et traduire certains mots, surtout des expressions anglaises » et qui « prend très vite une connotation ludique » (p. 137). L’écrivain déroule son récit dans l’entre-deux : la pleine compréhension du texte appartient aux lecteurs bilingues, et plus précisément québécois, du fait de la présence de formulations idiomatiques proprement québécoises, mais la présence de notes fait signe vers un second public, les « Français de France » selon l’expression d’Yves Beauchemin, citée à la page 83. Cette attention portée aux destinataires, Lise Gauvin la relève également chez Ahmadou Kourouma, dont les commentaires explicatifs sont, cette fois-ci, directement intégrés dans le corps du texte afin de « faire comprendre à un public hétérogène les subtilités de la culture malinké » (p. 114). Axel Gauvin, quant à elle, reproduit dans son roman Faims d’enfance la diglossie entre le créole et le français en donnant la préséance à un « destinataire qui appartient à un autre communauté que celle d’origine », du fait de la présence de notes « lexicales, mais aussi ethnographiques et historiques » (p. 91) cherchant à offrir une certaine transparence au texte. Et Lise Gauvin de conclure que « toute glose, voire tout procès de traduction inscrit dans le texte, donne à la culture du récepteur un statut supérieur à celle de l’émetteur » (p. 92). Cette analyse entre étroitement en dialogue avec les pensées de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin dans leur célèbre ouvrage The Empire Writes Back, Theory and Practice in Postcolonial Literatures, et avec celle de Graham Huggan, dans The Postcolonial Exotic : Marketing the Margins (2001), qui définit l’« exotisme postcolonial » comme un « mécanisme de traduction culturelle19 » destiné au public anglophone. Pour Huggan, les écrivains « dominés » infusent, dans leurs œuvres, les informations permettant au lecteur non initié d’accéder au sens du texte et à la culture « étrangère20 ». Au contraire, laisser des « mots intraduits » constitue un « acte politique21 » qui refuse d’accorder à la culture ou à la langue dominante un statut privilégié. En ce sens, lorsqu’un double destinataire est instauré dans l’écriture, les écrivains ont recours à une double forme de transmission : ils pratiquent l’auto-traduction (à travers la glose, le commentaire métatextuel et métalinguistique, la note infrapaginale) et, parfois, s’érigent, volontairement ou non, en interprète22. Toutefois, le décodage culturel et linguistique peut être dévié, biaisé par un usage subversif de la traduction. Lise Gauvin se penche ici sur l’exemple de Raphaël Confiant, qui pratique la dérision et l’auto-dérision, l’invention et l’opacité afin de « déjouer les habitudes de lecture, de déstabiliser ou de provoquer le lectorat tout en l’incluant, du moins de manière virtuelle, dans l’élaboration de l’œuvre » (p. 109). À propos de cette situation, qui donne bien souvent la préséance, dans l’écriture, à un destinataire étranger et monolingue (les Français de l’Hexagone), Lise Gauvin rappelle qu’elle relève d’une « institutionnalisation de la production littéraire » qui « passe par la validation de l’institution littéraire parisienne » (p. 66). Ce faisant, elle reprend ici des termes propres à la sociologie de la littérature qui, à travers les travaux et essais de Pierre Bourdieu23, Jacques Dubois24, Pascale Casanova25, Pierre Halen26, Gisèle Sapiro27, Claire Ducournau28 ou Tristan Leperlier29, a permis l’étude approfondie des rapports de force et des conflits qui se jouent dans la visibilité, la reconnaissance et la légitimité des littératures francophones. Ainsi, pour Véronique Porra, « l’institution que constitue le centralisme parisien suscite à n’en pas douter des positions esthétiques qui se traduisent en termes d’adaptation ou non à une norme ou à des normes, à un canon édictés ou consacrés par ce centre30 ». L’essai de Lise Gauvin cherche précisément à explorer les expérimentations romanesques proposées par les écrivains francophones, qu’elle n’évoque pas tant en termes d’écart par rapport à une norme que d’inventivité et de négociation. Elle se demande d’une part « dans quelle mesure les esthétiques contemporaines échappent au “français fictif” qui a longtemps tenu de langue littéraire » (p. 60), et d’autre part comment cette prise de distance avec la langue permet d’échafauder de nouvelles architectures romanesques.
La langue comme laboratoire et le roman comme atelier : expérimentation et subversion
9La « surconscience linguistique » relevée par Lise Gauvin donne lieu à des formes narratives et fictionnelles inédites qui mettent en scène le langage et la figure de l’écrivain. Lise Gauvin relève, dans la lignée de Michel Foucault (Les Mots et les choses, 1966), Julien Dällenbach (Le Récit spéculaire, 1977) et Jean Ricardou (Problèmes du nouveau roman, 1967) dont elle cite les travaux dans le chapitre 8, différents procédés propres au roman autoréflexif et métafictionnel issu d’une tradition littéraire remontant à l’écrivain britannique Laurence Sterne et à Denis Diderot : mise en abîme, enchâssement, duplication, réécriture autodiégétique, sont autant de moyens de créer une forme de distance à l’intérieur du récit et de rompre avec « l’effet de réel » tel que le définit Roland Barthes, c’est-à-dire une littérature qui s’attache au « détail concret », au référent, pour donner une illusion de réel31. Lise Gauvin souligne ainsi que plusieurs romans francophones conservent cet effet, cette « illusion », notamment en confinant les spécificités de langage (niveaux de langue, régionalisme, plurilinguisme) aux discours rapportés des personnages de roman. En effet, elle rappelle que la littérature réaliste du XIXe siècle
tout en se voulant pur reflet du social dont elle émerge, entretient également le mythe d’un narrateur distinct et distant de personnages dont il se garde bien de réfléchir les particularismes langagiers ailleurs que dans les discours rapportés, dans les transcriptions timides de quelques expressions ou dans des phrases fort circonspectes. (p. 62-63)
10L’esthétique réaliste se retrouve chez quelques écrivains francophones, tel Yves Beauchemin qui conserve par exemple le « clivage entre langue du narrateur et celle des personnages » (p. 85). Au contraire, de nombreuses œuvres présentent ce que Lise Gauvin nomme une « fiction linguistique » (p. 93), autrement dit l’élaboration d’un langage, d’une « langue artificielle » (p. 92) marquée par l’invention et l’hybridité. Cette « fiction linguistique » émerge notamment dans les œuvres qui jouent avec les codes du roman et font apparaître des doubles de l’auteur. Le chapitre 8 est ainsi consacré au roman de Denis Diderot, Jacques Le Fataliste, où le narrateur « n’hésite pas à se mettre lui-même en scène comme personnage et à entretenir un dialogue permanent avec un narrataire/lecteur devenu également personnage » (p. 151). Lise Gauvin tisse des échos entre cette fiction du XVIIIe siècle, qui exhibe ses propres mécanismes, et celles des romanciers francophones, qui ont tendance à faire de leurs romans des « atelier[s] » (p. 152), des laboratoires où expérimenter de nouvelles moutures narratives. Elle cite le narrateur d’Un dimanche au cachot de Patrick Chamoiseau dont le je se diffracte en multiples voix et personnages, et celui du roman Je suis un écrivain japonais de Dany Laferrière, qui présente « les diverses étapes de la fabrication du livre et de sa réception » (p. 156). Chamoiseau et Laferrière mettent en branle la fabrication d’une écriture fictionnelle sans cesse en mouvement, portée par « un questionnement inlassablement repris » (p. 155), jamais achevé, que Lise Gauvin relie aux poétiques de Victor Segalen, William Faulkner, Aimé Césaire, Édouard Glissant mais aussi à celles « du nouveau-roman ou à cette “obsession de l’écrivain” qui caractérise les scénographies postcoloniales » (p. 159). L’« obsession de l’écrivain », observée par Lydie Moudileno chez les auteurs antillais, martiniquais et guadeloupéens en particulier32, est employée par Yolaine Parisot pour désigner les écritures de Gary Victor, Dany Laferrière et Alain Mabanckou33. Lise Gauvin conclut à la confection d’un
laboratoire vivant dont l’effet est de proposer une reconceptualisation de la littérature par une nouvelle articulation entre texte et paratexte comme entre les figures auteur/écrivain/écrivant en position de narration et celles des lecteurs/narrataires représentés. (p. 159).
11Le dédoublement de la parole auctoriale s’exerce également à travers les figures de passeurs et le geste de transmission. Dans Monnè, outrages et défis d’Ahmadou Kourouma, le personnage de l’interprète, qui possède un rôle de médiateur entre le roi de Soba, Djigui Keïta, et les colonisateurs français, révèle une impossible traduction et la présence d’une opacité irréductible entre les cultures et les langues. Tout en étant « passeur de langues », l’interprète doit parfois « déclarer forfait » (p. 118) dans sa tentative de trouver un équivalent linguistique. Lise Gauvin y voit un « double du romancier » et une « représentation de l’écriture tendue vers une interculturalité et une intertextualité » dont l’ambiguïté est maintenue par l’impasse de la traduction (p. 119).
12Assia Djebar, étudiée au chapitre 9, compose ses récits selon un principe polyphonique et une « parole mosaïque » (p. 161) où les figures féminines tissent leurs paroles et leurs mémoires pour exhumer les histoires occultées, en particulier celles des femmes algériennes. Dans un entretien avec Lise Gauvin, elle exprime cette exigence de pluralité qui affleure même dans l’écriture de soi : « l’écriture autobiographique est forcément une écriture rétrospective où votre “je” n’est pas toujours le “je”, ou c’est un “je-nous” ou c’est un “je” démultiplié34 ». Lise Gauvin soulève plusieurs caractéristiques propres aux romans d’Assia Djebar : l’usage de la langue française, perçue à la fois comme une « libération » permettant « dévoilement » et « mise à nue » et comme « une nouvelle forme de voile » (p. 161), l’importance de la trace et de la parole transmise, portée par différentes figures (« témoin », « scripteuse », « écouteuse » (p. 162), la présence du multilinguisme et de l’intertextualité. À travers l’étude de Femmes d’Alger dans leur appartement (1980), Oran, langue morte (1997), La Femme sans sépulture (2002), La Disparition de la langue française (2003) et Nulle part dans la maison de mon père (2007), la multiplicité des voix qui traversent les récits de l’autrice, fondés sur une « situation d’écoute sororale » (p. 181) et une « pulsion mémorielle » (p. 182), se font entendre et dessinent en creux une figure de l’autrice à l’écoute des récits transmis. Assia Djebar écrit pour laisser entendre la voix muette des femmes en ressuscitant les histoires passées, à l’image de la conteuse, médiatrice entre les temps immémoriaux et le présent. Ces écrits traduisent une forme de (re)conquête de la parole, également perceptible dans les œuvres de Titaua Pau, dont l’écriture manifestaire se positionne en rupture avec l’exotisme et le « silence de la résignation » (p. 199) qui a longtemps dominé à Tahiti. « [E]xister en dehors des grands ensembles hégémoniques » (p. 204) revient, chez les écrivains étudiés par Lise Gauvin, à rompre avec certains modèles en proposant de nouveaux mythes (Titaua Peu), en intégrant une parole orale et vivante (Ahmadou Kourouma, Assia Djebar, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant), trouées de blanc et de silence (France Daigle) ou en se faisant collectionneur de mots (Réjean Ducharme).
13Un dernier exemple, placé en annexe, s’intéresse à L’Influence d’un livre de Philippe Aubert de Gaspé fils, considéré comme le premier roman de la littérature canadienne, publié en 1837. Lise Gauvin montre que, dès cette époque, le mélange des genres (roman historique, roman de mœurs, pastorale, légendes, intertextualité prégnante notamment avec Jacques le Fataliste) révèle une autoréflexivité qui « refus[e] l’illusion réaliste afin de mettre en évidence l’arbitraire de la fiction » (p. 227) dans un français émaillé de citations en anglais. Au sein de romans qui interrogent leur propre forme, la langue devient elle-même, chez les auteurs étudiés dans l’essai, laboratoire et terrain d’exploration.
*
14L’ouvrage de Lise Gauvin offre de nombreux outils théoriques et notionnels permettant d’aborder la diversité des écritures francophones contemporaines, qui se caractérisent par certains traits récurrents : « dimension manifestaire », « urgence de dire », « surconscience linguistique » (p. 209), « autoréférentialité » et « mise en scène de l’écriture » (p. 213). Afin de composer avec la pluralité linguistique, les auteurs inventent des stratégies afin de conférer à leurs textes une plus grande clarté ou au contraire une certaine forme d’opacité, en vue d’une réception souvent double. L’intérêt de l’ouvrage réside aussi dans la mise en exergue des différentes postures adoptées par ces écrivains (présence de personnage-écrivain ou de narrateur-écrivain, métadiscours, posture ludique) et des poétiques adoptées dans les romans, qui se présentent bien souvent comme des « formes mixtes qui font […] appel au collage et au fragment » et « sont également en rupture avec une certaine tradition du roman exotique » (p. 213). L’appareil conceptuel détaillé dans les premiers chapitres est ainsi appliqué dans l’analyse approfondie des œuvres choisies, constamment conscientes de leur forme et en construction. Elles composent avec le « défaut des langues35 » et l’inconfort que peut susciter le multilinguisme en proposant des formes inédites. En ce sens, Lise Gauvin estime que « la condition de l’écrivain francophone est exemplaire de la condition de tout écrivain36 », motivée par la nécessité d’écrire et d’inventer la langue d’écriture.

