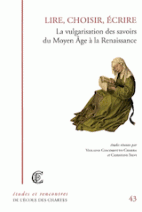
Une notion complexe & multiforme : la vulgarisation
1L’ouvrage dirigé par Violaine Giacomotto-Charra et Christine Silvi s’inscrit dans un courant de réflexion qui connaît un important développement depuis plusieurs années : l’étude de la littérature des savoirs et plus particulièrement de la littérature qui vulgarise ces savoirs1. Fruit de deux journées d’étude qui se sont tenues en 2007 et en 2008, ce livre réunit des contributions s’intéressant à différents genres textuels (des calendriers à la poésie), à différents domaines du savoir, comme la zoologie ou la philosophie, et embrasse une période large, grâce à l’étude de textes médiévaux et renaissants, dans le but de définir plus précisément la phénomène dit de vulgarisation.
2En effet, dans la mesure où l’étude de la littérature des savoirs implique de se spécialiser dans une discipline, les ouvrages publiés par un chercheur portent souvent sur l’histoire de la transmission du savoir pour un domaine en particulier2. Le programme de recherche « Le livre scientifique : définition et émergence d’un genre » a alors vu émerger une interrogation générale sur cette notion centrale. Ainsi, cet ouvrage poursuit l’objectif d’en donner une définition générale, croisant les regards de différents spécialistes. L’introduction, qui s’interroge sur la possibilité de « tracer les frontières de la vulgarisation » (p. 5), met la notion en perspective, par une étude diachronique et comparée des concepts de vulgarisation, vernacularisation et translation. Cette approche fait naître une double question. Qu’en est‑il tout d’abord du vulgarisateur, celui qui lit des textes véhiculant un savoir, choisit ce qu’il veut en transmettre et écrit son texte en conséquence ? Qu’en est‑il par ailleurs du lecteur visé par cette littérature ? Pour tenter d’y répondre, chaque article se présente comme une étude de cas. Si le lecteur ne peut qu’apprécier la richesse et l’érudition qui se dégage de l’ensemble, il pourra cependant noter la difficulté à mettre en relation les conclusions de chaque analyse, en raison même de l’ampleur du champ d’étude et de l’ambition généralisante de l’ouvrage, difficulté peut‑être soulignée par l’absence d’article conclusif.
Vulgarisation & vernacularisation
3La première forme de vulgarisation à laquelle l’on pense spontanément au sujet de la diffusion des savoirs au Moyen Âge et à la Renaissance vient du lien lexical que l’on peut tisser entre les substantifs vulgarisation et vulgaire, ce dernier désignant la langue vernaculaire au Moyen Âge, par opposition au latin3. Cette impression semble aller de soi : dans une Europe médiévale où le latin est la langue du savoir, maîtrisée par une élite, et où les langues vernaculaires sont des langues du quotidien, dont la connaissance est partagée par un plus grand nombre de locuteurs, la vulgarisation, qui souhaite diffuser le savoir, passerait tout d’abord par la traduction, qui en serait le geste fondateur. La langue anglaise possède le terme vernacularization pour désigner ce geste, que Violaine Giacomotto-Charra traduit en français par « vernacularisation ». Si un grand nombre d’ouvrages de vulgarisation sont bien des traductions, il apparaît en revanche clairement à la lecture du recueil que la vernacularisation ne signifie pas toujours un élargissement du lectorat.
4Certains articles étudient effectivement ce passage d’une langue à l’autre. La contribution de Jean Balsamo, « Traduction de l’italien et transmission des savoirs : le débat des années 1575 » (p. 97‑107), se penche sur la polémique qui agita la génération de 1575 en France, mue par deux désirs contradictoires : traduire des textes pour transmettre des savoirs d’une part et développer une culture nationale illustrée par des œuvres nouvelles et originales de l’autre. L’article de Jacqueline Vons, « Jacques Grévin (1538-1570) et la nomenclature anatomique française » (p. 133‑147), souligne l’importance du mouvement de traductions à la Renaissance pour la création d’une terminologie commune dans le domaine de l’anatomie. Elle étudie plus particulièrement le cas de Jacques Grévin, qui poursuit un double objectif en traduisant Vésale : rendre « accessible aux moins cultivés un savoir jusqu’alors réservé aux spécialistes » (p. 134) et « démontrer l’égalité entre la langue vernaculaire et le latin des savoirs » (p. 134).
5Cela dit, il convient de relativiser cet élargissement du lectorat qui serait dû à la vernacularisation. En effet, alors que « le latin est la langue des intellectuels et des savants de l’Europe entière » (p. 6), le peuple s’exprime en des dialectes différents et le français reste la langue partagée par une élite urbaine de la moitié Nord de la France jusqu’à la Renaissance. De plus, rares sont les personnes qui savent lire. Les traductions en français, ainsi que les textes écrits directement en français, ne touchent donc à cette période qu’un public assez restreint et l’on ne peut accepter, dans ce cas, la synonymie entre les concepts de vernacularization et popularization. Certains articles nous invitent certes à considérer la langue vernaculaire comme le meilleur moyen pour atteindre le peuple. Denis Hüe voit par exemple dans le Calendrier et compost des bergers « une forme particulière d’encyclopédie, une sorte de vade-mecum populaire et sciemment terre à terre, petit manuel armant son possesseur de toute une série d’indications pratiques » (p. 96), mais il indique que ce type de textes s’adressait en priorité à une population urbaine. Valérie Fasseur, qui étudie le Breviari d’Amor, écrit en langue occitane par Matfre Ermengaud vers 1288, évoque ainsi les intentions de l’auteur : « Matfre juge indispensable de protéger les laïcs contre la menace hérétique en mettant à leur portée, et dans leur langue, un abrégé de tous les savoirs possibles, mis au service du savoir doctrinal » (p. 69). Cependant, Christine Silvi, qui étudie « La revendication de la grécité dans quelques monographies d’oiseaux d’Aristote à Buffon » (p. 23‑47), retient plus particulièrement des « ouvrages en latin […], sans doute parce que le latin est aussi et avant tout la langue véhiculaire, celle qui permet, à l’époque médiévale comme au xvie siècle, la plus grande diffusion possible du savoir zoologique » (p. 23). Marie-Luce Demonet, quant à elle, rappelle qu’une première vulgarisation peut s’effectuer en latin « par les introductions, les abrégés, les compendia, les réductions, les présentations en tables, les summulæ ou sommaires, les loci communes et les polyantheæ » (p. 166).
6Ainsi, le choix de la langue vernaculaire n’est pas toujours le critère le plus pertinent pour classer un texte au sein de la littérature de vulgarisation : « la traduction s’adresse à un public élargi : elle rend le texte intelligible pour ceux qui ne connaissent pas, ou connaissent mal le latin, ou le grec, mais elle n’en rend pas forcément le contenu plus simple » selon M.‑L. Demonet (p. 166). Qu’en est-‑l donc de la simplification et de l’adaptation des savoirs ?
Vulgarisation & simplification du savoir
7Cet ouvrage met en lumière la diversité des liens qui unissent la vulgarisation et la simplification du savoir : les deux mouvements peuvent aller de pair ou bien être opposés, vulgarisation rimant alors avec enrichissement de la science.
8Tout d’abord, plusieurs articles du recueil soulignent le lien fondamental entre vulgarisation d’une part et simplification ou adaptation du savoir d’autre part. Ainsi, d’après Valérie Fasseur, Matfre Ermengaud se présente comme « un élu de Dieu pour sa simplicité, non pour sa science » (p. 55) et son « effort de vulgarisation du savoir théologique consiste à réduire le plus possible l’abstraction d’un savoir intellectuel pour l’inscrire dans le domaine de l’expérience » (p. 66). De plus, D. Hüe n’hésite pas à qualifier le savoir diffusé par le Calendrier et compost des bergers de « flou » et « vain » (p. 72), pour montrer qu’il se présente « sous une forme abrégée, minimale mais suffisante » (p. 95).
9En revanche, Christine Silvi préfère parler de « reformulation » (p. 24) et non de simplification. Selon elle, en effet,
il ne s’agit pas seulement de transmettre en les simplifiant les connaissances léguées par les Anciens, il faut encore les réagencer, les réactualiser parfois, voire les transformer, quand ce n’est pas les travestir, en fonction des objectifs visés bien sûr, mais également de l’attente des lecteurs. (p. 45)
10Enfin, la vulgarisation peut même aller à l’encontre d’une simplification. La contribution de Philippe Selosse, qui met en lumière « la vulgarisation des savoirs dans les traités d’histoire naturelle de Pierre Belon » (p. 149‑164), montre que la vulgarisation peut être comprise comme un « enrichissement de la science plutôt que comme sa simplification » (p. 21) durant les années 1530-1560, où
les auteurs font […] attention aux realia, renouvellent les pratiques (mise au point d’herbiers, excursions sur le terrain, voyages lointains d’observation…) et tentent d’articuler connaissances puisées dans la nature et connaissances livresques, en travaillant à identifier les plantes et animaux décrits par les Anciens ou à recenser les plantes ou animaux nouveaux et inconnus des textes des Anciens. (p. 151)
11Quant à Rosanna Gorris Camos, qui étudie « deux poèmes scientifiques [composés par Guy Le Fèvre de La Boderie et Peletier du Mans] hantés par le même désir de connaissance […], dans lesquels ils explorent la terre et le ciel à la recherche de leur vérité » (p. 234), elle démontre, par des analyses de citations nombreuses et minutieuses, que « le poète, dans ces vers, est souvent hermétique » (p. 264). Dans ce cas, « s’inverse peut‑être le mouvement de diffusion du savoir, qui, après avoir touché et instruit le poète, redevient, sous la plume de ce dernier, hermétique et partiellement opaque au simple lecteur » (p. 22).
12Ainsi, comme nous l’avons vu, vulgarisation ne s’accompagne pas toujours d’une vernacularisation ni d’une simplification. Est‑il donc impossible de trouver un critère déterminant de vulgarisation ? Il apparaît en fait à la lecture de l’ouvrage que le point commun indiscutable de tous ces textes tient à l’intervention conscience d’un vulgarisateur4.
Des choix d’écriture
13Comme le titre de l’ouvrage l’indique, la vulgarisation du savoir ne peut avoir lieu sans l’intervention d’un vulgarisateur, intermédiaire nécessaire entre le savoir et le public. Ces intellectuels, par leurs « choix et mise en ordre de la connaissance, coupes et travail de sélection, simplifications et transformations, adaptations, réécritures, etc. […] tiennent compte de leur lecteur potentiel et élaborent pour lui un projet conscient » (p. 18) :
l’auteur inventorie le savoir disponible — il lit les textes […] ; puis il devra choisir, parmi ces lectures […] ; il faudra enfin […] écrire tout cela et le rendre public, c’est‑à‑dire accessible au plus grand nombre, en employant un style clair et simple. Lire, choisir, écrire : ces trois actes sont au cœur des enjeux d’un texte de vulgarisation. (p. 186)
14Le vulgarisateur doit donc adapter le savoir en employant une langue plaisante et agréable et en recourant à différentes stratégies d’écriture, comme le dialogue ou la compilation.
15Parmi ces vulgarisateurs, le cas de Charles Estienne, étudié par Hélène Cazes, est particulièrement remarquable, par sa volonté même de « se défini[r] comme l’intermédiaire » entre le texte et ses lecteurs pour « susciter le désir du savoir » dans le but de « modeler un nouveau lecteur » (p. 116). Ce pari humaniste et éditorial passe « par un langage familier et accessible » (p. 121) qui transformerait idéalement « l’ouvrage pédagogique [en] plaisante conversation » (p. 123). La vulgarisation se fonde chez lui sur une invitation au dialogue. On retrouve cette attention portée au dialogue dans le corpus étudié par M.‑L. Demonet, qui concerne « la représentation des facultés de l’âme telle qu’elle s’effectue à la Renaissance » (p. 165). Elle rappelle que « docere en forme de dialogue connaît à la Renaissance une fortune remarquée » (p. 172) et envisage le dialogue comme « un mode privilégié de vulgarisation » (p. 171), dont les modèles sont très divers, allant du dialogue didactique médiéval au dialogue religieux, en passant par les dialogues socratique, cicéronien et lucianesque.
16Ambroise Paré, étudié par Myriam Marrache-Gouraud, constitue une autre figure remarquable de vulgarisateur, très différente de celle de Charles Estienne, aussi bien du point de vue de son écriture que de ses objectifs. En effet, son Discours […] de la mumie, de la licorne, des venins et de la peste, paru en 1582 à Paris, « a pour intention avouée, voire revendiquée, d’ouvrir les yeux du vulgaire » (p. 186) au sujet de l’inefficacité de remèdes médicaux coûteux. Il choisit pour cela d’accumuler des témoignages contradictoires dans le but d’en illustrer l’incohérence. Paré se différence alors des méthodes médiévales de vulgarisation par l’objectif même de son travail de compilation. En effet, les auteurs du Moyen Âge étaient « d’infatigables compilateurs » (p. 45) et ils accumulaient dans leurs textes de nombreuses références aux autorités du savoir dans le but, le plus souvent, de garantir le sérieux de leur travail, quitte à se servir de cette façade pour présenter des innovations. À l’inverse, Paré organise « une confrontation stérile : les discours les plus opposés se côtoient » (p. 192) dans son texte, afin de dénoncer aux lecteurs les tromperies dont ils sont victimes.
17Les différentes stratégies d’écriture que les vulgarisateurs mettent en œuvre dépendent de la matière qu’ils transmettent et du lectorat qu’ils cherchent à atteindre.
Vulgariser quoi & pour qui ?
18En effet, le vulgarisateur lit et choisit ce qu’il veut transmettre dans le but de s’adresser à un lectorat précis. Comme on l’a vu, ce lectorat ne peut être assimilé au peuple en général (exception faite du Calendrier et compost des bergers qui s’adresse au peuple urbain), qui était très largement analphabète. Ce public visé par la vulgarisation « demeure savant par définition » (p. 16). Dès le xive siècle, le roi Charles V entreprend un grand mouvement de traductions de textes variés à destination d’une élite intellectuelle qui n’est pas toujours excellente latiniste et pour laquelle il juge bénéfique la lecture de textes de savoir en français. De cette façon, il assoit également la légitimité de son pouvoir royal sur des bases savantes et la postérité a d’ailleurs retenu le surnom de « Charles V le Sage ».
19Parmi les auteurs étudiés dans le recueil, on peut citer le médecin Jacques Grévin, qui traduisit en français des ouvrages médicaux grecs et latins « dans une perspective d’ouverture vers un public cultivé, mais n’appartenant pas au monde médical » (p. 144) ou bien le naturaliste Pierre Belon, dont les ouvrages « sont destinés [en priorité] à des lectorats particuliers et bien définis, restreints aux seules personnes alphabétisées ou lettrées et excluant des catégories telles que les femmes, les ignorants, les marchands, les apothicaires, les analphabètes » (p. 151) et en second lieu à ceux qui ne parlent pas grec « qu’ils soient médecins (parfois), étudiants en médecine, marchands ou apothicaires ; […] bourgeois ; […] personnages de la cour » (p. 152). Quant aux « traités philosophiques empruntant un matériau scientifique » (p. 165) pour évoquer les facultés de l’âme, ils
s’adressent à un lectorat de débutants (les enfants) [des classes aisées bien entendu], ou à un lectorat sociologiquement peu concerné par ces matières : des hommes de loi ignorant des sciences mais curieux de philosophie, des chirurgiens ignorant la dialectique, des hommes d’affaires, artisans et marchands, une noblesse de robe fraîchement promue et encore peu éduquée, une noblesse d’épée qui n’a pas daigné apprendre le latin mais qui désire polir ses manières, et enfin les femmes, surtout les femmes cultivées, issues d’un honnête milieu social. (p. 165‑166)
20Enfin, Susanna Gambino-Longo, dans son article intitulé « Imaginaire et connaissance des nations barbares en Italie au xvie siècle » (p. 217‑232), montre que cette connaissance est « encore largement tributaire de la définition romaine classique » (p. 218) du barbare, ce qui prouve que les textes qu’elle étudie s’adressent à une élite qui maîtrise la littérature et la culture de la Rome antique.
21Cet ouvrage souligne ainsi combien cette littérature des savoirs diffuse des connaissances relevant de disciplines très variées, mais il apparaît également clairement que cette diffusion est presque toujours restreinte à une élite :
La vulgarisation des savoirs vise certes à diffuser le savoir hors du monde des clercs, mais aussi à rapprocher cette seconde élite [sociale, politique et financière] de la première, et, à terme, à la transformer également en une élite intellectuelle, ou tout du moins en la source possible de savants nouveaux. (p. 16)
22L’enjeu premier de la vulgarisation, dans cette optique, est donc la translatio, c’est-à-dire « un passage, un transfert » (p. 9) de la science d’une langue à une autre.
Vulgarisation & translation
23En effet, avant d’éduquer un public d’élite lecteur du français, « c’est bien la langue qu’il s’agit d’éduquer ici » (p. 9). Il faut élever le français au niveau du latin, afin que la littérature des savoirs puisse s’écrire directement en langue vernaculaire, tout en arrachant une science vivante et en progrès constants à la prison des langues mortes, qui, par définition, ne peuvent plus s’adapter aux nouvelles connaissances ni exprimer de nouveaux savoirs. « La conscience d’un lien entre l’exercice de la pensée et la pratique de sa langue devient un enjeu majeur du mouvement de vernacularisation » (p. 11). Cet enjeu est lié au concept de la translatio studii, qui évoque le déplacement géographique du savoir d’Est en Ouest au cours de l’Histoire et donc le déplacement de l’enseignement de ce savoir, ce qui permet de relier ce premier concept à un second, celui de la translatio imperii, car le déplacement du pouvoir est lié au déplacement du savoir. L’éducation de la langue française peut donc être un enjeu politique, comme l’avait bien compris Charles V.
24Ce lien entre exercice de la pensée et pratique de la langue vernaculaire est mis en évidence par Jacqueline Vons en ce qui concerne la nomenclature anatomique française. Le médecin Jacques Grévin, par ses traductions, cherche à la fois à créer une terminologie commune au sein de la communauté médicale (divisée à l’époque, rappelons-le, entre les médecins universitaires, qui se préoccupaient surtout de théorie médicale, et les chirurgiens et barbiers qui s’occupaient des opérations) et à « donner à la langue française un statut égal à celui des langues anciennes » (p. 142). De plus, J. Balsamo nous rappelle que, vers 1575, « l’élaboration d’un discours philosophique et scientifique […] était le grand enjeu des lettres françaises » (p. 99), à une époque où le français était encore jugé immature par rapport à cette autre langue vernaculaire qu’était l’italien, et « encore incapable de traiter des sujets élevés » (p. 100).
***
25L’ensemble des articles réunis dans ce recueil constitue un apport de grande qualité pour l’étude de la littérature des savoirs et plus précisément de la littérature de vulgarisation des savoirs. L’ambition généraliste de l’ouvrage permet au lecteur curieux comme au spécialiste de prendre connaissance de nombreux textes du Moyen Âge et de la Renaissance tout en rendant difficile la mise en relation des différentes conclusions. Cela dit, la grande diversité des cas abordés permet de distinguer les critères qui ne signent pas la vulgarisation dans tous les cas des critères que l’on retrouve à toutes les époques et dans tous les types de textes. Ainsi, le rôle actif et conscient du vulgarisateur, tout comme l’image qu’il se fait de son lectorat, apparaissent comme les deux éléments fondamentaux du travail de vulgarisation, qui aboutit donc à la translation des savoirs. À l’inverse, cette mise en perspective de corpus différents permet de remettre en question le lien qui est systématiquement établi entre vulgarisation et vernacularisation d’une part et vulgarisation et simplification du savoir d’autre part.

