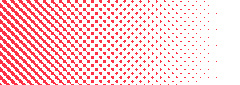Naissance, croissance et descendance des « livres-fantômes »
« Pour citer un récit hindou contemporain et sans doute véridique : le Swami était le père et la mère de toute science. Il écrivit un ouvrage très étudié sur la différence métaphysique existant entre la Substance et la Non-Substance, alors que ses lèvres étaient encore humides du lait de sa mère. » (Achmed Abdullah, Le Voleur de Bagdad)
« On ne décrit bien que ce qu’on n’a jamais vu. » (Pierre Mac Orlan)
L’absence et/ou la présence
1« L’absence est absolue, mais la présence a ses degrés »1, écrivait Gérard Genette dans Figures III, à propos de la distinction entre relations de personne(s) hétéro-, homo- et autodiégétiques. Or, à onze ans d’intervalle, on sait qu’il devait se raviser en ces termes : « Je ne dirais donc plus, comme jadis, « l’absence est absolue mais la présence a ses degrés. » L’absence aussi a ses degrés, et rien ne ressemble plus à une faible absence qu’une présence falote. Ou plus simplement : à quelle distance commence-t-on d’être absent ? »2 Détourné de son contexte narratologique originel, ce réajustement pourrait constituer l’horizon d’une réflexion sur le mode d’existence « fantomal » de certains livres, dont le degré d’absence ou de présence – ne tranchons pas – couvre toute l’étendue du spectre qui sépare autant qu’il relie ces deux pôles, et correspond à des modalités d’« incarnation/désincarnation » des plus variées. Aussi, sous l’égide de ce repentir genettien, souhaiterait-on placer l’ébauche d’une poétique du « livre-fantôme », attentive à la diversité des cas de figure qu’une telle formule peut prétendre subsumer.
2Toutefois, dans un souci d’économie, certaines des occurrences3 du phénomène en cause devront être – provisoirement, du moins – occultées : ainsi des textes à l’existence historique avérée, mais perdus, auxquels nous n’avons aujourd’hui « accès » que par le biais des évocations qu’ont pu en produire leurs glossateurs4 ; ainsi des « textes possibles spéculativement produits »5, tels que nombre de poéticiens, par vocation attentifs aux virtualités littéraires, ont pu les rêver – et, peut-être, etc. Bref, par « livre-fantôme », on entendra donc pour l’essentiel « livre imaginaire »6, produit le plus souvent, mais cette fois non exclusivement, en régime fictionnel. En outre, en termes historiques, sans nier aucunement la présence (parfois abondante) de phénomènes similaires dans les siècles antérieurs7, l’enquête portera principalement sur la littérature des xxe et xxie siècles, où le phénomène paraît revêtir une ampleur inédite, ainsi que des fonctions spécifiques.
3Sans que la métaphore biologique et/ou vitaliste qui informe son titre doive excessivement être prise au sérieux, la réflexion portera successivement sur les trois étapes que sont la naissance, la croissance et la descendance des livres-fantômes. À la rubrique « Naissance » seront ainsi répertoriés les multiples procédés qui, de la mention d’un titre d’œuvre imaginaire au déploiement du portrait bio-bibliographique de tel auteur supposé, favorisent l’émergence du livre-fantôme. A la rubrique « Croissance » seront ensuite analysés les divers phénomènes qui ressortissent à la création de bibliothèques-fantômes, et témoignent par là même d’une prolifération ou d’un essaimage de ces entités dotées d’un mode d’existence paradoxal – et dont les rapports le plus souvent conflictuels avec les ouvrages réels recensés dans le monde où nous vivons et lisons méritent également d’être examinés. A la rubrique « Descendance », enfin, seront envisagés les procédés transfictionnels8 qui, du rôle fondateur du livre de l’arabe dément Abdul al Hazred dans l’intrigue de nombreuses « Necronomiconides »9, à l’expansion narrative des untold stories holmésiennes dans nombre de « Sherlockeries », assurent en quelque sorte la postérité de certains livres imaginaires – « plus fantômes » que d’autres, puisque revenant(s).
4À l’issue de ce parcours tripartite, on espère qu’auront pu être quelque peu clarifiés les modes d’être et/ou de non-être des livres-fantômes, ainsi que certaines de leurs implications épistémologiques, tant ces entités problématiques engagent de fructueuses réflexions sur des notions telles que la force perlocutoire de l’écrit littéraire, le statut ontologique de la fiction, ou encore la nature du pacte que sa réception présuppose.
***
Naissance
(Quelques recettes pour créer des livres-fantômes)
5Pour qui souhaite donner naissance à un livre-fantôme, le procédé le plus économique consiste sans nul doute en l’invention d’un titre. Ce geste de nomination10 paradoxal est si répandu que, en 1997, Jacques Geoffroy a pu constituer une anthologie de Mille et un livres imaginaires11. De la Bragueta juris (Rabelais, Pantagruel, chapitre 712) à La Tour des ombres (attribué à Barnaby Rich, Butor, L’Emploi du temps13), en passant par L’Amadisiade ou La Gauléide (attribué à Mythophilacte, Furetière, Le Roman bourgeois14), etc., les exemples en sont à ce point légion qu’on se permettra ici de renvoyer chacun à son encyclopédie personnelle, pour se concentrer sur les tenants et aboutissants du procédé même.
6Tout d’abord, si paradoxe il y a, c’est bien sûr parce que le titre ainsi forgé par analogie formelle avec les pratiques titulaires authentiques ne renvoie en l’espèce à aucune réalité extérieure à lui-même. Pour autant, si l’œuvre qu’il « baptise » est indéniablement imaginaire, au sens d’« inexistante », il paraît quelque peu excessif de produire le même diagnostic à propos du titre lui-même, à partir du moment où son inscription sur la page le dote d’une présence, donc d’une forme d’existence. En outre, conclure à la pure et simple vacuité de tels titres reviendrait à négliger le poids des codes qui régissent nos habitudes de réception, ainsi que les pouvoirs de l’écriture littéraire.
7De fait, ces titres, tantôt thématiques, rhématiques ou hybrides, et vecteurs de multiples connotations, reconduisent mimétiquement les caractéristiques de ceux que portent les œuvres réelles, de même que leurs fonctions de séduction et/ou d’information15 ; à cette notable différence près que l’apport informatif s’y trouve biaisé, faute de contenu textuel auquel il pourrait référer. Retour à Cold Mountain16 et Retour au goudron17 ne présentent pas de propriétés formelles intrinsèques qui permettraient de les discriminer, alors que si la lecture du premier est possible, celle du second ne l’est pas. La forgerie des titres d’œuvres imaginaires est donc sous-tendue par un principe d’emprunt et/ou de dérivation, qui est aussi, en aval, un jeu sur/avec nos habitudes de réception. Reconnaissant tel moule formel déjà rencontré dans le titre d’un livre authentique, sur la base de cette analogie, le lecteur pourrait être enclin à en inférer erronément une communauté d’essence entre les « textes » en cause – pour peu que nul procédé de désambiguïsation ne l’avertisse ou ne le détrompe. Si besoin était, l’hypothèse d’une telle réception fautive, car confusionniste, confirme par l’absurde les pouvoirs « performatifs » de l’écriture littéraire, qui contribue à « créer » ce qu’elle nomme dans le moment même où elle le nomme. Toutefois, en l’occurrence, dire n’est pas au sens strict faire, puisque d’une part, la condition de l’avènement des entités littéraires réside, par le canal du texte, en un accord intersubjectif entre auteur et lecteur(s), et que d’autre part, leur statut ontologique apparaît des plus singuliers. Quelque indéniable que soit la force perlocutoire du discours littéraire, ne versons donc pas dans un nominalisme inconséquent, ou un relativisme outrancier : dans le monde où nous vivons, nous pouvons lire « La cité sans nom »18 et « Le Molosse »19 de Lovecraft ; pas le Necronomicon (je sais20…), qui y est pourtant décrit et mentionné21. A en croire l’ermite de Providence, nous devrions d’ailleurs plutôt nous en réjouir…
8En outre, les risques de méprise quant au statut des livres-fantômes paraissent à l’examen rarissimes, tant les littérateurs s’ingénient d’ordinaire à multiplier les procédés de désambiguïsation à valeur de garde-fou. Il est certes toujours possible de tromper les lecteurs en multipliant les leurres, ce qui relève de la supercherie22 : rien de plus aisé, dans la mesure où nul ne peut prétendre connaître l’intégralité des livres existants. Si l’on me passe une anecdote « personnelle », à la limite du sujet qui nous occupe, c’est ainsi que procédait l’un de mes condisciples – il se reconnaîtra –, émaillant ses dissertations universitaires de noms d’auteurs et de titres d’œuvres de son cru, à quoi s’ajoutaient ponctuellement quelques travaux critiques inventés pour la circonstance, et dès lors forcément ad hoc. La virtuosité présidant à l’invention de leurs titres et la finesse du dosage de ces références fantoches (point trop n’en fallait) lui permirent de n’être jamais pris en flagrant délit de démiurgomanie – et, pour ce que j’en sais, il court toujours.
9Livre-fantoche vs livre-fantôme ? La valeur heuristique du distinguo est peut-être sujette à caution… Toujours est-il que, le plus souvent, les auteurs s’efforcent de requalifier les potentiels leurres en semblants23, pour prémunir les lecteurs contre les risques de mésinterprétation durable. Pour prendre un exemple récent, c’est ainsi que paraît procéder Franc Schuerewegen, dans Introduction à la méthode postextuelle24, lorsque, analysant les possibles connotations érotiques de l’ostréophobie du narrateur de La Recherche, il convoque une référence manifestement macaronique, « « Proustian Sexuality and Queer Oysters », in Oklahoma Journal of Gay and Lesbian Studies, vol. XI, n° 5, 2008 » »25 ; attribuée par surcroît au « Docteur S*** »26. Manifestement macaronique, tant le crédit dont pourrait jouir cette source « érudite » est sapé par l’absurdité du titre comme par l’effet de surenchère ou de redondance qu’introduit la mention du lieu de publication. Trop beau/gros pour être vrai – même dans le champ concerné… –, un tel titre tend de lui-même, sinon à s’autodétruire, du moins à se désigner comme imaginaire, de même que le texte auquel il « prétend » renvoyer27. Tel était déjà, dans un contexte moins ambigu, le procédé utilisé par Georges Perec dans Cantatrix Sopranica L., et autres écrits scientifiques28. On peut en effet raisonnablement supposer qu’un titre comme Untersuchungen über die tomatostaltische Reflexe beim Walküren29 n’aura guère donné lieu à d’innombrables recherches en bibliothèque. Bref, en raison de sa fantaisie même, affichée dans la facture du titre, l’érudition fantaisiste se donne comme un jeu auquel le lecteur est convié – et qui ne vise donc pas à le piéger.
10Certes ces deux exemples – un essai universitaire fortement teinté d’ironie, un recueil de pastiches d’articles scientifiques – sont très particuliers. Mais, en dépit de la différence de genre ou de statut qui peut les en séparer, en régime fictionnel courant, la mention d’un titre d’ouvrage imaginaire ne vise pas davantage à la tromperie. Pour rester dans la même veine, le Malogranatum Vitiorum30 rabelaisien apparaît d’emblée comme pastiche titulaire, ce qui jette pour le moins quelque soupçon sur la possible existence d’un tel opus. Il faut toutefois convenir que ces titres d’œuvres imaginaires révèlent une importante variété de régimes ou de registres, du plus loufoque (vide supra) au plus sérieux : La Tour des ombres n’a a priori rien d’un titre « impossible », et aurait fort bien pu désigner une œuvre réelle, dans un autre contexte. Mais, dans L’Emploi du temps, l’effet de mise en abyme qui « apparie » roman-cadre de Butor et roman-encadré « de » Rich suffit, je crois, à établir la dimension imaginaire du second. Idem chez Volodine, où la facture des titres d’œuvres post-exotiques imaginaires (ou encore virtuelles) est parfaitement similaire à celle des œuvres publiées – sans qu’il soit là non plus question de volonté de tromperie, mais bien plutôt d’invitation à la rêverie31. Épuiser le champ des possibles en la matière exigerait décidément trop de temps ; aussi me contenterai-je de quelques observations :
11– Même si certaines exceptions ou certains cas-limites (vide infra) sont toujours possibles, d’ordinaire, le principe de « feintise ludique partagée » sur quoi repose l’expérience fictionnelle concerne aussi les livres imaginaires évoqués dans tel roman – à charge pour l’auteur de donner à son lecteur la possibilité de comprendre qu’il « ne feint que “pour de faux”32 ».
– Quand bien même ils ne possèdent pas de référents textuels avérés, les titres d’œuvres imaginaires, du fait de leur simple mention, participent d’une relation intertextuelle. Baptisons-la « intertextualité in absentia », « fantomale », « spectrale », ou que sais-je encore : cette particularité n’en prive pas pour autant la dynamique intertextuelle de ses implications usuelles, qui en sortent peut-être même renforcées33.
– La pure et simple évocation d’un titre isolé d’œuvre imaginaire n’est à l’examen pas si fréquente, comme nombre des exemples précédents, contenant en sus, tantôt une identité auctoriale, tantôt une origine éditoriale, ont déjà permis de le constater. Le plus souvent, le livre-fantôme naît en effet à la croisée de nombreux paramètres – dont il convient donc à présent de poursuivre l’inventaire.
Décrire le livre-fantôme
(intrigue, personnages, propriétés formelles et/ou thématiques)
12Que ces procédés s’ajoutent à la mention d’un titre ou s’y substituent, la présentation narrativisée des linéaments d’une intrigue, l’évocation plus ou moins détaillée des personnages qui la peuplent, comme plus généralement la mention d’un « contenu » et/ou de particularités formelles, correspondent au franchissement d’un degré supplémentaire dans le procès d’« incarnation » du livre-fantôme. Ainsi, entre autres multiples exemples, du bref extrait du Voleur de Bagdad d’Achmed Abdullah qui fournit la première épigraphe de cet article :
Pour citer un récit hindou contemporain et sans doute véridique : le Swami était le père et la mère de toute science. Il écrivit un ouvrage très étudié sur la différence métaphysique existant entre la Substance et la Non-Substance, alors que ses lèvres étaient encore humides du lait de sa mère34.
13L’absence du titre est ici largement compensée par la divulgation de la teneur même de ce traité de philosophie, dont la dimension imaginaire est toutefois pour le moins suggérée par la conjonction de trois ressources : médiation pseudo-érudite, modalisation affectant la soi-disant véridicité de cette source indéterminée, exagération caractérisée relative à l’âge du prétendu scripteur – la mention de la problématique étudiée par le Swami valant effet de surenchère ironique, puisque cet ouvrage (imaginaire) constituerait un cas d’école pour l’analyse des rapports entre « Substance et Non-Substance ». Encore cet exemple peut-il passer pour relativement atypique, dans la mesure où la relation instituée entre livres réel et imaginaire y procède de l’hétérogénéité – le roman d’Achmed Abdullah relevant de la fiction, le traité attribué au Swami de la diction35.
14Or, à l’inverse, c’est bien souvent une relation d’homogénéité qui unit ces deux pôles. Sur ce point, l’exemple schuerewegenien précédemment évoqué peut de nouveau nous être utile, où un essai universitaire bien réel (Introduction à la méthode postextuelle) recèle une source (« Proustian Sexuality and Queer Oysters ») qui, pour être imaginaire, n’en est pas moins présentée comme ressortissant elle aussi au domaine de la recherche universitaire. En outre, loin de se contenter de la mention d’un titre, Franc Schuerewegen développe par le menu ce qu’il présente comme les analyses du Docteur S***, qui constituent donc les pages 63 à 78 d’Introduction à la méthode postextuelle – témoignant dès lors d’une (fort) ironique pratique de l’apocryphie.
15De façon globalement similaire, en régime fictionnel également, c’est bien souvent une relation de phase qui unit livres réel et imaginaire, comme dans La Jalousie36 d’Alain Robbe-Grillet, avec l’exemple célèbre du « roman africain »37 dont les personnages intradiégétiques de Franck et A… partagent la lecture. Si le titre ne nous en est pas dévoilé, constituants diégétiques (en fait, métadiégétiques), personnages et événements (des « effets fâcheux que produit la quinine sur l’héroïne »38 à « la conduite du mari, coupable au moins de négligence »39) sont évoqués à intervalles réguliers, jusqu’à cette présentation narrativisée synthétique, à quelques pages de la fin du roman-cadre : « Les complications psychologiques mises à part, il s’agit d’un récit classique sur la vie coloniale en Afrique, avec description de tornade, révolte indigène et histoires de club… »40. De façon tout aussi notoire, l’analogie entre les deux livres excède largement leur commune essence fictionnelle ou même romanesque, au point que cet exemple est fréquemment cité pour illustrer le traitement moderniste de la mise en abyme – dont il devrait être question sans trop tarder. Pour l’heure, on se contentera de signaler que ce livre imaginaire tire sa « substance » de la caractérisation qu’en propose le narrateur primaire de la Jalousie, comme des commentaires qu’il délègue aux personnages de Franck et A… Le procédé essentiel réside donc ici dans la mise en œuvre des ressources de la présupposition : le fait même que narrateur et personnages du roman de Robbe-Grillet soient en mesure de décrire et gloser le « roman africain » sous tel ou tel de ses aspects laisse entendre que l’objet de leur attention « existe » – du moins au sens qu’il est permis de concéder à ce verbe quand on entend l’appliquer à un composant diégétique. Car tel est bien le statut du « roman africain », qui, en tant qu’« objet », émarge au même niveau narratif que les personnages qui le lisent, la propriété où ils se rencontrent, la palmeraie qui la borde, etc. Bref, si mentionner un titre suffit à provoquer l’avènement d’un livre-fantôme, y substituer ou y ajouter une caractérisation plus précise de sa forme et/ou de son « contenu » permet d’intensifier l’illusion de son existence – sans pour autant qu’il s’agisse le moins du monde de leurrer les lecteurs, bien au contraire, puisque, nous le verrons, se développe ainsi un phénomène de duplication spéculaire, dont on estime communément qu’il a valeur de dénudation du medium littéraire, comme de suggestion de fictionalité.
Interpoler des extraits
16Franchissant un pas supplémentaire, il advient que les littérateurs « accréditent » – dans le sens tout relatif, et fort ambigu, qui vient d’être spécifié – l’existence de tel ou tel livre-fantôme en en citant des extraits. Au lieu que, dans l’exemple de La Jalousie, seuls les personnages intradiégétiques de Franck et A… pouvaient lire le « roman africain », dans cette autre configuration (qui ne relève toutefois pas d’une différence d’essence, mais simplement de degré), ce sont alors les lecteurs extradiégétiques, autrement dit réels, qui se voient offrir un paradoxal accès au livre-fantôme. Tel est par exemple le cas dans Misery de Stephen King41, où est narrée la séquestration de Paul Sheldon, auteur à succès des aventures de « Misery Chastain », par Annie Wilkes, lectrice inconditionnelle de cette série historique à l’eau de rose. Par-delà la mise en place d’un huis-clos très efficace, en raison de l’angoisse qu’il distille, ce roman constitue une stimulante réflexion en acte sur les rapports de sujétion qui se nouent entre l’écrivain « grand public » et son lectorat, de même que sur la frontière entre littérature et paralittérature. En outre, l’un des procédés les plus ingénieux employés par King y consiste en l’interpolation, au sein de la diégèse, de larges extraits du manuscrit que le personnage d’écrivain en abyme se trouve littéralement forcé de rédiger, sous la menace croissante de l’admiratrice éperdue de l’héroïne qu’il a créée. En conséquence, les lecteurs réels ont dès lors la possibilité de lire alternativement, au sein du même volume, les aventures intradiégétiques de Paul Sheldon et Annie Wilkes, et les aventures métadiégétiques de « Misery Chastain » – toute confusion entre les deux niveaux étant prévenue par l’emploi de typographies distinctes, celle du « Retour de Misery » imitant les caractères d’une machine à écrire de médiocre qualité, défectuosités comprises.
17Ce procédé d’interpolation fragmentaire correspond à l’examen à une déclinaison métonymique de la création d’un livre-fantôme par voie de présupposition. En effet, si le Misery de Stephen King ne contient qu’une partie (quelques chapitres) du « Retour de Misery » de Paul Sheldon, la présence même de ces extraits nous incite à inférer l’existence du tout plus vaste auquel ils sont censés appartenir. Mais la différence réside bien sûr dans la possibilité qui nous est ainsi offerte d’un accès à ces pans du livre-fantôme – lequel y gagne dès lors en consistance. Pour autant, ces mécanismes citationnels ne visent absolument pas à accréditer durablement, en dehors de la diégèse de Misery, l’existence du « Retour de Misery », simple analogon intradiégétique42, dont la dimension imaginaire est d’emblée évidente. Que ce roman(ce) en abyme soit le foyer de réflexions métafictionnelles ne change rien à l’affaire, pour ce qui est de son statut ontologique du moins.
18Toutes choses égales par ailleurs, un procédé similaire dans son principe est à l’œuvre dans Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino43. Pour mémoire, l’intrigue-cadre, relatant les aventures d’un lecteur et d’une lectrice, intègre les divers débuts de romans (« italiens, cimmériens, japonais, sud-américains ; réalistes, métaphysiques, engagés, érotiques, fantastiques, phénoménologiques »44) qu’ils lisent, et doivent pour des raisons diverses abandonner sans en connaître la suite – de sorte que diégèse et métadiégèses s’enchaînent selon une alternance réglée, un chapitre sur deux. Le procédé, de même que ses implications vertigineuses, est beaucoup plus complexe et ambitieux – on s’en serait douté – que celui mis en œuvre par King ; mais il n’en confirme pas moins les analyses produites à propos du « Retour de Misery ». Au même titre que les personnages intradiégétiques du « lecteur » et de la « lectrice », les lecteurs/lectrices extradiégétiques (réel(le)s) peuvent lire les incipit de « Si par une nuit d’hiver un voyageur », « En s’éloignant de Malbork », « Penché au bord de la côte escarpée », etc. L’interpolation même de ces débuts de romans au sein de celui de Calvino présuppose là encore que leurs suites respectives existent « quelque part » – cette dialectique de la partie (présente) et du tout (absent) constituant en définitive une technique efficace pour la création de livres-fantômes. Mais, pour rendre justice à Calvino, ce point, essentiel dans le cadre d’une réflexion sur les livres imaginaires, ne constitue somme toute qu’un épiphénomène à l’aune de la complexité d’un texte s’achevant par une mise en abyme aporétique compliquée de métalepse, et portant par là même une inquiétude sur la frontière entre monde où l’on lit et monde que l’on lit.
Mise en abyme et/ou rhétorique métatextuelle
19Plusieurs des exemples précédents l’attestent, la création de livres-fantômes transite fréquemment par une représentation de l’activité scripturale et/ou de l’activité lectrice – stratégie(s) qui relève(nt) de ce que, depuis André Gide45 et Lucien Dällenbach46, l’on a coutume de désigner par l’expression de « mise en abyme ». En l’occurrence, il ne s’agit pas d’analyser le phénomène pour lui-même, ni d’empiler les exemples selon une logique cumulative ; aussi se contentera-t-on d’interroger les implications du procédé. Si mention d’un titre, évocation de personnages et/ou des contours d’une intrigue, présentation de propriétés formelles et/ou thématiques, citation d’extraits supports d’une éventuelle glose, etc., concourent à instituer une relation d’ordre spéculaire entre livre « abymant » (réel) et livre « abymé » (imaginaire), quels en sont donc les effets, autrement dit l’impact sur les lecteurs ? Le consensus relatif à la dimension « dénudante » et « déréalisante » de la mise en abyme a déjà été signalé ; encore importe-t-il, dans une perspective pragmatique, de décomposer le fonctionnement de ce mécanisme « à double détente ». De prime abord, sur le plan dénotatif, le procédé paraît jouer la carte de l’accréditation : La Jalousie nous « dit » que les personnages de Franck et de A… lisent et commentent un « roman africain », Misery nous « dit » que l’écrivain Paul Sheldon écrit « Le Retour de Misery », qu’Annie Wilkes lit chapitre après chapitre, au fil de sa rédaction, etc. Au même titre que les autres constituants diégétiques, le livre-fantôme est donc présenté, sinon comme réel, du moins comme un élément parmi d’autres de l’univers de l’histoire racontée (diégèse ou fabula), sur fond de commun statut ontologique – régi, en amont comme en aval, par le principe de feintise ludique partagée. Sauf supercherie de l’auteur, ou aberration du lecteur, il n’est bien sûr pas question d’y croire sérieusement (« pour de vrai ») ni de façon durable, seulement de faire semblant d’y croire (« pour de faux ») pour un temps, puisque telle est la règle du jeu fictionnel. Toutefois, il serait inexact de prétendre que le livre-fantôme ne se distingue en rien des autres constituants diégétiques, puisque, par le jeu de ressources variées, ce qui est également signalé, c’est l’essence – on l’aura compris, livresque ; voire, bien souvent, fictionnelle ; ou encore, romanesque – qu’il partage avec le volume au sein duquel son existence est posée, dans les termes et le sens évoqués plus haut. La suggestion de cette analogie vaudrait donc « dénudation », puisque, a minima, le medium commun aux deux opus (le réel / l’imaginaire) se trouve ainsi mis au jour ; et, par voie de conséquence, entraîne leur « déréalisation », en obérant l’illusion référentielle pour entraîner le report de l’attention lectorale sur un procès (partagé) de textualisation, inscrit le plus souvent en régime fictionnel.
20Pour autant, et à rebours d’une doxa moderniste plus naïve que la réputation de ses thuriféraires ne le laisserait à penser, il n’y a pas lieu d’opposer en la matière deux attitudes antagonistes, qui s’enchaîneraient nécessairement sur le mode de la consécution dans la temporalité des opérations de lecture. Autrement dit, et sauf cas d’espèce, je ne commence pas par croire à l’existence du livre-fantôme, avant de me raviser, une fois perçue l’analogie entre livre « abymant » et livre « abymé », pour alors seulement comprendre qu’il n’y a là, somme toute, que jeux de l’esprit/de l’écrit, c’est-à-dire littérature. Sur le plan empirique, comme l’a bien montré Jean-Marie Schaeffer, en raison du cadre pragmatique particulier qui régit l’expérience fictionnelle, la lecture implique au contraire un état mental « scindé »47 ou « biplanaire » (Iouri Lotman48), qui nous permet de faire comme si les énoncés assertifs contenus dans le texte n’étaient pas feints, tout en sachant qu’ils le sont. Si l’on souscrit à ces analyses, il s’ensuit que le lecteur de fiction feint (avec l’auteur) de croire à l’existence du livre-fantôme, tout en ayant conscience qu’il ne s’agit là que d’un artefact (doublement) imaginaire. Ce n’est pas là nier la spécificité du procédé ; mais bien plutôt affirmer que s’y joue un mécanisme d’amplification, et dès lors de désignation oblique du statut ontologique propre aux entités fictionnelles qui, à l’examen, toutes, « sont, sans être ». Au pays de la fiction, peut-être la spectralité est-elle ainsi en définitive la chose au monde la mieux partagée.
21Formuler un tel constat n’interdit pourtant pas de saluer l’inventivité de certains écrivains, qui ont su renouveler le topos du livre mis en abyme, par le jeu des ressources de la métalepse, dans un geste intensément métafictionnel. Ainsi, en particulier, de ces phénomènes que Dällenbach classait à la rubrique « mises en abyme aporétiques ». Du côté de l’écriture, l’œuvre d’André Gide en contient notoirement nombre d’exemples : on se souvient ainsi que le roman intitulé Les Faux-monnayeurs49 recèle plusieurs extraits du journal du personnage intradiégétique d’Edouard, qui ambitionne d’écrire un roman précisément intitulé « Les faux-monnayeurs ». Ou encore, dans la Sotie qu’est Paludes50, Hubert, figure d’écrivain imaginaire, travaille à l’écriture d’un roman dont le titre est également « Paludes » – « j’écris Paludes » y tournant au leitmotiv. Chez Calvino également, on l’a vu, dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, le titre du premier roman dont l’incipit est soumis à la curiosité du personnage du lecteur est – qui l’aurait oublié le devinera aisément – « Si par une nuit d’hiver un voyageur »51. Du côté de la lecture, si le procédé est moins fréquemment exploité, il a tout de même fait l’objet d’une déclinaison virtuose par Nathalie Sarraute, dans Les Fruits d’or52, dont les divers personnages produisent force commentaires évaluatifs sur un livre récemment paru sous le titre… « Les fruits d’or », et attribué à un écrivain du nom de « Bréhier ». Si ce type de configuration relève de l’aporie, c’est parce que l’identité des titres paraît suggérer une assimilation, scandaleuse pour la logique, du « contenu » et du « contenant » – situation tératologique dont on peut tenter de rendre compte (on ne s’en est pas fait faute) en mobilisant les métaphores de l’invagination ou du ruban de Möbius.
22Pourtant, à lire ou relire ces romans, on s’avise somme toute aisément que la confusion du livre enchâssé et du livre enchâssant n’y est jamais expressément formulée ; plus encore, que trop d’éléments discriminants viennent la contrecarrer, sinon l’interdire. Toutefois, en dépit de cette impossibilité manifeste, dans nos habitudes de lecture le poids du titre est tel que le redoublement qui l’affecte paraît suffire à immiscer le doute dans nos esprits. À tout le moins, semble se déployer ainsi, de façon fort économique, une variante particulièrement « transgressive » de la métalepse53, suggérant l’assimilation du livre imaginaire (intradiégétique) et du livre réel (extradiégétique). Et il n’est pas certain que la perception des différences séparant les deux items désignés par un seul et même titre suffise à totalement dissiper l’ombre ainsi portée sur nos convictions en la matière. J’ai beau pertinemment savoir que « Les fruits d’or » de Bréhier ne peut se superposer rigoureusement et sans reste aux Fruits d’or de Nathalie Sarraute (qui le contient), il n’empêche que le trouble dispensé par cette homonymie est appelé à perdurer, de façon diffuse, en dépit de ce savoir. Comme disait à peu près l’autre, « je sais bien, mais quand même… » Le propre des fantômes, dit-on, est de hanter jusqu’à ceux qui leur dénient toute existence ; peut-être les livres-fantômes, par la vertu de la mise en abyme aporétique (Dällenbach) ou de la métalepse (Genette et alii), possèdent-ils en définitive un pouvoir similaire…
23Si ce soupçon s’immisce déjà, sur la foi d’un simple titre partagé, à la lecture de textes qui ne paraissent pas spécifiquement l’encourager, on comprend qu’il devrait sortir considérablement renforcé de la fréquentation de livres dont les auteurs s’ingénient pour leur part, au moyen d’autres ressources, à l’entretenir de propos délibéré – fût-ce de façon ludique. Tel est, selon moi, le cas dans l’explicit du Vol d’Icare de Raymond Queneau : « HUBERT (refermant son manuscrit sur Icare) : Tout se passa comme prévu ; mon manuscrit est terminé. »54 Sans entrer, faute de temps, dans le détail d’un texte qui fait feu de toutes les possibilités inhérentes à la métalepse55, on peut toutefois observer que, cette fois, à la faveur de l’ultime réplique du personnage d’écrivain en abyme qu’est Hubert (remember Paludes…), et en son sein de l’emploi du possessif, l’assimilation du livre imaginaire (celui d’Hubert) et du livre réel (celui de Queneau) est pour le moins vivement encouragée. Certes, nul lecteur n’est censé, sur la foi de cet explicit, attribuer sérieusement Le Vol d’Icare à Hubert Lubert plutôt qu’à Raymond Queneau, ni même hésiter entre les deux identités auctoriales. Mais l’évidence du jeu n’interdit pas le vertige que suscite la transgression de la frontière de la représentation. Toutefois, même si le trouble qui découle d’un tel procédé paraît indéniable, plutôt que d’identifier là l’origine de quelque angoisse stricto sensu, dont le lecteur pourrait faire les frais devant le spectacle du vacillement de ses certitudes les mieux acquises, j’inclinerais à penser qu’est surtout ainsi ironiquement (si l’on préfère, par l’absurde) désignée la nature même du « pacte » d’écriture-lecture qui sous-tend l’expérience fictionnelle. Une fois encore, non pas leurrer, mais faire semblant, et le suggérer – pour le plaisir, partagé, des partenaires (particuliers) que sont auteur et lecteurs56.
24Reste, même si les implications en sont globalement similaires, que certains textes contemporains paraissent fragiliser davantage encore la frontière entre livre réel et livre-fantôme (ou imaginaire), en jouant non pas tant des ressources de la mise en abyme stricto sensu que de celles qu’offre plus généralement le métatextuel57. Tel est par exemple le cas du « cycle » de Monsieur Songe58 par Robert Pinget, consacré à l’évocation fort ironique des ratiocinations et procrastinations de l’aspirant-écrivain éponyme. Plus particulièrement, dans Charrue, apparaît un procédé, la « Note roman », qui relève à la fois, me semble-t-il, de l’allusion et de l’ironie métatextuelles. Qu’on en juge :
Note roman.
Pour suppléer à l’intrigue, étoffer le texte, accumulation de petits faits vécus, le tout accompagné de commentaires sur les aléas de l’existence, ou même pimenté d’interprétations psychologiques. Important la psychologie. Et glisser ça et là un terme scientifique, une référence littéraire, une interférence du narrateur, bref de quoi alimenter la réflexion d’un lecteur qui se veut averti59.
25Sur fond de brouillage de l’origine énonciative, auquel concourt l’emploi de l’infinitif jussif et de tours nominaux, le locuteur « effacé » fait sentir, sans le dire, le rapport de la pratique scripturale qu’il présente comme encore virtuelle avec celle qui est déjà actualisée dans/par Charrue, entre autres ouvrages de Pinget, d’ailleurs – ce qui correspond bien, puisqu’il est ici question d’écriture, à une variante métatextuelle de l’allusion, telle que la définit Fontanier60. Mais on pourrait tout aussi bien diagnostiquer une ironie métatextuelle, dans la mesure où la perception par le lecteur de l’analogie, voire de l’identité, entre écritures virtuelle et actuelle, implique une saisie des spécificités scripturales mêmes de Charrue, qui fournissent le « contexte vicaire »61 nécessaire à la production de l’effet d’ironie. Bref, trêve de tergiversations taxinomiques, l’essentiel réside en l’occurrence dans l’assimilation implicite du livre-fantôme (celui que Monsieur Songe ambitionnerait d’écrire) et du livre réel (Charrue, que Robert Pinget a écrit).
26Un principe similaire informe de façon non moins décisive la plupart des écrits de Marcel Bénabou, à commencer par Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres62, dont l’écriture est rythmée par la ronde des livres-fantômes (ou morts nés), comme l’atteste la révélation finale, à valeur de « mode d’emploi » rétroactif : « Je savais donc ce qui me restait à faire : une sorte de coup de force par lequel il me fallait arriver à faire exister fictivement des livres qui n’existent pas vraiment et, par là, donner une existence réelle au livre qui traite de ces livres fictifs. »63 Dont acte, puisque telle est précisément la structure du livre dont nous achevons la lecture au moment où nous prenons connaissance de ces lignes. Si l’ironie est omniprésente dans Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, elle y résulte cette fois d’une subtile mise en tension de la prétérition et de l’allusion métatextuelles, dont les effets antagonistes tendent à s’équilibrer. Une bonne part du sel de l’entreprise réside en effet dans le dépassement, par le lecteur, des dénégations du scripteur, qui, s’il irréalise les livres qu’il évoque, en combinant les ressources du système hypothétique et du mode conditionnel, n’en suggère pas moins à l’inverse, dans le même temps, que l’accumulation de ces livres inexistants contribue de façon paradoxale à l’édification de celui – bien réel – que nous tenons entre nos mains. Peut-être pourrait-on y voir une déclinaison littéraire du principe mathématique selon lequel « moins par moins égale plus » ? Assurément, quoi qu’il en soit, une brillante variation sur la dialectique de la Non-Substance et de la Substance – en tant que telle digne de l’intérêt du Swami d’Achmed Abdullah… À travers ces exemples, parmi d’autres (Pierre Senges64, Tanguy Viel65, etc.), on constate donc que, sur fond de réflexion métafictionnelle, et par la grâce des ressources variées du métatextuel, la frontière entre livre réel et livre-fantôme tend parfois à se faire des plus ténues – ce qui convoque inévitablement (il était temps) l’ombre tutélaire de Jorge Luis Borges.
Fictions de critique, d’édition critique, d’histoire littéraire
27En effet, un essai de poétique du livre-fantôme ne saurait faire l’impasse sur des textes tels que « Pierre Ménard, auteur du Quichotte »66, « L’approche d’Almotasim »67, ou « Examen de l’œuvre d’Herbert Quain »68, qui se situent à la croisée de l’étude critique in absentia, de l’apocryphie et de la supposition d’auteur – dans des pages justement célèbres, dont l’ambiguïté est encore amplifiée par la concision. Le commun dénominateur de ces textes réside notoirement dans le déploiement de considérations critiques relatives à des auteurs et des livres qui n’ont d’autre existence que celle que leur confèrent précisément les pages où Borges les évoque – ce qui relève donc d’une forme de parodie de critique littéraire. Il est dès lors difficile d’aller plus loin que ne l’a fait l’auteur de Fictions dans la « présentification » de livres imaginaires, sans basculer dans la mystification ; domaine avec lequel il a volens nolens flirté. Comme l’a bien montré Annick Louis69, la saisie de la nature fictionnelle de tels écrits dépend de la prédominance des « indices conventionnels de fictionnalité » sur les « indices conventionnels de référentialité »70. Or la hiérarchie de ces indices contradictoires, loin de ne dépendre que de facteurs purement textuels, est également tributaire de paramètres contextuels, comme les conditions d’édition, de publication et de réception71. Ainsi, de nos jours, pour les lecteurs de l’édition française de Fictions72, sous ce titre éminemment signifiant, la présence même de ces textes au sein d’un recueil où ils voisinent avec d’évidentes fictions telles que « Les ruines circulaires » ou « La bibliothèque de Babel », tend à limiter les risques de méprise sur leur statut. Contribue également à cette désambiguïsation73 l’adjonction d’un prologue autographe à valeur d’ « art poétique » :
Délire laborieux que de composer de vastes livres, de développer en cinq cents pages une idée que l’on peut très bien exposer oralement en quelques minutes. Mieux vaut feindre que ces livres existent déjà, et en offrir un résumé, un commentaire. Ainsi procédèrent Carlyle dans Sartor Resartus ; Butter dans The Fair Haven : ouvrages qui ont l’imperfection d’être également des livres non moins tautologiques que les autres. Plus raisonnable, plus incapable, plus paresseux, j’ai préféré écrire des notes sur des livres imaginaires. Telles sont Tlön, Uqbar, Orbis Tertius ; l’Examen de l’œuvre d’Herbert Quain ; L’approche d’Almotasim74.
28Mais, à l’époque de leur publication première en espagnol, plusieurs de ces textes n’étaient pas accompagnés de semblables garde-fous interprétatifs, puisqu’ils parurent originellement, en ordre dispersé, dans la revue Sur ; de sorte que, de leur propre aveu, certains lecteurs se méprirent, et crurent à l’existence réelle de ces livres imaginaires. Ces avatars de la réception des fictions borgésiennes nous rappellent donc toute l’importance du cadre pragmatique dans la perception de la fictionalité, et mettent en lumière la potentielle ténuité de la frontière entre création de livres imaginaires et mystification – même s’il semble s’agir ici, au risque de la contradiction dans les termes, d’une « mystification involontaire »75 (de la part de l’auteur) et/ou d’une automystification (de la part de certains lecteurs). Si l’on préfère éviter ces formules légèrement spécieuses, disons qu’est alors désignée a contrario la dimension partagée de la feintise ludique définitoire de l’expérience fictionnelle, puisque, comme l’affirme Jean-Marie Schaeffer, « il ne suffit pas que l’inventeur d’une fiction ait l’intention de ne feindre que « pour de faux », il faut encore que le récepteur reconnaisse cette intention, et donc que le premier lui donne les moyens de le faire76. »
29Soit. Mais il importe aussitôt de préciser que, dans le champ des pratiques artistiques, rien ne saurait contraindre les littérateurs à une telle clarification du statut de leurs écrits ; et que, tout au contraire, certaines œuvres tirent une bonne part de leur intérêt de l’indécision qui peut affecter leur statut – sans pour autant qu’on soit fondé à en inférer une volonté mystificatrice stricto sensu. Tel est exemplairement le cas des nombreux77 volumes consacrés par Jean-Benoît Puech à Benjamin Jordane, sa vie, son œuvre. Ainsi, Puech ne prétend pas sérieusement accréditer l’existence authentique de cet écrivain imaginaire, dont il publie pourtant ce qui est présenté comme autant d’« inédits […], notes de lecture sur des œuvres méconnues, journal intime ou littéraire, projets de romans, nouvelles achevées »78. En l’absence même du désir de tromper le lectorat, l’ambiguïté est ainsi portée à son comble, à la faveur d’un décalque habile des méthodes en vigueur dans le domaine de la critique et/ou de l’histoire littéraire – ce qui correspond à la systématisation de certains aspects de la poétique borgésienne. Jordane ne dispose certes que d’une vie littéraire, et Puech se livre ouvertement sous nos yeux à une invention de l’auteur, et corollairement de son œuvre ; mais, en dépit de ce savoir, il est difficile, à la lecture de ces volumes, de se défaire d’un trouble insistant – lié notamment à l’efficacité des nombreux indices conventionnels de référentialité. Tout fantomatiques qu’ils soient, ou plutôt précisément parce qu’ils le sont, auteur et livres imaginaires parviennent en l’occurrence à durablement hanter le lecteur, confronté pour sa part à une nouvelle règle du jeu, frappée du sceau de l’ambiguïté – et qu’il lui appartient en dernier ressort d’accepter, ou non.
30Cela dit, même si, pour les besoins de la démonstration en cours, je viens de mettre l’accent sur quelques cas-limites, foncièrement ambigus, il n’en est pas moins vrai, là comme ailleurs, qu’une grande variété de régimes – du plus sérieux au plus loufoque – peut être observée. En la matière, tout est en effet affaire de dosage, et l’exacerbation du ton parodique peut suffire à désambiguïser ce type de pratique. Par exemple, s’il est peut-être, à la rigueur, avec beaucoup de « bonne » volonté, encore possible de se méprendre sur la statut de telle ou telle des Chroniques de Bustos Domecq79, en dépit d’une nette surenchère ironique par rapport aux nouvelles déjà citées de Fictions, cela n’est plus le cas – du moins, espérons-le – à la lecture de L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster80. Dans ce roman d’Éric Chevillard, en effet, un narrateur de type homodiégétique, Marc-Antoine Marson, entreprend, en marge de la publication posthume de ses œuvres, de dresser le portrait bio-bibliographique de son défunt « ami », l’écrivain dont l’identité figure dans le titre. Or, au fil des pages, le lecteur comprend très vite qu’en lieu et place de l’exercice d’admiration auquel donne souvent lieu ce genre de tribut posthume, d’allusions perfides en notes de bas de page assassines, c’est à l’inverse à un véritable exercice d’exécration qu’il lui est donné d’assister. L’héroographie que laissait peut-être attendre le titre cède par conséquent la place, si l’on ose dire, à une « zéroographie »… Se développe ainsi une fort grinçante satire de certains us critiques, dont l’outrance même dit assez le caractère décalé – sans que le lecteur ait besoin de se reporter à l’étiquette générique « roman », présente dans le péritexte, pour dissiper d’éventuelles hésitations, qui n’ont pas lieu d’être. La cruauté outrancière dont fait preuve le biographe de feu Thomas Pilaster tient à elle seule lieu de guide-âne interprétatif, et suffit à placer l’entreprise sous le signe de la démarcation parodique. Aussi ni le statut du texte ni celui de ses objets (un auteur et une œuvre imaginaires) ne paraissent-ils douteux.
31Mais, à la réflexion, peut-être un tel diagnostic est-il excessivement optimiste et/ou péremptoire (?), tant il est vrai qu’en matière d’effets de lecture, mieux vaut se garder de toute généralisation intempestive. En outre, avec un auteur aussi facétieux qu’Éric Chevillard, la prudence est de mise : après tout, dans l’un de ses romans81 suivants, n’a-t-il pas fait subir au bien réel Désiré Nisard82 un sort somme toute fort proche de celui qu’il avait réservé à l’imaginaire Thomas Pilaster ?... Toutefois, compte tenu, entre autres paramètres, de l’ordre de parution de ces deux livres, si mésinterprétation il devait y avoir, gageons qu’elle verrait le lecteur, non pas prendre Pilaster pour un écrivain réel, mais bien plutôt, inversement, Nisard pour une figure imaginaire83 ; ce qui constitue sans doute, de la part de l’auteur à l’origine d’une telle méprise, la meilleure façon de démolir ce représentant éminent (ils le sont tous) quoique oublié d’une conception positiviste de l’histoire littéraire. Mais trêve de spéculations.
Croissance
(L’invasion des livres-fantômes)
32Quoi qu’il en soit, avec les exemples empruntés à Borges, Bioy Casares, Puech et Chevillard, la réflexion s’est insensiblement déplacée de la naissance à la croissance des livres-fantômes ; puisque entre la simple mention d’un unique texte et l’évocation, voire l’analyse, d’une œuvre, se fait jour une substantielle différence de degré. C’est donc en quelque sorte à l’invasion de la littérature par les livres-fantômes qu’il convient à présent de s’intéresser. De cet effet d’annonce, on aura donc inféré que le substantif « croissance » présent dans l’intertitre qui surplombe ce paragraphe doit être pris non pas dans l’acception de « développement individuel », mais dans celle d’« expansion », de « prolifération » ou d’« essaimage »84. Si Borges et Chevillard attribuaient à des écrivains imaginaires tels que Herbert Quain ou Thomas Pilaster toute une œuvre de même farine, il advient en effet que certains littérateurs procèdent à une démultiplication du procédé, et se livrent par là même à l’invention de bibliothèques entières – qu’il est dès lors tentant de considérer comme autant de bibliothèques-fantômes. Tel était déjà le cas, on l’a vu, au chapitre 7 de Pantagruel, où Rabelais multipliait à l’envi les références pseudo-érudites, dont la fantaisie présidant à l’invention de leurs titres connotait la dimension imaginaire, de même que le caractère parodique de l’entreprise. Différemment, à l’époque contemporaine, et de façon somme toute prévisible, compte tenu de la prévalence d’une ontologie du doute, les inventeurs de bibliothèques-fantômes s’affranchissent bien souvent d’un tel geste de surlignement ironique de leur activité de forgerie, et jouent plutôt la carte d’une relative ambiguïté. Ainsi par exemple de Roberto Bolaño, dans La Littérature nazie en Amérique85, texte dénué d’étiquette générique, et se présentant comme une compilation d’une trentaine de notices bio-bibliographiques, d’ampleur variable, « traitant d’auteurs du xxe siècle ayant en commun leur fascination pour le fascisme ou le nazisme »86. Si l’ouvrage n’est pas sous-tendu par une intention mystificatrice, il n’en reste pas moins que le trouble dispensé par plusieurs fictions d’éditions critiques (Borges, Puech) peut de nouveau s’immiscer ici dans l’esprit des lecteurs – en raison, une fois encore, du décalque rigoureux de certains habitus critiques. De fait, La Littérature nazie en Amérique épouse la forme d’un manuel d’histoire littéraire, et s’achève, sous le titre de « Quelques livres », par une bibliographie de 13 pages, conférant ainsi à la bibliothèque-fantôme une visibilité accrue. Sans doute est-il peu probable qu’un lecteur croie sérieusement qu’une bonne trentaine d’auteurs du xxe siècle aient pu mystérieusement, à si brève échéance, disparaître dans les oubliettes de l’histoire littéraire. Mais le moins que l’on puisse dire est que Bolaño maintient le statut de son texte dans l’indétermination, en s’abstenant d’y faire figurer les facteurs de désambiguïsation qui auraient permis de clarifier le cadre pragmatique approprié à sa réception. À l’inverse, la mention87, entre « La Petite Muette, d’Amado Couto, Rio de Janeiro, 1987 » et « Une philosophie simple, de Rory Long, Los Angeles, 1987 », de « Philosophie de l’ameublement, d’Edgar Allan Poe, dans Essais et Critiques, traduction de Julio Cortazar », contribue à brouiller les pistes, puisque par contagion métonymique, la présence de cette source vérifiable et avérée pourrait inciter à penser que les autres items répertoriés en bibliographie partagent son statut. Faut-il dès lors en conclure que la feintise ludique à laquelle se livre l’auteur risque de n’être pas partagée ? Sans doute serait-ce aller un peu loin : certes, la mention du texte de Poe entre ceux de Couto et de Long introduit une discordance troublante, qui opacifie le statut du livre de Bolaño, mais l’effet d’accumulation inhérent à l’édification d’une bibliothèque-fantôme vient, me semble-t-il, amplement compenser cet indice ponctuel de référentialité, noyé dans la masse des références imaginaires dont le caractère fantaisiste est souvent manifeste – comme dans le cas des ouvrages attribués à Zach Sodenstern : Les Gangsters-chauves-souris, et Le Quatrième Reich de Denver88… Nonobstant tel effet de flottement ponctuel, tel est bien d’ailleurs l’intérêt de l’entreprise de Bolaño : appliquer le principe de feintise ludique partagée définitoire de l’expérience fictionnelle, non plus seulement à divers constituants diégétiques « ordinaires », mais à un ensemble d’auteurs et d’œuvres, sur fond de sérieux apparent, sans lequel il n’y aurait guère de plaisir. Telle est, selon moi, la règle qui préside à l’invention des bibliothèques-fantômes.
33On en trouverait confirmation chez nombre d’écrivains œuvrant à la création d’univers spécifiques. Que les littératures dites, à tort ou à raison, « de l’imaginaire » (quelle littérature ne l’est pas ?...) recèlent nombre de livres… imaginaires ne devrait en effet guère surprendre – d’autant que l’acronyme « SF », sous lequel on range, souvent de façon abusive, ces productions, peut aussi signifier, rappelons-le, « Slightly Facetious », ce qui correspond bien à la « règle » qui vient d’être dégagée. A titre d’exemple, on peut mentionner l’ambitieux projet de Frédéric Werst dans Ward (ier et iie siècles)89, qui se présente comme une anthologie littéraire bilingue (français/wardwesân) d’une civilisation disparue, les Wards. Y sont « collationnés » textes religieux, épopées, essais de tous ordres ; complétés par une grammaire et un lexique du wardwesân – selon la logique de mimèsis formelle déjà à l’œuvre dans plusieurs des exemples précédents. On retrouve là, mais portée à son paroxysme, la tension entre feintise ludique partagée (puisque ni l’auteur ni les lecteurs ne sont censés croire à l’existence des Wards ou de leur littérature) et sérieux dans l’invention (puisque l’entreprise se caractérise par sa cohésion et son systématisme).
34Sans pour autant verser dans la critique de sources, en lisant/en écrivant ce qui précède, il est difficile de ne pas penser à Antoine Volodine, à qui nous sommes redevables de l’invention du « post-exotisme » : esthétique attribuée à une communauté carcérale de révolutionnaires internationalistes, vaincus et emprisonnés dans un quartier pénitentiaire de haute sécurité par les sbires du capitalisme triomphant (les « ennemis du bonheur »). Schème fédérateur de l’œuvre volodinienne, la notion de post-exotisme a été très précisément formalisée dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze90, texte hybride, entre fiction et art poétique, qui s’achève – fort providentiellement pour l’analyste des livres-fantômes –, sous l’intitulé parodique « Du même auteur dans la même collection », par une bibliographie recensant… 343 ouvrages post-exotiques – de « Des anges mineurs, romånce, Maria Clementi, 1977 » à « Retour au goudron, romånce, attribué à Lutz Bassmann, s. d. ». Déjà remarquable par son ampleur, cette bibliothèque-fantôme recèle en outre diverses particularités qui, pour peu que nous les percevions, nous font obligation de reconsidérer nos certitudes relatives aux rapports des livres-fantômes et des livres réels. En particulier, le premier item de la bibliographie en atteste, certains des livres effectivement publiés par Antoine Volodine, avant mais aussi bien après 1998, date de parution du Post-exotisme…, y sont répertoriés, mais sous une étiquette générique différente, et surtout attribués à d’autres auteurs, dans lesquels le lecteur peut reconnaître divers personnages récurrents des fictions post-exotiques. Entre intertextualité, métatextualité, métalepse voire transfictionnalité, prend ainsi corps une entreprise remarquablement ambitieuse, dont les implications ne sont pas moins stimulantes.
35En effet, l’attribution par l’auteur de certains de ses ouvrages à tel ou tel personnage fictionnel vient ici renchérir sur l’une des constantes axiologiques de l’œuvre où, en bonne logique égalitariste, la différence entre « le tien » et « le mien », et même entre « toi » et « moi », est régulièrement récusée. L’autorité, fût-elle littéraire, se trouve donc ainsi subvertie. Or, loin d’en rester là, Antoine Volodine va jusqu’à publier divers volumes aux éditions de L’Olivier, Verdier ou à L’École des loisirs, sous les hétéronymes de Manuela Draeger, Elli Kronauer et Lutz Bassmann, autant de personnages des fictions post-exotiques. Dès lors, on assiste à un parasitage en règle du monde éditorial, où prolifèrent désormais des livres bien réels, publiés sous l’identité de personnages fictionnels.
36Peut-être n’est-il pas inutile d’y insister : le projet volodinien ne relève ni de la supercherie, ni de la mystification, mais d’une pratique jusqu’au-boutiste de la fiction, fondée sur un souci d’extrême cohérence. Puisque la propriété est proscrite de l’univers post-exotique, elle n’a pas davantage droit de cité dans les espaces éditoriaux du monde réel. L’auctoritas y sera dès lors plurielle, ou ne sera pas…
37Il n’en reste pas moins que le trouble déjà maintes fois évoqué atteint ici son comble. Lorsque, en 1998, le lecteur prend connaissance de la première entrée de la bibliographie qui clôt Le Post-exotisme…, il identifie avec toutes les apparences du bon droit Des anges mineurs comme un livre imaginaire. On mesure donc sa probable surprise lorsque, un an plus tard, les éventaires des librairies présentent un livre bien réel portant ce titre91. Sans doute ne s’agit-il pas du même ouvrage, mais le dispositif volodinien, par le canal du livre, porte ainsi une inquiétude sur la différence entre imaginaire et réalité – de nouveau, conformément aux valeurs d’une œuvre exaltant l’annulation des dualités. Entre autres « leçons », la littérature post-exotique nous enseigne donc que le livre-fantôme pourrait bien, un jour ou l’autre, devenir réel.
Descendance
(Postérité des livres-fantômes)
38Autant qu’en termes de « croissance » (ou de prolifération), le traitement post-exotique des livres-fantômes pourrait être analysé en termes de « descendance » (ou de postérité) puisque, le destin éditorial des Anges mineurs en atteste, certains de ces opus imaginaires peuvent un jour cesser de l’être – aux distorsions près qui ont déjà été signalées. La propagation des livres-fantômes paraît en effet s’effectuer alors non seulement selon une dynamique horizontale (ou synchronique), mais aussi selon une dynamique verticale (ou diachronique) – que pourrait représenter la flèche du temps.
39D’aucuns estimeront peut-être que le phénomène est selon toute probabilité restreint au seul univers post-exotique, en raison de l’extrême singularité qui le caractérise ? Pourtant, à y regarder d’un peu près, des phénomènes pour partie similaires adviennent bel et bien dans d’autres œuvres, et/ou d’œuvre(s) à œuvre(s), dans l’espace interstitiel qui les relie. Que l’on pense par exemple au sort réservé au célèbre Necronomicon, inventé par Howard Phillips Lovecraft. J’ai déjà signalé que la naissance de ce livre-fantôme devait être recherchée dans deux nouvelles, « La cité sans nom » et « Le Molosse », où sont respectivement évoquées ses particularités constitutives et son titre. Pour mémoire, et à toutes fins utiles (?), cet opus, attribué à Abdul al Hazred, présente la particularité de rendre littéralement fous ceux qui ont l’audace de le lire. Le livre de l’arabe dément doit donc être considéré comme un élément de l’univers imaginaire édifié par Lovecraft, au même titre que les (autres) indicibles abominations qui le peuplent. A cette différence près, toutefois, que constitue l’essence (livresque…) commune au livre imaginaire et aux livres réels où il est mentionné, et d’où il tire son semblant d’existence.
40Or le Necronomicon lovecraftien n’en finit pas d’effectuer sa réapparition sous la plume d’auteurs variés, dont le point commun est de s’inscrire dans la littérature « de genre(s) ». Ainsi, entre autres multiples exemples, de Tony Mark, auteur d’une réécriture homosexuelle du texte-phare de Bram Stoker, sous le titre de L’Autre Dracula ou Les carnets secrets de Jonathan Harker92. Dans la suite de ce premier volume, intitulée L’Autre Dracula contre l’ordre noir de la Golden Dawn93, certains des pouvoirs surnaturels du vampire sont attribués à la possession de deux grimoires, « Le Livre d’Abramelin le sage » et… « Le Necronomicon »94, que Jonathan Harker s’efforce désespérément de retrouver. Le livre-fantôme inventé par Lovecraft migre donc dans le roman de Mark, dont il intègre la diégèse à la faveur d’une « captation » allographe. Idem dans La Mort dans l’Ouest95 de Joe R. Lansdale, où « Doc », médecin d’une bourgade du Far West confrontée à une invasion de morts-vivants, prend conscience de la nature du péril qui menace Mud Creek en compulsant divers ouvrages ésotériques de sa bibliothèque, où voisinent le « De vermis mysteriis », le « Livre noir de Doches » et – on l’aura deviné – « Le Necronomicon »96. Ou encore, l’intrigue de Celui qui bave et qui glougloute97 de Roland C. Wagner, autre Weird Western, est en grande partie fondée sur le livre-fantôme lovecraftien, où réside la clef de l’énigme qui oppose, dans un Ouest américain peuplé de figures diversement mythiques – de Kit Carson, Wyatt Earp, Doc Holliday, Buffalo Bill aux Dalton de Morris et Goscinny98 – les « Gardiens des portes du cauchemar »99 et le héros éponyme, dont la désignation complète est « Celui qui bave et qui glougloute tandis qu’il se meut entre les dimensions »100… Ce résumé à grands traits aura permis de comprendre que la novella de (l’autre) Wagner se veut un hommage iconoclaste à Lovecraft, qui y apparaît d’ailleurs fugitivement101 en tant que simple personnage, et dont divers fragments de l’univers imaginaire sont transplantés dans un Far West de fantaisie. Le caractère délirant d’une telle entreprise, apparemment sise aux antipodes des expérimentations d’une littérature mieux tempérée, ne doit toutefois pas faire perdre de vue ses tenants et aboutissants, qui s’apparentent à ce que Richard Saint-Gelais désigne par le terme de « transfictionnalité », pour désigner ce qui advient « lorsque deux textes ou davantage “partagent” des éléments fictifs (c’est-à-dire y font conjointement référence), que ces éléments soient des personnages, des (séquences d’) événements ou des mondes fictifs102. »
41Sans doute, à la lumière d’une telle définition, la réapparition du Necronomicon lovecraftien dans les diégèses des romans de Tony Mark, Joe R. Lansdale et Roland C. Wagner apparaîtra-t-elle comme un cas-limite, puisque le procédé ne correspond pas stricto sensu à l’« orthodoxie » transfictionnelle – pour peu qu’une telle orthodoxie puisse être dégagée. Mais parler d’« intertextualité » ou d’« hypertextualité » serait en l’occurrence insuffisant, dans la mesure où analyser le phénomène en ces termes ne rendrait pas compte de la dimension imaginaire de l’élément récurrent. Or tel est bien le cas du Necronomicon. Tout d’abord, chez Lovecraft, ce composant fictionnel effectue son retour de diégèse en diégèse (celles des récits successifs où il est évoqué), témoignant par là même d’une forme de transfictionnalité autographe. Ensuite, chez les nombreux auteurs qui y font référence, c’est non seulement en tant que livre(-fantôme), mais encore en tant que constituant diégétique, que l’ouvrage, doté en outre d’une valeur de « lovecraftème », réapparaît, à la faveur cette fois d’une transfictionnalité allographe. Il va sans dire que le but de la manœuvre n’est pas d’accréditer l’existence du Necronomicon, mais de rendre indirectement hommage à la figure tutélaire que représente son inventeur, tout en établissant une relation de connivence avec les lecteurs capables d’identifier la référence et d’apprécier le traitement qui lui est réservé. Le clin d’œil transfictionnel est donc dans le même temps signe d’appartenance à une communauté : celle des connaisseurs de l’œuvre lovecraftienne, dont le fonds encyclopédique personnel leur permet de goûter tout le sel de cette « private joke » qui ne demande qu’à devenir « public ». Bien loin de prétendre leurrer qui que ce soit, le procédé apparaît donc bien plutôt comme un jeu avec le pacte de lecture103, où la feintise ludique, par son application à l’objet particulier que constitue le livre imaginaire, se trouve comme élevée au carré, et par là même potentiellement dénudée. Ce qui n’empêche pas que, sur fond d’une telle désignation oblique de son statut pragmatique, à la faveur de ces migrations transfictionnelles autographes puis allographes, le livre-fantôme se trouve pérennisé.
42Hommage iconoclaste, clin d’œil aux happy few/many, jeu sur/avec le pacte de lecture : ces caractéristiques, compliquées par l’adoption d’une tonalité pince-sans-rire, sont également à l’œuvre au sein d’une autre communauté, celle des Sherlockiens ou aficionados du Grand Détective immortalisé par Conan Doyle puis par ses continuateurs. La pratique même de continuation allographe des aventures de Sherlock Holmes est trop connue pour qu’il soit utile de s’y attarder. En revanche, au sein même de ces innombrables Sherlockeries, deux variations transfictionnelles au moins méritent l’intérêt, en raison de l’éclairage particulier qu’elles permettent de porter sur la question du livre-fantôme.
43Tout d’abord, les lecteurs assidus du « Canon » holmésien le savent, l’une des caractéristiques notables des récits du Dr Watson tient à la présence en leur sein de nombreuses allusions à diverses enquêtes de Holmes dont, pour des raisons variées – au premier rang desquelles l’exigence de confidentialité –, la narration reste soit à entreprendre, soit à divulguer. Ces histoires potentielles ou inédites, que les spécialistes nomment les untold stories, apparaissent donc plutôt à l’examen comme autant de not yet told stories, puisque il s’agit là de matrices narratives, dont le déploiement n’attend plus que l’intervention d’un auxiliaire zélé – par exemple Richard L. Boyer narrant l’affaire du Rat géant de Sumatra104.Le plus souvent exploité pour l’écriture d’un unique volume, ce procédé a toutefois fait l’objet d’une systématisation par René Reouven qui, dans certaines de ses Histoires secrètes de Sherlock Holmes (« Celles que Watson a évoquées sans les raconter »)105, donne tout d’abord en épigraphe l’extrait du Canon qui lui tient lieu de point de départ, avant le texte de la nouvelle qui en constitue l’expansion narrative. Par exemple, « La sangsue »106 est précédé du bref extrait du « Pince-nez en or »107 à partir duquel le récit va se développer : « … Feuilletant les pages, je parcours mes notes sur la répugnante histoire de la sangsue rouge et sur la terrible mort de Crosby le banquier… » La dimension transfictionnelle d’une telle pratique d’écriture double n’est guère douteuse, puisqu’il s’agit alors de mobiliser, avec le plus de cohérence possible, les constituants diégétiques de l’univers holmésien originel, dû à la plume de Conan Doyle, pour en proposer une version « plus complète », par saturation des allusions qu’il recèle. Quant à la question du livre-fantôme, elle est ici présente sous la forme d’une variante, qu’il faudrait baptiser « manuscrit-fantôme ». Admettons que Watson ait rédigé les comptes rendus de diverses affaires, sans pour autant les porter à la connaissance du public. Dès lors, le rôle du continuateur est de se substituer à feu le bon docteur, en « divulguant » ces récits inédits – après réactivation, le plus souvent, de la fiction du manuscrit trouvé. Ainsi, de Conan Doyle à ses successeurs, non seulement le manuscrit-fantôme revient, mais il prend corps, de sorte qu’à la pérennité s’ajoute un gain en densité, puisque l’originelle allusion fugitive se métamorphose en un récit complet.
44Que de l’évocation de ce cas spécifique, on ne conclue toutefois pas trop vite à l’absence de livres-fantômes dans les textes qui composent le Canon. Au contraire, ils y sont légion : en particulier, Holmes en personne s’y voit attribuer la paternité d’un nombre impressionnant de monographies, portant sur des sujets aussi variés que la distinction entre les cendres de tabac, les motets polyphoniques de Lassus, ou encore l’apiculture. Sans doute l’énumération de ces traités-fantômes vise-t-elle principalement, du sein même des fictions, à alimenter la légende de l’éclectisme du Grand Détective ; mais, en bonne logique holmésologique, il conviendrait de rédiger un jour ou l’autre ces diverses monographies, pour qu’elles jouissent enfin d’une présence plus substantielle que celle que leur confèrent les simples allusions qui y sont faites dans le Canon. A vrai dire, j’ignore si ces traités ont ou non déjà été écrits : si tel n’est pas le cas, il serait grand temps de s’atteler à la tâche. A bon entendeur…
45Quoi qu’il en soit, l’idée même de rédiger l’un des livres-fantômes du Canon a fait l’objet d’une mise en abyme virtuose par Isaac Asimov, dans un bref récit intitulé « Le crime ultime »108, qui fragilise la distinction qu’opérait Paul Gayot, en préface à son Musée de l’Holmes, entre « holmésologie pastichante » et « holmésologie glosante »109. En voici l’argument : désireux de mériter pleinement son statut de membre de la société holmésologique des « Irréguliers de Baker Street »110, le personnage principal ambitionne de produire un écrit capable de susciter l’intérêt de son milieu d’élection. Après bien des hésitations, il élit pour objet d’étude l’un des principaux livres-fantômes du canon : La Dynamique d’un astéroïde, traité de mathématiques attribué au Professeur Moriarty, le « Napoléon du crime », alter ego maléfique de Sherlock Holmes111. Dès lors, l’essentiel du récit consiste en spéculations sur le possible contenu d’un tel opus, approximativement daté de 1875, comme sur les raisons du silence qu’a observé à son encontre la communauté scientifique. L’un des intérêts du récit d’Asimov est ainsi de nous faire assister à l’« incarnation » (ou à la textualisation) progressive du livre-fantôme attribué à Moriarty, tout en explicitant les présupposés de l’holmésologie : « Si nous suivons le point de vue des “Irréguliers de Baker Street” sur l’univers, alors le professeur Moriarty a existé, le traité fut écrit et a anticipé la Relativité Générale. »112 Tel est bien le postulat sur lequel se fonde cette curieuse discipline : l’existence de Holmes ne souffre aucune contestation ; Watson était son biographe ; et Conan Doyle un simple agent littéraire. D’où les traits suivants : « […] exacerbation de l’illusion référentielle, propension aux inférences audacieuses, supposition d’une continuité diégétique liant les récits et s’étendant au-delà de leurs bornes […] [qui] placent visiblement [l’holmésologie] en porte à faux par rapport à la critique officielle. »113
46Mais, ne l’oublions pas, intrinsèquement auto-ironique, cette démarche, indissociable d’une tonalité « tongue in cheeck » typiquement (?) anglo-saxonne, n’est recevable que cum grano salis ; et, comme le fait très justement observer Richard Saint-Gelais, une telle « insistance à supposer la réalité de Holmes est assez manifestement ludique pour remettre en question l’illusion référentielle par l’autre bout, celui de son exacerbation. »114 Aussi, à qui sait lire/rire entre les lignes, l’holmésologie a-t-elle tôt fait d’apparaître comme une fiction généralisée, dont le caractère auto-dénonciateur, pour n’être pas explicitement formulé – et pour cause, puisque du respect de ce non-dit dépend tout l’intérêt de l’entreprise –, est tout de même patent. Nous retrouvons donc là l’idée d’un jeu avec le statut des textes115 (suggéré par antiphrase) et le pacte de lecture (obliquement conclu), qui fait de l’holmésologie, discipline éminemment consciente d’elle-même, comme de ses tenants et aboutissants, une variété de critique transfictionnelle116 – dont la ludicité ne doit pas occulter la lucidité, tant les problèmes épistémologiques que soulèvent ses postulats paradoxaux sont cruciaux pour les théoriciens de la littérature. En fait, en régime holmésologique, comme l’atteste la variation d’Asimov sur le traité-fantôme du Professeur Moriarty, jeu, réflexion et rêverie ont indissolublement partie liée117.
Du livre-fantôme au livre-vampire
47Certes, même si, on l’a vu, elle s’en empare ponctuellement, l’holmésologie excède très largement la question du livre imaginaire. Toutefois, la logique qui sous-tend cette plus vaste entreprise « pseudo-non-fictionnelle » est également à l’œuvre dans la naissance et/ou la croissance et/ou la descendance du livre-fantôme, et peut tenir lieu de miroir grossissant, bien utile à l’analyste soucieux de formaliser ces phénomènes. En effet, cette longue déambulation spectrologique a permis de l’établir : qu’il s’agisse de la création du livre-fantôme, par invention d’un titre et/ou présentation narrativisée des contours d’une intrigue et/ou évocation plus ou moins détaillée de personnages et/ou mention de particularités thématiques ou formelles et/ou interpolation d’extraits et/ou instauration de mises en abyme et/ou exploitation des ressources plus étendues du métatextuel et/ou élaboration de fictions d’éditions critiques ou d’histoire littéraire ; de sa prolifération par constitution de bibliothèques-fantômes ; de sa circulation diachronique par migration transfictionnelle auto- ou allographe ; les mêmes principes sont en jeu. En dépit de variations d’intensité, il s’agit bien, dans tous les cas, d’instituer un jeu sur/avec le statut des textes et le pacte de lecture qu’ils présupposent ; de sorte que, loin de ne constituer qu’un épiphénomène divertissant, le livre-fantôme est susceptible de jouer le rôle d’un révélateur épistémologique – dans la mesure même où il met en exergue l’ontologie propre aux entités fictionnelles qui, toutes, sont, sans être, et appellent par là même un mode de réception spécifique. Ainsi le livre-fantôme témoigne-t-il d’une forme d’exacerbation ou d’élévation au carré du principe de feintise ludique partagée qui fonde l’expérience fictionnelle, et constitue-t-il un support privilégié pour le déploiement d’une réflexion en acte sur la fiction, plus généralement la littérature, plus généralement encore leur rapport au monde, mais aussi sur les démarches critiques que nous adoptons pour en rendre compte, comme sur les présupposés théoriques sur lesquels elles reposent.
48Aussi, en la matière, ne retenir que le jeu serait-il réducteur, tant il est indéniable que ce paramètre y est associé à la réflexion, et à la rêverie – « triple entente » que les écrivains déclinent à leur guise, en fonction du régime qu’ils souhaitent privilégier, du plus loufoque (L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster) au plus sérieux (Jordane revisité) donc ambigu. Au fil de cette enquête, j’ai dû bien souvent préciser en effet que le livre-fantôme n’était qu’un semblant, non un leurre, et que l’intention auctoriale présidant à son invention ne relevait ni de la supercherie ni de la mystification ; ce qui prouve a contrario que, dans certains cas, le doute est sinon permis, du moins possible et somme toute compréhensible. L’auteur a beau ne pas vouloir tromper ses lecteurs, en les incitant à croire sérieusement et durablement à l’existence du livre-fantôme, certains de ces essais de spectrologie appliquée à la littérature sont si ambigus que tout risque de méprise ne saurait être a priori exclu.
49Sans doute une telle (relative) indétermination peut-elle être interprétée comme un signe des temps, tant notre époque, sa littérature, et plus généralement son épistémè font la part belle au doute, à l’indécidabilité, et à la transgression des frontières – jusqu’au vertige. De fait, en tant que lecteur, puis-je vraiment distinguer avec assurance tel livre perdu, dont je n’ai connaissance que par ouï-dire, comme le Livre Second de la Poétique d’Aristote, autour duquel gravite l’intrigue du Nom de la Rose d’Umberto Eco118, et tel livre-fantôme des Fictions borgésiennes, dont je ne sais que ce m’en apprend son glossateur ? Sur fond de trop de lectures et/ou de « délecture »119, ne puis-je éprouver l’impression d’avoir lu quelque part tel ou tel de ces livres virtuels que Gérard Genette appelle de ses vœux dans plusieurs de ses ouvrages de poétique, par exemple ce roman constitué de monologues intérieurs au discours indirect libre, dont le titre m’échappe ?...120 A force de le croiser au fil de mes lectures, et d’en voir rappeler les propriétés maléfiques, le Necronomicon n’a-t-il pas fini par faire en quelque sorte partie de mon fonds encyclopédique personnel ? Ne puis-je en dire autant du Traité sur l’art de la détection de Sherlock Holmes, avec lequel les commentaires éclairés et teintés de condescendance que son auteur adresse régulièrement au Dr Watson m’ont de très longue date familiarisé ? Ces questions, parmi bien d’autres, constituent probablement autant de « scandales » logiques, et mon propos, en les posant, n’est pas de biffer d’un trait de plume suicidaire ce que j’ai mis si longtemps à établir et rappeler antérieurement. Simplement, de telles interrogations permettent in fine d’ouvrir la perspective, et de rappeler une évidence parfois perdue de vue : les préoccupations des écrivains et des lecteurs ne recoupent pas toujours exactement celles des théoriciens de la littérature… Et s’il importait, sur le plan théorique, de préciser le mode d’être (c’est-à-dire de non-être) spécifique du livre-fantôme, une fois cette tâche accomplie, peut-être est-il possible de céder à la tentation de la rêverie –comme nous y invitent nombre d’auteurs, comme le font nombre de lecteurs ? Sans en attendre la permission, larguons donc les amarres, en compagnie de Michel Tournier, pour un rapide voyage qui nous mènera d’Écosse en Transylvanie :
Un livre écrit, mais non lu, n’existe pas pleinement. Il ne possède qu’une demi-existence. C’est une virtualité, un être exsangue, vide malheureux qui s’épuise dans un appel à l’aide pour exister. L’écrivain le sait, et lorsqu’il publie un livre, il lâche dans la foule anonyme des hommes et des femmes une nuée d’oiseaux de papier, des vampires secs, assoiffés de sang, qui se répandent au hasard en quête de lecteurs. A peine un livre s’est-il abattu sur un lecteur qu’il se gonfle de sa chaleur et de ses rêves. Il fleurit, s’épanouit, devient enfin ce qu’il est : un monde imaginaire foisonnant, où se mêlent indistinctement […] les intentions de l’écrivain et les fantasmes du lecteur121.
50Métaphore pour métaphore, et quitte à demeurer sur un terrain cher aux folkloristes, si le livre-fantôme, par-delà ses vertus de révélateur épistémologique, est capable d’exercer une telle emprise sur l’imaginaire des lecteurs, n’est-ce pas parce que, à y regarder de plus près, il est à parts égales livre-vampire – en attente de notre fluide vital ? Dans cette perspective pragmatique, les différences entre livres réel et imaginaire s’atténuent, puisque le vampirisme (tel que défini par Tournier) leur tient lieu de commun dénominateur ; et l’on comprend donc que le livre-fantôme tire sa substance de la chair même de nos rêves. Aussi, fantôme ou vampire, à la rigueur, qu’importe ? Le livre imaginaire apparaît bien ainsi comme l’emblème du livre, dont il hyperbolise les propriétés artistiques aussi bien qu’esthétiques, tout en en célébrant la rencontre. À ce titre, La Tour des ombres, le Necronomicon, Retour au goudron et leurs semblables méritent bien que nous leur ménagions une place dans nos bibliothèques – fussent-elles intérieures122.