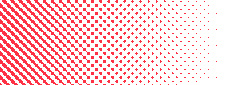Lire en français au pluriel, et jusqu’à entendre l’appel des notes
1Au cours des années passées à élaborer ce que j’appelle un « imaginaire hétérolingue », j’ai souvent cité cette définition de Barbara Cassin : l’intraduisible, c’est « non pas ce qu’on ne traduit pas, mais ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire ». Cette citation m’offre ici l’occasion d’une première note que voici1 (je reviens sur cet appareillage en fin d’introduction) et aussi celle d’un calque : je dirai qu’est située toute théorie qui ne cesse de (ne pas) en avoir fini de se situer. Comment déterminer où commence, où s’arrête une situation — surtout quand le vertige des urgences décrétées ou ressenties semble exiger une actualisation perpétuelle ? Est-ce que cette difficulté voue toute théorie située à l’obsolescence ? Je préfère penser que c’est surtout une exigence : si se situer, pour une pensée, implique de ne pas cesser de se situer, alors c’est une responsabilité à toujours et encore transformer cette situation. Il existe, cependant, une condition pour que l’apparente aporie tourne en dynamique bénéfique. Il faut que le débat soit possible, qu’il puisse y avoir palabre2, rapport agonique3. Or c’est précisément ce qui risque de n’être plus possible dans les universités de cette France, en ce tout début d’année 2021.
2La crise, certes, n’est pas nouvelle4. La (contre-)réforme Licence-Master-Doctorat (« LMD »), amorcée en 2002, engageait déjà l’université dans un processus de marchandisation des savoirs et de privatisation5. C’est toute une conception de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est mise à mal de façon systématique6. Ces derniers temps, la « loi de programmation pluriannuelle de la recherche »7 renforce la tendance libérale importée du modèle anglo-saxon. C’est pourtant sur une autre scène qu’une importation depuis les « campus nord-américains » se trouve dénoncée… Le 22 octobre 20208, le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer évoque des « courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l’enseignement supérieur9 ». Dans la foulée (le 31 octobre 2020), un texte signé d’une centaine de collègues croit bon de dénoncer « les idéologies indigéniste, racialiste et “décoloniale” (transférées des campus nord-américains) [...] nourrissant une haine des “Blancs” et de la France10 ». Le 20 novembre 2020, la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche est votée par le Sénat11, et se trouve augmentée d’un amendement qui introduit un nouvel article dans le code pénal12. Non contents de cet ajout, deux députés ont demandé l’ouverture d’une mission d’information sur « les dérives idéologiques dans les milieux universitaires »13. Le traitement médiatique réservé à ce conflit semble ignorer que le champ identifié comme « postcolonial » est loin d’offrir la moisson d’une pensée unique14.
3Ce numéro15 résonne doublement dans ce contexte : à la fois parce qu’il ne peut que s’y situer, et parce qu’il interroge le rapport de force entre « savoirs situés » et « savoirs objectifs ». Or cette apparente opposition s’avère trompeuse, dans la mesure où les deux paradigmes sont radicalement exclusifs. Dans le paradigme des « savoirs situés », en effet, l’objectivité est elle-même considérée comme « située », y compris par la prétention de ne pas l’être. De son côté, le paradigme des « savoirs objectifs » boute hors du domaine scientifique toute expérience, pratique, ou théorie « située » puisqu’elle ne sera par définition pas reconnue comme un « savoir »16. Pour le dire autrement : une approche située considère toute science objective en tant que situation tandis que l’approche objectiviste (plus qu’objective) ne considère pas le savoir situé comme un savoir. Difficile de s’entendre17 ! Pourtant, reconnaître le caractère situé (donc relatif) d’une position me semble nécessaire pour prendre en compte et dépasser aussi bien les conditionnements que les apports de la subjectivité qui s’y trouve impliquée. Comme un horizon offre une perspective davantage qu’il ne borne un paysage, se situer revient moins à se limiter qu’à prendre l’élan d’un perpétuel dépassement. La « situation » mise en jeu dans un « savoir situé » n’est pas une donnée fixe, mais une trame de relations réciproques, dynamiques18. Pour le dire encore autrement : toute situation est à faire advenir et à transformer19.
4Prenons l’exemple de cet article. Il a été rédigé à l’invitation de Marie-Jeanne Zenetti et de Cyril Vettorato, qui ont lancé l’appel pour ce numéro de Fabula‑LhT en décembre 2019. L’écriture en est entièrement modifiée à l’occasion de la journée d’études organisée le 12 février 2020, en pleine lutte contre la LPPR.
5Après quelques hésitations sur les modalités de cette journée, la rencontre se fait en jonction avec l’université populaire de Paris Diderot20. Seules les contributrices présentes en France métropolitaine ont pu se rendre à l’invitation, le reste des échanges tâchant de se tramer à distance. C’est l’occasion de prendre la mesure des discordances et conflictualités qui traversent le « nous » en effort de constitution21 et le diffractent d’enjeux sous-jacents22. L’inconfort qui en résulte n’est pas rhétorique, ni théorique : il affecte les corps et les pensées, parfois douloureusement23. S’il n’a pas toujours été facile de composer ce texte, j’ai aussi pris plaisir à chercher une façon d’inscrire la situation à même la forme de l’article.
6Cette expérimentation ne dédouanant pas de la traditionnelle (et bien utile) annonce de plan, la voici : je commencerai par poser les implications d’une mise en situation de la notion de « style » avant d’établir une alternative hétérolingue, qui s’appuiera sur deux exemples. La troisième et dernière partie basculera de l’analyse des textes littéraires à celle du texte que vous êtes en train de lire, envisageant la question du style dans le domaine académique. Cette approche « méta », indispensable à toute pratique située, ne sera pas conclue mais poussée à passer à l’acte, par-delà la barre des notes. Et c’est dans cet appareillage que je situe ma véritable proposition : donner à voir les marges pragmatiques dont tout texte scientifique s’accompagne le plus souvent en coulisse. Les notes situent toujours un texte en l’ancrant dans des références avouées, légitimes, tandis que les échanges plus informels sont souvent relégués aux oubliettes. Ici, je vous invite à plonger sous la barre des notes pour accéder à une piste de sous-titres situés. C’est par l’expérience que s’établira, j’espère, l’intérêt de la démarche.
Situé, le style ? Le « s » d’en français comme marque de pluriel
7« L’extrême évidence du rapport que nous entretenons avec notre propre langue est aussi ce qui nous la rend irreprésentable24 » : voici la toute première phrase de l’article de Laurent Jenny paru dans l’inaugural numéro 0 de la revue Fabula‑LhT. Autrement dit : nous évoluons dans notre langue, surtout lorsque nous croyons n’en avoir qu’une seule25, à la manière d’un poisson rouge persuadé de vivre dans un milieu naturel tant les parois de son bocal sont transparentes…
8La stylistique reconduit cette illusion, qui mesure les « figures » à l’aune d’un « propre » supposé inamovible. En effet, la notion de « style » repose sur une idée d’écart, qui perpétue le présupposé d’une norme situé dans le texte (endogène) ou non (exogène). D’où cette affirmation de Michel Beniamino :
L’écart stylistique — si tant est que cette notion a un sens — n’apparaît en toute clarté que dans le cadre strict d’une langue et la stylistique est incapable d’analyser ce phénomène dans le cadre d’une littérature écrite en situation de contacts de langue26.
9Michel Beniamino explique cette « situation » dans un autre texte : « Le problème réside dans le fait que les auteurs de ces travaux ont été formés dans le cadre de la stylistique, c’est-à-dire de la stylistique du français de France. Or, dans le cadre d’un texte produit par un écrivain ayant un répertoire linguistique étendu, la stylistique telle qu’elle existe est inadaptée27 ». Dans cette même perspective, Xavier Garnier affirme que les littératures francophones constituent un cas particulier, où le style constitue « non pas un écart dans la langue mais un écart de la langue elle-même28 ». Faudrait-il, dès lors, forger un terme spécifique pour envisager les littératures francophones ? L’opération aurait l’intérêt de ne pas oblitérer la « spécificité francophone » qui, selon Lise Gauvin, diffère irréductiblement de la situation des lettres françaises :
Tout écrivain doit trouver sa langue dans la langue commune, car on sait depuis Proust et Sartre qu’un écrivain est toujours un étranger dans la langue où il s’exprime, même si c’est sa langue natale. Mais la surconscience linguistique qui affecte l’écrivain francophone — et qu’il partage avec d’autres minoritaires — l’installe encore davantage dans l’univers du relatif, de l’a-normatif29.
10Une autre option, plus radicale, consiste à transformer corrélativement la notion de « style » et la conception de « la langue » afin d’admettre l’hétérogénéité constitutive de tout idiome, même national. D’après Cécile Canut :
La notion de « langue » telle qu’elle est posée par les linguistes ne peut être traitée comme une donnée du réel : ainsi posée, elle est une construction idéologique issue en grande partie de l’Occident pour lequel la langue est un élément identitaire. Assimiler la langue à une substance, voire une « essence », empêche toute compréhension des pratiques fluctuantes des locuteurs, déterminées par un ensemble complexe de phénomènes à la fois discursifs et pratiques30.
11Cette conception de « la langue » n’est pas compatible avec la notion d’écart ni même de variante ou de variété : seule une variation continue peut rendre compte d’une langue qui n’est plus envisagée comme une entité dotée d’une essence mais comme un ensemble de pratiques en transformation31. Autrement dit : il s’agit de lire le « s » d’en français comme une marque de pluriel32.
Pour un imaginaire hétérolingue
12Les approches postcoloniales ont volontiers recours à la théorie de la traduction, parfois pour considérer des cas effectifs, plus souvent pour en faire une métaphore33 ou une analogie34 d’écritures qui mettent en œuvre plus d’une langue à la fois, ainsi que les différences constitutives de chacune35. Rares sont, pourtant, les travaux consacrés à la caractérisation plus fine et précise de cette poétique. Le forgeur du terme « hétérolinguisme », Rainier Grutman, le définit comme « la présence dans un texte d’idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principal36 ». Par contraste avec le plurilinguisme ou le multilinguisme, l’hétérolinguisme met l’accent sur la différence37 : il ne s’agit pas d’additionner des langues chaque fois « une » mais de prêter attention aux différences aussi bien externes qu’internes qui diffractent chacune. Dès lors, il s’agit moins de la « présence » d’une autre langue que d’une « mise en scène » par laquelle se joue la différence interne à « la langue » même38.
13Pour mieux saisir ce dont il est question, voici deux exemples39. Aucune représentativité ici, mais deux saisies distinctes le long d’un continuum40 où se dégagent deux seuils : un seuil de lisibilité au-delà duquel l’autre langue est si différente qu’on ne peut même plus la déchiffrer ni l’identifier et un seuil de visibilité au-delà duquel l’autre langue est si peu remarquable qu’on ne la distingue peut-être même pas dans sa différence41. Plutôt que de situer ces deux textes par rapport à leur contexte d’énonciation, je m’intéresse à la manière dont ils situent eux-mêmes, par leur poétique, une différence dans/de « la langue »42.
14Quant à je (Kantaje) de Katalin Molnár (Paris, POL, 1996) est écrit dans une langue qui, à première vue, semble si étrangère qu’on se demande si le texte sera vraiment lisible43. L’étrangeté est exhibée jusqu’à « traduire » le français le plus classique… en « fransé » :
é kan chui venu an Frans, chparlè pa, chparlè peû, chparlè mal, toutfasson, chkonprenè trè mal skon me dizè mé kan chparlé, charplé kom Kornèy é Rassinn : « Ô kruèl souvenir de ma gloire passé ! Euvre de tan jour an un jour éffasé ! »
15Affranchie de la norme, la faute n’en est plus une et l’écrit rejoint, dans toute sa matérialité, la plasticité régénératrice de l’oralité44.
16De son côté, la poésie de Jean Portante ne manifeste aucune trace d’étrangeté — même le titre du recueil, Effaçonner (Echternach, L’orange bleue, 1996), pointe vers un double travail invisible d’effacement et de façonnement :
n’oublie pas d’arroser les plantes
l’eau passe devant les plantes
ce n’est pas à elle d’arroser
qu’elles attendent l’arroseur
17C’est entre les lignes qu’il faut prêter l’oreille pour entendre affleurer les autres langues, qui ne sont pas tant les traces archéologiques préalables au français que son devenir en poésie. Jean Portante explique : « Lorsque j’écris c’est comme si je plongeais une aspirine dans un verre d’eau. Voilà du moins ce que je voudrais. Diluer la langue ainsi utilisée, afin que, dissoute, elle se mette à nu, comme on le dit d’un câble électrique qui, quand on le touche, met à mort. […] Je ne suis donc ni francophone ni vraiment francographe45. »
18Ces deux exemples suffisent à perdre la mesure de l’écart pour prendre celle de la variation par laquelle une langue, le français en l’occurrence, ne cesse de différer d’elle-même. Là où le plurilinguisme et le multilinguisme additionnent des langues autres, l’hétérolinguisme invite à penser « la langue » autrement.
Indiscipline relationnelle
19Cet « autrement » aura eu un effet sur le type de texte que je produis en tant que chercheure. Contrairement au style qui opère volontiers une soustraction du contexte46, l’hétérolinguisme rend perceptible la dimension pragmatique de n’importe quel texte. Si aucun texte littéraire ne parle tout seul, comment continuer à croire à l’absence de source énonciative même pour un positionnement qui se voudrait « neutre, objectif ou ontologique » (tout en favorisant, plus ou moins subrepticement, les points de vue et les intérêts dominants) ? Un texte scientifique n’est certes pas un texte littéraire, mais une attention particulière peut être portée aux indices hétérolingues dans les textes académiques47. Comme le rappellent Deleuze et Guattari, « plus une langue a ou acquiert les caractéristiques d’une langue majeure, plus elle est travaillée par des variations continues qui la transposent en “mineur”48 ». Il existe des études consacrées à la poétique des textes scientifiques, dont le code est particulièrement difficile à « cracker », notamment dans le domaine des sciences dites « dures »49, et dans le courant de l’épistémocritique50. La description que donne Pierre Macherey de « la langue » universitaire est glaçante :
La manière dont l’enseignement universitaire aborde les thèmes qu’il traite, en en « parlant » au titre d’une parole surplombante et désengagée, a pour but premier de les neutraliser, en les coupant artificiellement des conséquences que serait susceptible de déchaîner leur mise en œuvre effective. Entre les murs de l’Université circule une parole ésotérique, d’autant plus libre qu’elle se présente comme déconnectée des enjeux qui échappent à sa prescription […]51.
20Comment traduire cet obscur idiome universitaire en universiterrien à partager52 ? Tout se passe comme si les discours d’enseignement et de recherche s’ingéniaient à effacer les guillemets : il s’agit d’escamoter les indices de l’énonciation au point que plus personne ne semble parler (et assurément pas en « je »). Dans les termes de Robert Vion :
l’effacement énonciatif constitue une stratégie, pas nécessairement consciente, permettant au locuteur de donner l’impression qu’il se retire de l’énonciation, qu’il « objectivise » son discours en « gommant » non seulement les marques les plus manifestes de sa présence (les embrayeurs) mais également le marquage de toute source énonciative identifiable53.
21C’est précisément cette dimension d’adresse qui, à mes yeux (à mes oreilles ?) condense l’essentiel de l’enjeu relatif au caractère situé d’un savoir en train de s’énoncer : à qui parle‑t‑il, qui lui répond — et sur quel ton ? L’un des indices permettant de répondre très concrètement à ces questions est (quasiment) toujours disponible dans un texte scientifique : il s’agit des notes de bas de page, ou de fin de document, comme c’est le cas dans cette revue en ligne. Les références choisies, leur nombre mais surtout la manière de citer et de se référer compose un « portrait de situation », trace les contours d’une figure d’énonciation en recherche — bref, dessine un ethos. Situées sous le texte, les notes forment un soubassement obligé, parfois dénoncé comme contraignant parce qu’il semble illégitime d’avancer une idée sans pouvoir se référer à du pré-existant ou élitiste, parce que la lecture s’en trouve heurtée, complexifiée54. Pourquoi ne pas s’en réjouir, au contraire, et doublement ? Une première fois parce que le traitement des notes permet de situer n’importe quelle énonciation, même la plus effacée. Une seconde fois parce qu’il est possible d’en jouer, comme savent si bien le faire les textes littéraires55, pour en faire un usage qui travaille la différence à l’intérieur de chaque texte, orchestre des voix multiples, offre hospitalité et accueil.
22Davantage qu’une prolongation de l’explicitation, je propose de passer à l’acte en plongeant sous la barre des notes située ci-dessous. J’insiste une fois encore avant cette plongée : si la rédaction de ces notes peut sembler singulière, ce n’est pourtant qu’une manière de grossir le trait, pour révéler de manière un peu plus spectaculaire que de coutume la dimension hétérolingue et polyphonique, donc située, qui habite tout appareillage de référence qui fait l’ordinaire d’un article théorique56.