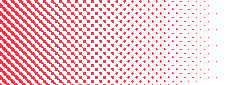« A GUEST + A HOST = A GHOST »
(Marcel Duchamp1)
1Sans chercher à remettre au goût du jour le genre ancien du dialogue des morts, on propose de soumettre l’œuvre d’Antonin Artaud à une analyse « spectrale », en la rapportant à l’invisible qui l’habite de façon étrangement lisible. Si cette œuvre nous hante toujours aujourd’hui, par-delà la vogue qu’elle connut il y a bientôt un demi-siècle, c’est sans doute parce qu’elle reste elle-même profondément hantée. Il n’est pas exagéré de l’avancer, tant les fantômes de toutes sortes y abondent : ombres dans ses poèmes, doubles dans son théâtre, spectres et suppôts dans sa correspondance comme dans ses traductions, larves et lémures dans ses cahiers.
2Dans une précédente étude (Cornille, 2019) que nous prolongerons ici, nous avons suivi un seul de ces fantômes, tenace, quoiqu’en même temps assez discret, n’apparaissant le plus souvent qu’au milieu d’un cortège de revenants : Gérard de Nerval, aux Chimères (1852) duquel, fameusement, Artaud fit un sort, en répondant à l’exégèse kabbalistique qu’en avait fournie Georges Le Breton (19452). Cette extraordinaire lettre d’Artaud, datée du 7 mars 1946, soit quelques semaines avant sa remise en liberté et deux ans avant sa mort, ne fut jamais envoyée, pas plus que ne fut achevé le projet qui en résulta d’une brève étude sur Les Chimères. Si Artaud se crut en droit d’en parler mieux qu’un autre, c’est, clamait-il, sur base d’une proximité vécue avec le poète : « j’ai toujours senti la vie de Gérard de Nerval près de la mienne » (1974a, p. 1843). Et il ne fait aucun doute qu’Artaud, lorsqu’il parle de Nerval, se met lui-même en scène, et qu’il pense innover alors qu’il ne fait que prolonger la parole d’un autre.
Art/Tod
3Le nom de Nerval était cependant déjà apparu une première fois sous la plume d’Artaud (Cornille, 2019), lorsque celui-ci publia en 1925, dans la Revue européenne, un poème en prose intitulé « La Vitre d’amour », intégré quatre ans plus tard à L’Art et la Mort (1929), paru chez Denoël. C’est sur les arcanes de ce poème que nous voudrions revenir, car il est loin d’avoir révélé tous ses secrets. On sait que le rejet par La Nouvelle Revue française (NRF) des premiers poèmes d’Artaud, en 1923, donna lieu à toute une correspondance entre le poète et Jacques Rivière que ce dernier publia en 1927 en lieu et place des poèmes refusés. C’est dans la foulée de cette reconnaissance retardée qu’Artaud conçut « La Vitre d’amour ». Nous essayerons de montrer comment ce poème en vient à illustrer le mode de reconnaissance de l’artiste moderne, rejeté, avant d’être reconnu.
4Du premier Artaud, on cite toujours L’Ombilic des limbes (1925) ou Le Pèse-Nerfs (1925), beaucoup moins le troisième recueil – le quatrième si l’on compte l’initial et très confidentiel Tric Trac du ciel (1923). Se composant de huit poèmes en prose, L’Art et la Mort s’illustre par des textes particulièrement sombres et lourds, dont deux pièces sur Héloïse et le chaste clerc Abélard, une lettre à la Voyante, une adresse à Uccello. « La Vitre d’amour », qui clôt le recueil, se distingue toutefois du lot, étant d’allure nettement plus légère : une fantaisie amoureuse à la façon d’un conte dont « La Mort » semble absente et dont l’inspiration ouvertement hoffmannienne4 la rapproche des récits de rêve surréalistes. Mais cette vitre va s’avérer faussement transparente, tant y abondent les reflets : s’y développe à vrai dire une façon d’allégoriser l’« Art ». Un pauvre étudiant, plongé dans ses livres, transi d’amour pour sa voisine, voit régulièrement celle-ci « à travers les vitres fendues » de sa chambre, sans jamais oser l’aborder. Mais lorsque soudain cette fenêtre s’ouvre, les reflets s’y démultiplient féériquement, faisant apparaître une assemblée de « grands auteurs » qui proposent leur assistance au jeune étudiant, exauçant du même coup le vœu de conquête initialement formulé par lui : « Je la voulais miroitante » (Artaud, 1976, p. 183), premiers mots du texte – au cas où l’on douterait encore que l’on passe au travers de cette vitre comme au travers d’une glace.
5Composé dans le courant du mois de janvier 1925, selon le manuscrit (soit quelques semaines après la Saint-Sylvestre), ce poème en prose5 tout en « verre » sur lequel se clôt le recueil semble s’ouvrir sur l’ensemble de l’œuvre : étant donné le principe du miroir qui y règne, il est prévisible que tout, à la fin, s’y inverse ou réponde à son contraire. Ainsi, aux « petits volcans » et leur « lave » du début qu’on trouve « accrochés aux aisselles » (Artaud, 1976, p. 1836) et au sexe de la bien-aimée correspond l’énoncé final : « une immense montagne de glace sur laquelle une chevelure blonde pendait » (p. 188). Cette image s’explique par la relation d’opposition qu’elle entretient avec les termes de l’incipit – la lave s’inversant en l’image d’une jeune femme frigide que contemple un « peintre pris de vertige » : car c’est bien cette Jungfrau qu’on aura reconnue dans ce pictural sommet des Alpes suisses, « montagne de glace » surmontée d’une chevelure de femme. Et si le narrateur précise que cette chevelure est « blonde », c’est vraisemblablement en écho à une chanson « stupide » qu’il vient d’entendre dans la rue : « Chez ma belle qu’il fait bon » (p. 187), variation sur l’air célèbre « Auprès de ma blonde, qu’il fait bon, fait bon, fait bon ». Ce principe du miroir, avec ses reflets internes, ses dédoublements à l’infini, émane de l’objet même qui est au centre de ce poème en forme de conte.
6Qu’est-ce en effet qu’une vitre aux yeux d’Artaud ? Ce peut être une surface d’inscription, comme lorsqu’un doigt y trace dans la buée les formes simplifiées de l’affection7. C’est le plus souvent un cadre, propice à l’apparition d’une image ou d’un paysage. Diaphane, on y voit à travers ; la vitre laisse alors entrevoir la femme avec laquelle le jeune homme du poème cherche précisément à s’« aboucher » : « Il me fallait trouver simplement le moyen de l’atteindre directement, c’est-à-dire, et avant tout, de lui parler » (Artaud, 1976, p. 185). Mais il arrive encore que la vitre se fasse miroir, comme lorsqu’une bourrasque soudain en force l’ouverture. C’est le cas ici : « Tout d’un coup la fenêtre s’ouvrit » (p. 185). À partir de là tout va s’inverser, un autre monde se révèle au narrateur, que ne gouvernent plus les règles du réel quotidien : « Je vis dans un coin de ma chambre un immense jeu de dames sur lequel tombaient les reflets d’une multitude de lampes invisibles » (p. 185). Ouverte sous un certain angle, la fenêtre, au lieu de montrer ce qui se passe au-dehors, reflète à présent l’intérieur de la chambre qu’occupe l’étudiant : « Je cessai donc de regarder à la fenêtre et d’espérer voir ma boniche chérie » (p. 185). Surgit alors une série de hauts personnages littéraires qui, se démenant comme des diablotins, permettront à ce docte lecteur d’enfin s’aboucher (littéralement, cette fois) avec sa voisine : il y aura Nerval, E. T. A. Hoffmann en personne, puis Achim von Arnim et Matthew Gregory Lewis, l’auteur du Moine, qui lui apprend comment obtenir sa belle, de manière non plus directe, mais oblique, « transversalement » : « tu l’auras quand tu n’y penseras pas » (Artaud, 1976, p. 186). Alors que l’étudiant s’attendait à la voir en face de lui, elle occupe à présent l’étage du dessus : « elle s’était couchée sur le plancher du dessus pour être plus près de moi ». Et la voici aussi soudainement à ses côtés, par le biais d’une transversale reliant les deux étages : celui, supérieur, de l’aimée et celle, en dessous, du célibataire qui aussitôt peut enfin s’aboucher à elle : « ce n’était pas le diable, ma petite boniche était dans mes bras » (p. 187).
La boîte de Pandore
7Elle était employée comme « bonne8 » dans une taverne : « une taverne d’Hoffmann », précise Artaud, qui ajoute : « nous étions à la nuit de la Saint-Sylvestre » (1976, p. 184). De fait, l’action est fortement inspirée d’un conte d’Hoffmann, Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre (1840), dont Gérard de Nerval, justement, donna une traduction partielle en 1831, avant d’y faire plus qu’allusion dans une nouvelle restée inachevée, Pandora (obtenue à partir d’une version antérieure, Amours de Vienne, La Pandora), nouvelle dont on venait, en 1921, d’assurer une première édition, aussi défectueuse que posthume9. Aussi est-ce Hoffmann en personne qui, dans le poème d’Artaud, semble mener le jeu (c’est lui qui pousse les pions sur le damier) et met en branle la ronde infernale où tout le monde se lance « à la poursuite de la petite bonne », c’est-à-dire de la dame qui court comme une « damnée » sur le damier10 : « Pierre Mac Orlan, le ressemeleur de bottines absurdes, passa, poussant une brouette sur le chemin11. À sa suite venait Hoffmann avec un parapluie, puis Achim von Arnim, puis Lewis qui marchait transversalement », car c’est ainsi, en diagonale, qu’on se déplace sur un damier. « Enfin », un peu comme Malherbe, « Gérard de Nerval apparut », au beau milieu du conte : « Il était plus grand que tout. Il y avait aussi un petit homme qui était moi » (1976, p. 18512). Lewis, Achim von Arnim, Hoffmann et Nerval sont des auteurs alors en vogue, très prisés en milieu surréaliste : André Breton en fait grand cas dès le début des années 1920. S’ils paraissent à Artaud « stupides », peu dignes « d’être considérés comme de grands auteurs », cette mise à distance est de peu de conséquence. Ils lui servent d’intercesseurs, tout décédés qu’ils soient.
8Décidément, rien n’est moins transparent qu’une vitre du moment qu’elle se met à miroiter : celle-ci, striée d’allusions les unes plus surprenantes que les autres, s’avère d’une opacité à toute épreuve. Véritable kaléidoscope, mosaïque composée de fragments de vers, « La Vitre d’amour » se construit ainsi par petits fragments empruntés à d’autres auteurs. Les allusions seraient-elles donc si nombreuses ? Or il ne sert à rien d’observer « à travers les vitres », du reste « fendues », la chose que l’on désire. Ne cherchez pas là, nous dit en somme l’auteur : vous ne trouverez que « transversalement », quand vous n’y penserez plus, placés de biais et non plus en face : « lire l’œuvre d’un poète c’est avant tout lire au travers. Car toute œuvre […] écrite est une glace où l’écrit fond devant le non-écrit » (Artaud, [1946] 1979, p. 130), écrira-t-il dans Variations à propos d’un thème, d’après Lewis Carroll. Il faut savoir lire de travers, ou « de traviole », comme Artaud le fera de Carroll (ou de l’autre Lewis, et comme il le fera bientôt de Nerval), savoir en faire une mauvaise lecture, afin que surgisse une virtualité qui cherche à naître. Se pourrait-il donc que toute l’œuvre d’Artaud tienne dans cette vitre où tout s’inverse : y compris le cours des influences et des genèses ? Mais ne serait-ce pas parce qu’ils sont faits d’anciens fragments de textes ou obtenus à partir de ses propres écrits revisités, que les textes d’Artaud finissent aussi par se prolonger dans l’avenir ? « La pensée avec laquelle les écrivains agissent n’agit pas seulement par les mots écrits mais occultement avant et après l’écrit parce que cette pensée est une force qui est dans l’air et dans l’espace en tous temps [sic] », avançait-il obscurément dans une lettre à Anne Manson, datée du 21 novembre 1944 (1996, p. 211), en visant le caractère spectral de toute influence.
9Pour preuve, ce passage du Moine (1796) de Lewis, auteur qu’Artaud fait apparaître dans « La Vitre d’amour » bien avant d’en traduire le roman, cinq ou six ans plus tard. Toute fenêtre qui s’ouvre abruptement est propice à l’apparition de spectres, nous enseignent les romans gothiques. C’est bien ce qui se produit dans Le Moine. La jeune et jolie Antonia, que le moine convoite, vient de perdre sa mère, tuée de la main de ce dernier. Retirée dans sa chambre, elle se lamente, quand « soudain, le vent, repoussant la fenêtre d’un coup brusque, entra dans la pièce [qui] lui apparut immédiatement toute changée : une buée blanche flottait au ras du sol » (Lewis, [1796, 1931] 1966, p. 280 ; trad. Artaud13). C’est le spectre de sa mère. Cependant on observera avec intérêt que cette fenêtre qui s’ouvre ne figure ni dans le texte original de Lewis, ni dans la traduction de Léon de Wailly qui faisait jusqu’alors autorité : elle est entièrement de la main d’Artaud, pour qui, visiblement, toute vitre est machine à fantômes.
Carroll sur le carreau
10Mais le plus étonnant est que sous cette référence directe à Lewis se joue une autre référence, non moins prophétique, si l’on veut, mais nettement moins directe et pour tout dire franchement transversale, à un autre Lewis qui, s’il n’était chanoine, n’en n’était pas moins pasteur, et qu’Artaud traduira également. Nous voulons parler de l’auteur d’Alice au pays des merveilles (Carroll, 1865) et d’un second volume qui en français s’intitule De l’autre côté du miroir (1871) et quelquefois, de manière plus apte, À travers le miroir (Through the Looking-Glass). Qui ne se souvient des premiers pas d’Alice de l’autre côté du réel ? Ayant traversé le miroir dont le verre s’était transformé en une sorte de buée, elle voit dans la chambre inversée le jeu d’échecs laissé derrière elle, et dont les pièces de bois à présent s’animent – reines, rois, tours et chevaux se promenant « deux par deux » avant de se « renverser ». N’est-ce pas sous cet angle que se présente « La Vitre d’amour », avec ces « têtes sans corps » (un « cheval de bois », une « reine », une « tour » et des « pions ») qui se heurtant, « tombaient comme des quilles » (Artaud, 1976, p. 185) ? Vingt ans plus tard, sous la sollicitation de son médecin à Rodez, le Dr Ferdière, Artaud traduirait un chapitre de ce livre, « Humpty Dumpty », devenu « Dodu Mafflu14 ».
11Or ce livre de Carroll, Artaud jure ne l’avoir pas lu avant 1947, pas plus qu’il n’aurait eu connaissance de son auteur15. Comment expliquer dès lors la possibilité de cette lecture de Through the Looking-Glass de Lewis Carroll, auquel, bien plus tard seulement, Artaud devait faire un sort ? Ce miroir permettrait-il donc de se projeter dans l’œuvre à venir ? Déjà il était surprenant qu’Artaud nous fasse voir à travers sa « Vitre » l’auteur du Moine, qu’il ne traduirait que bien plus tard. En fait, à y bien regarder, ce texte est comme une fenêtre donnant sur son œuvre à venir : Lewis, Carroll, Nerval se retrouveront tous trois sous sa plume. En les évoquant, le poème les agit, les performe, et programme leur apparition future16. Ainsi se comprennent un peu mieux les libertés qu’il prend à traduire et l’invraisemblable accusation de plagiat qu’Artaud lance contre Carroll, revers de cette « Parole soufflée » (c’est-à-dire à la fois volée et chuchotée), dont parlait autrefois Derrida17. Si Artaud, lorsqu’il traduit, adapte, varie, traite comme sien le bien d’autrui, c’est qu’en réalité il croit se le réapproprier :
J’ai eu le sentiment, en lisant [la chanson de Dodu Mafflu sur être et obéir] que ce petit poème, c’est moi qui l’avais et pensé et écrit, en d’autres siècles, et que je retrouvais ma propre œuvre entre les mains de Lewis Carroll. (Artaud, 1979, p. 147).
12Carroll l’aurait donc plagié par anticipation. Ceci rejoint les propos d’Artaud sur Balthus, peintre de la transversalité, qui, s’inscrivant de manière oblique dans la lignée des peintres, devenait paradoxalement le devancier de ses prédécesseurs : si Balthus peint comme Poussin, disait Artaud, « c’est qu’il était là quand Poussin établissait ses paysages, et que maintenant, il reprend son bien, tout simplement » (1990, p. 3318). Propos qu’Évelyne Grossman (2004) résume en évoquant justement un miroir déformant l’image comme dans le bouillon d’une vitre :
La déformation de l’image renvoyée à l’oblique dans le miroir – Artaud se regardant de travers, à travers Balthus se regardant, à l’infini des reflets déformés des miroirs en mouvement. (Grossman, 2004, p. 45).
13Mais aussi bien Artaud se regardant à travers Nerval, Hoffmann, M. G. Lewis et Carroll.
Bande enrôlée sous une même banderole
14On est en droit cependant de se demander ce que vient faire Pierre Mac Orlan parmi d’aussi illustres auteurs que « La Vitre d’amour » fait apparaître ? On pourrait s’étonner de la présence, au sein d’une si auguste compagnie de spectres, de ce romancier, contemporain d’Artaud, certes (et donc bien vivant), mais n’ayant aucun rapport avec les milieux que ce dernier fréquentait. En creusant un peu, on s’aperçoit toutefois qu’au revers de « La Vitre d’amour » on ne trouve pas seulement l’un des contes les plus connus d’Hoffmann. Il y a aussi un roman d’aventures dont Artaud fit, en 1921, l’éloge dans Demain, la petite revue que dirigeait le Docteur Toulouse (alors en charge de l’asile de Villejuif où avait séjourné Artaud) : dans cet article, intitulé « Pierre Mac Orlan et le roman d’aventures » (1921), Artaud dit apprécier tout particulièrement Le Nègre Léonard et Maître Jean Mullin (Mac Orlan, 1920), roman paru à la NRF et aujourd’hui oublié (Artaud, 1980). S’il ne tarit pas toujours d’éloges à l’égard de Mac Orlan, comme lorsqu’il rendra encore compte de La Cavalière Elsa (1921) ou de Malice (1920) (Artaud, 1980, p. 201 et 214), recueil de nouvelles dont il regrette l’incohérence, Artaud n’en estime pas moins que Mac Orlan « peut passer pour le Mage, et le Prophète de l’aventure », et considère Le Nègre Léonard comme un « chef-d’œuvre », en raison du « fascinant cachet d’irréalité presque logique » que son auteur a su conserver en transposant « dans l’époque actuelle des vieux thèmes de sorcellerie » (1980, p. 192 et 195).
15Au vu des premiers mots de ce roman – « Ma servante rousse met la table » (Mac Orlan, 1920, p. 11) –, il est difficile de ne pas songer au rôle de « boniche crapuleuse19 » que joue dans « La Vitre d’amour » l’aimable voisine du narrateur, dont la chevelure n’est certes pas « cuivrée », mais « blonde » : blonde ou rousse, peu nous importe, pourvu qu’elle soit fille du Nord. En effet, précise Mac Orlan, Katje, c’est son nom, « est une flamande de Knocke [sic] », village situé au bord de la mer du Nord. Rapidement devenue sa maîtresse, Katje se retrouve le plus souvent toute nue, en particulier lorsqu’elle descend du second étage pour rejoindre le lit du narrateur : de même, c’est « dans la chambre au-dessus » que le porte-parole d’Artaud entend les « soupirs ardents » de sa « boniche », il est vrai d’un abord plus difficile, quoique peu gênée de se déshabiller « devant sa lucarne » (Artaud, 1976, p. 183). Si, pour la saluer, montent de la rue des chansons populaires « d’une stupidité affreuse : Chez ma belle qu’il fait bon » (1976, p. 187), c’est en écho visiblement à celle qui est entonnée dans le roman de Mac Orlan :
Ah qu’on est bien, mad’moiselle
Ah qu’on est bien près de vous (Mac Orlan, 1920, p. 48)
16Mais l’élément le plus déterminant, dans cette lecture transposée que réalise Artaud du Nègre Léonard, a trait aux propos du jeune homme, lorsque la « boniche » se trouve soudain dans ses bras : « Ce n’est pas le diable, tu vois bien, me dit-elle. Eh non, ce n’était pas le diable, ma petite boniche était dans mes bras » (Artaud, 1976, p. 187). Le narrateur a beau le réfuter, c’est pourtant bien le diable qui s’en est mêlé. Katje, son double mac-orlanien, si elle est bonne de jour, est sorcière de nuit, et ne manque pas d’entraîner dans l’un de ses sabbats son amical employeur pendant que celui-ci rêvait à sa fenêtre. C’est à cette occasion que celui-ci fera la rencontre du diable et de deux de ses acolytes : le nègre Léonard et Maître Jean Mullin, qu’il retrouvera plus tard en Allemagne, fortement vieillis, dans une taverne quelque peu hoffmannienne. Katje finit par disparaître à son tour, ses traits s’effaçant, son visage devenu lisse comme un œuf… voire comme une « montagne de glace sur laquelle une chevelure blonde pendait » (Artaud, 1976, p. 188).
17Ne peut-on toutefois pas s’étonner au moins de voir Mac Orlan « poussant une brouette » ? Pourquoi ce portrait de l’artiste en colporteur ? C’est ne pas savoir que Mac Orlan fut aussi brièvement éditeur, qu’il dirigea successivement deux maisons au début des années 1920, La Banderole et La Renaissance du Livre20. Or qu’y publia-t-on ? Essentiellement des classiques ; et c’est ainsi qu’on trouve au catalogue de La Banderole les Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre d’Hoffmann21 et que La Renaissance du livre annonça la parution d’une œuvre de son compatriote et contemporain, Achim von Arnim. Quant au « chanoine Lewis », que Mac Orlan chérissait, on sait le sort qu’Artaud, traducteur, lui réservera cinq ou six ans plus tard. On se rappelle en outre que ces Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre n’étaient pas publiées dans n’importe quelle version française par les éditions de La Banderole : il s’agit de la traduction partielle, portant sur les seuls deux premiers chapitres sur quatre que comporte la nouvelle, telle qu’elle fut proposée au Mercure de France en 1831 par un Gérard de Nerval amoureux de l’Allemagne. Le détour par Hoffmann visait à vrai dire l’auteur des Chimères, car c’est bien à la traduction de Nerval qu’Artaud fait référence, celle-ci venant s’inscrire dans un véritable enchaînement intertextuel, édité à la même enseigne : Adelbert von Chamisso, cité par Hoffmann, à son tour traduit par Nerval, lui-même admiré par Artaud, futur traducteur du Moine de Lewis ([1796, 1931] 1966).
18Pourquoi Artaud, en convoquant ainsi le ban et l’arrière-ban, n’évoque-t-il que des auteurs liés à une même maison, réunis sous une même « banderole » ? Sous couvert de cette allusion éditoriale, quelle autre maison d’édition au juste est désirée de la sorte ? Car, à coup sûr, ce n’est guère chez Mac Orlan qu’Artaud souhaite faire paraître ses poèmes, mais bien sous la bannière de la NRF. « La Vitre d’amour » dirait-elle donc la naissance éditoriale retardée d’Artaud ? De fait, malgré un premier refus essuyé, le calcul va s’avérer payant : très peu de temps après avoir réussi à se faire accepter par la NRF, Artaud rejoindra, bien éphémèrement il est vrai, la petite bande des surréalistes. Voilà qui éclairerait d’un nouveau jour cette chambre d’étudiant si peuplée de noms glorieux. Sous les couches déjà repérées, une autre lecture du poème est possible, qui renvoie à des sources qu’Artaud se garde bien de nommer.
Artaud « tard désiré et tôt détruit »
19Pour nous en convaincre, autant remonter jusqu’à l’origine, au moment où, début 1923, Artaud contacte Jacques Rivière à la NRF, en lui envoyant une série de poèmes jugés incohérents : Rivière en refuse la publication, mais prolonge l’échange de lettres entre eux. Dès sa correspondance avec Rivière, qui ne le comprend guère tout en voulant le guérir, « le problème » est clairement exposé par Artaud en termes de combat, de lutte avec les mots. À l’instant même où « la chose est sur le point d’émaner », et le poème sur le point de se réaliser dans toute « sa richesse » ou d’atteindre son point d’orgue, voilà qu’« une volonté supérieure et méchante attaque l’âme comme un vitriol, attaque la masse mot-image […] et me laisse, moi, pantelant », écrit-il le 6 juin 1924 (Artaud, 1976, p. 52-5322) – le « vitriol » étant ce qui se projette en vitrifiant corps et âme, yeux et peau. On songera ici au commentaire que Jacques Derrida (1986) a développé à partir du mot « subjectile », mot rare désignant ce qui est placé « en dessous », qu’Artaud lui-même n’utilise qu’à trois reprises, mais dont la logique (qui se rapporte d’abord à ses dessins plus tardifs où le crayon laisse des marques profondes dans le papier, souvent troué) innerve toute sa pensée, corrélé qu’il est au mot « projectile », qui peut être un crayon ou une plume entamant l’épaisseur de la page ; si le subjectile, à la fois support et surface, peut désigner ainsi la page ou le canevas, il se diversifie aussi en peau, hymen, paroi, entre-deux, bref tout ce qui peut être traversé : percé, perforé, dans un rapport d’une certaine violence, par un projectile, tel que pinceau, plume ou crayon23. À ce compte-là, il faudrait considérer également comme subjectile la vitre elle-même, que l’on sait « fendue », comme par quelque projectile.
20En définitive, de quoi veut réellement nous parler « La Vitre d’amour », avec son défilé de personnages littéraires, cette procession folle d’auteurs qui semblent vouloir venir en aide à un pauvre étudiant en lettres : un débutant en somme ? De littérature, bien entendu, de son impossibilité, mais aussi de l’« angoisse de l’influence » (Harold Bloom, [1973] 2013) dont elle témoigne. Pour sûr l’auteur se présente ici en position inférieure devant une si auguste assistance : Nerval est tellement « grand », et lui si « petit ». D’où la menace du refus qu’encourt Artaud, l’entrave qui lui est faite, par ceux qui l’entourent, le guident et lui apportent des conseils dont le sens lui échappe d’abord. Que signifierait autrement le projet formulé par celui qui semble ne vivre qu’au travers d’une vitre ?
Il me fallait maintenant trouver un moyen de m’aboucher avec la réalité… Ce n’était pas assez que d’être abouché avec la résonance obscure des choses. (Artaud, 1976, p. 184).
21L’expression revient un peu plus loin, dans un sens plus littéral, se rapportant plus directement à la « bonne », objet de son amour : « Je ne sais pas comment m’aboucher avec elle » (p. 186). Or c’est là une expression qu’on trouve aussi dans le texte sur lequel s’ouvrait L’Ombilic des limbes dont la parution comme livre, en juillet 1925, coïncidait avec la publication en revue de « La Vitre d’amour » :
Je voudrais faire un Livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n’auraient jamais consenti à aller, une porte simplement abouchée avec la réalité. (Artaud, 1976, p. 62).
22Autant dire que la « bonne » tant désirée vaut ici pour l’œuvre artaldienne elle-même. Voilà donc qui ouvrirait « La Vitre d’amour » à une lecture quasiment allégorique, le texte se muant en commentaire sur lui-même, en affirmant que tout « vrai » poème se doit de forcer une ouverture, une porte ou une fenêtre donnant sur une « autre » réalité, certes, mais aussi sur la simple réalisation de l’œuvre, par sa mise en livre aux mains d’un éditeur : la nécessité « avant tout de lui parler » rappelle l’entretien que Rivière accordera à Artaud. Et c’est ainsi que cette vitre fait naître un auteur. En deux temps : tu réussiras quand tu n’y penseras plus.
L’énervé de la ainereffe
23Une fois admis ce principe métadiscursif à l’œuvre sous le texte, on voit se multiplier les allusions à l’œuvre déjà faite ou en train de se faire. Que penser par exemple de cette réflexion de l’amoureux, suite aux propos de « Nerval » selon lequel « tout ceci » aurait un « lien » : « Il ne connaît même pas le poids des mots, pensai-je » ; ce à quoi l’étudiant rétorque : « Pardon, le prix, le prix des mots » (Artaud, 1976, p. 186). Un tel lien entre le poids des mots et leur prix ne peut se concrétiser que sur le marché des biens symboliques : chez l’éditeur, en vitrine. Il y aurait dès lors une signification beaucoup plus vulgaire à attribuer au titre du second recueil d’Artaud : ce « beau Pèse-Nerfs », dans lequel se laisse lire dans le plus grand désordre le verbe « penser », ne viserait-il pas aussi la relation commerciale avec la « sacro-sainte » NRF, où Artaud, comme tant d’autres, désire ardemment que paraissent ses écrits, et avec laquelle il y aura toujours une question de pour et de contre à « peser », une question de « fric » ou de « pèze » à débattre ? C’est selon toute apparence ce que l’avenir lui réserve, puisque dès sa mise en liberté, en mai 1946, Artaud n’aura de cesse de réclamer auprès de Gallimard des arriérés pour Le Théâtre et son Double, paru en 1937, au moment de son internement. La question sera cependant réglée peu après sa « sortie » de Rodez, dès le mois d’août 1946, lorsque Gallimard s’engage à publier les Œuvres complètes d’Artaud. Le contrat n’est pas encore signé que déjà Artaud tient toute prête sa préface. Intitulée « Préambule », il y est beaucoup question de sa correspondance avec Rivière.
24Paradoxalement, c’est par la publication en revue de son échange épistolaire avec Jacques Rivière, consécutif au refus de mai 1923, qu’Artaud verra s’ouvrir les portes de la NRF. Les sept premières missives aggravent la distance entre les deux correspondants, en tournant sans cesse autour de l’impossibilité de penser : Rivière estime qu’Artaud parle très bien de son impossibilité d’écrire. Mais un revirement complet s’opère soudain à la huitième lettre, lorsque Rivière lui annonce qu’il lui « est venu une idée » : celle de publier leur correspondance en lieu et place des poèmes – riche idée à laquelle Artaud répond, tout en s’empressant d’acquiescer, qu’il y avait lui-même songé. Voilà donc qu’une fenêtre s’ouvre. C’est bien ce que laisse entendre le texte d’Artaud : « Tout à coup la fenêtre s’ouvrit. » Entendez que ce même coup signale aussi la reconnaissance de son art : cet échange ayant paru dans la revue, en 1924, il sera suivi l’année suivante de L’Ombilic des limbes, à la NRF toujours, du Pèse-Nerfs, également en 1925 (mais chez un autre éditeur), et enfin de leur correspondance en forme de petit volume, paru en 1927 chez Gallimard.
25« La Vitre d’amour », rappelons-le, parut en juillet 1925, il y a cent ans, dans la Revue européenne24. Rédigé après le refus initial de la NRF de publier certains de ses poèmes, ce texte aurait-il gardé des traces de ce faux départ ? La question peut d’autant plus légitimement se poser qu’on assiste à une véritable sacralisation du rejet, au travers du rituel épistolaire qui s’installe entre les deux auteurs. Paradoxalement, Artaud fait œuvre non pas en dépit, mais grâce au refus qui lui fut infligé au départ : « C’est que la question de la recevabilité de ces poèmes est un problème qui vous intéresse autant que moi. Je parle, bien entendu, de leur recevabilité absolue, de leur existence littéraire » (Artaud, 1976, p. 30), dira-t-il d’emblée à Rivière. Que ce retard ait profondément blessé l’auteur, cela ne fait aucun doute : « De votre réponse, je vous en ai voulu pendant longtemps » (p. 35). Sans doute, Artaud aurait-il pu insérer « La Vitre d’amour » dans l’un de ses deux recueils précédents ; il n’en fit rien, choisissant de le placer en dernière position dans L’Art et la Mort, comme s’il s’agissait pour lui de conclure sa production poétique sur un rappel de son refus initial. « La Vitre d’amour » est non seulement le dernier « poème » de L’Art et la Mort, mais avec lui se clôt aussi à vrai dire la série de trois recueils poétiques qui ont amené Artaud sur le devant de la scène littéraire. Ayant ainsi réglé ses comptes avec la NRF, à mots couverts, il se tournera ensuite vers le théâtre, les voyages, et ce pesant silence empli de cris sur lequel l’œuvre, pour (en) finir, s’achève en versant dans la folie. À ceci près qu’en 1946, lorsque Gallimard envisage la publication de ses Œuvres complètes, l’occasion se présente à Artaud d’y revenir une dernière fois, sous forme de « Préambule », en disant ouvertement son sentiment sur le refus initial, et non plus en termes voilés, sur le mode allégorique choisi dans « La Vitre d’amour ».
« Installer le bonhomme »
26Dans ce « Préambule », Artaud s’exprime non sans malice sur l’esprit de la maison, en se rappelant ses premières tentatives poétiques, rédigées, pensait-il, en conformité avec l’esprit qui y règne :
Ce style s’appelait dans ma conscience : recevabilité d’un poème au Mercure de France, aux Cahiers d’Art, à Action, à Commerce, et surtout et par-dessus tout à cette sacro-sainte NRF dirigée par Jacques Rivière. (Artaud, 1976, p. 10).
27La question de la « recevabilité » différée de ses poèmes (et donc de leur « irrecevabilité » première), de « leur existence littéraire », déjà agitée dans sa correspondance avec Rivière, revient donc au premier plan dans le « Préambule » (Artaud, 1976, p. 11). Il n’y est même question que de cela. Ce qu’Artaud reproche à Rivière, ce qu’il déplore le plus en lui, c’est d’abord son goût pour « les poèmes du genre décharné dans le bien-écrit » (p. 10), alors que lui-même défend une conception autrement charnelle de la poésie. Il s’agit pour Artaud de savoir « par quels mots entrés au couteau dans la carnation qui demeure […], par quels mots je pourrai entrer dans le fil de cette viande torve », cette « viande à saigner sous le marteau » (p. 11). Et il ajoute, en ciblant toujours Rivière :
Le mot-squelette lève sa robe, s’ouvre au-dessus de la robe-loque d’un langage tard désiré et tôt détruit. Que le poème soit vide d’émotion ou de sens, cela, je crois, lui importait assez peu, mais il aimait beaucoup la breloque où tremble son esprit, la breloque de l’amande amère sous la langue qui la détruit. (p. 10).
28Par-delà le jeu de mots sur « robe-loque », il convient d’interroger plus avant cette « breloque », qui semble indiquer une reprise textuelle de plus. De fait, ne lisait-on pas dans « La Vitre d’amour » cette question : « Quelle est la meilleure breloque, quel est le bijou le plus beau, quelle est l’amande la plus fondante ? » (1976, p. 187), qui elle-même reprend l’incipit à forte connotation érotique de ce « conte » – connotation qui explique d’ailleurs le titre auquel Artaud avait d’abord songé, « Le Sexe en verre » (1976, p. 403) :
Je la voulais miroitante de fleurs, avec de petits volcans accrochés aux aisselles, et spécialement cette lave en amande amère et qui était au centre de son corps dressé. (1976, p. 183).
29Voilà désignés les seins et le sexe de façon non décharnée. Or cette « amande », on vient de le voir, se retrouve également dans le « Préambule » de 1946, directement associée à l’autre mot emprunté à « La Vitre d’amour » : « la breloque de l’amande amère ».
30Là ne s’arrêtent d’ailleurs pas les rappels. Après avoir opposé aux squelettes de la NRF sa volonté d’« entrer dans le fil de cette viande torve », voici qu’Artaud ressent le besoin de répéter cet adjectif rare, mis cette fois entre parenthèses et en lettres capitales : « (je dis torve, ça veut dire louche) », mot dont la sonorité retentit encore à travers l’impossibilité d’« introduire ma trame dans ces poèmes avortés » (1976, p. 11). « Torve » est dit de l’œil qui louche, qui regarde de travers ou de façon oblique. Cette notion de « travers », on la trouvait déjà, également disposée en capitales, dans « La Vitre d’amour » : « Tu l’obtiendras transversalement » (1976, p. 186), lisait-on au sujet de la bien-aimée. Si « torve » s’affiche ici en capitales, c’est sans doute afin de correspondre aux capitales dont est doté ce « transversalement » dans le petit conte de 1925. Mais pourquoi donc cette préface aux Œuvres complètes, en revenant nommément sur la correspondance avec Rivière, ferait-elle par trois fois référence aussi ouvertement à « La Vitre d’amour » ? Un tel retour, après vingt ans, sur ce « conte », semble confirmer qu’avec « La Vitre d’amour », l’auteur nous parlait déjà (« transversalement » et non pas directement) de la maison Gallimard.
31Il est, de ce point de vue, tout à fait intéressant de comparer le « Préambule » à sa version initiale, celle qu’Artaud, dans un cahier de juillet 1946, a d’abord songé à intituler « Installer le bonhomme25 », et dont il réutilisera surtout les propos délirants de la fin : « Moi poète j’entends des voix » (1986, p. 431 ; 1976, p. 14), etc. S’y dessine le même geste inaugural que dans la version finale, où il commence par écarter Tric trac du ciel de ses Œuvres complètes (alors que ce recueil y était d’abord prévu, et qu’il finira par y figurer) ; mais l’exclusion porte cette fois sur ses tout premiers poèmes, jamais publiés, qui lui paraissent détestables à présent : « on ne trouvera pas dans ce premier tome tous les poèmes que j’ai finis avant de les faire sortir de ma plume de 1913 à 1922 » (1986, p. 43126). Dans sa conclusion aussi, Artaud reste assez fidèle au plan initial. Là où les deux textes divergent de la manière la plus manifeste, c’est qu’il n’est, dans cette première version, absolument pas question du « style NRF » sur lequel va s’appesantir le « Préambule ». Aucune évocation de Rivière, non plus, ni la moindre allusion à leur correspondance. À cela, il est peut-être une raison fort simple : « Je n’ai pas le texte de L’Art et la Mort » (1986, p. 443), notait-il dans un cahier qu’on peut dater également de juillet 1946 ; mais il obtiendra peu après un exemplaire de son recueil, comme l’atteste sa lettre du 12 août 1946 à Gallimard : juste à temps pour que « La Vitre d’amour » projette ses innombrables reflets sur le « Préambule ». Artaud n’aurait rédigé la version définitive, si différente, du « Préambule » qu’une fois en possession d’un exemplaire de L’Art et la Mort, dans lequel il pouvait à loisir réfléchir à sa « Vitre d’amour ».
32On peut donc se demander s’il n’y aurait pas eu d’emblée un lien entre ce poème en prose de 1925 et la « sacro-sainte » NRF qui venait de publier le premier recueil d’Artaud. Derrière cette « Vitre » se cacherait un portrait de Jacques Rivière en jeune fille. En bien-aimée. N’est-ce pas là forcer les choses ? Voilà pourtant qui est loin d’être exclu27. En 1923 avait paru chez Grasset Le Fleuve de Feu, roman de François Mauriac, auquel Rivière consacra une « Note » dans la NRF (1er juillet 1923), après que celle-ci en eut assuré la prépublication en feuilleton (le dernier des trois feuilletons ayant paru en mars 1923). Cette même année Artaud à son tour consacrera à ce roman de Mauriac un court article, plus modestement publié dans sa propre et très éphémère revue, Bilboquet (encore une référence au domaine du jeu) : « La préoccupation du péché », y affirme-t-il, est l’angle moral « sous lequel Mauriac nous force à considérer chacun des gestes de ses personnages » (1976, p. 273). Or voici qu’Artaud oppose, comme il le fait souvent dans ses commentaires critiques28, à cette œuvre de Mauriac qu’il admire, un roman de Jacques Rivière publié un an plus tôt (c’est le seul paru de son vivant), qu’il n’apprécie guère :
On peut mettre le Fleuve de Feu à côté d’Aimée de Jacques Rivière, une sorte d’éducation sentimentale […]. Il y a entre ces deux livres toute la distance qui sépare une opération chirurgicale des épanchements du confessionnal. Jacques Rivière semble travailler sur une espèce de matière morte[, alors que] François Mauriac ne renonce à rien de la vie. (Artaud, 1976, p. 274).
33Étrangement, cette allusion au péché, au confessionnal, va se retrouver telle quelle dans « La Vitre d’amour » : « C’était un ciel de péché protestataire, un péché retenu au confessionnal » (1976, p. 183). Tout se passe comme si les écrits d’Artaud se construisaient de reprise en reprise, par un collage de fragments de textes autrefois rédigés. Ce « confessionnal » n’apparaît dans le conte qu’afin d’assurer le lien avec ce compte rendu, écrit deux ans plus tôt, et son renvoi hostile à L’Aimée de Rivière dont la « matière morte » semblait à Artaud si éloignée de la vie. Car c’est bien sous le signe de la mort qu’est d’emblée placé Rivière au destin si funeste.
34Dans son « Préambule », Artaud fera d’ailleurs écho à ce décès, en reprenant une dernière fois l’image de l’amande, cette fois concassée :
Sous l’amande amère écrasée, il y a le cadavre d’un homme mort. Ce mort s’appelait Jacques Rivière vers le début d’une étrange vie : la mienne. Jacques Rivière me refusa donc mes poèmes, mais il ne me refusa pas les lettres par lesquelles je les détruisais. (Artaud, 1976, p. 13).
35L’image initiale fait visiblement écho à « la breloque de l’amande amère sous la langue qui la détruit » (1976, p. 10), mais aussi à cette « meilleure breloque », cette « amande fondante » qu’évoquait déjà « La Vitre d’amour ». Qu’on se le tienne pour dit : sous le sexe d’Aimée, il y a donc ce cadavre d’homme ; sous ce « Sexe en verre » se dissimulait Rivière, qui mourut emporté par une fièvre typhoïde en février 1925. Et Artaud d’ajouter : « Il m’est toujours apparu très étrange qu’il soit mort peu de temps après avoir publié ces lettres » (1976, p. 13). Et précisément au moment où se rédige « La Vitre d’amour ». Serait-ce une simple coïncidence ? Ou l’effet d’un sort que lui aurait jeté son correspondant, à la suite d’une dernière visite ? Quoi qu’il en soit, Jacques Rivière, spectralisé à son tour, finit ainsi par rejoindre in extremis le cortège de fantômes mis en scène par Artaud.
Le Grand Verre et la petite « vitre »
36Voici une dernière coïncidence, certes moins sinistre, mais non moins troublante : on verra qu’elle touche au cœur même de la mécanique du refus. Elle semble à première vue relever de la plus pure synchronicité artistique : Marcel Duchamp, alors proche des surréalistes29, cessa en 1923 de travailler à La Mariée mise à nue par ses célibataires, même (titre dans lequel il avait pris soin de déguiser son prénom30), pour ensuite se mettre à jouer professionnellement, et non sans succès, aux échecs. Y aurait-il eu quelque influence de l’artiste sur le poète31 ? Sans doute Duchamp et Artaud sont-ils deux noms que la critique ultérieure associera souvent32 : s’ils se sont rencontrés, il n’en existe aucune trace ; pas la moindre allusion à l’un sous la plume de l’autre. Mais il va de soi qu’Artaud, fréquentant les milieux dadaïstes dès 1922, connaissait le nom et certains aspects de l’œuvre de Duchamp : aurait-il dès lors eu vent de la Mariée ? Cette « peinture » sur verre est aussi connue sous cet autre titre : Le Grand Verre, ce qui ne peut manquer de nous interpeller. D’autant plus que Duchamp situe l’élément féminin (la « mariée ») dans la partie supérieure du Grand Verre, réservant la partie inférieure aux « célibataires » qui la désirent ; pareillement c’est « là-haut », dans « la chambre au-dessus » de celle du narrateur, qu’Artaud place la « bonne » dans sa « Vitre d’amour », réintroduisant ainsi le figuratif que Duchamp avait soigneusement éliminé de sa représentation – « La Vitre d’amour » s’achevant sur l’évocation d’un « peintre » désespéré, qui finit par retrouver ses pinceaux en forme de « cyprès33 ».
37Entreprise en 1915, après le refus initial infligé par les cubistes au Nu descendant un escalier en 1912, qui sera pourtant acclamé l’année suivante à New York, l’installation à deux vitres repose, aux dires mêmes de l’artiste, sur l’idée qu’une œuvre d’art ne s’affirme pas d’emblée, mais fait l’objet d’un rituel en deux temps : au refus (rejoué par une mariée se refusant aux célibataires) succède la réhabilitation (réalisée lors de sa mise à nue par eux). Mais n’est-ce pas selon une semblable loi du « talion » ou de revanche que se joue également la petite « Vitre » d’Artaud, dont on a vu qu’elle commente allégoriquement le refus essuyé en 1923, puis son acceptation par la NRF un an plus tard ? À l’instar de Duchamp, Artaud s’inscrirait ainsi dans cette nouvelle tradition (la tradition du nouveau) qu’avaient inaugurée les impressionnistes avec leur Salon des refusés. Un nouveau mode de légitimation se mettait ainsi en place : au refus premier succèderait le succès différé, l’artiste moderne s’autoproclamant avant d’être reconnu par autrui. Il y a là décidément un bel exemple de synchronicité : ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais elle fait sens. Comment ne pas songer à la mariée, à ses célibataires, avec ce cortège de prétendants lancés à la poursuite d’une dame fort peu vêtue ? « Les clients de tous les restaurants du monde partirent à la poursuite de la petite bonne » (Artaud, 1976, p. 185) qui, « comme toutes les bonnes », « se déshabillait devant sa lucarne » (p. 183). On n’oubliera pas non plus le titre original du poème, « Le Sexe en verre », qui a peut-être été omis parce que trop transparent au regard du Grand Verre de Duchamp.
38Il est en effet troublant de constater de telles similitudes, que l’on dirait soigneusement inversées par Artaud. Ainsi n’y a-t-il pas neuf, mais six célibataires : le poète étudiant, Hoffmann, Achim von Arnim, Lewis, Mac Orlan et Nerval. Certains d’entre eux sont dotés d’attributs qui en font un chanoine (un prêtre chez Duchamp), un ressemeleur, un restaurateur (un serveur de café chez Duchamp), ce dernier qualificatif étant gonflé jusqu’à l’infini (« les clients de tous les restaurants du monde »). Le fait que « des têtes sans corps » y fassent des « rondes », alors que les célibataires de Duchamp apparaissent dépourvus de têtes, constitue à n’en pas douter l’inversion la plus manifeste qu’aurait effectuée Artaud. Dans le même passage du poème, on notera également la mention d’anges aux « ailes en pieds nickelés » qui renvoient, d’une part, à la déjà célèbre bande dessinée et, d’autre part, aux pieds en nickel de la fameuse « broyeuse de chocolat » (l’une des pièces du Grand Verre) à laquelle répondrait en écho cet « écrasement d’une chose suave ».
39De telles coïncidences sont en trop grand nombre pour relever du simple hasard. Le fait qu’Artaud fasse intervenir dans son « tableau », sous prétexte d’un « jeu de dames », des pions, un cheval, une tour, une reine, n’est pas sans lien avec la nouvelle occupation de Duchamp, qui, ayant rangé ses pinceaux, s’adonne à temps plein aux échecs, dès 1923. Mais « échec » est un mot qui fait écho à celui de « refus ». Aussi bien, l’échec initial de l’étudiant célibataire auprès de sa « blonde », suivi d’un revirement de situation aussi inexplicable qu’inattendu lorsqu’elle lui tombe dans les bras, rejouerait à vrai dire l’échec d’Artaud à placer ses poèmes à la NRF, en 1923, qui mènera indirectement à la parution inopinée de sa correspondance avec Jacques Rivière en 1924 et à sa réhabilitation en tant que poète. Il y aurait, en d’autres mots, entre Le Grand Verre et le Nu descendant un escalier le même rapport qu’entre « La Vitre d’amour » et la lettre de refus adressée par Rivière à Artaud. C’est à partir du rejet d’une de leurs œuvres que les deux artistes en créent une autre qui, de surcroît, s’érige en commentaire de ce rejet – à cette différence près qu’Artaud se situe encore dans le retard et le mimétisme, face à l’œuvre de Duchamp. À moins qu’il ne faille envisager une autre hypothèse, d’obédience résolument surréaliste : la télépathie. À peine Marcel Duchamp avait-il, sous le pseudonyme de Rrose Sélavy, publié une série de jeux de mots, éparpillés dans la revue Littérature en 1922, qu’aussitôt Robert Desnos lui emprunta ce titre de Rrose Sélavy, tout en multipliant des jeux de mots qui, selon André Breton, « se donnaient pour le produit d’une communication télépathique avec Marcel Duchamp alors à New York » (Breton, 1969, p. 9034). Au binôme Desnos-Duchamp succéderait ainsi le couple Artaud-Duchamp sur fond de clairvoyance.
Chie-Mère
40À peu près au moment où Duchamp (en 1936) entame la restauration du Grand Verre, fêlé lors de son transport à New York, Artaud part d’Anvers pour le continent d’Amérique, et tout s’inverse pour lui à partir de cette traversée en bateau. Transperçant au Mexique, à travers ses rituels, ses danses, ses plantes et ses paysages, cette « vitre fendue », fragile et mal défendue, de son âme, Artaud va se retrouver à jamais « de l’autre côté », pour ne plus en revenir qu’en morceaux : à l’image de l’« assemblage disloqué » de ses écrits futurs (cahiers d’écolier saturés de griffonnages, raturés et troués de dessins et de mots). C’est, aux yeux de l’Occident, la folie qui vient sur lui jeter ses rets. En rejoignant ainsi le petit club très sélect des artistes que la société a suicidés (Baudelaire, Poe, Van Gogh, sans oublier Nerval), Artaud va pouvoir enfin renaître, une fois sorti de l’asile de Rodez après dix ans d’enfermement : « Mais un Antonin Artaud en gésine, et de l’autre côté de tous les verres mentaux », clamait-il déjà dans « Paul les Oiseaux, ou la Place de l’amour » (1925 ; Artaud, 1976, p. 68). Dès 1946, le nom de Nerval ressurgit dans l’œuvre d’Artaud de manière autrement plus personnelle que dans la « Vitre ». Artaud désormais se projette sur l’axe nervalien des Chimères en prolongeant à sa manière (c’est-à-dire en s’y incrustant et en le dilatant) le second tercet de « Antéros » :
Ils m’ont plongé trois fois dans les eaux du Cocyte, plongé nu pour me faire oublier, plongé fœtus pour me faire oublier, brûlé trois fois dans ce vitriol génésique. (Artaud, 1974a, p. 199).
41Sonnet dont il interprète le dernier vers – « Je ressème à ses pieds les dents du vieux dragon » – comme un engendrement de Nerval par lui-même, et en conséquence d’Artaud à travers Nerval.
42La poésie de Nerval est en effet comparée à « un primitif enfantement » (Artaud, 1974a, p. 191), une parturition, dans la douleur et les affres, d’êtres neufs, dans la volonté qui l’anime de « faire revenir » ces « petits enfants » que sont « Antéros, Artémis » (p. 197). On sait l’insistance avec laquelle Artaud se dira fils de ses œuvres, au sens le plus littéral, en s’en prenant à cette « mère traître qui prend son utérus pour être », à laquelle il opposera cette « Madame utérine fécale », dans le limon vitreux de laquelle Artaud voit la source noire de toute poésie, ainsi qu’il l’écrit dans Ci-Gît :
Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère,
et moi ; niveleur du périple imbécile où s’enferre l’engendrement (Artaud, 1974b, p. 77).
43Ou encore, dans une lettre à Henri Parisot datée du 7 septembre 1945 :
[…] ce n’est pas une façon de naître, que d’être copulé et masturbé neuf fois par la membrane […] et je sais que j’étais né autrement, de mes œuvres et non d’une mère (Artaud, 1979, p. 161).
44Il ira même jusqu’à contempler le scénario inverse : « Antéros se venge de sa mère, s’il la fait naître avec des vieilles dents » (Artaud, 1976, p. 186) – le jeu de mots sur « fait naître » auquel il se prête n’étant peut-être pas dû au hasard. Serait-ce donc cela le sens ultime, insoupçonnable, de « La Vitre d’amour » : Artaud né in vitro, et non in utero ?
45Dans son dernier grand texte, Pour en finir avec le jugement de Dieu (1947), prévu pour la radio, on lit ceci en premier lieu, qui peut surprendre :
J’ai appris hier
l’une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines […]
Il paraît, parmi les examens ou épreuves que l’ont fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l’épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme,
et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l’insérer dans un bocal
et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite avoir lieu. (Artaud, 1974c, p. 7135).
46C’est pourtant bien ce que réalisait « La Vitre d’amour » : on ne renaît qu’au travers d’un autre que soi ; et cet autre vous a prévu et vous annonce. Ainsi, par une coïncidence des plus heureuse, retentissent dans le nom même d’Antonin Artaud ceux des deux seuls poèmes nervaliens (ré)cités par lui : « Antéros » et « Artémis ». Mais ne dirait-on pas tout autant que c’est en Artaud que Nerval se pensait déjà ? Ce qui n’est pas immédiatement lisible n’en produit pas moins des effets repérables : le passé s’immisçant au sein du présent, les spectres trafiquent au milieu des vivants. Et inversement. Il aura donc fallu attendre Artaud pour qu’un auteur atteigne ces mêmes limites du langage déjà abordées par Les Chimères, les retraverse et en revienne pour, non sans éclats, en faire œuvre à son tour.