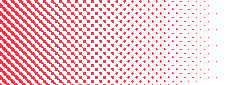L’album pour enfants entre culture contemporaine et légitimation savante : une mémoire scolaire et didactique
François Quet est décédé au mois de novembre 2022, alors qu’il avait transmis la version achevée de son article. Les directrices du dossier remercient ses proches d’avoir autorisé sa parution.
1En conclusion d’une somme consacrée à l’histoire de la lecture (Cavallo et Chartier, [1997] 2001), Armando Petrucci décrit les pratiques sociales de lecture de l’extrême fin du xxe siècle comme caractérisées notamment par la contestation multidimensionnelle des canons, dans le contexte général d’un « désordre dans la lecture ». « L’ordre traditionnel de la lecture », écrit-il, « consistait (et consiste) non seulement dans un répertoire unique et hiérarchisé des textes lisibles et “à lire” mais aussi dans des liturgies déterminées de comportement des lecteurs et de l’usage du livre, qui demandent des environnements spécifiquement équipés et des instruments particuliers » ; « [l]es pratiques médiatiques aujourd’hui les plus répandues, l’habitude de lire des messages en mouvement », avance-t-il encore, sont « exactement le contraire de la lecture entendue dans son sens traditionnel, linéaire et progressive » : elles se rapprochent de « la lecture transversale, cavalière, interrompue, tantôt lente, tantôt rapide, qui est celle des lecteurs déculturés » (p. 450-52).
2L’apparition et le succès de plus en plus évident de la bande dessinée, puis de l’album illustré pour les jeunes enfants dans la deuxième moitié du xxe siècle témoignent à mon sens, bien avant la généralisation des pratiques de lecture sur écran, d’un « désordre dans la lecture », qui en conteste les grandes normes autant qu’il en modifie les publics et les usages. Ces « nouvelles manières de lire », tant qu’elles s’exercent dans le domaine privé, sont essentiellement étudiées par les sociologues et les historiens de la lecture qui sont conduits à les décrire et à les analyser. En revanche, l’introduction dans la culture scolaire de nouveaux supports de lecture, qui supposent l’ouverture des répertoires, l’adoption de nouveaux modes de lecture, de nouveaux tempos, et la découverte de nouveaux rapports à l’écrit, pose un certain nombre de questions d’ordre théorique en même temps que didactique, sur la légitimité des canons (déconstruits, reconstruits), sur les objets et finalités de l’acculturation à la littérature (lecture de textes/lecture d’image/lecture de documents « pluricodés »), sur les manières d’entrer en littérature (nouveaux corpus/nouveaux modes d’appropriation). Pour aborder ces questions, il convient de rappeler dans quel contexte la littérature de jeunesse, puis les albums pour enfants se sont introduits dans l’univers scolaire et plus précisément à l’école primaire.
L’album comme objet des politiques publiques d’éducation à la lecture (1972-2022)
3Les travaux de Marc Soriano1, d’une influence considérable, ont introduit au cours des années 1970 ces productions texte-image – bien installées dans les pratiques sociales de lecture enfantine depuis notamment l’après-guerre – auprès du monde enseignant et de la recherche pédagogique. Dans un article de 1972, ce spécialiste des contes et notamment de ceux de Charles Perrault évoque une « bataille des programmes » sur fond de résistance de l’institution contre toute modification du répertoire canonique. Pour lui, pourtant, « le vrai danger » réside dans « une éducation trop ambitieuse qui, à cause de ses ambitions mêmes, passe “au-dessus de la tête de l’enfant” et laisse passer les années de sa formation sans lui procurer une véritable expérience du plaisir de la lecture » (p. 13). L’article développe de nombreux arguments en faveur de la littérature pour la jeunesse et de la place qu’elle doit, selon le chercheur, tenir dans les programmes scolaires. Il note cependant que malgré des initiatives nombreuses2 et des travaux universitaires dispersés, ce qui fait véritablement défaut est « une politique culturelle d’ensemble » (p. 16).
4Cette politique sera assez largement mise en œuvre au cours des années 1980 y compris dans les écoles maternelles et en particulier avec l’introduction des albums. Ainsi peut-on lire dans une circulaire ministérielle en 1986 :
La fréquentation précoce d’une bibliothèque-centre documentaire et de livres se trouvant dans la classe apprend à en utiliser les ressources. Par l’intermédiaire du maître, l’enfant reconnaît progressivement les supports, les formes et les fonctions de l’écrit. Habitués dès la petite section aux albums et aux livres, puis aux sources documentaires, aux textes écrits sous leur dictée par le maître et à toutes sortes de travaux relatifs à l’écrit, les enfants ne cessent de « conquérir de la lecture ». (p. 6 ; c’est moi qui souligne).
5Dès cette époque vont se succéder les dotations, les plans nationaux de lecture pour l’école, les listes de titres recommandés et les documents d’accompagnement qui aident au choix des ouvrages et à la préparation de leur lecture en classe, jusqu’à la proposition d’une option « Littérature de Jeunesse » au concours de recrutement des professeurs des écoles en 2006. Le document ministériel de 2008 intitulé « Une culture littéraire à l’école » propose ainsi des axes pour « Lire et interpréter l’image » du CM1 à la sixième :
C’est donc bien l’ensemble texte/images qui, le plus souvent, doit être compris et interprété. On pourra, à cet égard, s’inspirer du travail qui se fait traditionnellement sur l’album à l’école maternelle, c’est-à-dire à un âge où l’enfant ne sait pas encore lire. On peut se reporter au programme et aux documents d’application du champ disciplinaire « Arts visuels » pour aborder les illustrations des œuvres lues. Il convient de découvrir les relations de l’image et du texte en prenant conscience des diverses modalités de cette relation dans la construction du sens de l’œuvre : effets de redondance, complémentarité, juxtaposition, récits parallèles, divergence, etc. Ainsi, la comparaison de plusieurs illustrations d’un même texte dans des éditions d’époques différentes peut mettre en évidence comment les choix iconographiques influent sur le sens du texte, comment l’image, tout autant que le texte, mais par d’autres codes et effets, participe au travail d’élaboration de la signification. On sera toutefois attentif à ne pas enfermer les élèves dans une explication inutilement formaliste. Il ne s’agit pas, à l’école primaire, de mémoriser les catégories de la sémiotique de l’image, mais, simplement, de s’en approprier la signification et d’en éprouver les effets. (p. 4).
6De cette évocation rapide, on peut retenir que l’insertion de la littérature pour la jeunesse à l’école ne s’est pas faite sans conflit : il a d’abord fallu admettre que la lecture ne pouvait s’acquérir sans la fréquentation des livres3, et ceci dès le plus jeune âge, que les ouvrages classiques, constituant le répertoire historiquement constitué de l’école, ne pouvaient suffire à cette acculturation, que les récits en image (les albums) non seulement pouvaient jouer un rôle dans l’apprentissage et la familiarisation des jeunes élèves avec le monde des livres, mais qu’ils pouvaient apporter, au-delà de leur fonction instrumentale, des émotions et des réflexions qui relèvent d’une expérience esthétique à part entière.
Avènement de l’album « résistant » comme enjeu de la formation enfantine à la littérature
7Les années 1990 voient l’intégration dynamique, dans les corpus scolaires, d’albums récents au fonctionnement esthétique et narratif remarquable, que la recherche didactique qualifiera de « résistants ». Des modes et situations de lecture spécifiques sont préconisés à propos de ce corpus particulier, tandis que quelques albums phares sont longuement commentés et analysés par la communauté pédagogique et fréquemment « travaillés » dans des séquences de classe dont on trouve encore des traces dans l’actuelle documentation en ligne. En 1999, dans un numéro de Repères, revue influente auprès des formateurs d’enseignants, Catherine Tauveron propose d’initier les élèves, dès le plus jeune âge, aux « spécificités de la lecture littéraire4 » ; celles-ci sont associées au « plaisir particulier qui consiste à être le partenaire actif d’un jeu avec un texte qui a du jeu (des béances à combler, des pièces qui glissent l’une sur l’autre et peuvent s’imbriquer en une multitude de configurations à la manière d’un mécano), jeu dont il convient à tout moment d’inventer les règles » (p. 12). La notion de « textes résistants » est lancée ; l’album pour la jeunesse en constitue d’évidence un support privilégié dans la mesure où il est nécessairement polyphonique, la relation entre l’image et le texte ne pouvant être que plus ou moins redondante ou collaborative.
8Catherine Tauveron accorde ainsi une place centrale, dans son article fondateur, à une série très séduisante de commentaires sur l’album Petit Lapin rouge et sur sa conclusion. Cet album de Rascal et Claude K. Dubois (1999) raconte l’histoire d’un petit lapin devenu rouge fortuitement, et de sa rencontre avec le célèbre Chaperon de Perrault. L’un et l’autre décident de modifier le cours de leur histoire, vouée pour l’un à la rencontre de chasseurs, pour l’autre à celle du loup. L’album se termine cependant devant une nappe de pique-nique avec la proposition ambigüe de la fillette : « Eh bien mangeons, mon lapin… J’ai une faim de loup. » Le titre considéré convient à merveille à la définition proposée du littéraire : l’ambigüité de sa chute ouvre un champ de possibles dont le lecteur est invité à s’emparer ; le jeu est partout, entre le texte et ses hypertextes, entre le texte et l’image, entre le sens dénoté (une faim de loup) et ses possibles connotations.
Nous considérons, avec d’autres, que la lecture littéraire est une activité de résolution de problèmes, problèmes que le texte pose de lui-même ou que le lecteur construit dans sa lecture. (Tauveron, 1999, p. 17)
9D’autres albums, au cours de la même période, seront fréquemment sollicités par l’école au point de devenir à leur tour des classiques, tous pour la même raison : la disjonction entre le texte et l’image, l’incomplétude du texte, la polyphonie énonciative suscitent une complexité qui ne peut être tranchée ou qui doit l’être au prix d’un pari interprétatif, lequel nécessite une grande maturité de lecture. Un article de Graziella Deleuze qualifie en 2014 de « postmodernes » ces albums – qui ont désormais la faveur de nombreux enseignants – moins pour des raisons de chronologie (un « deuxième âge » de l’album) que pour des raisons formelles et d’audace narrative5.
10Des auteurs comme Philippe Corentin, constamment ironique, Anthony Browne – Une Histoire à quatre voix (1998) sera bientôt d’une lecture aussi obligatoire que jadis La Chèvre de Monsieur Seguin et Les Contes du Chat perché –, Rascal bien sûr – presque toujours aussi malicieux et elliptique que dans Poussin noir (1997) constituent un nouveau Panthéon pour les enseignants des écoles maternelles et élémentaires : on ne compte plus les propositions pédagogiques pour en faciliter la lecture en classe sur une ou plusieurs séances, isolément ou associée à un « réseau » d’œuvres thématiquement, ou, mieux, formellement voisines. Pour ma part, j’ai souvent signalé d’autres albums assez équivalents à l’attention des enseignants ou des futurs enseignants.
11Pou-poule (Loufane, 2002) est a priori une réécriture de La Chèvre de Monsieur Seguin, qui voit – après plusieurs pages de poursuite très angoissantes – la poule et le renard convoler de façon à la fois improbable et amusante : un arrêt sur image avant la dernière illustration permet de faire des hypothèses et de rendre très manifeste l’effet de surprise et le jeu de l’auteur avec son jeune public. Jojo la Mâche d’Olivier Douzou (1993) raconte, une double page après l’autre, la disparition d’une « mâche » (vache) dont l’apparence se dilue fragment par fragment (l’illustration minimaliste le permet) aux quatre coins de la page, et dont les parties du corps en papier découpé finissent par illuminer une nuit étoilée. Pour de jeunes lecteurs, la métaphore de la mort de l’être cher est loin d’être évidente : reste l’énigme (à déchiffrer) d’une histoire assez abstraite qui ne se livre pas aussi facilement, bien qu’elle s’adresse au même public, que, par exemple, Petit Ours brun a trouvé un oiseau mort (Aubinais et al., 2022).
12Les éditions du Rouergue présentent ainsi Le Drame (2000), de Claire Franek :
Ça commence par un accident. Et puis, tût-tût, pin-pon, vrrr… ça s’enchaîne et ça n’arrête plus : embouteillage, travaux, inondations, animaux qui s’échappent, tour qui s’écroule, etc. Une escalade d’événements et de catastrophes… pour jouer.
13Pour jouer en effet, puisqu’un cadrage plus large montre finalement que ce que nous avions pris pour un enchainement réaliste (et dramatique) d’événements (le titre nous y invitait), n’était en fait qu’un jeu entre deux enfants : jeu de maquettes, de simulacres miniatures (personnages, animaux, automobiles, constructions), dont l’effondrement nécessaire n’est en rien un « drame ». Ici encore, l’effet de surprise montre une volonté de jeu avec le lecteur passant par la déréalisation du monde représenté. Ici encore, un arrêt sur image avant la fin permet de montrer la distance entre les attentes créées par l’autrice et sa malicieuse conclusion.
Un album « postmoderne » ?
14Qu’il s’agisse de « pièges » (aussitôt déjoués) offerts à l’intérêt des jeunes lecteurs ou de significations rendues énigmatiques par des ellipses, narrations croisées ou démultiplication des points de vue, les albums considérés ont en commun d’inviter le lecteur à entrer dans une activité à dimension stratégique et métalittéraire. Faut-il y voir les prémices d’un genre ou seulement la marque d’une école et d’une période ? On peut noter que ce travail sur les codes n’avait pas toujours été dans les intentions des auteurs pour la jeunesse (ainsi les innovations des albums du Père Castor, pour la plupart inspirées par les avant-gardes russes, ne visent pas à déstabiliser le lecteur). Il est particulièrement clair que les auteurs et autrices d’albums « résistants » comme leurs commentateurs et commentatrices des années 1990 ont été formés ou ont été influencés par les théories poétiques et narratives élaborées au cours des années 1970.
15On peut en identifier les manifestations suivantes :
-
La pauvreté signalée des matériaux (rusticité du trait, collage, photomontage) dans des œuvres comme celles de Bruno Heitz, Christian Voltz, Lionel Le Néouanic ou de précurseurs comme Leo Lionni, est caractéristique de formes esthétiques ou narratives qui renseignent le lecteur sur leur élaboration, ce que Jean Ricardou nommait le « récit dégénéré » dans Le Nouveau roman ([1973] 1990, p. 70). Dans ce cas, le matériau (paille, papier découpé ou fil de fer) et le procédé représentatif sont au moins aussi visibles que l’objet représenté.
-
Les jeux sur le signifiant sont une autre façon de manifester l’autotélisme de la représentation. Le parasitage du narratif par le poétique, l’autoreprésentation grâce à de multiples jeux de miroirs (chez Nadja, chez Corentin, etc.), les récits enchâssés, la scénarisation de figures de créateurs/artistes/auteurs sont une constante de la production pour la jeunesse et un procédé caractéristique de l’avant-garde identifiée sous le nom de « nouveau roman », de ce que Jean Ricardou encore appelait le récit « abymé » ([1973] 1990, p. 70).
-
La confusion des genres. L’album-théâtre est un genre en voie de constitution, la forme album elle-même peut recouvrir des organisations textuelles et iconiques très dissemblables : poème singulier distendu au fil des pages à la mesure d’un livre, conte traditionnel illustré. Le documentaire fictif sur des objets réels et le documentaire réel sur des objets fictifs permettent de catalyser le jeu sur les difficultés liées à la réception d’ouvrages au statut incertain et à la distinction du vrai et du faux dans le monde réel. « L’ère du soupçon » (Sarraute, 1956) jeté sur les représentations atteint désormais aussi les lectures pour enfants.
-
Le « récit avarié » désigne, pour Jean Ricardou ([1973] 1990, p. 129), toutes les formes de jeu sur l’énonciation dans le recours à toutes les organisations possibles de la polyphonie : de l’ironie aux points de vue décalés, en passant par les narrations divergentes d’un même événement. Les multiples versions juxtaposées du Petit chaperon rouge ou de Boucle d’Or produisent sans doute un effet de réseau comparatif mais elles invitent aussi le lecteur enfant à construire un rapport complexe et défiant avec les discours.
-
L’inachèvement, caractéristique de « l’œuvre ouverte » chère au premier Umberto Eco (1962), se retrouve aussi bien dans le dessin ostensiblement imparfait que dans les subtilités d’une narration suspendue (aspects caractéristiques de l’œuvre de Rascal, qu’on songe à Petit Lapin rouge pour le récit interrompu ou à C’est l’Histoire d’un loup et d’un cochon (2000), pour le côté « ni fait ni à faire »).
Un moment dans l’histoire de l’enseignement de la lecture et de la littérature
16Plusieurs raisons ont donc guidé le processus de classicisation de certains ouvrages.
17Des raisons théoriques tout d’abord : les analystes comme les créateurs et créatrices appartiennent à une génération marquée par les renouvellements littéraires et théoriques du second xxe siècle et le structuralisme, toutes approches qui visent à valoriser la réflexivité, la distanciation et la forme.
18Des raisons stratégiques ensuite (plus ou moins conscientes sans doute) : il fallait montrer que les objets nouvellement introduits dans les écoles étaient au moins aussi pertinents, aussi sophistiqués que ceux qui s’en trouvaient retirés (faute de place) et qu’ils préparaient vraiment aux lectures adultes les plus exigeantes. Il fallait « légitimer » la littérature de jeunesse et en particulier la part de celle-ci qui s’ouvrait au langage des images en choisissant, dans la production de plus en plus étendue d’albums pour la jeunesse, ceux qui paraissaient offrir la meilleure garantie de complexité. Pour répondre à l’exigence d’ambition (voir Marc Soriano ci-dessus), il fallait se montrer aussi ambitieux, aussi exigeant que possible : si Catherine Tauveron signale qu’il ne s’agit pas d’évincer les « textes faciles », elle prend tout de même le soin de les qualifier de « collaborationnistes » pour mieux les opposer aux textes « résistants ». On ne saurait rêver ni d’une hiérarchisation plus explicite ni d’une disqualification plus vigoureuse.
19Des raisons didactiques enfin, puisque la résistance du texte offre une situation similaire à celle que les didacticiens des mathématiques promeuvent au cours de la même période : la situation de lecture devient une situation-problème qui invite à la réflexion, à la relecture attentive, à la confrontation du texte avec lui-même, à la mise en relation de ses parties pour échafauder des hypothèses de sens.
Mettre en œuvre, dès la petite section, des espaces culturels, […] c’est d’abord, ce qui est fondamental, permettre à l’enfant de se construire en tant que sujet de désir. C’est ensuite l’inscrire dans une première approche de la complexité. (Devanne, 1992, p. 16)
20Bernard Devanne, dont les travaux précurseurs datent précisément du début des années 1990, définit ainsi très clairement les deux temps de cette ouverture à l’album dès l’école maternelle. Premièrement, il faut une bibliothèque de référence dès les premiers apprentissages, parce que l’entrée dans l’écrit n’est pas seulement l’acquisition d’une technique mais une acculturation ; il faut que les enfants fréquentent les livres, texte et image, avant de savoir lire. Mais il faut aussi que cette découverte soit celle de la complexité :
Ce faisant, c’est rompre de façon radicale avec les pratiques les plus répandues : sous couvert d’une meilleure accessibilité aux petits enfants, on privilégie le simple, le rudimentaire, le tronqué, le faux. Ayons le courage de le dire : l’échec scolaire n’est pas sans rapport avec les pratiques systématiques de l’« accessible aux petits enfants », par lesquelles, soumis à une progression du simple au complexe, chacun est ballotté de petite comptine en petit exercice graphique, de petit jeu de repérage en petit puzzle… (Devanne, 1992, p. 16)
21Ici, c’est la répétition de petit qui assure la stigmatisation des ouvrages d’ambition plus modeste.
22On peut évidemment se demander aujourd’hui si cette attention à la complexité devait être la compagne nécessaire de la prise en compte des enjeux spécifiques de la formation à la littérature, de l’école maternelle à l’école élémentaire – et si les situations et les ouvrages complexes promus (à juste titre) n’excluaient pas un autre rapport à la littérature et à la culture que pouvaient favoriser différemment d’autres types d’albums. Dès la fin des années 1990, des critiques s’élèvent contre une position théorique qui valorise autant les vertus de textes réputés « difficiles ». Francis Marcoin craint la prééminence de cette « démarche intellectualisante » : « Le jeu sur la narration ne finit-il pas par devenir scolastique ? » (2004, p. 5) ; en analysant une première réception d’Une histoire à quatre voix, album très connu et très lu pour son jeu évident sur la polyphonie narrative, Anne Leclaire-Halté (2006) montre des élèves de CM1 prioritairement focalisés sur les aspects formels « déroutants » de l’objet, passant à côté de sa compréhension globale et de la critique sociale à laquelle elle conduit. Elle constate le peu d’implication subjective de ces élèves et leur retrait devant les différentes interrogations morales et sociales que l’album invite à construire ; après avoir exprimé ses réserves sur les « ouvrages favorisant une approche esthétique plutôt que des textes favorisant l’identification », elle conclut en se demandant si ces textes ne font pas courir à certains élèves le risque de « décrocher » de la lecture.
23Pour ma part, sans jamais remettre en cause l’intérêt didactique des textes résistants à l’école, j’ai montré (Quet, 2010) que la présentation à des groupes d’élèves de grande section de l’album Le Drame évoqué plus haut ne suscitait pas nécessairement la participation au jeu souhaité par l’autrice et que l’adhésion à une lecture réaliste pouvait perdurer malgré la découverte des dernières pages ; une autre enquête indiquait qu’une lecture scolaire approfondie du consacré et ambitieux Otto. Autobiographie d’un ours en peluche de Tomi Ungerer (1999) ne laissait la plupart du temps, à un an d’intervalle, que le souvenir d’une histoire de nounours abandonné, sans aucune trace de la lecture historicisante et mémorielle pourtant mise en relief un an auparavant par l’enseignante (Quet, 2007).
24Christophe Joigneaux, dans une passionnante note de synthèse sur la construction d’une « littératie précoce », relève l’intérêt de la fréquentation des « petits livres » et pointe le danger de la scolarisation d’albums très ou trop complexes :
Il apparaît ainsi que la lecture répétée à des enfants de classes populaires ou moyennes de « petits livres », caractérisés par leur simplicité (commodité d’usage en raison de leur format réduit ; textes répétitifs composés de mots relativement familiers ; images destinées seulement à illustrer le texte), serait particulièrement propice au développement de la connaissance des correspondances entre graphies et phonies et de la reconnaissance de mots (McCormick & Mason, 1986). Même les compétences liées à la compréhension (inférence des relations de causes et de conséquences, anticipations d’éléments narratifs…) pourraient elles aussi être considérablement développées chez des enfants de quatre ou cinq ans de milieux populaires par des relectures fréquentes d’albums relativement simples (au sens de ce qui vient d’être précisé) (Elster & Walker, 1992). Inversement, le décalage entre le degré de complexité des albums donnés à lire à l’école et celui des dispositions à les comprendre se traduirait par un dégoût durable pour la lecture en général (Allington, 1984 ; Oka & Paris, 1987)6. (Joigneaux, 2013, § 46).
25Alors que de nombreux jeunes lecteurs ont découvert la lecture à travers des séries décriées par l’ensemble des prescripteurs (bibliothécaires, enseignants, institutions), on peut se demander ce qui a bien pu les toucher dans ces lectures illégitimes et ce qu’ils y ont gagné.
26« Si une histoire de la littérature, et notamment de la littérature de jeunesse, pouvait et même devait encore à la fin du xxe siècle éviter de s’intéresser aux productions de masse, ce n’est plus le cas aujourd’hui », écrit Anne-Marie Mercier-Faivre dans l’introduction d’un ouvrage sur la série romanesque des « Six Compagnons » de Paul-Jacques Bonzon (Quet, Mercier-Faivre, 2022, p. 13). Ce qui est vrai des séries pour adolescents doit l’être aussi de la production pour la jeunesse dans son ensemble ; le « désordre dans la lecture », loin de devoir nécessairement déstabiliser les enseignants, apparait apte en effet à stimuler des approches variées, dont la richesse n’est pas tant dans la célébration d’un corpus limité et prestigieux que dans l’infinie variété des rencontres possibles. Petit Ours Brun se brosse les dents (Aubinais, 2008) – déclinaison récente d’un incontestable classique de la littérature adressée aux tout petits créé par Danièle Bour – et N’oublie pas de te laver les dents (Corentin, 2009) – album humoristique et dialectique également récent de Philippe Corentin – peuvent se croiser dans la salle de bains, et l’âne Trotro peut tranquillement continuer son chemin de la maison à la classe.