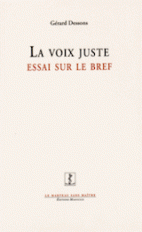
Penser le bref
1Gérard Dessons propose dans La Voix juste une réflexion sur cette « catégorie majeure de la modernité critique » (p. 11) qu’est la brièveté, qu’il préfère appeler pour sa part « le bref », en nominalisant l’adjectif. La perspective adoptée est très large, dans l’espace comme dans le temps, et l’on ne peut qu’être impressionné de l’aisance avec laquelle G. Dessons passe de Platon à Poe ou de La Fontaine à Mallarmé ; il considère que « l’histoire du bref […] est faite de moments différents » (p. 134) et s’interroge ponctuellement sur les étapes qui lui semblent les plus décisives dans cette histoire. Le titre du livre s’explique par l’idée selon laquelle « poétiquement, le bref d’un texte se confond avec le sentiment de sa justesse », produisant ainsi une « impression de convenance absolue » (p. 126). Nous ne ferons ici qu’examiner ce qui est dit des pratiques des moralistes classiques, seule question qui nous soit familière. Mais on aura compris que ce n’est qu’un aspect de l’ouvrage, parmi beaucoup d’autres : concrètement, Baudelaire y est plus présent que La Rochefoucauld.
Critique de la critique
2L’idée directrice de l’ouvrage est que « le bref n’est pas le court » (p. 43), ou encore que « le bref […] ne peut s’appréhender qu’en dehors de toute approche dimensionnelle » (p. 139). Cette idée, peu contestable, recoupe étroitement les vues respectives d’Alain Montandon1, Bernard Roukhomovsky2 ou les nôtres3. On peut s’étonner, dans ces conditions, que G. Dessons présente comme innovante ou paradoxale une thèse finalement consensuelle.
3Cela tient apparemment à un certain manque d’information, qu’explique sans doute l’ampleur vertigineuse de l’enquête, mais qu’il est permis de regretter pour un domaine de recherche somme toute spécialisé. Il est surprenant de conduire une réflexion sur la brièveté sans jamais alléguer, pas même en bibliographie, les travaux pourtant incontournables de Louis Van Delft4, Françoise Jaouën5 ou Marc Escola6. Et G. Dessons peut sembler imprudent d’étudier le genre de la maxime sans jamais se référer aux apports majeurs de Corrado Rosso7, Maria Teresa Biason8 ou Charlotte Schapira9. Des lectures plus nourries eussent clarifié certains points : par exemple, le jugement très sévère de Vigny sur le genre des maximes, cité p. 76, n’est qu’une des innombrables pièces d’un « procès » constamment instruit au fil des siècles, dont C. Rosso a retracé les grandes lignes10.
4Le ton adopté par l’auteur peut parfois surprendre par sa virulence. G. Dessons n’hésite pas à écrire que la notion de forme brève « s’est imposée comme une catégorie évidente, employée généralement en dehors de toute discussion, l’importance pour l’analyse résidant plutôt dans la légitimité apriorique de l’étiquette » (p. 26), ou que la vulgate critique promeut « la confusion entre l’idée de bref et l’idée de court » et véhicule « une déshistoricisation des discours » (p. 27), en somme se caractérise par son « simplisme » (p. 25). Le discours critique n’est pourtant pas aussi candide que ne l’imagine G. Dessons. La vérité est que la légitimité de cette « catégorie finalement peu questionnée » (p. 31) qu’est prétendument la « forme brève » n’a jamais été pleinement admise ; en particulier, on discute régulièrement l’application de la notion aux productions des moralistes classiques11. G. Dessons est donc fondé à la critiquer, mais nous croyons qu’il ne parvient pas à trouver le bon angle pour le faire. Il fallait souligner l’anachronisme objectif que constitue l’expression, en tout cas pour les productions du xviie siècle, et s’adosser au métalangage classique pour raisonner plutôt en termes de « pièces détachées » : la formule se trouve notamment sous la plume de Vaugelas, de Colletet, de La Bruyère… Elle est par exemple commentée par Louis Van Delft12. Elle implique que là où nous avons tendance à souligner la concision, les mentalités classiques insistent davantage sur la coupure ou l’absence de liens entre les unités textuelles. C’est l’isolement qui constitue la maxime.
5G. Dessons prend par ailleurs la curieuse initiative d’appeler « brèves de salon » (p. 74) les maximes mondaines, par analogie avec nos « brèves de comptoir » contemporaines. Le but déclaré de l’auteur est de dénoncer la « superficialité du regard » qu’il croit observer dans le discours critique, au moyen d’un « anachronisme » explicitement présenté comme tel (ibid.). Mais le raisonnement semble peu cohérent puisqu’il admet, dans le même temps, qu’il est seul à s’exprimer de la sorte : « l’expression “brèves de salon” […] n’est évidemment pas attestée » (ibid.). On voit mal en quoi une innovation individuelle serait apte à dénoncer une pratique collective.
Dire & ne pas dire
6G. Dessons est inévitablement conduit à la question, capitale dans les discours du xviie siècle, de ce que nous avons appelé l’« économie sémiotique13 », qui consiste à associer « plus de sens et moins de mots » (p. 85). Mais nous pensons qu’il va trop vite quand il croit y reconnaître le principe de la litote : « la définition de la litote comme manière d’écrire par laquelle on dit beaucoup en peu de mots » (p.90). La litote n’est pas affaire de nombre de mots, mais de signifié lexical ; il n’est pas plus court de dire « ce n’est pas mauvais » que « c’est bon ». L’auteur estime de toute façon que « dans la question du bref, l’enjeu n’est pas de dire plus, mais de dire autrement » (p. 91) ; mais il cite à la p. 135 la maxime 142 de La Rochefoucauld, qui dit précisément le contraire : « c’est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses ». Il semble alors que G. Dessons pousse trop loin le rejet du quantitatif qui anime toute sa réflexion, au point d’estomper le paradoxe qui fait pourtant tout l’intérêt des discours classiques et que commente, par exemple, Will Grayburn Moore14. Il admet par ailleurs que « le silence est encore du langage » (p. 17), ce qui est indéniable mais semble contradictoire avec le refus d’un surplus de sens.
7On peut penser que l’auteur fait fausse route quand il explique, dans un premier temps, que « la maxime, l’apophtegme, la pensée se constituent dans l’émission » (p. 71). Mais il semble mieux comprendre les choses quand il ajoute que « le succès des maximes, pensées et autres épigrammes tient beaucoup au fait qu’elles requièrent l’activité du lecteur ainsi placé en situation de co‑énonciation » (p. 77). Pour bien poser le problème, il fallait partir du célèbre mot de Mme de Sablé écrivant à Mme de Schonberg qu’elle a « admirablement achevé la maxime15 ». Achever la maxime suppose qu’elle soit en elle‑même inachevée, c’est‑à‑dire en attente du lecteur, dont la pensée propre va en développer et en assumer le sens. C’est le dialogue de l’auteur et du lecteur, le contact de deux esprits, qui définit la maxime ; il s’agit d’un texte lacunaire et programmatique, qui esquisse ou suggère un raisonnement pour inviter le récepteur à aller plus loin, activement ; bien lire la maxime, c’est se l’approprier pleinement. La maxime applique en quelque sorte une règle de la conversation honnête que La Rochefoucauld énonce lui‑même : « Il y a de l’habileté à n’épuiser pas les sujets qu’on traite, et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et à dire16. » Jean Lafond a consacré de belles analyses à cette « esthétique de l’inachèvement volontaire » et à cette « collaboration nécessaire qu’exige de la part du lecteur la réflexion brève17 ». Bérengère Parmentier rappelle, de même, que « les pensées “détachées” sont supposées laisser place à la réflexion du lecteur18 », et Maria Teresa Biason confirme que « la maxime demande continuellement à l’activité spéculative du lecteur de compléter son sens19 ». C. Rosso souligne élégamment le rôle décisif de la rumination personnelle des maximes : « Après chaque maxime il faut s’arrêter, et lire le blanc, c’est‑à‑dire faire parler le silence20. » Stefano Genetti parle lui aussi de « blancs à lire21 ». G. Dessons en convient d’une certaine façon : « le bref, alors, fait penser » (p. 89). Robert Baschet notait déjà, en termes similaires : « Faire penser, voilà bien à quoi tendait le moraliste22. » Cela n’empêche pas G. Dessons d’ajouter, en se fondant sur une célèbre boutade de Breton : « rien n’est dit d’autre que ce qui est dit » (p. 133). Dans une maxime, autre chose est virtuellement dit que ce qui est matériellement dit, quelque chose d’imprévisible, d’inépuisable et d’indispensable : ce que le récepteur va en tirer par lui‑même, avec ses lumières propres. La maxime est à dire autant qu’elle est dite. Deux lecteurs différents ne liront donc jamais la même maxime. C’est un genre constitutivement mouvant, qui repose en somme sur une réécriture permanente et infiniment diversifiée.
***
8Cet essai comporte bon nombre d’idées intéressantes et devrait faire date dans les études sur la brièveté. Gérard Dessons montre par exemple de façon probante que le présent employé dans les proverbes repose sur « la fusion de deux valeurs d’emploi », puisqu’il apparaît d’une part comme « le temps des vérités éternelles et immuables », mais d’autre part « actualise cette éternité […] dans le temps empirique de l’énonciation » (p. 42). On trouve aussi dans La Voix juste de belles pages sur les différences majeures entre le proverbe et la maxime : au plan social, « la maxime classe et le proverbe déclasse » (p. 37), et au plan énonciatif, « je peux toujours rapporter une maxime à un auteur », alors que le proverbe se présente comme un « discours anonyme » (p. 41). G. Dessons propose par ailleurs des arguments neufs et précis, d’ordre lexicologique, pour souligner la différence entre « le bref » et « le court » : il observe finement que « contrairement à court, bref a une affinité forte pour le champ du langage » (p. 46), puis montre que les deux adjectifs divergent « en fonction de l’engagement ou du désengagement du locuteur par rapport au discours » (p. 49). Il rappelle aussi que « la parole vraie est une parole concise » (p. 59) et que « la vertu première du parler bref a été son rapport intime à la vérité » (p. 64), ce que confirment nettement les textes. Tout cela est fort bienvenu. Quant au style de G. Dessons, il est le plus souvent ferme et élégant, d’où un indéniable plaisir à la lecture.
9En somme, l’intérêt majeur de cet ouvrage est qu’il donne en permanence à penser, qu’il stimule efficacement la réflexion — fût‑ce sur le mode de la contestation. Un peu comme une maxime.

