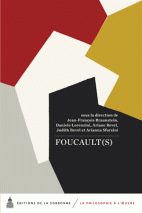
Sollicitations de M. Foucault
1Loin de vouloir répertorier les « usages canoniques » de Foucault, cet ouvrage collectif se propose de réfléchir à partir de Foucault. Dans le commentaire du texte de Kant Qu’est-ce que les Lumières ?1, Foucault déclare que « la tâche du philosophe est de diagnostiquer le présent ». François Hartog (p. 97) s’interroge sur le « présentisme » d’un philosophe plutôt attendu sur la question de l’espace (au motif que la structure est un concept éminemment spatial). Mais c’est bien du temps qu’il s’agit ici, problématique qui court dans les Dits et Écrits2. Face à l’incapacité des intellectuels à capter le « contemporain », souligne Foucault, il faut admettre que la crise est un perpétuel présent, et l’analyser comme tel. Or la sollicitation du présent suppose une « attitude » particulière, une relation spécifique à l’actualité, puisque diagnostiquer le présent signifie dégager un ethos philosophique (via une élaboration de soi-même). Le rapport « sagittal » à l’actualité prend donc la forme d’une autocritique rationnelle et questionne par là même le pouvoir de la vérité : « C’est dans la contingence de l’hic et nunc que les choses se jouent, c’est-à-dire que ce travail peut et doit s’engager » (p. 104). C’est pourquoi il n’existe pas de dogmatisme de la pensée chez Foucault, dont l’œuvre suscite un rapport non discipliné au savoir, autrement dit une pensée toujours en acte.
2Mais précisons que le rapport au temps se mesure aussi aux relations théoriques que Foucault entretient avec la discipline historique. Jean-François Braunstein (« De l’histoire des sciences à l’épistémologie historique », p. 61) montre sans ambiguïté que l’œuvre de Foucault est indissociable d’une pensée de l’histoire et de l’histoire des sciences en particulier. D’après J. Bouveresse3, le Foucault « américain » est encore attaché à l’idéal des sciences de l’Aufklärung, là oùle Foucault « français » estime nécessaire de se délester des notions d’objectivité et de vérité, invoquées par la tradition épistémologique. Si le premier enseignement de Foucault porte sur l’épistémologie des sciences de la vie, de la psychologie, de l’histoire, c’est le débat avec Canguilhem (1904‑1995) qui amène Foucault à introduire le concept d’« archéologie ». Foucault se réclame du médecin-philosophe dans sa conception de l’histoire des sciences, histoire comprise comme un ensemble à la fois « cohérent et transformable de modèles théoriques et d’instruments conceptuels » (p. 64). Cette conception de l’histoire des sciences fait l’objet de critiques acérées de la part des historiens « classiques », qui reprochent à Foucault de valoriser la théorie au détriment des faits. Foucault s’explique pourtant sur un certain nombre de distinctions : les champs du savoir relèvent soit de l’épistémographie (dimension descriptive des discours scientifiques), soit de l’épistémocritique (qui pense l’histoire des sciences en termes de vérité et d’erreur), soit de l’épistémologie (analyse des concepts scientifiques et de leurs applications). Foucault revendique pour sa part une certaine manière d’interroger l’histoire des sciences : il pose des questions philosophiques à l’histoire des savoirs, et emprunte à Bachelard (1884‑1962) l’idée d’une discontinuité de l’histoire des sciences. Comme le souligne Jean-François Braunstein (cf. supra), Foucault s’inspire de Canguilhem lorsqu’il identifie selon quel espace d’ordre s’est constitué le savoir, éliminant de ce fait toute visée téléologique. De surcroît — toujours à l’instar de Canguilhem — Foucault considère que l’histoire des sciences n’est pas étrangère à des préoccupations éthiques et politiques (le mathématicien Cavaillès est mort sous les balles des allemands en février 1944).
3Jacques Revel (« Michel Foucault, histoire et discontinuité », p. 83), insiste sur la discontinuité comme « opérateur historiographique », le discontinu constituant à la fois le donné et l’impensable : l’écriture de l’histoire des sciences se charge de le faire apparaître, la structure spatiale se révélant ici déterminante (le savoir s’articule sous la figure de la série et du tableau). L’auteur précise que Foucault entend finalement rompre avec le discours de l’histoire (y compris des sciences), et qu’il renouvelle la « vision » du temps historique qui lui est en général associée.
Une histoire du « contre-pouvoir »
4Le concept d’archéologie, bien entendu, est décisif : il rend manifestes les « socles épistémiques » déjà pointés dans Les Mots et les choses (et délaissés dans l’œuvre ultérieure), et provoque l’avènement de la « contre-histoire » voulue par Foucault. Bertrand Binoche (« La généalogie de la généalogie de la … », p. 91) décrypte la triple (sur)détermination contenue dans le concept d’archéologie : 1. réflexion sur la formation du savoir-historique comme savoir-pouvoir, 2.généalogie de la généalogie — ou encore interrogation sur le rapport des sciences au pouvoir4 —, 3. généalogie du racisme. Cette dernière acception est à l’origine du concept de biopouvoir, forme de « gouvernementalité » qui contrôle les corps dans l’espace social. Dans le séminaire Sécurité, territoire, population (leçon du 11 janvier 1978), le biopouvoir est défini comme « l’ensemble des mécanismes par lesquels ce qui constitue dans l’espèce humaine ses traits biologiques fondamentaux, va pouvoir entrer à l’intérieur d’une politique, d’une stratégie politique, d’une stratégie générale de pouvoir… ». À ce titre, la lutte des classes tend à s’effacer devant la « guerre des races », le racisme moderne ayant — selon Foucault — codifié biologiquement les racismes d’origine ethnique ou religieuse.
5Certains auteurs, pour ce motif, s’intéressent au « discours sur la race », et à la possibilité d’ouverture à une « contre-histoire ». Ann Laura Stoler (dans le texte « L’éclat de Foucault dans les études (post)coloniales. Trop “prêt-à-porter” ? », p. 107), rappelle que F. Fanon, S. Weil, J.-P. Sartre, A. Memmi, A. Césaire (parmi d’autres) ont déjà parlé des effets délétères de la colonisation, de la surveillance et de la violence infligées par l’Europe (aux colonisés comme aux colonisateurs). Mais, d’après Foucault, c’est le détournement du savoir qui fonctionne comme une arme brutale dans la gestion coloniale : les archives coloniales témoignent de ce rapport complexe entre savoir et pouvoir. La méthode foucaldienne permet in fine de repérer la déraison au cœur de la raison : l’imaginaire prend le pas sur le savoir, les enjeux de pouvoir s’incarnant dans la peur des Blancs, etc. Ce que nous apprend Foucault, c’est que seule une histoire « récursive » appréhende les débris de l’histoire coloniale, même s’ils sont difficiles à saisir. Les discours coloniaux n’ont jamais réussi à juguler ni maîtriser les « dispositions » des colons comme des colonisés, et faire l’histoire de la colonisation, c’est se heurter forcément au non-dit du discours, à l’indicible, exactement.
6Mais reste à savoir si le traitement foucaldien du racisme ne fait pas l’impasse sur le problème de l’impérialisme, et sur les travaux de Gramsci, par exemple. Orazio Irrera (« Racisme et colonialisme chez Michel Foucault », p. 126) rappelle qu’Edward Saïd (critique littéraire palestino-américain, 1935‑2003), s’il fut influencé par Foucault (en témoigne son ouvrage majeur, L’Orientalisme), conteste néanmoins certaines de ses analyses : le concept de discipline est insuffisant à rendre compte de la résistance au pouvoir. L’Inde est d’ailleurs un laboratoire « exemplaire » pour saisir la politique des gouvernés. Gayatri Spivak (théoricienne indienne de la littérature, née en 1942) remarque que les développements de Foucault dans l’Histoire de la sexualité ratent la dimension économique de la colonisation, tandis que Pierre Macherey5a mentionné l’intérêt de Foucault pour l’accumulation primitive du capital, en lien avec le pouvoir. L’ambiguïté demeure au motif que Foucault fait une place — dans Sécurité, territoire, population, cours du Collège de France de 1977-1978 — à la domination économique de la colonisation mais soutient par ailleurs que le phénomène colonial a surtout eu des répercussions sur les structures juridico-formelles de l’Occident lui-même. En bref, un colonialisme « interne » a accompagné les tentatives « externes » de colonisation : L’Histoire de la folie6ainsi que Surveiller et punir7font état de l’émergence de microcosmes disciplinaires, qui enclavent les individus « déviants » en les exilant vers les colonies. Cibler les vagabonds, les mendiants, les nomades, les délinquants, les prostituées etc. est l’impératif majeur pour une société qui, autrefois garante de la souveraineté, est devenue disciplinaire. Mais il faut préciser que la tendance à l’enfermement est d’origine religieuse, les dispositifs disciplinaires puisant dans les techniques claustrales et les exercices ascétiques pour s’exercer.
7D’après Sandro Mezzadra (« Foucault dans les études des frontières et des migrations », p. 141) Foucault ne se prononce pas sur le problème des frontières et migrations, mais ne cesse d’analyser les phénomènes d’exclusion et d’enfermement, à l’instar du philosophe italien G. Agamben, dans Homo sacer8. Il s’agit ici d’élucider l’inclusion dans la société d’un « corps étranger », en d’autres termes d’expliciter l’inclusion différentielle à l’œuvre dans la société(p. 143). De ce point de vue, tout ce qui touche aux notions de frontière, d’espace de tension(s), se révèle fondamental, et dévoile un certain type de pouvoir, celui qui s’emploie à « gérer » le capital humain dans ses migrations et déplacements. La mobilité des migrants, constate Foucault, n’est pas seulement le résultat du biopolitique ; elle traduit aussi une revendication de liberté de la part des migrants, et anticipe donc les luttes émancipatrices au sens de Marx.
8Christian Laval (« Foucault ou l’obligation de la liberté », p. 185) se propose précisément de relire Marx à partir de Foucault. Dans son cours sur la Naissance de la biopolitique (1978‑1979), Foucault met en évidence la façon dont la politique néolibérale « cible » les subjectivités. Il renverse même la doxa dominante en soutenant que le capitalisme, loin de démanteler les institutions et de déréguler les forces économiques, accomplit en fait un travail « constructif » : il engendre de nouvelles normes. Foucault s’éloigne ici de Marx, mais considère cependant avec Marx que « nous sommes les effets de nos pratiques », ainsi que les « produits de notre propre histoire » (p. 189). C’est dire que Foucault a pris très au sérieux l’idée de Marx sur l’auto-praxis des hommes dans l’histoire, et qu’il pense, avec Marx, que les luttes socio-politiques s’accompagnent d’une transformation de soi. Mais l’originalité de Foucault, d’après Christian Laval, est de répondre à la nécessité de transformer le monde en proposant des « contre-conduites » susceptibles de s’inscrire, envers et contre tout, dans des « pratiques du commun » (p. 191).
9Pascale Gillot (« Michel Foucault et le marxisme de Louis Althusser », p. 245) confirme que Foucault ne se reconnaît pas dans le marxisme. Dans le chapitre 8 des Mots et les choses, Foucault attaque avec virulence la lecture de Marx par Althusser, estimant que la notion de « coupure épistémologique » n’introduit en rien une discontinuité dans l’histoire. En bref, Foucault ne « croit » pas aux analyses antihumanistes d’Althusser, ni à sa critique de l’anthropologisme et de l’historicisme. Or, rappelons-le avec l’auteur, Althusser a pris ses distances envers l’homo œconomicus et l’homo psychologicus, et rejoint Foucault dans sa critique des sciences humaines9. Dans Lire le capital10, Althusser introduit le concept de causalité structurale, qui n’est pas sans parenté avec celui d’archéologie chez Foucault. Par ailleurs, le concept de surdétermination — théorisé par Althusser — rompt avec la philosophie de l’histoire hégélienne, également combattue par Foucault. Enfin, la théorie de l’idéologie, chez Althusser, est proche de la conception du pouvoir disciplinaire chez Foucault. Il est possible, en effet, de relier le processus de subjectivation à l’œuvre dans l’idéologie (Althusser) — comme processus incarnant autant une figure de la constitution subjective qu’une forme d’assujettissement — à celui présenté par Foucault dans nombre de ses textes. La fonction-sujet foucaldienne est à repérer dans le « dressage corporel » et dans l’assignation de « fou » infligés par le pouvoir psychiatrique, par exemple, comme dans le processus d’individualisation rendu possible par ces mêmes technologies de pouvoir. Les techniques normalisatrices engendrent une forme de « subjectivation » du corps, et participent de la reconnaissance de soi. On pourrait objecter que l’individu n’est pas le sujet et qu’une reconnaissance de soi obtenue par l’assujettissement ne doit plus rien à la liberté (voir à ce propos l’intervention de Judith Butler, infra).
10D’après Sandro Chignola (« L’alernative wéberienne. Sciences sociales, éthique et philosophie dans le dernier Foucault », p. 262, traduit par J. Revel et A. Sforzini), si Foucault s’intéresse aux sciences sociales, c’est que la philosophie peut se révéler impuissante à penser un réel « polémique », fait de tensions et de lignes de fragilité. Et c’est à la sociologie de Max Weber que l’auteur se réfère, pour faire droit à la politique de la philosophie déployée par Foucault, c’est-à-dire à une pratique philosophique « située », engageant une éthique du travail intellectuel. La philosophie conserve donc une puissance de subjectivation, et si sa parole est « politique », c’est parce qu’elle incarne le « courage de la vérité ». Dans un texte de 1982, Foucault soutient que la vérité devient praxis, éthique11, analyse qui n’est pas sans rappeler, selon l’auteur, la forme d’ascèse interne au monde, dans la réflexion de Weber. Daniele Lorenzini12 prolonge cette problématique (« La parrêsia et la force perlocutoire », p. 277) en insistant sur l’effet perlocutoire13 des énoncés, sur la parole en tant qu’action. Stanley Cavell, ici convoqué, parle à ce propos de « propositions éthiques », pures expressions du sentiment, et visant à susciter diverses réactions14. La vérité est à penser en « actes de langage », et pas uniquement en termes logiques (de vrai et de faux). Pour ces raisons, un énoncé parrèsiastique est indéterminé, et laisse à l’interlocuteur toute latitude pour répondre de telle ou telle manière. Il suppose une prise de risque de la part du locuteur — et l’on retrouve là le « courage de la vérité » — locuteur dont l’implication retentit nécessairement sur le récepteur. C’est pourquoi, conclut D. Lorenzini, il convient de redéfinir cette vérité comme un événement, et même, comme une « vérité-foudre » (p. 284).
Le pouvoir de la (des) norme (s)
11Si la question du pouvoir de la norme est au cœur des textes foucaldiens, elle donne lieu, néanmoins, à une certaine stratification sémantique. Selon Jean-François Kervégan (« Foucault, le droit, la norme », p. 171), Foucault a d’abord articulé norme et normalisation, mais ses derniers travaux s’emploient à circonscrire un nouveau type de « normativité » (contenue implicitement dans les dispositifs de pouvoir). La thèse de l’auteur est que Foucault « déprécie » le droit, ou, du moins, qu’il fait le lien entre libéralisme économique et « régression du juridique ». Nos sociétés sont soumises à des régulations normatives, et le droit, in fine, s’oppose à la norme. Les technologies disciplinaires — nées à la jonction des xviiie et xixe siècles — opèrent une césure avec le droit, mais aussi avec le paradigme économique. D’après Jean-François Kervégan, il devient impossible de penser la société à partir du droit, y compris du « droit naturel » : les droits de l’homme n’ont pas fondamentalement réduit la puissance du pouvoir disciplinaire. Paolo Napoli (« Au-delà de l’institution-personne », p. 177, traduit par A. Revel) examine également les développements de Foucault sur la relation entre souveraineté — pouvoir royal — et pensée juridique (théorie du contrat) dans les sociétés occidentales depuis le Moyen-Âge. L’idée de Foucault est que le droit est un instrument de domination, idée qui n’est d’ailleurs pas étrangère à Marx. Les théories du droit sont obsédées par le personnage du souverain, réaffirme Foucault, alors qu’il « faut couper la tête du roi » et forger un droit (paradoxalement) anti-disciplinaire. Au terme de son enquête, Foucault livre une critique de l’institution, personnification abstraite d’un centre de pouvoir capable de produire de nouvelles dynamiques normatives : « L’important, ce n’est donc pas les régularités institutionnelles, mais beaucoup plus les dispositions de pouvoir […], constitutifs à la fois de l’individu et de la communauté15 ». L’auteur conclut, dans la filiation de Maurice Hauriou16, que l’institution porte autant la marque de la « chose » (comme les règles de droit) que de la « personne », comme mouvement instituant de nouvelles catégories juridiques et de nouvelles normes sociales.
12Une autre série d’interventions (Cinquième partie « L’aveu, le corps, la sexualité », p. 194) reprend à nouveaux frais la pensée de Foucault sur le pouvoir de la norme. Philippe Sabot (« Sexualité, identité, vérité », p. 195) signale l’intérêt de Foucault pour Herculine Barbin dite Alexina, hermaphroditequi réactive tous les tentatives de la société pour « réguler » et « corriger » les anomalies sexuelles. Les normes médico-juridico-sociales fixent le « genre », mais le nouage entre sexualité, identité et vérité est-il aussi évident qu’il le paraît ? Quel est, stricto sensu, le « dire-vrai » de cette femme devenue tragiquement un homme à l’âge de vingt-et-un ans ? La difficulté à dire le vrai de son sexe, c’est que l’ambiguïté génitale est d’emblée considérée comme transgressive. D’après l’auteur, si le discours médical de l’époque traite l’hermaphrodisme comme une « monstruosité » morale, c’est parce qu’il est incapable d’établir scientifiquement la vérité anatomique de ce sexe « duplice ». De surcroît, c’est l’ensemble des inclinations sexuelles qui constitue le critère déterminant : Herculine/Abel est suspectée d’homosexualité, alors que l’indétermination visant sa propre identité sexuelle est à son comble. Assignée de force à un sexe qui ne peut se dire, le sujet voit son identité confisquée par un discours normatif, celui de l’ordre médico-juridique.
13Judith Butler soulève une problématique analogue, mais centrée sur la question de l’aveu (« Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice :le cas de l’aveu sexuel17 », p. 223).Dans le style fluide qui la caractérise, la philosophe américaine se demande comment des sujets « agents » peuvent être assujettis par le pouvoir de la norme, et se sentir liés par ce qui les aliène. C’est que, face à un pouvoir qui l’interpelle, le sujet ne perd pas totalement sa liberté d’action : l’aveu sexuel produit — au moment même où il est proféré — une sorte de contre-discours. Non seulement l’acte d’aveu (relatif à ses comportements sexuels « illicites ») ne dit rien, sur le fond,de son objet et de sa véridicité, mais il contient même une dénégation « inavouée ». En bref, il échappe en partie au pouvoir du système pénal : la loi ne peut pénétrer dans la sphère « qui va au-delà des termes de l’identité » (sexuelle), à savoir celle du désir et de son mode de subjectivation. L’identité sexuée peut se construire ailleurs que dans la norme.
14Michel Senellart (« Gouverner l’être-autre. La question du corps chrétien », p. 205) s’appuie sur Sécurité, territoire, population18pour soulever la question de la « verbalisation des fautes » (la pénitence). Si le christianisme apparaît comme « une religion de l’aveu », il n’épingle pas tant l’identité du chrétien qu’il ne contribue à l’effacer, l’efficace du pardon inclinant le sujet à renoncer à lui-même. Il faut donc voir dans le processus de subjectivation mis en œuvre, plus qu’une conquête de soi19, une « rupture d’identité » (p. 210). Si la « publication de soi » (publicatio sui) dans l’exomologèse20, par exemple, dramatise la pénitence — humiliation de soi, prosternation… — l’obligation de se manifester soi-même comporte une dimension ontologique : c’est l’être même du pécheur qui est en jeu, être promis à « mourir à la mort », c’est-à-dire à renaître. Que la pénitence fasse du christianisme une religion de « mort vivant » (les mots sont de Foucault) ne signifie pas, aux yeux de l’auteur, qu’elle soit indissociable d’un acte de foi et de la communio avec les autres qui l’accompagne. La sujétion provoquée par l’aveu témoigne encore de l’histoire de la subjectivité chrétienne.
—
15C’est par les textes figurant au début de l’ouvrage que l’on voudrait paradoxalement conclure. Dominique Lecourt (« Le sadisme de Michel Foucault », p. 37) nous présente en effet un Foucault inhabituel. En 1970, Foucault considère le marquis de Sade comme « le fondateur de la littérature moderne » (il a rédigé son œuvre en prison, poussé par une « nécessité intérieure »). Mais dans un retournement pointé par l’auteur, Foucault finit par déclarer la lecture de Sade ennuyeuse : le principe de « jouissance répétée » fait de Sade un « sergent du sexe21 », qui ne témoigne plus, in fine, de l’assimilation entre Kant et Sade, formulée par Lacan22. Dans Qu’est-ce que les Lumières ?, Foucault affirme même que l’athéisme du marquis est délesté de tout naturalisme, et que son matérialisme est sans rapport avec celui, par exemple, de La Mettrie. L’« érotisme en acte » de Sade est donc original, puisque la description de ce corps « fantasmé » confère du sens au sensible. Mais on pourrait rétorquer que le corps sadien n’a rien d’érotique, si l’on convient — avec Lacan — que la jouissance « machinique » mise en scène par Sade détourne du désir. En revanche, il est probable que le libertinage sadien abolit les frontières individuelles, ce qui permet à D. Lecourt de soutenir que Sade est aussi un écrivain de l’illimitation.
16Étienne Balibar, qui ouvre le recueil, s’attarde précisément sur M. Blanchot, écrivain du « ressassement éternel »et d’une « pensée du dehors » :une pensée dont l’objet est le dehorset une pensée venant du dehors. L’article d’Étienne Balibar est consacré à cette bivalence, et suggère que le « Je » mis hors de soi par le langage (exclu du discours, exproprié), institue une écriture comme expérience-limite et comme expérience de la limite. Un tel langage n’est ni dénotatif, ni référentiel, ni expressif, il est a-subjectif, la littérature creusant en elle-même un vide. Déporter le langage hors de soi confronte inéluctablement aux limites de la pensée et de l’écriture. La seule chose probante, c’est l’équivocité du concept d’extériorité : définir un « pur dehors » est toujours problématique, qu’il s’agisse d’une extériorité absolue — insaisissable — ou d’une limite intrinsèque à l’intériorité même (sur le modèle de l’enfermement). Foucault et Blanchot nous indiquent en fait que toute extériorité fait signe vers une zone-frontière — un nexus —qui noue inextricablement transgression, impensé, altérité. Dans l’Ordre du discours23, Foucault insiste sur la conflictualité incessante propre au langage, sur les procédures d’exclusion matérialisées dans certains types de discours. Gilles Deleuze et Georges Bataille ont aussi repéré l’autre du discours, la parole du sujet s’incluant, comme chez Foucault, dans des rapports de force invisibles, mais opérants. Le langage porte en lui sa propre étrangeté, l’extime est au cœur de l’intime, dirait Lacan.
17Arianna Sforzini, enfin (« Pouvoir risible, pouvoir du rire. Le grotesque et l’ubuesque selon Michel Foucault », p. 45), entame son intervention avec un texte cité par Foucault dans Les anormaux24. Il s’agit d’un rapport d’expertise médico-psychologique portant sur trois « prévenus », dans les années 1970. Le discours du médecin rapporteur nous fait littéralement rire, ce qui ne serait pas le cas, s’il était simplement moralisateur. Le plus drôle est l’emphase du discours, les experts psychiatres n’hésitant pas à considérer les homosexuels impliqués dans l’affaire (vol et chantage sexuel) comme de futurs habitants de Sodome et Gomorrhe (sic). La dimension grotesque de ce type de discours, et qui n’est pas sans rappeler certains passages du Médecin malgré lui de Molière (cité par Foucault), fait basculer la folie du côté de l’interprète, et rend le pouvoir « ubuesque ». Mais si la discipline et le pouvoir peuvent prendre le masque du ridicule, ils engendrent dans le même temps un contre-pouvoir : la parole du fou ne suscite-t-elle pas des possibilités carnavalesques de résistance, à l’instar du bouffon, dans les tragédies de Shakespeare ?

