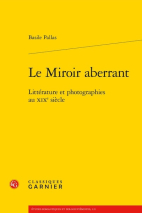
Rendre au photographique sa visibilité : pour un renouvellement esthétique de la photolittérature
1Si, pour définir l’image photographique, nous avions à choisir, selon le célèbre mot de Jean-Luc Godard, entre une image juste et juste une image, et que nous nous référions, pour ce faire, aux incunables et classiques de la littérature photographique, nous opterions alors, selon toute probabilité, pour la première définition. Parmi les ontologistes et les sémiologues de la photo, une doxa s’est établie : elle serait une image vraie, une restitution fidèle de la réalité, si fidèle que l’image s’efface. Un médium estompé. Une vitre, en somme. Un invisible qui n’informe pas, mais qui montre et qui dit vrai.
2Cette conception mythique de la photo comme technique de restitution fidèle de la réalité, qui existe depuis son invention en 1839, s’est constituée, tout au long du xixe siècle, en véritable lieu commun de la critique. Effet de l’impression de la lumière sur un support photosensible, le fonctionnement technique de la photographie – trop souvent méconnu de ses commentateurs qui, ce faisant, opèrent de nombreuses réductions simplificatrices – est au fondement de ses définitions embryonnaires. Phôtos-graphein, le dispositif d’impression entraîne rapidement ses productions dans une logique de l’empreinte : la photo, comme « écriture de la lumière », porterait la trace authentique du réel. Garantes d’authenticité, l’empreinte et la solarité sont au fondement du mythe de l’image-vraie : dans un article de 1862, Théophile Gautier écrit que la photo « ne saurait mentir, non plus que l’astre est son collaborateur » (1862, p. 35) ; « Solem qui dicere falsum audeat ? », se demande Victor Hugo ([1853], 1967, p. 1070), observant les calotypes de son fils. Comme un « miroir qui a gardé toutes ses empreintes », selon la formule de Jules Janin (1839, p. 147), la photographie ne pourrait pas ne pas être vraie. Œuvre du soleil, elle serait l’empreinte – quasi-magique – du réel.
3Couplée à cette idée d’empreinte, l’acheiropoïésis de l’image photographique (devons-nous rappeler ici l’anathème de l’antimoderne Baudelaire ? L’appareil évincerait l’artiste…) l’inscrirait dans un imaginaire de la révélation mystique, sinon de la vérité religieuse. L’évènement photographié laisse une trace sur un support, comme le visage du Christ a laissé la sienne sur le linge de Véronique. Vérité authentifiante de la trace et vérité quasi-métaphysique de la révélation : l’acheiropoïèsis, d’origine technique ou mystique, participe à cette conception de la photographie comme Vérité, pendant moderne de la Vera Ikona. Évincer la main humaine, c’est éviter la métamorphose des artistes poïétiques qui informent le réel ; évincer la main humaine, c’est aussi écarter les compromissions mensongères du péché, ses apparitions et ses fantasmes. Vérités technique et mystique donc, que celles de la photo. Image vraie dans tous les sens ? Devenue vraie à force de discours, de critiques, de réductions et métaphores qui, insérés dans une culture visuelle précise, ont forgé un mythe : celui de l’idée de photographie, pour le dire avec François Brunet (2000). À défaut d’une ontologie sérieuse, le xixe siècle a fondé l’idée-topos d’une image vraie. L’imaginaire d’une image juste.
4Au xxe siècle, ce mythe trouverait sa théorisation, et les idées d’empreinte et de fidélité, leur concept solide : l’indice et l’icône. Autour des années 1980, les ontologies de l’image photographique, en redéployant le mythe de l’image-vérité à partir d’une sémiologie non-logocentrique (ou néo-peircienne), lui confèrent une légitimité nouvelle. Sous l’impulsion d’une démarche essentialiste, l’indice, qui suppose une contiguïté physique avec son réfèrent, et l’icône, qui implique une similarité qualitative ou une ressemblance, deviennent les traits définitoires du signe photographique. Rosalind Krauss dans Le Photographique (1990), Roland Barthes dans La Chambre claire (1980) ou Philippe Dubois dans L’Acte photographique (1990) ont chacun contribué à faire de l’indice – et, dans une moindre mesure, de l’icône – la caractéristique définitoire de l’image photographique. Comme trace authentifiante d’un réel passé, la photo trouverait sa valeur dans l’exactitude et la perfection1 du donné à voir. Sa prétendue non-médiatisation lui conférerait ainsi une puissance inédite d’attestation. C’est l’adage barthien : « Quoiqu’elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photographie est toujours invisible : ce n’est pas elle qu’on voit » (Barthes, 1980, p. 18). Le médium disparaissait derrière la suréminence d’une absolue référentialité. Invisible ou transparente, l’image s’était estompée : de Jules Janin à Roland Barthes, commentateurs, critiques et théoriciens auraient tué le médium. Ainsi, pour une certaine doxa, la photo était-elle devenue, selon les mots de Basile Pallas, « parfaitement invisible parmi les images, occultée par la réalité qu’elle capture » (p. 18‑19). Une simple capture du réel. Un équivalent de la vue. Une image si juste que l’image s’efface.
5Que faire, dès lors, des images truquées ? Des « défauts » sur la plaque de verre ou le papier salé ? Des espaces flous, tâches obscures et trous lumineux ? Des improbables déformations, courbures non souhaitées et quelques « effets disgracieux de l’aberration sphérique » (Quincarlet, 1854, p. 164) ? Que faire de toutes ces déformations, tous ces écarts –que Basile Pallas appelle « aberrations » – qui seraient, selon les mots de Marc-Antoine Gaudin, « originel[s] et inévitable[s] » (Gaudin, 1854, p. 133) ? Rien, si l’on s’inscrit dans l’imaginaire de l’image-vraie ; les aberrations, il ne peut que les ignorer. La définition de la photographie comme un calque exact du réel, comme image transparente, s’avère éminemment problématique lorsqu’elle est confrontée aux productions photographiques elles-mêmes. La restriction définitionnelle de la photographie l’enferme dans une catégorie de pensée incapable d’aborder correctement les photos existantes, où le médium se manifeste souvent, sinon toujours. En définissant la Photographie, la sémiologie s’est éloignée des photographies.
6En ce sens, dans un essai paru en 2006, le philosophe Clément Rosset, qui s’est intéressé aux trucages photographiques, s’érige contre la lecture barthésienne dont il dénonce « le caractère utopique de l’idée de photographie-vraie » : « Du caractère fantasmagorique des photographies truquées, il ne s’ensuit naturellement pas que toute photographie est trompeuse, mais seulement qu’il n’est aucune photographie dont il est possible de garantir l’authenticité » (Rosset, 2006, p. 31). Il s’agit, selon Rosset, d’inverser les rapports : lorsqu’on s’intéresse à la photographie, comme image existante, et non comme concept théorique, sa valeur esthétique doit primer sur sa valeur de vérité. En s’attardant sur les phénomènes d’aberrations – qu’il définit comme « remise en cause de la transparence de l’image et de l’invisibilité de la photographie, ou plus précisément, de l’invisibilité du photographique au sein de la photographie » (p. 29-30) – Basile Pallas entend suivre ce chemin, celui d’une approche esthétique de la photographie en littérature. Ou plutôt, il entend révéler cette approche, suivant l’hypothèse suivante : la littérature serait le révélateur des aberrations.
La littérature comme révélateur des aberrations
7Cette attention portée au phénomène de l’aberration – ou à « l’ensemble des symptômes de la distance que la chose photographiée entretient avec son référent » (p. 29) – se situe au croisement d’une triple démarche. Il s’agit premièrement d’accorder une importance particulière à la praxis photographique, aux processus d’élaboration d’une image artefactuelle et, surtout, aux incessantes corrections que son développement suscite : derrière la transparence de l’image se cache une multitude d’opérations qui révèlent, de ce fait, sa facticité. En second lieu, l’aberration renvoie aux processus de déformations physiques – tâches, courbures, flou, etc. – qu’induisent les « aléas » de la technique photographique. Enfin, au-delà des questions matérielles du médium, l’aberration peut agir au niveau phénoménologique : lorsqu’une image photographique impose quelque anamorphose, sa puissance de révélation provoque la déstabilisation de la synthèse du voir ; l’aberration opère ainsi au niveau perceptif d’une conscience qui dé-forme l’image.
8Cette triple dimension de l’aberration – praxéologique, physique et phénoménologique – nécessite une approche tout à la fois générale et singulière de l’image photographique, de la production à la réception, et du regard à la vue. Le Miroir aberrant répond à cette double exigence : naviguant dans un vaste corpus, qui couvre une large période (de 1839 à la fin du long siècle), Basile Pallas sait rester proche des textes, dont il capte – à la faveur de méticuleuses microlectures – la singularité. Partant d’un nombre considérable d’œuvres, indépendamment des genres et courants littéraires, Le Miroir aberrant s’inscrit dans « l’approche diagonale » préconisée par Jean-Pierre Montier (2015, p. 16) : d’une part, l’étude, qui n’est pas strictement littéraire, ne cesse d’enrichir son objet d’une ouverture constante aux discours critiques et techniques ; d’autre part, elle ne se restreint pas aux seuls « classiques » de la photolittérature, mais propose d’explorer, en lecture fine, nombre de textes peu connus, contribuant ainsi à l’élargissement bénéfique de son répertoire. Refusant toute progression chronologique, puisque l’histoire de la réception photographique diffère largement de son historicité technique, Basile Pallas structure son développement en suivant la typologie des aberrations possibles.
9En ce sens, la première partie de l’ouvrage (p. 55‑140) s’attaque au rapprochement, courant dès les années 1850, entre réalisme littéraire et photographie. (Ré)ouvrant l’épineuse question des rapports entre mimèsis et représentation, l’auteur du Miroir aberrant montre que le parallèle entre réalisme littéraire et photographie ne peut se résumer à la question de la transparence, puisque la photographie a parfois servi de repoussoir au discours réaliste. Pour nombre de littérateurs, peindre ou écrire à la manière de la photo, ce serait, justement, empêcher le réalisme. Ainsi Gautier, pour accuser le non-réalisme de Courbet, compare-t-il ses œuvres « au laid du daguerréotype » (1851, p. 1) : son exaltation du détail, comme une profusion de réel, serait une négation du réalisme, au profit d’une certaine esthétique de la laideur. Dans Les Nuits d’octobre – ouvrage dans lequel Nerval suggère que la littérature a cherché à « daguerréotyper la vérité » ([1852], 1993, p. 335) – la photographie, comme outil discursif, est sujette à d’intéressantes caractérisations. Certes, sa force de captation du réel est inouïe, mais elle est toujours prise dans un ensemble de conventions propices aux illusions du spectateur. Champfleury enfin, dans sa Légende du daguerréotype (1863), qui s’érige contre ce rapprochement topique entre photo et réalisme, accuse le caractère « exact » des photographies, insistant sur les manipulations illusionnistes des opérateurs. Bref, l’exactitude même de la photographie peut être le vecteur des aberrations possibles : c’est parfois la profusion des détails qui dé-forme le réel, toujours phénoménalisé par une conscience qui désire et discrimine. Réaliste, au sens d’une restitution de l’expérience phénoménale, la photographie ne l’est pas.
10Si la photographie transcende notre monde phénoménal, c’est qu’étrangement, elle révèle une part du réel. C’est qu’elle nous montre certains détails que, jusqu’alors, nous ne voyions pas. Photographier, c’est donc se rendre compte de la fragilité du « voir » et, ce faisant, du concept même de « réel ». Cette labilisation photographique du réel – et donc du percevoir – occupe Basile Pallas dans la deuxième partie de son ouvrage (p. 141‑302). En commençant par évoquer Nadar et son projet de photographier l’ensemble des souterrains de Paris, il montre que l’intégration du photographique au paradigme de l’objectivité n’a pour conséquence que la désillusion du photographe (Nadar, 1889). Le réel ne saurait être capté ; sa puissance d’échappement est, au contraire, réactivée. Poursuivant par une lecture comparée de L’Homme des foules de Poe ([1840], 1951) et Lettre d’un fou de Maupassant ([1885], 1974), Basile Pallas étudie les menaces qui planent sur un personnage-observateur qui veut percevoir le réel à la manière de la photo : le sujet regardant tombe alors dans une confusion généralisée, assistant à la déstructuration de son être-au-monde. Dans cette perspective, c’est sur les rapports entre photo et hallucination que Basile Pallas clôt sa seconde partie, à la faveur d’une lecture étroite de L’Animale de Rachilde (1893). La photographie, qui n’est plus comprise comme une puissance d’attestation, apparaît ainsi comme « un agent de déréalisation du monde » (p. 302).
11Ainsi la photo impose-t-elle quelque confusion : le réel et son image se confondent. Si le monde, tel qu’il est perçu, perd de son objectivité, celle-ci impose l’éclatement du concept même de représentation. Son image serait si vraie, si ressemblante, qu’elle entrerait véritablement dans le réel, au risque de quelque substitution. Et cette ressemblance excessive inquiète. Dans le déni de sa nature même d’image, la photo peut exercer une fascination qui fait croire à sa réalité, sinon à sa vie. En ce sens, dans la troisième partie de son ouvrage (p. 303‑469), Basile Pallas s’attache d’abord à l’étude des textes qui, invitant à la prise de conscience de la nature artificielle des images photographique, dénoncent une telle fascination : à partir du « Portrait ovale » de Poe ([1842], 1951) ou de La Curée de Zola (1871), il démontre que la littérature peut inciter à se départir de la fascination et proposer quelques moyens de se déprendre des images. Dans cette continuité, et pour penser la question du corps dans (de) la photographie, l’auteur propose une lecture sculpturale du photographique : voir en une photographie une sculpture s’inscrit dans une dynamique du désir qui redéploie la question de l’image vivante. Le devenir-sculptural de la photographie s’oppose ainsi à l’invisibilité fondamentale dont parlait Barthes ; l’image vivante vaut souvent comme un remplacement radical du référent (pensons, par exemple, à l’Andréide de L’Ève future, et son rapport iconique à l’insuffisante Alicia Clary). Bref, la fascination appelle le simulacre, qui s’oppose à l’image-vraie. La seconde atteste le réel, le premier le remplace.
12À l’image vivante, qui invoque une disparition déictique du médium, s’opposent la matérialité des images, leur support et leur objectalité. C’est sur ce point que se concentre la quatrième et dernière partie du Miroir aberrant (p. 471‑568). Dans un premier temps, dans quelques ouvrages illustrés, guides touristiques ou récits de voyage, Basile Pallas étudie la manière dont les textes mobilisent la « matérialité » des illustrations photographiques qui les accompagnent, soit qu’ils nient leur médiocre qualité, soit qu’ils l’évoquent directement pour « reprendre le pas sur la description ». Dans un second temps, il s’intéresse aux textes qui font de la matérialité photographique (médiumnique ou technique) un point central de leur intrigue, tantôt métaphoriquement, comme chez Villers de l’Ilse-Adam (1886) tantôt littéralement, comme dans « Le portrait » de Gustave Geffroy (1894), où la disparition matérielle d’un daguerréotype, dont l’image s’efface peu à peu au profit de quelque résidus chimiques, constitue le point nodal du récit.
13Dans cette version remaniée de sa thèse de doctorat, défendue en 2017 sous la direction de Pierre Laforgue, Basile Pallas tire les conclusions théoriques de l’aberration photographique au croisement de l’histoire littéraire, culturelle et critique. Ainsi révèle-t-il, au sein d’une construction interprétative complexe, un pan (trop) méconnu des transactions photo-littéraires : certes, comme l’a montré Jérôme Thélot, les écrivains du long siècle ont largement contribué à l’élaboration du mythe de l’image juste – si bien que l’idée de la photographie serait, avant tout, une « invention littéraire » (Thélot, 2003, p. 1). Mais ces littérateurs ont aussi su prendre le contrepied de cette idéalisation photographique. D’une attention portée au médium à tous les symptômes de quelque « irréalisme », il existe une pensée littéraire de l’aberration photographique, de la photographie comme une image, juste une image. Littéraire certes, mais pas seulement. Cette déréalisation de la photo, qui vaut comme une réitération de son imagéité, n’est pas thématisée qu’en littérature, mais opère à de multiples niveaux (peinture, sculpture, imagerie médicale, etc.), dans un réseau complexe d’interférences médiatiques que Le Miroir aberrant restitue avec audace et clarté. C’est son premier mérite. Son second mérite, sur lequel nous voulons nous attarder un peu, se situe au niveau de l’historiographie critique des rapports entre photographie et littérature. Le Miroir aberrant, en proposant une lecture esthétique de ces rapports, vaut comme un renouvellement de la critique photolittéraire et, nous le défendons, comme un dépassement salutaire de ses quelques apories potentielles.
Pour un renouvellement esthétique de la critique photolittéraire
14Depuis le milieu des années 1990, et le renouvellement post-logocentrique des études intermédiales, nombreux sont les critiques qui ont étudié les rapports entre photographie et littérature au xixe siècle. En 2002, Philippe Ortel, qui fait figure de pionnier dans le domaine, a publié une version remaniée de sa thèse sous le titre La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible. L’ouvrage entend démontrer à quel point l’image et la technique photographique ont exercé une influence – tout à la fois invisible et profonde – sur le champ littéraire, du romantisme à Proust. Partant du concept de « médium auto-raturant » formulé par Daniel Bougnoux (1991, p. 23), Philippe Ortel veut révéler la présence inconsciente de la technique photographique, omniprésente et raturée, dans les productions littéraires du xixe siècle. Dans cette lignée, le colloque « Littérature et Photographie » organisé en 2007 à Cerisy-la-Salle (Montier et al., 2008) et l’ouvrage collectif Transactions photolittéraires paru en 2015 aux presses universitaires de Rennes (Montier (dir.), 2015), entendent poursuivre cette approche, en l’élargissant à de plus larges corpus, et en tentant d’élaborer une méthode pour l’analyse de ces rapports photo-littéraires. Ces contributions – qui forment désormais les classiques de la « critique photolittéraire » – sont généralement portées à s’inscrire dans un cadre théorique précis.
15La tendance a été d’utiliser les concepts fondamentaux de la sémiologie, puisqu’elle considère le texte et l’image comme des systèmes de signes qui peuvent interférer entre eux. Sémiotiser la photographie, c’est la soumettre au modèle du langage, ce qui facilite, en conséquence, l’étude de ses rapports intermédiaux avec la littérature. En ce sens, Philippe Ortel considère la photographie comme « un outil de connaissance, un moyen de maîtrise, de surplomb à partir duquel on peut prendre connaissance des choses » (2002, p. 6). Or, comme le souligne Basile Pallas, « considérer l’image comme relevant d’une semiosis permet en outre de rendre compte d’une lecture de l’image qui a marqué le cours de son histoire et qui a contribué à forger sa définition comme image vraie, dont les valeurs étaient celles de la preuve, de l’attestation, c’est-à-dire des valeurs linguistiques » (p. 35). La critique photolittéraire, en s’inscrivant tendanciellement dans une démarche intersémiotique, réitère à sa façon le mythe de l’image vraie ; c’est évidemment fructueux, puisque cette valeur de vérité traverse l’histoire culturelle de la photographie, mais cette approche a aussi ses limites, puisqu’elle tend à ignorer la concrétude médiumnique du photographique au profit d’une idée, d’un concept, d’une métaphore, d’un mythe ou d’un imaginaire de la photographie.
16Bref, l’idée sémiotique d’une photographie indiciaire et invisible a pour conséquence une précarisation de son statut. Puisque, dans cette perspective, l’image-médium photographique n’existe presque pas, son appréhension théorique nécessite quelque détour, et ce, de sa réception primitive aux élaborations sémiologiques modernes : « [L]es usages discursifs de la photographie, dans les domaines intellectuels les plus variés, concourent à ne plus réfréner à la photographie elle-même, mais à son idée, c’est-à-dire à opérer une réduction comparable à celle qu’elle subira dans les théories modernes » (p. 44). Ainsi en va-t-il du concept même de « photolittérature » tel qu’il est défini par Jean-Pierre Montier :
Le concept de photolittérature désignera l’ensemble des conjonctions qui, des années 1840 à aujourd’hui, ont noué la production littéraire avec l’image photographique, les processus de fabrications spécifiques qui la caractérisent (sémiotiques, esthétiques, etc.) qu’elle infère. Il s’agit […] d’œuvres dans lesquelles le procédé et l’imaginaire qui est associé (l’exploitation de l’idée de révélation, la rhétorique de l’inversion en positif/négatif, ou noir/blanc, ou bien encore la décomposition de descriptions en équivalents d’instantanés, etc.) jouent un rôle structurant (2015, p. 20-21).
17L’invisibilisation du médium photographique – qui trouve son aboutissement dans la sémiologie barthienne – impose une approche métaphorique de ses influences intermédiatiques. Si la photo, à force de vérité, est devenue un quasi-équivalent de la vue, toute évocation littéraire de la vue ne porte-t-elle le spectre d’une photographicité possible ? Ainsi la photolittérature se trouve-t-elle parfois à déceler, dans les textes, les symptômes potentiels d’une photographicité diffuse, à défaut d’une attention portée aux évocations directes de l’image et, surtout, de la médiatisation photographique. L’étude des rapports entre littérature et photographie prend alors le risque – et ce n’est pas sans conséquence sur le plan épistémologique – de devenir une étude des rapports entre littérature et idée de la photographie, ce qui parfois, comme l’évoque très justement Basile Pallas, impose un dépassement du champ des photographies existantes.
18L’intégration de certaines œuvres à la photolittérature apparaît comme une classification a posteriori risquant de mettre en valeur ce qui n’est qu’un symptôme de réflexions plus générales, non centrées sur la photographie ou même sur la littérature elle-même, ni sur leurs relations, mais sur des problèmes ayant trait plus généralement à la représentation de la réalité, qu’elle soit photographique ou littéraire. De ce point de vue, lire des œuvres comme si elles relevaient de la photolittérature, chercher en elles les caractéristiques qui l’incluraient ou non dans ce champ, n’a plus vraiment de sens (p. 38).
19L’idée, la métaphore ou le mythe – qui peuvent englober, in fine, tout ce qui a trait plus généralement « à la représentation de la réalité » – sont tout à fait susceptibles de transcender la photographie comme chose existante. Subsumer l’isotopie d’une idée de la photographie – devenue, à force de métaphorisations et de réductions sémiologiques, un quasi-équivalent de la vue – sous la recherche de quelque influence photographique à l’œuvre, c’est faire face à quelque problème d’ordre logique : soit le symptôme potentiel devient une preuve suffisante, soit la récurrence sémantique d’une idée photographique (révélation, négatif, esthétique du détail, noir et blanc, etc.) ne manifeste in fine qu’elle-même, comme la preuve réitérée d’une photographicité diffuse, « comme une métaphore qui transporte son référent vers un ailleurs que l’analyse doit être en mesure de déterminer » (p. 43).
20Sous ce rapport, l’approche élaborée par Basile Pallas vaut, selon nous, comme un redéploiement salutaire de la photolittérature. L’attention portée au médium, à la médiatisation photographique, permet de se départir du mythe de l’image-vraie et, ce faisant, d’en revenir aux photographies existantes : la photo reprend le pas sur son idée, et l’esthétique sur la valeur de vérité. Ce double retour – à l’image et aux images – c’est le recadrage herméneutique d’un geste critique qui s’apparente, parfois, à quelque démarche tautologique, comme une idée-de-la-photo-littérature. Dans cette perspective, en éprouvant l’idée de photographie – sa valeur de vérité – à l’aune de la littérature, Le Miroir aberrant se situe au croisement de deux autres opérations majeures.
21Premièrement, il révèle une approche littéraire du photographique qui n’est pas empêtrée dans le paradigme de l’image-vérité, contrecarrant ainsi la réduction tendancielle de leurs interférences au simple niveau de l’idée, du mythe, de l’imaginaire ou du réseau métaphorique. Montrer que la littérature fait preuve d’une conscience matérielle et pratique – et, pour ainsi dire, esthétique – du phénomène photographique, c’est s’inscrire doublement dans l’actualité de la recherche : d’une part, c’est poursuivre, en littérature, les travaux de Clément Chéroux (2013) ou Peter Geimer (2018) sur les aberrations optiques de l’image photographique ; d’autre part, c’est explorer, à partir de la photographie, l’objectalité des œuvres d’art en littérature, dans la continuité des travaux récents de Marta Caraion (2020).
22En second lieu, en pluralisant les définitions de la photographie, Le Miroir aberrant participe au questionnement nécessaire de la sémiotique barthienne : tous les discours sur la photo ne s’inscrivent pas dans l’élaboration du mythe essentialiste de l’image-vérité ; à l’inverse, leur multiplicité bouleverse la vision unifiée de la photographie élaborée par les théories de l’indice. Ainsi Basile Pallas s’inscrit-il dans la suggestion facétieuse de Jérôme Thélot : « [L]a photographie est une affaire trop sérieuse pour laisser ses seuls historiens et ses seuls sémiologues en parler tranquillement » (2009, p. 15). Mais à l’inverse de Jérôme Thélot, il ne situe pas son dépassement littéraire de l’ontologie sémiotique au niveau de l’idée ou de la raison photographique, mais à celui du médium, de la concrétude matérielle de ses aberrations. C’est là toute la force d’une démarche aux accents presque wittgensteiniens : c’est le médium qui transcende l’idée, et non l’inverse ; c’est l’usage réel de la photo qui transcendance son usage métaphysique et qui, ce faisant, participe de son éclatement. Rendre au photographique sa visibilité, c’est opérer quelque descente : et l’Idée n’est plus qu’une image, juste une image.
***
23François Soulages, dans son Esthétique de la photographie, en s’inspirant de la notion de littérarité, proposait une conceptualisation fort intéressante de la « photographicité » :
Qu’est-ce qui dans une photo relève de la photographie ? En d’autres termes, qu’est-ce que la photographicité ? Le concept de « photographicité » désigne ce qui est photographique dans la photographie. Toutefois, nous pouvons lui adjoindre une deuxième caractéristique qui rend la photographicité symétrique de la littérarité dont parle Todorov dans la Poétique [...] ; ainsi, la photographicité désigne cette propriété abstraite qui fait la singularité du fait photographique – ce fait renvoyant aussi bien au sans-art qu’à l’art (2017, p. 112).
24Cette seconde caractéristique a souvent guidé le travail de la critique intermédiale : la recherche, dans les textes, des « propriétés abstraites » de la photographie, de ses émanations idéelles et métaphoriques, est un poncif de la photolittérature2. Mais pensée ainsi, la photographicité ne réfère pas – ou plus – forcément à la photographie, entendue comme un ensemble de techniques et d’images existantes. À titre d’exemples, les scènes d’apparition au miroir dans Spirite de Gautier ([1865], 2002) ou Le Horla de Maupassant ([1887], 1979) quoiqu’elles fassent preuve de quelque photographicité, comme une réitération analogique d’un imaginaire associé à la photographie, ne peuvent fonctionner comme des références certaines à la photographie.
25Cela étant, l’approche de Basile Pallas propose un renouvellement, sinon un recadrage, de la critique photolittéraire. La photographicité n’est plus entendue comme une présence métaphorique, mais comme une interrogation littéraire de « ce qui est photographique en photographie » : la praxis, la technique, le medium et la médiatisation. Bref, c’est un retour à l’image. Et ce retour fait montre d’une triple efficace : bousculer l’essentialisation sémiologique, étendre les territoires de la photolittérature et rendre au photographique sa visibilité.

