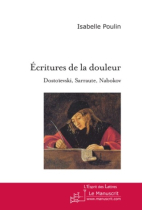
La douleur en partage
1Publié en 2007, Écritures de la douleur d’Isabelle Poulin est l’un des premiers ouvrages à interroger l’appréhension littéraire de la douleur1 et conserve aujourd’hui encore toute sa pertinence. Il échappe à une approche purement thématique du sujet en examinant simultanément la représentation de la douleur au sein de la fiction, son rôle dans le geste de l’écriture, et ses effets sur les lecteurs. Les jeux d’affinités et de contrepoints entre les trois auteurs choisis sont l’occasion, en accordant une place privilégiée au précurseur Dostoïevski, de mettre en lumière une intertextualité dense et de théoriser la fictionnalisation de la douleur, en croisant les approches médicales, psychanalytiques et critiques.
Extraire la douleur du silence : un apanage littéraire ?
2L’introduction défend l’idée d’une valeur spécifique du discours littéraire qui ne se contente pas de prendre la douleur pour objet mais se laisse innerver par elle, pour en révéler les points saillants et les zones d’ombre. Isabelle Poulin plaide ainsi pour donner à la littérature une place à part entière dans le champ de la douleur, majoritairement occupé par la médecine et la psychanalyse, en montrant qu’elle est non seulement capable d’approfondir notre connaissance de la douleur mais qu’elle peut jouer un rôle pragmatique dans l’évolution des pratiques. Situé dans le sillage des travaux de Gérard Danou, l’ouvrage prend appui sur la conviction que « [l]’écrivain en sait plus que le médecin sur l’homme malade2 » et qu’il « peut prêter sa voix à l’homme souffrant » (p. 49).
3Si la douleur a tendance à se dérober à l’écriture, elle apparaît comme un point de contact possible avec les lecteurs, fermement ancré dans le réel. C’est donc à partir de la lecture que s’opère le nouage entre les trois auteurs étudiés, jalons d’une filiation littéraire polémique reliés par une « hantise commune de la rupture » : « Dostoïevski est à l’affût de tous les mots à double tranchant, Nabokov de tous les faux amis, Nathalie Sarraute de tout ce qui coupe dans la langue » (p. 25). D’emblée se pose la question du pouvoir de la littérature, qui opère dans l’espace d’un entre-deux restreint pour engager un rapport aux lecteurs : « La parole fuit les corps trop violemment touchés, mais ce qui ne touche pas les corps donne envie de fuir » (p. 31).
4Des pages éclairantes sont consacrées à l’histoire des représentations de la douleur depuis la fin du xixe siècle jusqu’au tournant du xxie siècle, moment où elle devient l’objet d’un « engouement » (p. 35) partagé par la médecine, la psychologie et l’anthropologie. Peu à peu s’impose l’idée que la douleur, inutile, doit être combattue. Isabelle Poulin retrace le trajet de sa prise en charge médicale, jusqu’à l’approche pluridisciplinaire qui envisage la douleur comme un « puzzle que ne peut reconstituer seul un médecin », « au croisement du biologique, du culturel et du social » (p. 41), un phénomène transversal qui disqualifie une approche purement corporelle de ses manifestations. La question du sens qu’il est possible ou non de prêter à la douleur offre l’occasion d’un détour sur le mouvement doloriste des années 1930 ainsi que sur l’intégration progressive du domaine de « l’anormal » à la maladie, déplacement favorisé par les œuvres littéraires qui explorent par l’introspection des corps et des consciences souffrants.
5La question de la mise en mots de la douleur et de ses effets sur l’expérience se pose avec la même acuité dans l’écriture et dans l’élaboration de questionnaires médicaux répertoriant une série de noms et d’adjectifs soumis aux patients pour tenter de cerner simultanément la nature et l’intensité des symptômes ressentis (à l’image du questionnaire de l’hôpital Saint-Antoine, reproduit dans l’annexe de l’ouvrage). Située apparemment sur un terrain « dérisoire » (p. 53), la fiction peut-elle offrir un « point de vue » inédit pour « apprendre à regarder en face » (p. 56) la douleur, à travers l’expérience de la lecture ? « C’est ce risque : sortir indemne d’une lecture, sans avoir été affecté, que cherchent à prévenir selon nous Dostoïevski, Sarraute et Nabokov en faisant le choix d’une écriture, aux frontières de la poésie et du roman, qui permet d’inventer simultanément un “instrument optique” et son mode d’emploi » (p. 57). La double gageure de la taxinomie et de la traduction est analysée au prisme de la définition de la douleur proposée par la revue Pain en 1979 (« an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage »), éminemment ambiguë et sujette à des interprétations divergentes. La difficulté à définir la douleur est confirmée par la théorisation mouvante et imparfaite de la notion dans les écrits de Freud.
6Dire, voir, mais aussi écouter, toucher et imaginer, font partie des prérogatives littéraires pour appréhender la douleur, dont Isabelle Poulin analyse les ressorts tout au long du livre : « seule la littérature peut apprendre ce qui fait l’individuel de la langue, de la douleur3 » (p. 69).
Du contact à la blessure
7L’ouvrage analyse avec précision la manière dont Sarraute et Nabokov se sont emparés des voies creusées par Dostoïevski. Dans le premier chapitre (« Seuils critiques ») est mise en évidence l’origine des « effondrements spectaculaires » (p. 78) que subissent les personnages dostoïevskiens : l’interlocution douloureuse créée par les failles de la parole. L’omniprésence des corps meurtris traduit cette vulnérabilité, dont rend compte une écriture qui tend sans cesse vers la limite et s’apparente à un puits indéfiniment creusé :
8Il s’agit de faire reculer le moment où ça s’arrête de parler (d’écrire), en recherchant pour les obstruer tous les points de jaillissement de la douleur, qui sont autant de points de rupture. La douleur-dont-on-ne-peut-rien-faire constitue, si l’on veut, le hors-texte. Mais un hors-texte menaçant dont les frontières sont fluctuantes, un bord qui peut se retourner à tout moment en débordement, et interdit de faire de la douleur (comme on a pu le faire de la souffrance) le sujet de l’écriture (p. 90).
9Sarraute s’inscrit explicitement dans les pas de son prédécesseur en fondant ses récits sur l’exploration de conversations heurtées, tout en privilégiant un « imaginaire de la parole qui suggère que l’horreur peut surgir à tout moment, mais l’écriture s’arrête avant » (p. 85). Nabokov choisit lui aussi un mouvement de recul pour aborder les « coulisses presque intemporelles de l’effroi » (p. 80), une « fragmentation du regard » (p. 82) qui crée un effet d’opacité en se focalisant sur une surcharge de détails, mais il se démarque davantage de Dostoïevski dans sa prédilection pour des sujets apparemment légers, qui révèlent toutefois une réflexion sur son époque.
10Isabelle Poulin se donne pour horizon la question « Pourquoi la fiction ? » et discerne aussi bien dans l’espace restreint dévolu à la littérature que dans les trois œuvres étudiées un élan vers l’Autre. Ce désir de contact se délite toutefois pour aboutir à un constat d’échec de la communication ou pour dériver en quête aliénante pour le sujet. Le souci de l’autre est dès lors intimement lié à des « violences textuelles » (p. 91) qui caractérisent les relations entre auteurs et lecteurs au sein des trois œuvres, sensibles dans des dispositifs de réflexivité menaçante.
11L’écriture et la lecture de l’expérience douloureuse éprouvent et questionnent les limites de la littérature : comment s’accommoder de l’incommensurabilité des mots par rapport aux maux du corps ? Le cas de Marguerite Duras et de Robert Antelme, confrontés à la transposition littéraire d’une douleur vécue dans la chair, témoigne de la part de honte comprise dans cette gageure. Eux aussi conscients qu’« [u]ne douleur écrite est nécessairement un simulacre » (p. 105), Sarraute et Nabokov maintiennent néanmoins leurs efforts pour se saisir du « malheur de l’interlocution » (p. 116) et en partager les failles intimes, dans leur intérêt commun pour la langue maternelle russe, qu’ils associent respectivement à l’abandon et à l’exil4.
12Le deuxième chapitre (« Les conteurs d’histoire et les bouches béantes ») détaille les risques inhérents à la saisie fictionnelle de la douleur. La difficulté à transmettre celle-ci est examinée à partir du manque d’écoute et des malentendus qui entravent la communication dans Vous les entendez ?, récit dans lequel Sarraute refuse tout point de vue surplombant. Isabelle Poulin voit dans les œuvres des trois auteurs une mise en scène du désir de distinction et du risque majeur de l’écriture : « s’abîmer dans la copie ; qui est aussi le risque de toute lecture autosatisfaite, c’est-à-dire menée dans l’indifférence d’autrui » (p. 128). La peur de l’invisibilité du narrateur dans Portrait d’un inconnu (Sarraute, 1948), mise en écho avec celle des personnages dostoïevskiens de L’Éternel mari (1870) et de L’Idiot (1868-1869) et celle du narrateur d’Otčajanie (Nabokov, 1932), illustre la notion de « voix passive », qui, selon Isabelle Poulin, « sert à dire la souffrance des êtres de langage, lesquels sont condamnés, s’ils ne parviennent à réfléchir dans le miroir des mots leur singularité absolue, à être reproduits en série, à être parlés par d’autres » (p. 135).
13Le rapport douloureux à la fiction est particulièrement sensible dans l’œuvre de Dostoïevski, qui fait accéder à la douleur par le double biais de la misère sociale et de la maladie : la sensation du déjà-lu perturbe le surgissement de la douleur, tandis que la souffrance originelle en jeu dans la « voix passive » est avant tout celle du langage. « Dostoïevski déplace la question de la douleur d’un niveau de réalité (une histoire de pauvres gens) à un autre (l’écriture de cette histoire) : déréalisée par l’usage humiliant qu’en ont fait les livres, la douleur retrouve un peu de sa force vive en se déposant sur les mots » (p. 147). Entre précision et opacité, entre désespoir et humour se dessine une vision mouvante de la douleur dans l’œuvre de Dostoïesvki, rendue d’autant plus instable que les termes « douleur » et « souffrance5 » en russe font l’objet de traductions multiples. Nabokov et Sarraute privilégient eux aussi les affects par rapport aux concepts, comme le confirme la place qu’ils accordent au motif de la bouche ouverte, symbole d’une violence verbale omniprésente.
Du corps à la politique
14La deuxième partie de l’ouvrage examine comment la jouissance ou le rejet face à la douleur de l’autre peut resserrer ou entraver les relations intersubjectives, et comment ce motif est utilisé dans les trois œuvres pour refléter la tyrannie politique et les rouages de l’Histoire.
15Pour Isabelle Poulin, la question de la distance adoptée face à la douleur d’autrui se pose simultanément sur le plan des histoires racontées, sur celui de la narration et sur celui de la lecture : un transfert aurait lieu du livre aux lecteurs, pour mêler les origines des voix douloureuses données à entendre6. Le premier chapitre (« La roue du langage ») met l’accent sur Dostoïevki, qui fait de la douleur « la doublure de la langue » (p. 173), et met en scène le « désir de contact dont procède l’invention de paroles touchantes, c’est-à-dire une écriture du pathétique qui permette aux corps de se rencontrer, à la douleur d’être partagée » (p. 176). L’auteur russe comme Sarraute s’attachent à sonder le dégoût ressenti à partir de la parole des autres, mettant en évidence la proximité entre mot et attouchement.
16Le lien interrogé par Isabelle Poulin entre sentimentalité et goût du supplice, entre douleur et jouissance, est approfondi à partir du personnage de Stéphane Trofimovitch dans Les Démons (1871-1872), caractérisé par ses émotions et sa sensualité débordantes. La douleur imprègne la société tout entière, des relations familiales au pays lui-même et fragilise les discours des personnages, à la fois impuissants et potentiellement dangereux : « [t]oute grande idée est une parole touchante qui peut dégénérer en attouchement : viol de conscience ou de corps informes » (p. 195). La maladie est associée dans les œuvres de Dostoïevski et de Nabokov à un souci de faire converger l’ici-bas et l’infini, ce que l’autrice démontre grâce à des intertextes bibliques et poétiques.
17Les hypothèses proposées sur le statut du lieu commun sont particulièrement fructueuses. Tandis que Sarraute y voit « un point de départ ou de rencontre » (p. 204), le lieu commun est décrié par Nabokov. Dans Portrait d’un inconnu (1948), Sarraute donne la « sensation que la douleur concerne le déplacement même dans les mots qui (dé)possèdent, déshabillent, dont le mouvement de ressac confine à la folie » (p. 206). Les mots de tous sont à l’origine des affres ressentis par le « vieux », mais c’est étonnamment en recourant lui-même aux mots stéréotypés de l’avarice qu’il trouve un apaisement temporaire. Le lieu commun s’avère donc à la fois le point d’origine de l’aliénation et la possibilité d’incarner la douleur, comme c’est également le cas dans la nouvelle « Terreur » (publiée par Nabokov en 1926). Si les deux auteurs examinent au microscope les douleurs inaperçues tapies dans les liens entre les propos banals et l’obscénité, Nabokov rejette le lieu commun, notamment à cause de son rapport douloureux à la langue russe et à la traduction, grevé par un « difficile rétablissement du corps dans une langue étrangère » (p. 209).
18Isabelle Poulin s’attarde sur l’exemple de Lolita (1955) pour souligner les risques d’une représentation édulcorée de la violence du narrateur, tyran agressif qui peut susciter le rejet des lecteurs au lieu de « souligner le danger de la fibre sentimentale » (p. 217). Ce roman manifeste des affinités avec l’écriture sarrautienne, dans l’hypersensibilité qui échappe aux impératifs de la pudeur, et dans la conviction commune que la douleur échappe aux mots, qu’« écrire revient à briser (à écorcher) les couches (les peaux) qui la recouvrent » (p. 222‑223).
19Le deuxième chapitre (« Peines de mort : le bruit du temps ») analyse la manière dont la mise en fiction de la douleur peut être rapportée au souffle de l’histoire. L’expérience du bagne conduit Dostoïevski à attirer l’attention des lecteurs sur « l’insoutenable » (p. 230) en évitant qu’ils s’y habituent ou qu’ils détournent le regard. Les châtiments corporels, la torture et la peine de mort abondamment présents dans ses œuvres lui permettent de questionner les défaillances du rapport avec celui qui souffre, souvent pris pour cible, ignoré ou jugé. Des exemples issus du Don, de Pnine, de L’Invitation au supplice (1938) ou de La Vraie vie de Sebastian Knight (1940) montrent les variantes du tableau de l’exil élaboré par Nabokov, qui crée souvent le malaise en superposant insouciance et violence, horreur et parodie dans sa représentation de l’indignité, et entremêle dans ses personnages les différentes acceptions de la maladie (physique, éthique, historique). Selon Isabelle Poulin, l’écrivain se donne deux horizons : d’une part, « faire croire à la douleur écrite tout en en dénonçant l’artifice, de façon à transmettre la sensation de l’insurmontable », d’autre part, révéler une « déchirure qui fait écho à la “ligne brisée” de l’Histoire, et suggère que l’écrivain cherche à se glisser dans ses “failles” » (p. 250). Dans le cas de Sarraute, l’horreur des camps de la mort n’est pas explicitement mentionnée, mais apparaît à l’état de traces, notamment sous la forme d’une « sensation permanente d’un danger de mort dans son œuvre, et la transformation de la situation historique en questions “de notre temps” » (p. 252). C’est dans la parole qu’est réinvestie la violence de l’histoire, indissociable de l’arrachement douloureux à la mère et à la langue maternelle, dont rend compte l’assimilation fréquente entre parole et torture. Le motif de l’étouffement, la récurrence de personnages « terroristes » (Les Fruits d’or, Disent les imbéciles), et la hantise des mots qui pétrifient la réalité ou le souvenir sont la preuve de la lutte engagée par l’autrice contre le déni de l’Histoire.
20Enfin, un bref chapitre (« S’entresouffrir : fictions extrêmes ») revient sur les raisons d’une écriture du détour, privilégiée par les trois écrivains. La poésie apparaît comme une nécessité qui transcende la voix du sujet et peut accroître sa force (Dostoïevski), comme un élan qui opère la transition d’un langage incertain à l’ancrage dans le corps (Sarraute), comme un « poème-et-commentaire » (p. 268) qui insère les mots dans un dispositif spéculaire (Nabokov). La vision stéréoscopique, le recours au flou, au hors champ ou à la focalisation sur un détail sont autant de manières d’écrire sans décrire directement la douleur, plus volontiers saisie dans sa dimension sonore, qui permet de la suggérer sans tomber dans la complaisance. Le lecteur pourra regretter que la question du cri soit si brièvement évoquée.
Regarder la douleur : humilité et responsabilité
21En conclusion Isabelle Poulin rappelle l’effort de créer par l’écriture un lieu commun qui puisse faire voir la douleur en évitant le risque de sa banalisation. L’imagination offre un « troisième œil » qui peut révéler la douleur, voire la faire comprendre7, mais se trouve bien sûr dépourvue du pouvoir de l’éloigner, si ce n’est, éventuellement, pour les auteurs eux-mêmes. Pour « approcher la douleur vivante, sans lui porter atteinte » (p. 288) et « franchir des seuils de tolérance, sans être atteint soi-même » (p. 289), Dostoïevski, Sarraute et Nabokov adoptent une écriture qui ne cesse de se retourner sur elle-même pour mieux établir un lien aux lecteurs. In fine, le pouvoir de la fiction est modeste mais salutaire :
22La douleur reste hors texte. Il suffit d’ouvrir sa lucarne (fenêtre, radio, télévision) et la violence du monde saute à la figure. Reste le pouvoir de l’infime. La qualité de certains moments. La sensation d’être soutenu par le regard de l’autre. La certitude que la littérature entretient ce regard, et qu’il faut continuer (p. 290).
*
23L’ouvrage est d’abord pertinent dans une perspective comparatiste, qui trace les sillons subtils reliant Dostoïesvki, Sarraute et Nabokov, au sein même de leurs choix d’écriture. Trois apports se dégagent à cet égard : il s’agit de « livres de l’intranquillité, dans lesquels la douleur n’est pas ce dont s’empare l’écriture comme pour en soulager la communauté, mais ce contre quoi elle s’édifie, en veillant à ce que le poids en soit bien partagé » (p. 71) ; ces œuvres vont puiser au sein de l’interlocution et du dialogue les résonances et les effets de la douleur qu’elles mettent au jour ; elles font enfin le « choix d’écritures obliques qui cherchent à donner le pressentiment et non une représentation de la douleur » (p. 274). Plus largement, l’intérêt du travail d’Isabelle Poulin dépasse la question de la douleur pour réinterroger sous un angle singulier le rapport entre la fiction et l’expérience, prolongeant ainsi l’analyse poétique sur le terrain éthique. La variété et la richesse des exemples offrent une matière à réflexion qui s’étend au-delà des conclusions explicites de l’ouvrage et peut être réinvestie dans d’autres corpus.

