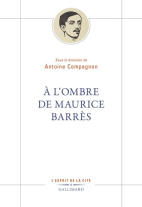
L’héritage controversé d’un héritier
1Que reste-t-il de Barrès aujourd’hui et, plus précisément, que reste-t-il de l’écrivain à l’influence considérable qu’il a pu être à la Belle Époque ? Si la cause semble entendue et perdue depuis longtemps auprès du public, à qui l’on ne propose plus que des éditions plus ou moins confidentielles à côté d’éditions scientifiques qui le sont, elles, par définition, quelle place Barrès occupe-t-il, sinon dans les programmes des concours et des universités – Barrès ayant complètement disparu des manuels scolaires –, du moins dans le monde de la recherche ? De ce point de vue, la résonance proustienne du titre choisi pour ce volume, À l’ombre de Maurice Barrès, accentuée par le nom de celui qui l’a dirigé, Antoine Compagnon, a quelque chose d’ironique et même de cruel pour celui qui fut jadis le « Prince de la jeunesse », avant de devenir un « professeur d’énergie » et, finalement, le « Rossignol du carnage ». Au moment où Proust, qui n’était après tout son cadet que de neuf ans, faisait encore ses gammes, Barrès occupait le centre du monde littéraire et intellectuel français, d’une façon si éclatante que nul ne songerait à discuter le choix fait par Michel Winock dans son Siècle des intellectuels de présenter la période antérieure à la Grande Guerre comme « les années Barrès ». Mais alors même que le Centenaire de la mort de Barrès ne suit que d’un an celui de la mort de Proust, alors que les étagères des bibliothèques et les sommaires des revues scientifiques témoignent encore du faste avec lequel a été célébré celui de Du côté de chez Swann, le nombre somme toute restreint de manifestations et de publications, à une époque où la mondialisation de la recherche produit une inflation de la production sur les auteurs et les sujets à la mode, est significatif du relatif désintérêt des chercheurs pour la figure de Barrès.
Une œuvre réservée aux historiens ?
2Même si la minceur du volume dirigé par Antoine Compagnon, qui rassemble cinq contributions inédites ainsi qu’un article d’Albert Thibaudet, pourrait de ce point de vue apparaître comme symptomatique, la qualité des contributions et le choix des sujets permettent malgré tout de « repérer quelques aspects remarquables d’un cas compliqué » (p. 10) et de soulever du même coup les principales questions qui sous-tendent la réception de Barrès, c’est-à-dire à la fois son infortune littéraire, son « annulation » même, suivant le terme choisi par Compagnon (p. 9), et sa place ambiguë dans la recherche française. À l’ombre de Maurice Barrès réunit les contributions de trois chercheurs en littérature (Jessica Desclaux, Alexandre de Vitry et le directeur du volume), et de deux historiens (Michel Winock et Grégoire Kauffmann), ce qui n’est pas rare dans un volume collectif consacré à Barrès. Par sa nature même, le corpus barrésien constitue tout à la fois une œuvre littéraire et un ensemble de documents de premier intérêt pour comprendre la vie intellectuelle et politique de la Belle Époque, en particulier l’histoire des idées politiques.
3À une époque où nombre de travaux interrogent les frontières du littéraire, le caractère inclassable ou, du moins, difficilement classable, de certains de ses textes, voire leur nature hybride, pourrait d’ailleurs être de nature à renouveler l’attention portée par les chercheurs en littérature. Le travail éditorial mené tout récemment sur les Chroniques de la Grande Guerre par Denis Pernot et Vital Rambaud1, par exemple, montre bien qu’un tel texte, à la frontière de différents genres, est bien celui d’un écrivain, même s’il ne peut être approché sans un rigoureux travail de contextualisation historique. C’est pourtant l’inverse qui se produit en général : non seulement certains textes comme Les Diverses Familles spirituelles de la France, les Chroniques de la Grande Guerre apparaissent comme des documents historiques, mais c’est l’œuvre littéraire au sens strict qui tend à être considérée sinon comme un document, du moins comme le témoignage d’un état de la littérature et de la sensibilité française autour de 1900. Au mieux, on reconnaît en effet à Barrès une place importante au sein du patrimoine littéraire français, mais on ne relit guère son œuvre à la lumière des outils et des questionnements propres à notre époque.
4L’article d’Alexandre de Vitry, « Maurice Barrès, l’individualisme et nous », montre néanmoins qu’elle peut encore parler au lecteur d’aujourd’hui, parce qu’elle conserve une forme d’actualité. De manière convaincante, Vitry avance l’hypothèse que l’égotisme de Barrès « nous informe, plus encore que sur le paysage idéologique de la fin du XIXe siècle, sur certaines des apories propres peut-être à tout système démocratique, […] dont la littérature constitue une espèce de révélateur privilégié » (p. 101). Il montre ainsi que cette œuvre, ancrée dans son époque et informée par les idées politiques de son temps, entretenant « un dialogue avec les systèmes politiques fondés sur l’individu, celui, républicain, de la Déclaration des droits de l’homme, […] celui des anarchistes évidemment, ou encore du fouriérisme » (p. 99), pose des questions encore actuelles, dans la mesure où notre époque est « traversée par les deux grandes passions de Barrès : celle de l’individu et celle de la communauté » (p. 105). Mais de tels questionnements restent rares, et ne sont pas de nature à remettre en question ce constat : l’œuvre de Barrès n’intéresse plus guère aujourd’hui que les historiens de la littérature – il est significatif que la manifestation phare du centenaire Barrès ait été un colloque organisé par la Société d’Histoire littéraire de la France – et les historiens tout court.
Nationaliste, fasciste, ou simplement conservateur ?
5Il n’est pas besoin de chercher très loin les causes de cette désaffection, directement liée à deux notions, l’une appartenant au vocabulaire et à l’époque de Barrès – « nationalisme » –, et l’autre, postérieure et accolée tardivement à son nom : « fascisme ». Dans ce volume, les deux articles signés par des historiens font le point sur ces deux questions et, en même temps, sur les débats qu’elles ont pu susciter. Dans « L’inventeur du nationalisme français », Michel Winock retrace les étapes de l’engagement politique de Barrès, du boulangisme à l’affirmation d’un nationalisme nourri entre autres par les idées de Jules Soury. S’il rappelle que la xénophobie et le protectionnisme faisaient déjà partie du programme de Barrès candidat à la députation en 1893, s’il éclaire le rôle moteur joué par l’anti-intellectualisme dans la formation de cette doctrine et retrace sans complaisance la genèse de l’anti-protestantisme et de l’antisémitisme qui l’ont accompagnée, l’historien n’oublie pas de souligner que l’engagement politique du jeune écrivain ne fut d’abord pas réellement pris au sérieux par ses confrères, en particulier « les jeunes écrivains de gauche, socialisants futurs dreyfusards » (p. 39), ni qu’il « y a chez Barrès un fond de scepticisme qui lui interdit d’adhérer à une vérité absolue » (p. 53). En ce sens, la synthèse de Winock est l’antithèse du travail mené naguère par Zeev Sternhell dans les années 1960 qui, en faisant de Barrès non seulement le promoteur du nationalisme français, mais encore un précurseur du fascisme, a précipité le discrédit total de Barrès. Dans « Le père de tous les fascismes ? Le Barrès de Zeev Sternhell », Grégoire Kauffmann, proposant une synthèse objective des objections et débats historiographiques qui ont remis en question la valeur des conclusions proposées par Sternhell, lui reproche justement de s’en être tenu à une « stricte histoire des idées », en ignorant « le contexte économique, social et littéraire dans lequel évolue Barrès » (p. 79), en s’abstenant de « s’interroger sur l’homme Barrès, ses raisons d’agir et son rapport complexe aux idées » (p. 83) et finalement en feignant d’ignorer que Barrès était d’abord un écrivain, soucieux de réussir dans et par la littérature, et un esprit particulièrement complexe, parfois difficile à saisir. Cette complexité, des commentateurs récents l’ont bien soulignée, en particulier Emmanuel Godo, depuis ses premiers articles2 jusqu’à sa récente synthèse3. Dans ce volume, Jessica Desclaux insiste sur la manière dont l’ironie a toujours été présente dans les écrits de Barrès, qui « programme à ses débuts, le scandale comme un effet de sa réception tout comme il cherche à nouer un lien particulier avec la jeunesse » (p. 58). La « voix ironique » adoptée par Barrès pour déboulonner les statues des maîtres Renan et Taine, on la retrouve encore, identique, dans les textes du député boulangiste, remarque finement Desclaux : « aphorisme critique, portrait satirique, bon mot railleur caractérisent son style » (p. 70).
6Mais ni l’ironie, ni le goût du paradoxe et du contrepied, ou du contrepoint, ni son style même, ne peuvent grand-chose lorsqu’un écrivain est jugé infréquentable. Barrès n’a même pas pour décorer sa disgrâce les habits du maudit. Mieux vaut sans doute un exil ou le peloton d’exécution que des funérailles nationales : « Barrès ne fut pas assez odieux, pas assez haïssable, mais trop divisé, trop compliqué, pour que nous en fassions l’incarnation du mal absolu », note justement Compagnon (p. 31). Force est donc de constater, avec Alexandre de Vitry, que « moins caustique que Léon Daudet, sentant moins le soufre que les écrivains collaborateurs, il n’a jamais vraiment fait son retour, même polémique, contrairement à tant d’autres, que ce soit en librairie ou dans les colonnes des journaux » (p. 89). Antoine Compagnon a beau écrire que « l’annulation de Barrès depuis plusieurs décennies demeure énigmatique », la messe semble bien dite. Au demeurant, à supposer que le travail objectif des historiens parvienne vraiment à dissocier Barrès d’un « fascisme français » dont l’existence même fait d’ailleurs débat au plan historiographique, « la composante conservatrice de sa personnalité », éludée par Sternhell, mais rappelée par Kauffmann, n’en constitue pas moins « un aspect fondamental de sa personnalité » (p. 87). Ce conservatisme constitue sans doute la principale explication du discrédit de Barrès, non pas seulement dans le public, mais plus encore chez les spécialistes de littérature, à la fois parce que l’on tolère moins difficilement le panache de positions extrêmes et parce que ce conservatisme a trouvé chez lui un prolongement naturel dans le goût des honneurs et des positions officielles, jusqu’à faire de cet « héritier », pour reprendre la notion mise en avant par Thibaudet, un notable des lettres.
Réussir vite au risque de gâter l’avenir
7Jessica Desclaux nous rappelle pourtant à quel point Barrès fut un formidable inventeur de formes en même temps qu’un écrivain irrévérencieux et ironique à l’égard des maîtres établis, à commencer par Taine et Renan. Pour se démarquer d’eux et attirer la lumière sur lui, il a su inventer « une autre forme que celle de l’article critique traditionnel ou de l’éreintage », en lui substituant une forme originale de « dialogue ironique, écrit à la manière de l’intéressé » (p. 64). Reste que même si ce « ton rieur » et ce recours presque systématique à l’ironie assurent chez le jeune Barrès « une certaine continuité entre le critique littéraire et le chroniqueur politique » (p. 71), sans jamais disparaître complètement dans les œuvres ultérieures, on ne peut nier que son œuvre, au plan formel, s’est construite comme à rebours, avec la volonté affichée, à partir des Déracinés, de renouer avec un certain réalisme balzacien, loin des audaces formelles des débuts et sans craindre la forme engoncée du roman à thèse.
8Une des clefs de l’infortune littéraire de Barrès réside aussi dans le fait que même l’ironie, la liberté de ton et l’invention formelle participaient chez lui d’une stratégie concertée pour parvenir à occuper le devant de la scène littéraire, en manifestant une soif de reconnaissance sans équivalent, comme le montre bien l’article de Jessica Desclaux. Un mot de Barrès cité par cette dernière, conscient du risque comporté par la recherche du scandale et de la polémique, résonne de manière presque prophétique : « Pour un avantage immédiat, je gâte l’avenir. Ma carrière est dans le livre, non dans le militant, et il en reste toujours quelques éclaboussures. » (p. 60) Un succès rapide et une reconnaissance immédiate, en effet, assurent rarement une gloire durable : parmi les « classiques modernes » dont Barrès était « de quelques années seulement l’aîné » (p. 8), comme le rappelle Antoine Compagnon, Proust et Gide en témoignent exemplairement – le premier par sa trajectoire, le deuxième par sa volonté de « gagner [s]on procès en appel », de n’écrire « que pour être relu4 », ce qui le conduisait à se flatter de ses maigres tirages, avant la Première Guerre mondiale. Antoine Compagnon observe à juste titre que Barrès a « payé cher le fait d’avoir atteint trop tôt, dès 1889, le zénith de sa gloire » (p. 24), et sollicite brillamment Thibaudet – dont ce volume reproduit aussi l’hommage à la mort de Barrès – pour montrer qu’il était dès lors condamné à apparaître comme un « héritier » et comme celui qui avait « volé l’outil » (p. 22-26). De sa contribution, par-delà les réflexions sagaces sur le rôle de certains éditeurs – qui appellerait une étude plus systématique afin de mieux cerner la place ambiguë et paradoxale qu’occupaient les écrivains de la droite radicale dans le monde éditorial français des années 1960 – on retiendra aussi le témoignage personnel d’un lettré qui était adolescent à cette époque, afin de ne pas oublier à quel point Barrès a été partie intégrante d’une certaine sensibilité littéraire française, au moins au XXe siècle.

