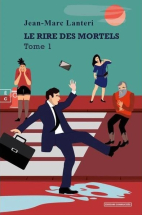
Mourir de rire
1Disons-le d’emblée, le livre de Jean-Marc Lanteri, Le Rire des mortels, qui paraît en deux volumes aux Éditions Complicités, est un livre qui devrait faire date pour quiconque s’intéresse à la question du rire et du comique. Jean-Marc Lanteri est enseignant chercheur en Études théâtrales, auteur d’un essai important sur Koltès. Le Rire des mortels, n’est cependant pas un livre sur le théâtre, même s’il concerne aussi le théâtre. S’il fallait en définir brièvement le projet, on pourrait dire qu’il s’agit d’une tentative de généalogie du rire — le « propre de l’homme » en ce qu’il se sait mortel, comme on va le voir — dans une dimension anthropologique.
Le retour à Bergson
2Le point d’origine de la réflexion de Jean-Marc Lanteri se situe dans le célèbre essai de Bergson, Le Rire, qui reste une référence, si ce n’est la référence majeure, pour lui comme pour la plupart des penseurs du rire. L’auteur pointe cependant un manque chez Bergson, qui constitue l’ouverture dans laquelle sa réflexion s’immisce et se développe. Ce manque, ou cet impensé, c’est la mort. Jean-Marc Lanteri montre, à travers une analyse approfondie de l’essai de Bergson, que celui-ci, en même temps qu’il l’entrevoit comme élément fondateur de la généalogie du rire, la refoule. C’est ce que signale la fameuse formule, « du mécanique plaqué sur le vivant », dont les six cents pages de l’essai constituent, d’une certaine manière, une glose. De cette formule, il montre à la fois les limites et, plus encore, les perspectives inouïes qu’elle ouvre dès lors qu’on en révèle ce qui secrètement la travaille : la mort à l’œuvre.
3Cet essai constitue ainsi un hommage à Bergson en même temps qu’un dépassement de son interprétation. Comme Jean-Marc Lanteri l’écrit : « tous les anti-bergsoniens sont bergsoniens, les uns le sachant quelque peu, les autres l’ignorant totalement, et ils œuvrent tous à ce vaste refoulement de la mort que l’on retrouve jusque chez Bergson, alors que tout est dit dans Le Rire, fût-ce entre les lignes, de la théorie fest-thanataire » (t. 1, p. 77).
La « théorie fest-thanataire »
4La « théorie fest-thanataire » proposée par Jean-Marc Lanteri — « fest » pour festif, pour la joie socialisée et socialisante du rire —, c’est le dépassement de Thanatos et de « l’archéo-rire », ce rire primitif qui n’en est pas encore tout à fait un et qui surgit du spectacle incompréhensible de l’agonie et de ce qui en découle : la révélation théâtralisée, ou plutôt pré-théâtralisée, de notre finitude. C’est la pierre angulaire de la théorie proposée dans ce livre. C’est elle qui autorise la « généalogie spéculative » (t. 2, p. 8) qui constitue la méthodologie de l’essai, et dont le modèle pourrait se rencontrer chez Freud, celui de Totem et Tabou, élaborant, à partir d’une approche de type métapsychologique et anthropologique, un mythe des origines. Une autre référence pourrait être Masse et Puissance d’Elias Canetti, tout anti-freudien qu’il soit (la référence à la « meute », la horde primitive, est commune aux deux, ainsi qu’à Lanteri).
5En quoi consiste au juste cette généalogie ? Dans une expérience de pensée qu’il nous fait partager, Lanteri se projette dans ce moment où, en une première fois mythique, plusieurs hommes ont vu un autre homme mourir. Et, convoquant René Girard à l’appui de sa thèse, il décrit une scène dans laquelle, sidérés par les spasmes de l’agonie, les vivants se mettent à les imiter.
6« Le rire est donc né, commente Jean-Marc Lanteri, comme archéo-rire ou Ur-Lachen […] face au trauma terrible de l’agonie » (t. 1, p. 17). La version légère de ce rire originel et effroyable, ce sera donc le « fest-rire », léger, civilisé, convivial. Il faut alors poser les termes d’une dialectique : « Bien sûr, l’Ur-Lachen est dans l’ADN du fest-rire » mais « le fest-rire n’advient que si la mort se trouve écartée de l’événement comique » (t. 1, p. 21).
7Comment Bergson passe-t-il à côté de cela ? Il y a, montre Jean-Marc Lanteri en embrassant la philosophie de Bergson au-delà de son essai sur le rire, un vitalisme inhérent à celle-ci qui exclut la mort. C’est ce vitalisme qui conduit Bergson à l’escamoter dans son analyse du rire :
Chez Bergson, le mort ne surgit pas à la place du vivant et ne remplace JAMAIS le vivant mais, en un effet mécanique dont le contenu n’est qu’analogiquement thanataire, il se plaque sur le vivant sans pouvoir le tuer et sans jamais se substituer à lui, faute de quoi le rieur ne rirait pas. […] l’on rit, donc, non pas […] parce qu’on n’est pas ce mort-là, mais […] parce qu’il n’y a pas de mort (t. 1, p. 74).
La mort est dans le rire
8La pensée de Lanteri s’organise en trois « livres », répartis sur deux volumes par l’éditeur (le Livre I d’une part, les Livres II et III de l’autre). Une fois installé le mythe originel dans une copieuse introduction intitulée « Les cavernes du rire », le premier livre (« Les trois temps de Thanatos ») creuse, sur un plan anthropologique et philosophique, le rapport du rire à la mort — qui restera le fil conducteur de l’essai — dans un va-et-vient constant entre élaboration théorique, exemples empruntés à la vie quotidienne et examen de moments comiques issus d’une multitude de références théâtrales et cinématographiques, secondairement littéraires, d’une grande diversité, qui vont de Kafka à Pierre Desproges ou Patrick Timsit, et de Rabelais ou Shakespeare à Alfred Hitchcock, composant une « Poétique du comique » qui donne son titre au Livre II.
9Jean-Marc Lanteri traque ce qu’il nomme le « riaptus » (le rire comme raptus) : « Le riaptus, c’est un court-circuit hilarant. D’un côté, la ligne qui mesure la charge thanataire. De l’autre, celle de sa fest-conversion », à savoir, sa mutation en « fest-rire » (t. 1, p. 45). Ce qu’illustre l’exemple suivant : « Dans son sketch, Une histoire à mourir de rire, Bourvil est les deux lignes à la fois, réunies en un seul corps. D’un côté, l’agonisant qui hoquète et éructe. De l’autre, l’homme ressuscité qui s’esclaffe » (t. 1, p. 45, n. 20). La grille d’interprétation est convaincante. Elle fonctionne sans discontinuer au travers de la diversité des exemples convoqués.
10Trois auteurs — « trois des plus grands génies comiques dans l’histoire de l’art » (t. 1, p. 35) — s’imposent cependant, au sein de cette myriade d’exemples, comme des références majeures qui courront tout au long de l’essai : Molière, Feydeau et Chaplin. Le Livre III, qui s’aventure aux confins du comique et du rire (il s’intitule « Humour, ironie, sourire »), fera venir au premier plan la figure de Beckett, celui qui opère la délicate synthèse du comique et de l’humour : « Beckett, c’est Feydeau revu par Swift » (t. 2, p. 146). On appréciera le sens de la formule.
11« Tous les arts qui émargent au comique, écrit Lanteri, arts du théâtre ou du cinéma, de la bande dessinée ou de la littérature, nous proposent […] des simulacres thanataires » (t. 1, p. 52) : des « thanartefacts » (ou artefacts thanataires) qui miment la mise à mort sans la donner. Est alors mise à nu la dialectique évoquée plus haut, celle de la mort à l’ouvrage dans le rire qui ne le provoque qu’à condition d’en être, dans le même mouvement, écartée.
12C’est, chez Molière, dans Les Fourberies de Scapin, le sac dans lequel Géronte est enfermé par Scapin pour y être « supplicié par mille coups de bâton conventionnellement inoffensifs qui, s’ils étaient effectivement donnés et reçus, tueraient n’importe quel vieillard, alors que ces coups de bâton comiques n’attentent jamais à la vie de la victime et la tuent faussement » (t. 1, p. 52).
13C’est, chez Feydeau, le « thanartefact génial » (t. 1, p. 53) que constitue le fauteuil extatique de La Dame de chez Maxim, dans lequel le docteur Petypon endort et réveille ses victimes, au gré des circonstances et des besoins, véritable « machine thanartefactuelle » inventée par le dramaturge :
le poète comique conçoit un simulacre thanataire quasi parfait, où l’imitation de Thanatos est parfaitement crédible et parfaitement réversible, et cette machine au fluide efficace usine en série les fausses morts et les fausses résurrections. Le docteur Petypon […] tue et réanime aussi facilement ses cobayes, sans attenter à la certitude intime du rieur que la mort n’est pas là, que personne ne mourra et que tout le monde, in fine, sera sain et sauf, alors même que ces faces, figées par l’action paralysante du fluide, imitent à merveille la mutique fixité de la mort (t. 1, p. 53).
14Mais il faudrait citer in extenso la remarquable analyse de ce « cas d’école du comique thanataire ».
15C’est, encore, chez Chaplin, la machine à faire déjeuner l’ouvrier dans Les Temps modernes. Celle-ci se dérègle et Charlot ingurgite deux boulons métalliques :
L’ingestion accidentelle, de ces boulons détermine […] l’énorme charge thanataire, qui fait rire dans la mesure où la mort du cobaye est décrétée impossible par le contexte même où il s’insère : le burlesque. Le burlesque cinématographique, c’est ce royaume des hommes-protée qui toujours vivants se relèvent, même après un millier de chutes. Bien sûr, la charge thanataire est considérable et théoriquement l’issue pourrait être létale. Un vrai boulon avalé peut tuer, mais au contraire du boulon réel, le boulon comique semble tuer mais ne tue point. (t. 1, p. 55)
16Ce n’est pas le comique mais l’humour qui « autorise Thanatos à refaire authentiquement surface » (t. 2, p. 120), comme si tout humour était, par nature, noir. Dans le comique, en effet, le « cobaye » est inclus au thanartefact, et le rieur ne voit à peu près rien de la mort qui y est amalgamée. Dans l’humour, l’humoriste grossit le thanartefact, de sorte que le destinataire garde la possibilité de voir la mort incluse. C’est dans cette mesure que l’humour n’est pas systématiquement comique, mais peut aussi heurter ou provoquer la réflexion. Quant à l’ironie, qui « s’occupe d’objets de savoir », elle « ne fait […] jamais rire parce qu’elle n’a pas de relation réelle ou artefactuelle avec la mort » (t. 2, p. 182).
De nouveaux mots pour dire le comique
17On l’aura entrevu dans les citations qui précèdent, l’invention langagière de l’auteur, qui pratique volontiers le mot-valise, est constante. Elle est au service d’une fabrique proliférante de concepts, méthodiquement définis au fil de la lecture et constituant une sorte de « boîte à outils » ayant pour visée une classification des formes du comique, tous genres confondus, un peu à la manière dont use Deleuze dans cet autre livre d’inspiration bergsonienne (le Bergson, en l’occurrence, de Matière et Mémoire) : Cinéma. Elle n’est sans doute pas dénuée d’humour. Elle manifeste, en tout cas, une jubilation communicative dans l’invention, qui permet à Lanteri d’offrir une vision kaléidoscopique du rire, tournant autour de son objet, jusqu’à l’épuiser.
18Car telle est l’ambition, qui peut surprendre tant elle est devenue rare aujourd’hui : celle d’embrasser un objet jusqu’à l’exhaustivité, quitte à donner au rire une extension qui mène à ses confins, quitte à donner à la mort une dimension métaphorique, comme celle qui l’assimile à la castration, via le mythe de Méduse, auquel l’ouvrage consacre de très belles pages inspirées par deux récits d’Hoffmann et par une relecture de Freud.
19La culture hilaristique de Lanteri (pour reprendre le néologisme qu’il utilise dans le sous-titre de son livre) est encyclopédique, tout comme ses références philosophiques et psychanalytiques — Freud, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche… sont régulièrement convoqués. On saluera aussi la richesse conceptuelle de son essai qui incite indéniablement à faire fonctionner les outils d’analyse mis à disposition — pour soi-même, lecteur ou spectateur, ou dans un cadre pédagogique. Quoi qu’il en soit, l’œuvre ainsi constituée est une somme. Un monument dédié au rire autant qu’aux mortels que nous sommes.

