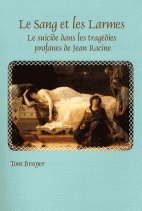
Une esthétique racinienne de la mort
1Associer la tragédie à la mort d’un personnage n’a rien d’original, associer Racine à la tragédie non plus, pourtant la rencontre du dramaturge et d’une fin d’autant plus spectaculaire qu’elle est désirée, mérite qu’on l’étudie. C’est l’opinion de Tom Bruyer qui dans Le Sang et les Larmes, Le suicide dans les tragédies profanes de Jean Racine, propose moins une lecture thématique de l’œuvre qu’un éclairage sur la manière dont le suicide participe à la compréhension de certaines pièces. Puisque « le suicide fait partie intégrante de la dramaturgie racinienne » (p. 301), il convient de se saisir d’un élément que la recherche sur le tragédien semble avoir négligé.
2Le projet se justifie tout d’abord sur le plan historique. La traditionnelle rupture du xviie siècle opposant l’esthétique flamboyante de Corneille à la retenue racinienne du règne de Louis XIV est rappelée plusieurs fois car elle a pour conséquence la disparition, chez l’auteur de Phèdre, du suicide d’honneur. Les plaies nobiliaires cèdent la place aux affres de passions exclusives. Cette évolution littéraire ne se fait pas sans heurts, qui permettent d’envisager les attentes du public contemporain aux auteurs, mais aussi de proposer une définition de la tragédie. T. Bruyer n’hésite donc pas à convoquer tous les documents critiques qui témoignent à la fois de la réception de Racine et de la constitution assumée d’une esthétique propre au tragédien. C’est par conséquent ce champ strictement littéraire qui sera valorisé. L’étude écarte ainsi immédiatement toute lecture biographique qui signalerait un attachement au thème du suicide. Le code de la tragédie réclame la mort volontaire, il ne tient pas compte d’opinions personnelles y afférant. De même, T. Bruyer met en garde contre une lecture anachronique qui chercherait à « illustrer la conception métaphysique et morale du tragique qui caractérise le sentiment d’impuissance face au malheur1 » (p. 304). L’orientation strictement esthétique assure la cohérence du propos.
3L’élaboration du corpus répond à la même exigence. En ne retenant que les tragédies profanes, l’auteur situe sa réflexion dans un cadre qui rend possible la représentation du suicide, prohibé par les religions monothéistes. On pourrait cependant discuter ce choix. En effet, outre le fait qu’Athalie soit citée à raison dans un passage mettant en évidence l’importance de la cérémonie dans le théâtre racinien, l’unité du corpus repose sur une assimilation des sujets antiques et du cadre oriental de Bajazet. Or cette différence spatio‑temporelle influe sans doute sur le traitement de la mort. D’ailleurs toutes les tragédies gréco‑latines ne sont pas traitées de la même manière et l’on pourra s’étonner de prime abord de constater que le suicide d’Œnone par exemple ne soit qu’entraperçu quand Bérénice, pièce où aucun suicide effectif ne survient, connaît un développement conséquent. Cette différence s’explique en réalité fort bien car T. Bruyer élargit son intérêt des actes aux pensées aussi bien qu’aux expressions mortifères. Il reste que cet élargissement profiterait sûrement d’une intégration des deux dernières œuvres, quand bien même leur commande par Mme de Maintenon les distingue.
4Il convient de dire que l’organisation du livre refuse de consacrer des chapitres successifs aux différentes tragédies et que l’auteur rejette l’idée d’une progression du thème au fil des années. Le livre préfère souvent associer deux pièces pour créer un jeu d’écho assez pertinent qui illustre une question que le suicide pose à la tragédie (par exemple Andromaque et Iphigénie pour révéler l’importance du cérémonial, ou les modalités du suicide exprimées à travers La Thébaïde et Bérénice).
Un panorama des différents suicides
5Sans réellement constituer une typologie exhaustive que le lecteur pourrait apprécier au prix peut‑être d’une certaine pesanteur, T. Bruyer choisit de traiter le suicide sous plusieurs éclairages apparemment indépendants mais qui concourent tous à une compréhension dynamique du corpus. La réflexion se nourrit de plus très régulièrement d’études variées qui lui permettent de toujours rebondir sur une idée, qu’il s’agisse des travaux attendus ici de Georges Forestier ou Jean Emelina, ou pour se placer en diachronie de ceux de Marie‑Noëlle Lefay‑Toury concernant l’époque médiévale2. Enfin, la fréquentation régulière avec les références antiques, Sénèque en tête, assure de la manière dont les sources sont travaillées à l’époque moderne d’une part, par la main de Racine d’autre part.
Le suicide comme marque de l’évolution du genre ?
6Dans son entreprise de présentation des suicides, T. Bruyer a soin d’immédiatement préciser qu’il n’entend pas se limiter aux seules morts effectives. Cette latitude lui donne l’occasion de traiter longuement du retrait de Junie chez les Vestales en insistant sur la mort symbolique qu’il recouvre. Or ce constat conduit à un renversement des rôles. Junie, traditionnellement vue comme la victime de la tyrannie, précipite Néron dans un désir de mort. Ce dernier désespoir n’a pas de conséquence funeste pour l’empereur, mais il signale que la forme symbolique du pouvoir change de main. D’ailleurs ce retournement s’exprime également dans la jalousie amoureuse car « Les héroïnes citées agissent en vue de s’approprier le bonheur de la rivale ou du moins en créant un simulacre d’union souhaitée avec la personne aimée » (p. 76). Ainsi Eriphile dans Iphigénie qui se sacrifie à la place du personnage éponyme pour se rapprocher d’Achille, ainsi Hermione dans Andromaque qui rejoint Pyrrhus dans la mort. Dans ce dernier cas, celle qui a commandité l’assassinat de son amant expie son crime, pervertissant en quelque sorte le modèle littéraire des amants malheureux qui s’unissent dans la mort. D’une certaine manière le bourreau devient victime. Or ce renversement révèle une particularité du théâtre de Racine dans lequel le sexe faible cesse de mériter ce qualificatif : « les héroïnes raciniennes semblent priver leurs antagonistes masculins d’un “beau trépas”, en monopolisant le droit de décider de la vie et de la mort » (p. 72). Il s’agit bien d’une rupture avec l’idéal nobiliaire héritier d’une tradition antique et que Corneille a fait sienne. Le suicide d’honneur appartient à la sphère masculine, la place accordée aux femmes par Racine oriente vers la rhétorique des passions. Il n’est pas étonnant dans ce contexte que la référence au mariage jouisse d’une importance nouvelle.
L’importance du cérémonial
7Grâce au couple de pièces, Andromaque et Iphigénie, T. Bruyer souligne l’importance de l’espace sacré pour son thème. Dans un siècle où la mort ne peut s’affranchir de l’autorité religieuse, les références profanes se parent d’atours chrétiens. Cette adaptation qui a fait réagir contre l’invraisemblance historique de certaines situations compose une cohérence dans l’œuvre étudiée. Ainsi le sacrement du mariage participe‑t‑il apparemment au décès par le biais du sacrifice assumé par les femmes. L’autel et le temple réclament que l’on se consacre à une fonction de recueillement, mais paradoxalement celle‑ci manifeste une détermination remarquable, comme celle d’Andromaque qui tient tête au roi d’Épire ou comme la résolution d’Iphigénie d’accepter sa propre immolation. Dans les deux cas, les personnages envisagent un espace autre, un en‑dehors de la scène qui représente un retrait de l’intrigue et une disparition définitive. Cette vision des femmes explique peut-être qu’elles soient plus nombreuses que les hommes à se suicider chez Racine. La manière de disparaître est corrélée au genre. En effet, on apprend qu’en regard de la « mort à la romaine », plutôt virile, qui consiste à mourir par le fer, la pendaison est méprisée parce que trop populaire mais aussi parce que renvoyant plus particulièrement aux femmes. De là s’explique en partie l’évolution de la mort de Phèdre qui meurt par la lame chez Euripide, par la corde chez Sénèque et finit empoisonnée chez Racine. Ce dernier expédient se teinte d’une idée de ruse pernicieusement distillée comme l’atteste une étude de vocabulaire qui conduit T. Bruyer à proposer une contamination de la mort par la parole. Sous l’égide de Marcel Mauss, l’auteur suggère l’existence d’un don de la parole empoisonnée qui circule parmi les personnages. Si l’idée interpelle, et si elle pourrait s’appliquer dans une certaine mesure à la Médée de Corneille, on peine cependant à en trouver des preuves convaincantes chez Racine. Il reste néanmoins que la documentation solide rend la lecture intéressante, notamment par la prise en compte de dramaturges contemporains de Racine.
Dramaturgie du suicide
8Après avoir cherché à montrer la diversité des suicides et leur résonnance dans le champ culturel, T. Bruyer s’intéresse à la part que la mort volontaire occupe dans l’économie des pièces et surtout à la manière dont elle renseigne sur l’esthétique tragique, qu’il s’agisse d’interroger les codes de ce genre particulier ou de mettre en évidence une stratégie discursive qui se fonde sur elle.
Rappel des questions soulevées par le thème
9Le premier chapitre de la seconde partie du livre, intitulée « Dramaturgie des passions et esthétique de la mort chez Racine », nous invite à reprendre les débats théoriques qui ont constitué la tragédie tout au long de l’histoire. Le sujet du livre impose de parler du dénouement où se situe ordinairement la mort des personnages. La distinction de Racine à ce propos se lit dans l’introduction de Bérénice qui défend la possibilité pour une tragédie de ne pas se solder par la fin d’un protagoniste. Cependant c’est bien la vocation de la mort sur scène qui présente le plus d’intérêt. Au-delà de la discussion sur la nécessité d’exposer le public à la violence, l’édification des spectateurs se trouve au cœur des textes théoriques et Bruyer reprend les positions de Guarini exposées dans son Compendio della poesia tragicomica (1590) qui « récuse un des poncifs de la dramaturgie humaniste en prônant que la tragédie ne doit pas enseigner la vertu. Le suicide (“l’atto volontario”), parmi d’autres actions atroces dignes de la tragédie, aide le spectateur à maîtriser sa crainte excessive devant la mort physique, la tragédie lui permettant alors d’évacuer les deux émotions tragiques de la crainte et de la pitié » (p. 190). La référence aristotélicienne semble indépassable quand bien même une autre option est adoptée. Ainsi, en rendant compte de la Poétique de La Mesnardière publiée en 1640, l’auteur précise‑t‑il que « la représentation du suicide étant d’ordinaire “illégitime” au nom de la morale chrétienne, selon La Mesnardière elle contribue cependant à l’édification morale du public. La mort volontaire constitue alors la clef de lecture pour l’interprétation morale de la catharsis aristotélicienne » (p. 196). L’ombre du Stagirite plane donc durablement ; ce constat aurait cependant sans doute pu figurer dans l’introduction du livre car il n’aboutit pas réellement à comprendre la poétique racinienne. D’ailleurs, dans ce chapitre de trentesept pages, neuf pages sont consacrées à Racine et quatre seulement au dénouement, ce qui ne correspond pas parfaitement au sujet de l’ouvrage.
Particularités raciniennes
10Les deux derniers chapitres du livre se construisent sur deux couples de tragédies. Dans un premier temps, par l’association de Bajazet et d’Iphigénie, l’auteur interroge l’innovation du dramaturge qui puise dans un fonds pour aménager une vision personnelle. Dans la pièce tirée de l’antiquité, Racine intègre un personnage de son invention, Ériphile, de manière à rationaliser les différentes strates de la légende (Iphigénie sacrifiée puis sauvée), mais cette intervention conduit également à un questionnement identitaire (Ériphile apprendra qu’elle est fille d’Hélène et se suicide sur l’autel destiné à sa cousine) qui rappelle celui d’Œdipe. À l’opposé, dans Bajazet, Racine semble reprendre la cruauté orientale attendue par ses contemporains. On pourra s’étonner à ce sujet de la note qui attribue au xviie siècle l’idée d’un despotisme oriental soutenue par « Mitchell Greenberg [qui] observe un shift dans la représentation du souverain oriental qui évolue d’un monarque légitime […] à la figure répugnante du despote sanguinolent » (p. 240). Les textes politiques du xvie siècle n’ont de cesse en effet de stigmatiser l’usage d’une force brutale observée en Orient, héritiers en cela d’une tradition bien plus ancienne qu’a étudiée François Hartog3.
11Le dernier chapitre s’intéresse aux modalités du suicide en distinguant deux extrêmes. Tout d’abord, La Thébaïde, où le spectateur assiste à plusieurs morts volontaires, insiste sur la liberté de tels actes. Contrairement au fatum ancien, les personnages raciniens se veulent maîtres de leur vie et n’en viennent à la dernière extrémité que pour agir définitivement sur une situation qui leur échappe. T. Bruyer parle ainsi de « chantage mortel » (p. 259) qui contraint les survivants à composer avec une mort qui a la force d’un argument. À l’opposé de cette grande tuerie, Bérénice,qui ne verra mourir personne, reprend un fonctionnement identique. En effet, le suicide y apparaît comme une « arme rhétorique par excellence » (p. 269). Racine opère donc une transformation radicale : le suicide semblait, notamment avec Corneille, la marque d’une bravoure supérieure, dans Bérénice cette grandeur se gagne par le renoncement à la mort.
***
12Le livre de Tom Bruyer traite bien sûr de son sujet, le suicide dans les tragédies profanes de Racine, mais d’une manière originale qui met en évidence des renversements dramatiques : l’évolution du bourreau en victime, la paradoxale force des personnages faibles, mais aussi plus subtilement l’emploi du suicide comme une menace dont une des forces consiste à ne pas avoir lieu. Les références culturelles et bibliographiques sont très nombreuses et assurent une validité académique incontestable. Néanmoins, cette qualité révèle aussi ses faiblesses. Le lecteur rencontre en effet toutes les figures attendues (Girard, Genette, Barthes, Mauss, Scherer, Uberfeld…) sans que leur mention soit toujours indispensable. À l’inverse, certaines pistes qu’elles proposent ne sont pas toujours approfondies. Par exemple, il est sensé de rappeler que « La double articulation texte‑représentation demeure essentielle aux yeux d’Anne Uberfeld dans toute “lecture” du théâtre » (p. 20), mais ce rappel crée l’attente d’une analyse des procédés scéniques concernant le thème étudié (la mort d’Atalide sur scène évoquée p. 245 se solde sur le constat déceptif : « Aucune didascalie ne nous renseigne sur le moment précis où ce suicide doit se produire sur scène », p. 246).
13Dans le même sens, la très fréquente mention de l’ironie auquel l’auteur ne consacre pas réellement de développement (ne serait‑ce que pour la définir précisément) frustre tant on sent qu’elle lui tient à cœur et qu’elle pourrait participer à ce renversement dont il a déjà été fait mention. Or la répétition exacerbe l’attente, « l’ironie tragique » est une expression qui attend son traitement, et la phrase « Racine exploite à fond le ressort dramatique de l’ironie dramatique » (p. 242) embarrasse par son absence de précision. Les nombreuses occurrences de ce terme coïncident si peu avec la lecture traditionnelle de Racine, que le lecteur songe immanquablement à Voltaire. En effet, cette caractéristique semble si évidente que « Racine se plaît souvent à ironiser lui‑même, presque inconsciemment » (p. 71). Par ailleurs, cette caractéristique conduit à un bouleversement générique total puisque « Dans le sillage de Raymond Picard, Jacques Scherer n’hésite pas à invoquer le passage du tragique au comique comme clef d’interprétation de mainte tragédie racinienne » (p. 61). Cependant, la promptitude avec laquelle le public ridiculise des passages ne justifie pas naturellement une appropriation des éléments comiques par le tragédien. T. Bruyer se montre d’ailleurs parfois gêné autant que séduit devant cette idée : « Sans reproduire le jugement dépréciateur du critique [Marcel Gutwirth] à l’encontre d’une possible interprétation comique de Mithridate, nous ne pouvons toutefois écarter cette piste subversive » (p. 62). La subversion réclame toutefois des preuves claires pour avoir quelque portée, et l’idée reprise de Jonathan Mallinson (p. 285) selon laquelle la peine de Titus devant le désespoir de Bérénice correspond à un épisode comique, surprend plus qu’elle n’emporte l’adhésion. Sans doute faudra‑t‑il parcourir les ouvrages cités pour découvrir une lecture innovante et drôle des pièces de Racine.
14Il reste que le livre montre l’intérêt d’un thème précis dont la richesse refuse une synthèse contraignante. Les pistes abordées ne sont pas généralisées à l’ensemble du corpus, mais il s’agit bien là d’un indice par lequel on reconnaît une étude se saisissant d’outils nombreux et pertinents.

