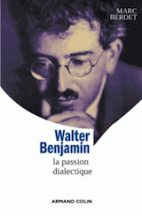
Benjamin, dialecticien de la culture
1La pensée de Walter Benjamin (1892-1940), tendue entre philosophie, sociologie de la culture et critique littéraire, demeure d’une brûlante actualité. Bien que des pans entiers de ses Gesammelte Schriften (Œuvres complètes) continuent de demeurer inaccessibles au lectorat français, des nombreuses éditions de référence et des travaux exégétiques de grande qualité ont vu le jour dans les deux dernières décennies. Entre l’excellente synthèse critique de Rainer Rochlitz1 et la récente réédition du chantier benjaminien sur Baudelaire (avec des fonds d’archive inédits2), un point commun demeure : la tentative de trouver un centre de gravité à une œuvre hétéroclite, hybride, excentrique. L’ouvrage de M. Berdet, publié dans la collection « Comprendre » (Armand Colin), se place d’emblée, par sa teneur exégétique et la richesse des fonds d’archive mobilisés, dans ce renouvellement de la réception critique du penseur allemand. À mi‑chemin entre initiation chronologique à l’œuvre et essai sur la question dialectique dans sa pensée, il constitue un outil précieux pour entrer dans une pensée multicentrée et réputée difficile d’accès, car bouleversant les routines disciplinaires et académiques de production du savoir. En conjuguant les qualités pédagogiques et analytiques qu’un tel format de manuel requiert, Walter Benjamin. La passion dialectique est également doté — last but not least — d’un appareil critique bilingue (français/allemand) parfaitement maîtrisé.
2Dès l’exergue, le lecteur est introduit à la singularité de la pensée dialectique de Benjamin, dans le champ des philosophies hégéliano-marxistes, d’un côté, et de la Kritische Theorie, de l’autre. En reprenant un extrait de la « Conversion avec André Gide » de Benjamin, M. Berdet situe parfaitement cette singularité : la dialectique pratiquée par le philosophe ne se réduit pas à une pure « méthode de l’intellect » mais épouse une « revendication passionnelle des extrêmes ». Voici synthétisée l’économie de raison et de sensibilité, d’intellect et de passion, d’engagement et de distanciation, qui caractérisa la démarche philosophique de Benjamin. Voici cristallisée, surtout, la contradiction motrice qui en fit fonctionner si singulièrement la pensée, déployée entre la sociologie, la philosophie et la critique littéraire : contrairement au paradigme hégéliano-marxiste, il n’a jamais été question pour Benjamin d’organiser les manifestations de la vie historique afin d’atteindre une synthèse générale, un modèle totalisant, une explication synthétique. Il fallait, tout au contraire, les prendre dans leurs « extrêmes », dans leurs polarités, dans leurs écarts, afin de retrouver, au cœur des choses mêmes et de manière très inductive, l’intégralité de la vie historique.
3Ce raisonnement, M. Berdet le restitue admirablement, en plongeant dans les différentes régions de l’œuvre benjaminienne : la métaphysique, l’esthétique du baroque, la trilogie politique sur les catégories du pouvoir et du droit, le gigantesque chantier sur les Passages parisiens et Baudelaire, l’analyse des rapports entre l’œuvre d’art et la reproductibilité technique, le testament spirituel sur l’histoire.
4Une césure et une constance traversent ainsi l’œuvre benjaminienne, telle que présentée par Berdet. La césure est l’année 1924, où des « clignotants communistes » s’allument sur la route du philosophe, qui se confronte dès lors de manière plus systématique à la méthode du matérialisme historique (p. 18). La constance est la démarche dialectique, entendue comme une manière d’organiser la pensée, dans son rapport à l’objet, axée sur les contradictions et l’impossibilité de les dépasser ; c’est pourquoi la dialectique benjaminienne, unique en son genre, est une dialectique à l’arrêt (Dialektik im Stillstand), ouverte non vers la « solution des tensions », mais vers l’arrêt cristallisant les contradictions en mots et en images (p. 21‑22). Deux textes constituent, en ce sens, les points de gravitation du premier et du deuxième Benjamin : les Origines du drame baroque allemand (1924-1925) et le Livre des passages (1927-1940). Deux « points de repères » ou « motifs centraux » sont d’ailleurs choisis par M. Berdet afin de restituer la pensée benjaminienne, entre discontinuités et permanences : « la quête de l’origine » et « le statut de l’expérience à l’heure de la modernité » (p. 19). C’est in fine la notion de culture qui permet d’articuler ces deux topoi benjaminiens, dans la mesure où elle permet de lier la question de « l’origine des productions culturelles (le moment originaire où l’homme peut s’arracher au mythe pour entrer dans l’histoire) » et « celle de l’expérience que les hommes en font ici et maintenant, en particulier dans la métropole moderne » (ibid.). La problématique à travers laquelle M. Berdet choisit de restituer l’unité de l’interrogation benjaminienne est donc la suivante : comment relier, dans l’analyse dialectique de la culture, les catégories présidant à la genèse des différents domaines de la culture elle-même (le jeu, le droit, la création artistique, l’éducation, le récit, le temps) et celles que les hommes mettent en jeu dans leur expérience quotidienne, dans la pratique même de la culture ?
5Cette problématique est ouverte à la question politique, mais de manière substantiellement différente par rapport aux approches dialectiques hégéliano-marxistes. Si pour celles-ci, le politique tient à la résolution des contradictions socio-historiques, ce qui suppose un savant éclaireur, pour la « dialectique à l’arrêt » telle que l’imagine Benjamin, une telle solution n’a plus lieu d’être3. Le savant doit cristalliser les contradictions traversant la culture moderne, dès lors que celle-ci est projetée vers son origine : tout au plus, il en retiendra une image. Cette modestie n’équivaut pas à fermeture au politique car, comme le souligne M. Berdet, il en va ici du changement même de la vie :
Si un détail microscopique attire le regard de Benjamin, c’est parce que, révélateur d’une modernité dont on fait aujourd’hui encore l’expérience, il porte aussi en lui une résistance qui empêche les passions trop longtemps comprimées de se libérer : un jupon, une publicité, le nom d’une place, une scène de théâtre, un poème, une grève, une architecture, un film et une anecdote historique peuvent, s’ils sont bien compris, changer la vie. (p. 22)
Topoï de l’origine : métaphysique, critique littéraire & Trauerspiel
6La question de l’origine des productions culturelles se décline dans des lieux multiples dans le parcours du philosophe allemand. Sa première acception, dans les travaux de jeunesse, est puisée dans le romantisme : en écho au combat du jeune Werther, Benjamin s’insurge contre la puissance mortifère et conformiste de la culture bourgeoise, et s’interroge sur les catégories ayant présidé à son émergence. Comment des formes de culture aujourd’hui poussiéreuses ont pu surgir, à un moment ou à un autre, de la vie ? C’est ici que la problématique des origines se noue à celle de la « jeunesse », sur laquelle Benjamin réfléchit à partir de la pédagogie émancipatrice de Wyneken (p. 25‑32), en opposant l’élan vital des jeunes à la culture philistine des adultes (p. 33‑41). Le domaine de la jeunesse, que Benjamin aborde en sa qualité de représentant du mouvement estudiantin et dans le but de contribuer à une réforme de l’éducation, lui permet d’éprouver, pour la première fois, la « dialectique à l’arrêt ». Les jeunes étudiants, dit‑il, ne doivent pas s’engouffrer « dans le langage anachronique de la culture et de la tradition des générations passées », mais réactiver des projets, des rêves, des utopies permettant de « libérer l’avenir » (p. 38‑39).
7La question de l’origine, tout en maintenant son articulation génétique avec la vie (Leben), trouve ensuite un bain de jouvence durable dans le judaïsme, la théologie et la métaphysique. C’est alors la question du langage qui occupe Benjamin, dans une confrontation philologique constante avec les textes sacrés. Derrière la Bible, Benjamin entrevoit une théorie de la connaissance fondée sur le pouvoir créateur du langage : l’homme connaît en nommant, et fait advenir à travers le langage. Ce stade adamique du langage, qui servira plus tard au philosophe pour penser la nature du processus de création artistique, est opposé à la Chute de l’Éden : celle‑ci enclenche une scission douloureuse entre le langage, l’homme et les choses, en même temps qu’une déchéance de l’homme à l’état de coupable. Scission génératrice du pouvoir donc, selon deux chemins différents. D’un côté, derrière la scission de l’ancienne unité adamique gît la possibilité que certains groupes d’individus s’approprient et détournent le pouvoir du langage, en jouant de sa nouvelle indétermination : Benjamin s’achemine ici vers une critique de l’usage bourgeois du langage « qui se sert des mots comme de véhicules vides d’un sens extérieur » (p. 45). De l’autre côté, la scission du langage, de l’homme et des choses est génératrice du pouvoir, le verdict divin constituant une grammaire générative pour le verdict judiciaire et, plus généralement, pour le droit humain (ibid.).
8Mais rien n’est perdu à jamais : afin de restaurer une expérience authentique, il faut renouer avec la dimension nominative et magique du langage. C’est dans le territoire des analogies poétiques, dans la tâche du traducteur (p. 48‑51) ou du critique (p. 51‑52), pensées à partir de l’exemple du romantisme de Iéna et des figures de Hölderlin, Schlegel et Goethe, que l’on peut retrouver l’ancienne fonction du langage. Or, une telle actualisation ne vaut pas, comme le souligne à juste titre M. Berdet, uniquement pour ses enjeux critico-littéraires : elle se situe d’emblée dans un questionnement ouvert au politique. Derrière la littérature, Benjamin entrevoit une dialectique constamment rejouée entre l’origine mythique de la culture, l’arrachement au mythe par le langage ou la création, et la rédemption messianique, pensée à partir de l’ouverture utopique. Cette construction du politique au cœur même de la critique littéraire, sur laquelle Benjamin revient dans sa Thèse d’habilitation consacrée au drame baroque allemand, constitue le socle premier sur lequel s’érigent d’autres questionnements plus proprement politiques, sur la violence du droit, les catégories de l’histoire, l’appropriation de l’œuvre d’art par les masses. Bien que l’auteur identifie la projection politique du « jeune » Benjamin, cette dimension, sans doute difficile à saisir en raison de la polysémie que l’attribut politique recouvre dans l’œuvre du penseur allemand, n’est pas suffisamment reliée aux travaux de maturité4.
L’ouverture au politique
9Dans le chapitre « Une trilogie politique », M. Berdet identifie dans le politique une thématique majeure du seuil de la maturité. Le lecteur est ici confronté à un intelligent travail de reconstruction de la problématique du politique au cœur même d’une trilogie imaginée en 1920 et dont il ne reste aujourd’hui qu’un volet, le célèbre texte sur la « critique de la violence ». Élaborée suite à la rencontre avec E. Bloch, la pensée politique de Benjamin met en tension les catégories du religieux, la question de la violence et les catégories du politique (la liberté, l’action, la communauté). Tout d’abord, elle réhabilite le religieux, producteur d’utopie et d’élans messianiques, comme boussole pour l’agir politique :
Lorsqu’un homme souffre et aspire au bonheur par exemple, le monde divin s’intensifie, et cela peut générer en retour des mouvements politiques. Tout comme dans « La vie des étudiants », la sphère métaphysique semble rigoureusement séparée du monde profane, mais peut toujours agir sur lui via des individus éprouvés qui s’en servent comme boussole pour orienter leur action. En tout cas la politique, écrit Benjamin, ne doit rien vouloir, car vouloir imposer des fins, même religieuses, reviendrait à ruiner le royaume messianique que l’on prétend servir. (p. 114)
10L’agir politique demeure pensé en étroite articulation avec la manifestation d’une liberté, la critique d’une domination, la réalisation d’une autonomie. Benjamin clarifie cette position en opposant le politique à la sphère du pouvoir, indissociablement liée à l’administration de la violence (p. 115). C’est dans le cadre de sa « critique de la violence » que ce thème est largement exploité : « Son cadre d’intervention est celui d’un démontage du droit bourgeois et de la violence dite légitime d’État » (p. 117), avec deux « temps forts : d’abord une déconstruction de la violence légale pour en révéler le fond mythique ; puis une réhabilitation de la violence divine qui, actualisée par les anarchistes, pourrait délivrer les sociétés humaines de l’injustice » (p. 118). Cette analyse aboutit à la valorisation de la grève ouvrière, avatar de l’utopie, contre la grève révolutionnaire, entendue comme une résurgence mythique du pouvoir (p. 128). Le politique se définit ainsi en étroit accord avec l’utopique, comme le souligne M. Berdet dans une belle transition argumentative :
Ce mot d’utopie, il faudrait peut être l’entendre en deux sens, étymologique et politique : d’une part, comme ce qui n’a pas lieu, ce qui demeure « sans lieu » ; d’autre part, comme tableau littéraire d’une humanité anticipée. […] D’un point de vue normatif, [ces fables épistémologiques] pourraient agir comme dans un discours de type politique, celui du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau par exemple, qui montre, avec sa fable du bon sauvage, ce qui manque à l’homme pour être complètement accompli. C’est en ce sens qu’il faudrait comprendre la première définition benjaminienne de la politique qui communique avec sa métaphysique de jeunesse, « satisfaire une humanité non-accomplie ». (p. 134‑135)
Les formes de l’expérience moderne
11Le déclencheur de la deuxième thématique benjaminienne, à l’origine du « cycle français » de la maturité, est une plongée dans les archives de la vie culturelle parisienne du xixe siècle. Benjamin y voit le moment génétique de structuration de la modernité capitaliste, avec ses tensions et contradictions. C’est ainsi dans le but de comprendre l’origine des catégories de l’expérience moderne, où les rapports à la ville, à la marchandise et au temps s’entrecroisent dans un écheveau indémêlable, que Benjamin s’attelle au chantier des Passages.
12Dans ce travail archéologique, comme pour les travaux de jeunesse, c’est la focale messianique, rédemptrice, révolutionnaire qui oriente le regard. En reprenant la dialectique hégéliano-marxiste, Benjamin montre dans son analyse de la vie parisienne au xixe siècle que les catégories de la domination capitaliste ouvrent à trois types d’expérience : « l’“expérience vécue” (Erlebnis), poison du sensationnel propre aux fantasmagories bourgeoises, l’“expérience du choc” (Chockerlebnis) dans la grande ville, en particulier pour la masse, et l’“expérience historique” (Erfahrung) de l’éveil » (p. 142). Cette tripartition choisie par M. Berdet est éclairante à double titre : d’une part, d’un point de vue proprement philologique, elle rend compte de la pluralité des significations de l’« expérience », mot extrêmement polysémique en allemand, repérables dans l’œuvre de Benjamin. Ces différentes acceptions, loin de pouvoir être dissociées ou opposées de façon étanche, doivent être dialectisées dans l’analyse, comme le souligne M. Berdet. D’autre part, d’un point de vue méthodologique, cette tripartition rend compte d’une unité de fond de l’enquête benjaminienne sur les formes de l’expérience moderne. Entre Paris, capitale du xixe siècle et Charles Baudelaire, le geste analytique de Benjamin consiste à montrer que derrière la domination symbolique du capital, dans les catégories mêmes de cette domination, est nichée la lueur d’une libération possible, d’une nouvelle accélération de l’histoire. Bref, d’une émancipation politique des masses. Benjamin semble ainsi déplacer la question politique au cœur même de l’analyse historique des catégories de la modernité et de l’enquête sociologique sur les pratiques sociales.
13Entre les décors d’intérieurs bourgeois (p. 144‑147) et l’architecture des nouvelles Expositions marchandes et industrielles, les produits industriels destinées à l’exposition et les images de mode (p. 148‑150), l’esthétisation de la marchandise dans les Passages (p. 170‑171) et la marchandisation de tous les produits sociaux, y compris artistiques et littéraires (p. 173‑176), l’on trouve un même « imaginaire capitaliste » et une même « idéologie bourgeoise » en voie de constitution. Il s’agit de faire de la ville une gigantesque « terre d’aventure », de se représenter l’espace social comme une collection d’espèces naturelles, d’assouvir un « besoin de sensation » propre à des individus aux nerfs surstimulés5 et de jeter les bases d’une ferme croyance dans le progrès. Bref : d’étoffer une « expérience vécue » du capitalisme en passe de pénétrer et structurer durablement l’imaginaire collectif et les consciences :
Car, qu’il s’agisse de l’homme-étui, du collectionneur, des commission organisatrices des Expositions universelles ou d’Haussmann, à des degrés divers, la conscience rêve selon un processus délirant de refoulement. Elle effectue une transfiguration (Benjamin emploie souvent le terme de Verklärung) des conditions techniques, économiques et sociales dans un rêve sensationnel qui joue avec des images lointaines pour assoupir la multitude des grandes villes. Benjamin écrit en effet que « le capitalisme fut un phénomène naturel par lequel un sommeil nouveau, plein de rêves, s’abattit sur l’Europe, accompagné d’une réactivation des forces mythiques ». Le sujet de ce sommeil est la bourgeoisie. Les forces productives nouvelles (machines, fer, verre, ouvriers) font pression pour renverser des rapports de production inadaptés à cette nouvelle ère, mais la classe dominante veut dormir encore un petit quart d’heure…ou un petit quart de siècle. (p. 152)
14Bien que l’influence freudienne ne soit pas suffisamment approfondie par M. Berdet6, un parallèle peut ainsi être construit, à titre de méthode d’analyse, entre l’analyse psychanalytique des rêves et l’analyse sociologique de la culture. Tout comme la vie psychique manifeste et refoule à la fois l’inconscient sexuel, la culture manifeste et refoule à la fois, dans l’imaginaire collectif, l’inconscient économique. Ce parallèle est très fécond heuristiquement pour comprendre l’inversion, sur laquelle M. Berdet passe trop rapidement (p. 164), que propose Benjamin de la méthode du matérialisme dialectique : passer d’une analyse univoque de la détermination économique du culturel à une analyse biunivoque de l’expression de l’économique dans le culturel.
15Le rêve dont la société bourgeoise se leurre, par l’« expérience vécue » capitaliste, est ainsi compris entre la reproduction de la domination et la possibilité d’un éveil, social et politique. La culture capitaliste les porte ensemble, comme les deux faces d’un même objet : c’est à l’analyste de séparer le bon grain du contenu utopique de la culture, qui peut servir de grammaire émancipatrice aux masses, de l’ivraie du mythe dominateur.
Benjamin se propose d’interpréter l’imagination allégorique du point de vue de l’histoire. L’allégorie balance sans cesse entre deux pôles opposés, spleen et idéal, mélancolie et sublime, tendances suicidaires et esprit de révolte. Il faut stabiliser cette hésitation perpétuelle dans une image qui fixe les polarités, dans un arrêt sur images qui permet de voir toutes les tensions en présence. Une telle stabilisation permettra de récupérer quelque chose de l’expérience sensationnelle des mythes modernes (position) après leur dissolution dans l’expérience des chocs de la vie urbaine (négation), d’en faire voir « l’extrait » ou le « précipité » que l’acide de l’expérience du choc (Chockerlebnis) dégage au sein même de la pure sensation vécue (Erlebnis) sous la forme du cristal de l’expérience authentique du devenir collectif (Erfahrung). Autrement dit, il reste insuffisant de saisir la situation économique et sociale, encore faut-il retourner au rêve de son dépassement en libérant ce dernier des archaïsmes qui l’encombraient dans de fausses synthèses : ni rêve ni veille, mais éveil. (p. 181).
16Ce travail relève de la « dialectique de l’arrêt », une dialectique construite dans le prolongement d’Hegel, Marx et Bloch, repensés à travers le concept central d’allégorie (p. 183‑189 ; p. 200‑202). Grace à ce travail critique, Benjamin peut retrouver derrière les forces de la marchandise déployées dans les Passages, des images utopiques, comme l’humanité émancipée des phalanstères de Fourier (p. 191‑193).
17Mais ce travail critique suppose également (ce que M. Berdet ne dit pas) une orientation phénoménologique du regard, à même de saisir, dans les perceptions ou les usages de la culture, souvent tributaires de la nouvelle « puissance de choc » de la ville moderne, la production de nouvelles catégories libératrices. Ce point devient crucial dès lors que le regard de Benjamin se porte sur les nouveaux rapports à l’œuvre d’art rendus possibles par la reproductibilité technique et le déclin de l’aura (p. 205‑243). Le philosophe y voit un élargissement des possibles de l’expérience esthétique et l’apparition d’un nouvel équilibre entre compétence et plaisir, entre individuel et collectif, dans la réception, ce qui la dote d’une virtualité politique. Ce prisme phénoménologique, qui fait de Benjamin un sociologue de l’expérience esthétique ouvert à la question politique, est l’une des passerelles fondamentales entre les deux textes fondamentaux du « cycle parisien », Paris, capitale du xixe siècle et L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique.
18Ici, le prisme dialectique adopté par M. Berdet semble produire autant de lumières que de régions d’ombre. Il occulte en effet une spécificité du regard (souvent appelé « micrologique ») que Benjamin déploie sur un matériau empirique (littéraire, artistique, d’archive) accumulé au fil de vingt ans de recherches. Bien que la question dialectique reste l’un des fils conducteurs de son œuvre, la plongée dans l’empirie, dans les archives des rêves du xixe siècle ou dans les formes d’expérience esthétique qui lui sont contemporaines (cinématographique par exemple), est solidaire de la production progressive d’un nouveau regard. Phénoménologique de par son insistance sur les catégories de la conscience, les modalités de perception, les formes de l’expérience, ce nouveau regard permet ainsi de complexifier la construction du politique du philosophe. Défini comme l’ouverture de nouveaux possibles par l’utopie dans Paris, capitale du xixe siècle, il semble « se disséminer » dans les modalités concrètes de l’expérience esthétique dans L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique. D’une définition imagée, il semble muer vers une définition presque catégorielle, ce qui le rend soluble, une fois de plus, dans une sociologie de l’expérience ou de la réception.
Éléments de critique & prolongements
19La synthèse de Marc Berdet a l’avantage d’apporter, à l’intérieur d’une œuvre hétéroclite et difficile d’accès, tiraillée entre une réception savante spécialisée et des usages « braconniers » parfois peu rigoureux de la part des non-spécialistes, une ligne problématique claire et cohérente. Quand bien même il s’agisse d’un parti pris interprétatif (quelle lecture d’un auteur peut se targuer de « neutralité » ou de totalité du regard ?), la question dialectique vient éclairer des pans entiers de la pensée benjaminienne, souvent dissociés selon une logique de thèmes, d’objets, de périodes de la production intellectuelle. Le fil rouge tissé entre la question de l’origine, abordée dans les thèmes de la jeunesse, de la genèse du droit et de la langue, ou de l’archéologie de l’histoire, et la question de l’expérience, déclinée dans les différentes manifestations de la modernité (les passages, la reproductibilité technique), constitue une bonne clef d’entrée dans la pensée d’un auteur rétif à tout réductionnisme ou à toute lecture univoque.
20On regrettera alors uniquement un élément dans la présentation : que l’auteur ait choisi de ne pas consacrer de développements aux « usages » de Benjamin dans la philosophie et les sciences sociales. Un tel approfondissent n’aurait guère nui à la restitution de la trajectoire de pensée : un auteur est également ce que l’on en fait, et ce d’autant plus que l’œuvre de Benjamin demeure, par les problèmes de traduction et d’appropriation disciplinaire qu’elle suppose, éminemment « ouverte ». Or, le lecteur s’interrogeant sur les usages de Benjamin, dans les domaines de l’anthropologie, de la sociologie et de la philosophie, ne trouvera ici qu’un menu programme. Pour ne faire que trois exemples : la critique de la violence du droit et la notion de « vie nue », élaborées dans le cadre de la « trilogie politique » reconstruite par Berdet, ont été centrales pour la refondation, en dialogue étroit avec Foucault, du paradigme biopolitique dans la figure de l’Homo sacer7. La théorie de l’enfance et du jeu esquissée par Benjamin a été largement importée, par l’accent qu’elle met sur l’autonomie du joueur et sur les catégories propres à sa pratique, dans les récents développements des Game Studies8. Les réflexions de Benjamin sur l’« histoire à rebrousse-poil » ont fait couler beaucoup d’encre dans la théorie historiographique, en confrontant les historiens à la question de l’historicité et du positionnement politique face à l’objet9. Ces exemples pourraient d’ailleurs être multipliés, en évoquant les réappropriations, parfois sauvages, de Benjamin, pour caractériser la condition post-moderne, ou les travaux, à cheval entre sociologie et philosophie, se saisissant de la question de l’utopie pour penser le statut du conflit politique10. Il eût été très fécond de retracer ces usages et plus particulièrement les inflexions analytiques qu’ils commandent à la problématique benjaminienne, afin d’identifier quelques éléments pour les postérités de l’auteur. Il ne reste qu’à espérer que ce sujet fasse l’objet du prochain ouvrage de M. Berdet.

