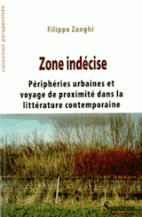
L'écrivain en visiteur périurbain
1Cet essai de Filippo Zanghi s’inscrit dans un champ critique en plein essor : l’interaction des études littéraires et des études urbaines. Selon une approche plus liée à la géographie littéraire d’un Michel Collot qu’à la géocritique de Bertrand Westphal1, l’ouvrage explore un riche corpus littéraire contemporain à la lumière des catégories d’analyse formées par le géographe ou le sociologue. Il fait ainsi ressortir les formes d’expérience et de pensée de l’espace que le texte littéraire met en jeu. L’essai se distingue à la fois par ses qualités d’écriture et par la grande finesse de ses analyses, qui articulent avec brio vue d’ensemble et commentaire de détail. Dans un style clair et plaisant, l’ouvrage développe une réflexion très structurée qui témoigne d’une ouverture bienvenue aux travaux récents en géographie, en sociologie et en anthropologie de la ville.
De la banlieue aux périphéries urbaines
2L’essai témoigne de l’intérêt croissant, au sein de la littérature française contemporaine, pour l’exploration des marges urbaines, quartiers sensibles et zones d’ombre de la ville moderne. Prenant acte des insuffisances du terme de « banlieue » pour penser les espaces urbains liminaires, il lui préfère l’expression de « périphérie urbaine », qui possède le double avantage de ne pas faire écran à la connaissance du terrain sous l’amas de représentations stéréotypées, et de permettre une lecture plus fine des zones concernées, à travers la triade urbain/suburbain/périurbain substituée à un clivage ville/banlieue aujourd’hui daté. Sans méconnaitre la difficulté de trouver dans ce domaine une terminologie à la fois précise et non connotée, on peut néanmoins se demander si la substantivation de l’adjectif « périphérique » ne maintient pas, de manière involontaire et atténuée, un rapport hiérarchique entre des territoires centraux et d’autres secondaires qui seraient voués à graviter autour des premiers2.
3F. Zanghi ne s’intéresse pas directement ici à la « littérature des banlieues », mais privilégie les explorations périphériques qu’entreprennent six auteurs parisiens, à travers des formes d’écriture bien distinctes : Jacques Réda, Jean Rolin, Philippe Vasset, François Maspero, Denis Tillinac et François Bon. Si ce corpus semble au premier abord hétérogène, allant de la prose poétique rédienne au reportage d’un J. Rolin ou au journal de bord d’un Fr. Bon, il trouve une certaine unité générique dans le choix résolu de formes non fictionnelles, qui permet d’envisager ces écritures sous l’angle des « narrations documentaires » théorisées par Lionel Ruffel3. Mais c’est surtout l’attention au « projet viatique » (p. 21) en jeu dans ces œuvres qui motive leur regroupement : ayant renoncé au traditionnel récit de voyage mis à mal par Michaux et Lévi-Strauss, leurs auteurs pratiquent des incursions plus ou moins brèves dans les périphéries franciliennes, que F. Zanghi propose de nommer des « voyages de proximité » (p. 18). Prévenant la mise en cause d’un corpus aussi « parisien » pour parler des banlieues, F. Zanghi tente de renverser en avantage ce point de vue socialement marqué, en valorisant la rencontre avec les formes d’altérité – spatiale, sociale, identitaire – que de tels déplacements engendrent. Ces œuvres permettraient de creuser un certain « différentiel », suivant l’expression de Claude Reichler4, entre la vision a priori de la périphérie urbaine, et celle qui résulte du travail d’enquête sur le terrain et de sa mise en texte. En quoi une telle démarche peut-elle renouveler notre vision des périphéries urbaines ?
4L’interrogation qui forme le fil directeur de l’ouvrage dépasse l’herméneutique littéraire pour porter sur le rapport de l’écriture à son contexte social : il s’agit de mesurer l’impact potentiel de ces voyages de proximité sur le lecteur, pour voir s’ils aboutissent à une revalorisation du regard sur les périphéries urbaines. Est-ce que le « différentiel » épistémique et affectif qui sépare l’avant et l’après du voyage conduit à des transformations réelles du discours littéraire sur ces espaces ? Prenant appui sur un vrai travail de différenciation des œuvres à travers une série d’analyses microstructurales, F. Zanghi fait ici une réponse contrastée, qui soutient l’hypothèse d’une « requalification » partielle des périphéries urbaines.
Le voyageur & la ville
5La flânerie, la déambulation urbaine, la littérature de voyage, constituent autant de traditions auxquelles peuvent se rattacher les œuvres abordées, mais qui pourtant ne les spécifient pas de manière complètement satisfaisante. Il faut donc admettre que cette requalification s'appuie sur une part de nouveauté ou de différence, que les premiers chapitres de l'essai tentent de circonscrire. Cette irréductible spécificité tient à la nature des liens qui unissent plusieurs composantes majeures des projets d'écriture des différents écrivains : l'ampleur des parcours, la nature ou le « type » d'espace parcouru, la relation à l'espace urbain et plus généralement au paysage, ou encore le point de vue adopté.
6Dès lors, les auteurs partagent des éléments communs qui justifient leur assimilation à des « voyageurs de proximité ». La « cartographie » de leurs itinéraires, rendue relativement facile par les nombreuses références aux localités, permet de conclure que la « zone des voyages de proximité » correspond à « l'échelle de l'aire urbaine parisienne » (p. 33). Le trajet de Fr. Maspero et d'Anaïk Frantz, ce « Roissy-Express » imaginaire, représente comme le squelette de cette aire urbaine, entendue selon l'INSEE comme l'espace défini par les migrations pendulaires qui joignent le pôle urbain à des pôles résidentiels. Par ailleurs, les voyages de proximité sont généralement « effectués à pied » (p. 37), à rebours des pratiques dominantes qui tendent à faire de l'automobile le moyen de transport privilégié. Enfin, et l'on reconnaîtra ici l'influence de Georges Perec et de l'OuLiPo, un certain esprit de contrainte préside au déplacement : J. Rolin délimite une zone de parcours à laquelle se tiendront ses nombreuses pérégrinations, tandis que Ph. Vasset choisit de visiter exclusivement les « zones blanches » de l'agglomération parisienne. Bien sûr, si l'on entre dans le détail de chacune des œuvres, les nuances abondent. J. Réda, entre autres, se cantonne souvent au Paris intra-muros et aux communes proches ; Fr. Bon décide précisément de s'interdire l'usage de la marche à pied et les arrêts en gare pour interroger la perception de l'espace depuis le wagon du train. De même, il paraît plus difficile de réunir ces auteurs lorsqu'il s'agit de comparer les « types » d'objets spatiaux qu'ils privilégient : certains, comme Ph. Vasset, sont experts en lieux ouverts, indécis, éphémères, quand d'autres, comme J. Réda, interrogent tout aussi bien le bâti que les « ruines », le passé qui affleure ou l'avenir qui s'esquisse. Il n'en demeure pas moins que, comme le constate F. Zanghi (p. 37), un certain mouvement de décentrement est à l’œuvre, qui pousse les voyageurs vers les périphéries proches, et vers ce que généralement on ne regarde pas.
7Parallèlement à cette part de nouveauté, il est bon de réinterroger les œuvres étudiées à la lumière des traditions littéraires qui les ont nourries et qui en conditionnent la lecture : les littératures des xixe‑xxe siècles ont largement contribué à fonder, voire à figer des pratiques urbaines et des postures d'auteur face à la ville. Ainsi sont étudiées ce que Filippo Zanghi identifie comme trois « manière[s] d’être dans la ville qui [sont] historiquement constituée[s] », à savoir la « fenêtre perceptive », « le mélange » et « la flânerie » (p. 125). Le constat est globalement celui d'une persistance de ces schèmes de perception et de description de l'espace urbain (auxquels peuvent s'en ajouter d'autres, comme le panorama par exemple), sans pour autant que l'image et la conception de la ville restent similaires. Au contraire, il semblerait que malgré les lieux communs abondamment diffusés à travers tous types de supports médiatiques, notre époque connaisse un affaissement du mythe de la ville, et de sa vision pittoresque ou sublime.
8En ce qui concerne la « fenêtre perceptive », un des cas les plus éclairants est sans doute celui de J. Rolin. Dans La Clôture, il radicalise le recours à ce dispositif de perception au point de le dévitaliser. Cette banalisation intervient en même temps qu'un renversement axiologique de ce à quoi elle permet d'accéder : la vue de Paris ou de ses environs ne permet plus une saisie grandiose, mais marque « au contraire un essoufflement de la ville-paysage, produisant ainsi un anti-paysage » (p. 113). Comme on l'a déjà vu, le corpus étudié permet d'ailleurs moins d'interroger le territoire urbain central que celui de la proche périphérie. Et de ce point de vue, la « banlieue » s'inscrit aussi dans une riche tradition de la représentation littéraire. Si la « ville moderne » incarnait, « de Balzac à Baudelaire », l'hybridité qui caractérise d'ailleurs la « modernité » selon Jean Starobinski5, « l'hétéroclite banlieusard » a prolongé cette dissonance « qui caractérisait déjà la ville en propre » (p. 120). À l'instar de l’œuvre d'un J. Réda, cette prééminence de l'esthétique du mélange ne semble pas démentie par la littérature contemporaine. C'est d'ailleurs ce même J. Réda qui incarne le mieux la figure du flâneur contemporain : aux principes traditionnels de la flânerie – la marche à pied, l'immersion dans la foule, la « lecture » des signes de la ville, la sensibilité aux traces du passé – peuvent s'ajouter certains traits plus originaux comme la tendance à une « hérésie » piétonnière, consistant à marcher « là où il ne viendrait à l'idée à personne ne serait-ce que de mettre pied à terre » (p. 128).Cette reprise de la flânerie, également sensible chez J. Rolin et Ph. Vasset, semble bien moins évidente dans les autres œuvres du corpus. Parfois marquée par un refus de la marche à pied (on pense encore à Fr. Bon, mais aussi au livre de Fr. Maspero), l'intérêt porté à la présence et à la parole de l'Autre confronte le lecteur à un biais documentaire, essentiellement sociologique et ethnologique. Or « cette dimension sociale ne peut pas être rapportée au modèle de la flânerie » (p. 135). Là encore, les œuvres étudiées se jouent des repères : à la fois reprise et renouvellement des traditions, banalisation et remise en question de certaines pratiques, il en faudrait peu pour parler, à leur égard à toutes, d'une conception « postmoderne » de l'écriture (p. 129).
9Mais ce recours parfois désinvolte à des ingrédients du passé s'explique aussi par la tonalité généralement ironique de leur écriture. Mélange de cynisme et de mélancolie, l'ironie est dirigée tout autant contre la méthode employée par les écrivains eux-mêmes (ce qui confine alors à une sorte d'autodérision généralisée), que contre les tensions « plus proprement paysagères » (p. 140). Autant dire que tout y passe : de « l'ironie voltairienne » d'un Fr. Maspero, qui tourne en dérision les écueils d'une soi-disant « modernité », à « l'ironie flaubertienne » d'un J. Rolin qui englobe les décideurs, les usagers et le narrateur lui-même dans un même persiflage sans véritable cible identifiée. Dans un bel effet de boucle, l'ironie concerne in fine la forme même ou la tradition même de la description paysagère : les énoncés ironiques « ne décrivent, au final, que la résistance, la tension éprouvée d'entrée de jeu lorsqu'il s'agit de livrer un propos esthétique sur le paysage »6.Le paysage constitue en effet le prisme qui permet à F. Zanghi d’articuler les différents types d’expérience en jeu dans le voyage de proximité, et partant de donner à l’essai son centre de gravité.
La périphérie urbaine, entre paysage & anti-paysage
10S’inspirant des travaux de Cl. Reichler et de son équipe sur les paysages des Alpes, F. Zanghi en tire une définition du paysage comme point d’articulation des pôles matériel, personnel, sociopolitique et culturel7. Le corpus est méthodiquement exploré à la lumière de ces quatre pôles, qui dessinent l’architecture générale de l’ouvrage. L’auteur se livre par ailleurs à une historicisation bienvenue de la notion de paysage, qui en dynamise l’apparente inertie, en la pensant comme une matrice perceptive en reconfiguration permanente. Moins donné que construit, le paysage constitue une interface reliant l’intime à l’extérieur, une surface de projection de nos représentations, mais aussi une territorialisation des tensions sociales et politiques. Qu’il envisage la dimension corporelle du paysage ou les modèles esthétiques qui en informent la représentation littéraire, l’essai cherche toujours à cerner en quoi le « paysagement » réalisé par les textes pourrait opérer une forme de requalification des zones concernées. C’est à une telle vision plurielle du paysage que renvoie l’expression de « zone indécise » empruntée à Leslie Kaplan, d’abord circonscrite à l’aire urbaine parisienne explorée au sein des œuvres, pour gagner en profondeur au fil de l’ouvrage et désigner les diverses formes d’interaction paysagère issues des pérégrinations périphériques des écrivains.
11Si tout paysage se définit relativement à un point de vue, l’étude du paysage implique, au-delà du regard, une attention aux autres perceptions sensorielles. C'est alors le « monde sensible » dans sa totalité que rencontrent les auteurs étudiés ici, quitte à faire appel à la théorie phénoménologique8. La « zone indécise » fait ainsi son entrée dans le grand registre des descriptions paysagères. Selon F. Zanghi, ce point de vue paysager sur les espaces urbains périphériques semble constituer, tout comme la ville, un problème. Aux « prises paysagères » auxquelles l'auteur faisait référence dans l'introduction (p. 32), s'ajoutent ensuite l'idée d'une « promesse » de paysage, motivée par une approche « phénoménologique » du paysage (p. 39), ainsi que d'un « enrichissement paysager », qui s'accentue à la faveur du « changement de métrique », c’est-à-dire de la pratique des « mobilités non pédestres » (p. 73). Que signifie cette « promesse » ou cet « enrichissement » ? On comprend en fait que la littérature entretient une relation ambiguë avec le paysage, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Comme le montre bien F. Zanghi, le paysage en littérature est encore largement perçu relativement à son origine esthétique, c’est-à-dire qu'il donne lieu à une « appréciation » (p. 91). Dès lors, l'évaluation est souvent négative et revient en partie à dresser le constat d'un « échec de la modernité » : voies de communication déroutantes, architectures sans style, aménagements urbains fonctionnalistes… À la « non-architecture » de J. Réda succède bien vite l'idée d'un « non-paysage » (p. 99), inspirée de la notion d'« anti-paysage » développée par Cl. Reichler9 voire des « non-lieux » théorisés par Marc Augé10. Il n'en demeure pas moins que, comme dans tout voyage, les paysages banlieusard et suburbain sont l'occasion d'une interrogation identitaire : l'autobiographie affleure à travers l'identification des auteurs aux paysages, et c'est toute une communauté qui est convoquée à travers les signes du passage des générations ou des grands repères historiques collectifs, comme dans le Boulevard des « Maréchaux ». Faite d'ici et d'ailleurs, de beau et de laid, de soi-même et d'Autre, cette « zone » fait donc bien de l'indécision son premier critère de définition.
12Les six auteurs parisiens réunis ici partagent le projet initial de sortir de la capitale pour enquêter au plus près du terrain, visant ce que J. Réda nomme le « contact brut et générateur d’émotions avec les phénomènes »11. Si le décentrement géographique est bel et bien réalisé, l’essai montre comment la quête d'un décentrement au sens social du terme se révèle souvent un vœu pieux, en fonction des démarches employées par les auteurs : D. Tillinac ne consacre qu’un seul jour à son tour des Maréchaux, et Fr. Bon ne descend pas du train Paris-Nancy, tandis que Fr. Maspero et A. Frantz arpentent un mois durant les stations du RER B, et que Ph. Vasset et J. Rolin passent plus d’un an en explorations urbaines.Mais la possibilité d’une approche décentrée des périphéries urbaines dépend plus encore de la manière dont l’écriture se nourrit des matériaux recueillis sur le terrain. F. Zanghi note la persistance chez la plupart de ces auteurs de représentations stéréotypées des banlieues, caractérisées par leur insécurité, leur laideur, voire une certaine déshumanisation de l’espace urbain, sous les effets délétères du fonctionnalisme architectural des années 1950-70. On pourrait ainsi facilement qualifier la démarche de ces écrivains d’amateurisme bien-pensant, selon une posture équivoque qui ne serait pas sans rappeler le « tourisme humanitaire » des Belles âmes de Lydie Salvayre12, dont les petit-bourgeois arpentent les cités et bidonvilles occidentaux pour découvrir, dans un mélange de pitié et de fascination, la misère sociale qui les entoure. Toutefois, le voyageur littéraire n’ayant ni les mêmes objectifs, ni la même démarche que le sociologue ou le géographe de la ville, il ne saurait aboutir à des résultats comparables en termes d’objectivité scientifique.
13C’est précisément ce décalage épistémologique qui peut contribuer à défamiliariser le regard sur les périphéries urbaines, et permettre de restituer au terme banlieue toute sa « pluralité référentielle »13. Le décentrement atteint son maximum chez J. Réda, et l’essai montre bien comment le promeneur rédien épouse une approche authentiquement phénoménologique ; à l’inverse, les périphéries urbaines apparaissent chez D. Tillinac sous un jour plus pittoresque, et donc moins décentré : le perçu est rabattu sur le déjà su. Mais quels paysages résultent de ces tentatives de décentrement plus ou moins avortées ? Peut-on considérer ces visions comme des témoignages d’une certaine forme d’engagement sociopolitique de l’écrivain ?
Figures de l’écrivain impliqué
14Évoquant le récent travail de Sonya Florey sur les nouvelles formes d’engagement du discours littéraire14, l’essai s’achève en mettant en rapport la posture auctoriale et le potentiel intersubjectif du paysage représenté au sein de l’œuvre. Les six textes étudiés mettent en scène des moments d’étonnement voire de total désarroi de l’écrivain-voyageur, confronté à des espaces, des discours ou des usages sociaux dont il ne maîtrise pas les codes. L’interaction avec les habitants locaux désarçonne le regard et défait les repères de l’enquête méthodique, de sorte que le voyageur se retrouve impliqué par l’autre. Ces moments de bascule débouchent-ils sur une ouverture véritable de l’œuvre au paysage de l’autre, qui permettrait à l’habitant de se réapproprier son environnement quotidien à travers sa mise en forme littéraire ? F. Zanghi explore à ce propos deux cas de figure intéressants, qui montrent à la fois la valeur et les limites d’une telle implication. Dans Les Voyageurs du Roissy-express, le narrateur présente certains échanges que François et Anaïk ont avec les habitants au discours direct libre, empêchant d’attribuer de façon univoque les répliques. Ce nivellement permet de défaire fugacement la hiérarchie, inhérente à ce type d’enquête, entre la parole d’un intellectuel parisien et celle d’un banlieusard de la cité des 4000 à la Courneuve. Mais c’est le dispositif narratif de La Clôture qui poursuit cette expérience à son plus haut degré au sein du corpus, permettant au lecteur d’accéder au paysage de l’autre, c’est-à-dire de l’autochtone. Analysant la manière dont un homme qui vit sous le périphérique métaphorise en une « plaine de neige » une flaque d’eau sur le bitume, F. Zanghi y discerne une appropriation symbolique par l’habitant de son environnement. Cet espace discursif accordé à l’autre pour bâtir son propre paysage au sein du texte ferait de J. Rolin, davantage que de Fr. Maspero, la figure de proue du « reporteur impliqué » au sein du corpus ; par contraste, J. Réda – et dans une moindre mesure Ph. Vasset et D. Tillinac – incarneraient celle du « promeneur décentré ».
15Reprenant la thèse de Jacques Rancière, F. Zanghi esquisse alors sur quelques pages finales une hypothèse audacieuse et quelque peu utopique sur la « fonction politique » de ces récits de voyage, qui aurait mérité d’être approfondie. L’interaction de l’écrivain-voyageur avec la population locale ouvrirait un territoire partagé entre le voyageur-écrivain et les personnes rencontrées, établissant une nouvelle forme de « partage du sensible »15 qui redistribuerait le pouvoir de (se) représenter et de s’approprier symboliquement les espaces périphériques.
***
16La qualité d’analyse de l’ouvrage est de nature à ouvrir des discussions fructueuses, tant sur les œuvres que sur les problématiques abordées. Évoquons ici deux points de débat possibles. Le premier concerne l’inévitable question de la cohérence du corpus, au sein duquel l’œuvre de Fr. Bon occupe une place assez problématique. Paysage fer est moins une exploration des périphéries urbaines que de l’entre-ville, cette alternance de paysages urbains et ruraux qui s’égrènent le long du Paris-Nancy. Plus proche ici d’un Jean-Christophe Bailly désenchanté que d’un Fr. Maspero ou d’un Ph. Vasset, l’œuvre semble par moments s’inscrire dans une démarche trop distincte pour constituer un contrepoint efficace aux autres textes étudiés ici. De même, le choix et la place des deux œuvres de J. Réda, certes représentatives de son œuvre mais forcément réductrices, ne va pas non plus de soi. D'une génération plus ancienne que les autres auteurs étudiés (exception faite de Fr. Maspero), il est aussi le seul à s’inscrire dans une démarche d’écriture ouvertement poétique. Symptomatiquement, F. Zanghi semble souvent en faire un cas à part, dans la mesure où il se démarque des conclusions tirées à propos des autres œuvres.
17D’autre part, on pourrait interroger la méthodologie employée ici pour faire dialoguer critique littéraire et études urbaines. F. Zanghi reconnaît dans l’introduction que son essai « n’a pas une ambition véritablement interdisciplinaire » (p. 24) ; les concepts issus d’autres disciplines visent simplement à conférer au texte une « plus-value » (ibid.) géographique ou sociologique. Cette approche de l’interdisciplinarité semble réductrice sur le plan théorique, et ne rend pas justice à certains développements où F. Zanghi montre tout le potentiel heuristique qui peut résulter d’une véritable interaction entre herméneutique littéraire et sciences sociales. La manière dont la notion de paysage est traitée témoigne de cette ambiguïté. L’auteur déclare en introduction qu’il va s’agir de « construire par les textes les quatre pôles du paysage » (p. 32), mais ces pôles sont issus des travaux de Cl. Reichler et de son équipe. Ainsi, a-t-on vraiment affaire à une « construction », ou plutôt à la reconstruction par le critique littéraire de concepts donnés par le géographe, et qu’il s’agirait d’appliquer au texte littéraire ? Si la définition du paysage est a priori, le littéraire cherche à retrouver dans le texte un concept préexistant, au lieu d’inférer une définition du paysage spécifique aux œuvres concernées. La géographie est instrumentalisée comme outil heuristique, afin de répondre aux questions que le littéraire se pose dans les termes mêmes où il se les pose. Or, on l'a vu, cela revient à reproduire face au texte une tension qui agite déjà la notion même de paysage. En géographie, le paysage ne dépend pas d'un quelconque jugement de l'individu : il y a paysage à partir du moment où une certaine étendue de pays est saisie depuis un point de vue. Cette conception est-elle alors compatible avec ce que F. Zanghi entend par une « promesse de paysage » ? Ou même avec l'expression d'« anti-paysage » qu'il reprend à Cl. Reichler ? Ne pourrait-on envisager d’autres formes d’interactions entre critique littéraire et sciences sociales, qui considéreraient autrement ces dernières qu’en termes de « plus-value » ?
18Se pose donc in fine la question que pose toute entreprise interdisciplinaire : comment combiner les outils et les savoirs de plusieurs disciplines lorsque l'on s'attache à élucider les textes d'auteur. La réponse se trouve peut-être tout simplement dans le caractère singulier des textes choisis. On comprend alors nettement ce que l'on a pressenti durant toute la lecture de cet essai : les textes étudiés sont tout autant des récits de voyage d'un certain genre (des récits de « voyages de proximité ») que des discours sur les récits de voyage ; ils ont tout autant de choses à nous dire sur une certaine écriture du parcours que sur le réel auquel ils se confrontent durant ce même parcours, achevant ainsi de les constituer comme des objets d'analyse complexes qui invitent le lecteur, par leur nature même, à une lecture interdisciplinaire.

