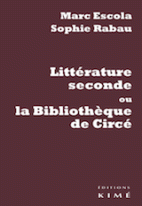
Comment les œuvres œuvrent‑elles dans le temps ?
1Je dois me livrer devant vous à un douloureux exercice de ventriloquie, puisque je me trouve aujourd’hui devoir rendre compte seul d’un livre écrit à quatre mains, en l’absence donc de celle avec qui j’ai échafaudé de longues années durant cette Bibliothèque de Circé : ma complice et amie Sophie Rabau. C’est le moment de redire le mot de Montaigne, que la perte d’un ami emmura comme on sait dans sa propre bibliothèque : Nous étions à moitié de tout ; il me semble que je lui dérobe sa part. J’étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu’il me semble n’être plus qu’à demi. » (Essais, I, 28). En l’absence de Sophie Rabau, il me semble que je ne peux plus aimer notre livre qu’à moitié, et qu’en vous en parlant seul aujourd’hui, je lui dérobe un peu plus que sa part.
*
2L’ouvrage paru aux éditions Kimé en 2015 est issu d’un séminaire donné près d’une décennie plus tôt au sein du Département de français de l’Université Saint‑Joseph de Beyrouth à l’invitation de son directeur d’alors, le professeur et romancier Charif Majdalani, soucieux de répondre à une double demande des étudiants : le besoin d’une part d’un séminaire de théorie littéraire qui ne soit pas un panorama de la théorie française des années 1970‑1980, mais qui vienne présenter et mettre en œuvre la « théorie des textes possibles » que nous cherchions alors à développer au sein de la jeune équipe Fabula, dans la lignée des travaux menés par Michel Charles à l’École normale supérieure au milieu des années 19901 ; le souhait d’autre part d’un atelier de création littéraire ou « d’écriture créative », comme on le dit désormais par un anglicisme qui mériterait à lui seul réflexion. En Charif Majdalani, le romancier autant que le directeur de département — le romancier peut‑être plus que le directeur — rechignait à voir s’ouvrir un tel atelier, mais il avait bien perçu ce que la notion de « textes possibles » pouvait receler de potentialités émancipatrices, si j’ose dire, en ménageant des passerelles entre la lecture et l’écriture. Cette demande d’un enseignement de la création, qui se fait jour un peu partout dans le monde depuis le début du xxie siècle, doit sans doute se comprendre comme le signe d’une « fatigue du commentaire », d’une usure d’un mode de relation aux œuvres qu’on peut nommer « herméneutique », d’une désaffection proprement historique à l’égard de « la critique littéraire » en tant que celle‑ci s’attache à la signification, historique ou actuelle, des œuvres. Le succès rencontré par la notion de « textes possibles », qui a fait les beaux jours de l’équipe Fabula à ses débuts, peut s’analyser aussi comme une réaction au climat crépusculaire qui était celui des études littéraires au début de la dernière décennie, crépuscule à peine troué par la leçon inaugurale d’Antoine Compagnon en novembre 20062 et dont Tzvetan Todorov brossait le tableau le plus sombre dans un essai paru quelques semaines plus tard qui déclarait La Littérature en péril3. On débattait alors (souvenez‑vous) de la possible extinction des études littéraires — débat que j’avais pris l’habitude de trancher publiquement en ces termes : une discipline peut en effet mourir de son esprit de sérieux, c’est‑à‑dire d’un excès (d’une surdose) d’érudition.
*
3Revenons au séminaire de Beyrouth ; son programme était d’emblée celui qui a ensuite décidé de la composition du livre. Il s’agissait d’étudier (classiquement) la « fortune » (Nachleben) d’un épisode de l’Odyssée (le séjour chez Circé au chant X de l’Odyssée, qui voit la métamorphose des compagnons d’Ulysse en cochons), en confrontant (ce qui est moins classique) deux séries de textes « seconds » traditionnellement et institutionnellement distinctes : d’une part la série des récritures attestées de l’épisode (de Plutarque à Joyce dans Ulysses, en passant par La Fontaine dans la fable liminaire du troisième recueil des Fables : « Les Compagnons d’Ulysse », XII, 1) ; d’autre part (ou en même temps) la série des commentaires auxquels ce même épisode a donné lieu (d’Apollonios de Rhodes ou Lycophron à Victor Bérard ou Michel Serres). Le projet consistait à confronter systématiquement les gestes du commentaire savant apparemment le plus rigoureux et les opérations de libre transformation d’un texte dont sont issues les récritures ; et l’ambition était de mettre en lumière la parenté entre la littérature secondaire (si l’on retient des usages académiques allemand l’expression de Sekundär Literatur pour désigner les commentaires) et la littérature au deuxième degré (selon la locution choisie par G. Genette pour désigner dans Palimpsestes les textes issus de la transformation ou de l’imitation d’un texte premier). Pour dire les choses plus simplement : il s’agissait de montrer, sur le cas d’école constitué par cet épisode de l’Odyssée, que le commentaire le plus scrupuleux s’autorisait des interventions sur le texte qui revenait à le transformer, quand les récritures révélaient une interprétation du texte premier.
4Cette démonstration ne peut pas même être esquissée ici, si bien que j’en expliciterai seulement les deux postulats centraux : deux propositions proprement théoriques que j’énoncerai d’abord sous leur forme abrupte (apodictique), avant de leur donner une manière de post‑scriptum :
51. Le premier postulat est repris, au bénéfice de cette Bibliothèque de Circé, de l’épilogue d’un précédent ouvrage paru sous ma seule signature, Lupus in fabula :
Il n’est pour les textes littéraires que deux façons d’assurer leur pérennité : leur constitution en hypotexte qui les fait revivre dans un hypertexte (une récriture), le renouvellement de leur signification dans des interprétations neuves (les commentaires). On voit mal qu’on puisse distinguer rigoureusement les deux dynamiques, au prétexte que l’une relève de « la littérature » et requiert d’authentiques « auteurs » tandis que l’autre intéresse la « réception » et demande seulement de rigoureux interprètes. Ces deux procès sont en réalité étroitement solidaires : réécritures et commentaires s’élaborent dans un espace commun — celui des possibles du texte source.4
62. Le deuxième postulat est étroitement solidaire du premier :
Si la diversité des interprétations et des récritures à laquelle un même texte peut donner lieu est diachroniquement attestée, on doit pouvoir en rendre compte synchroniquement. Non qu’il faille postuler que le texte « enferme » ou contient en puissance toutes les lectures et récritures dont il est passible : on ne peut nier l’arbitraire des interprétations, leur inscription dans l’Histoire, et l’inaliénable inventivité des créateurs, mais on posera que les opérations de récriture ou de commentaire répondent chacune à leur façon à la pluralité, aux incohérences locales et aux silences du texte premier.5
7Je gloserai maintenant ces deux déclarations de principe :
81. Le premier postulat, on l’aura sans doute compris, vise à donner une unique réponse à la question qui fait aujourd’hui le titre de mon propos — « Comment les œuvres œuvrent‑elles dans le temps ? ». Il invite à penser l’une par l’autre, et dans les mêmes termes, les deux dynamiques qui font la vie et la durée des œuvres en assurant le renouvellement de leurs publics (au pluriel). Deux exemples ici, également canoniques : les Contes de Perrault nous seraient‑ils aujourd’hui encore familiers s’ils n’avaient régulièrement fait l’objet depuis 1695 de récritures, imitations, réemplois, adaptations ou détournements parodiques ? Le recueil de Perrault offre l’exemple d’un de ces « classiques » qui n’ont quasiment plus de lecteurs dans leur texte original (qui sait encore que les contes en prose comportent des « moralités » en vers ?), mais dont les « histoires » demeurent vivantes dans toutes les mémoires, contaminées par d’autres versions dont, bien sûr, celles des frères Grimm et de Disney. Comment comprendre par ailleurs qu’au sein du corpus des tragédies grecques qui nous ont été conservées, Antigone ou Œdipe nous soient aujourd’hui plus immédiatement accessibles (à tous les sens du terme) que, disons : Les Troyennes (nonobstant l’adaptation proposée par Sartre en 1965) ou Les Suppliantes, sinon parce que les interprétations délivrées par Hegel pour la première et par Freud pour la seconde ont suffisamment renouvelé la signification attachée à leur texte respectif pour assurer aux deux tragédies un public absolument imprévu de Sophocle ?6
9Le parcours proposé dans La Bibliothèque de Circé vise à traiter dans les mêmes termes les transformations hypertextuelles (les récritures) et les transformations métatextuelles (les commentaires) — comme autant de variantes délivrées dans le texte considéré. Commenter un texte ou le récrire, c’est déduire de la lettre du texte premier le complexe statique des textes possibles dont le libre jeu ouvre l’œuvre à l’historicité. Nous proposons de penser sous le nom de « littérature seconde » cette zone où commentaire et réécriture échangent leurs ambitions respectives, et « secondarisation » l’ensemble des procédures par lesquelles un texte vient au jour dans les marges d’un autre, quelle que soit sa finalité affichée. L’essentiel de nos analyses a dès lors consisté à mettre en lumière les gestes communs aux commentaires et aux récritures : ainsi de la fragmentation imposée au texte premier pour réélaborer son matériau, des opérations d’addition ou de soustraction imprimées à sa lettre, de l’assignation d’une genre ou d’un registre à l’œuvre retenue, ou ainsi encore des décisions de recontextualisation… Impossible ici d’illustrer cet éventail d’opérations. Je signalerai simplement un des temps forts du livre, pour autant qu’il me soit permis d’en juger : l’analyse croisée des commentaires philologiques de l’épisode par l’érudite Anne Dacier, au cœur de la seconde querelle d’Homère (1716), et des audaces de Joyce dans l’épisode correspondant de Ulysses (1922) qui tient dans l’évocation d’un rituel sado‑masochiste. La philologue française et le romancier irlandais, pour des raisons qu’on ne peut pas imputer tout uniment à une fantasmatique à chaque fois singulière, nous montrent Ulysse entrant dans une maison de passe mais non pas exactement pour consommer… Pour le détail trépidant des scénarios correspondants — de ce qu’Anne Dacier veut lire et de ce que Joyce nous fait lire dans l’épisode homérique — voyez les chapitres 6 et 7 de l’ouvrage, auquel le neuvième vient offrir un supplément lui‑même inattendu.
10Si je retiens cet exemple, ce n’est pas seulement pour l’argument commercial ; c’est qu’il rend manifeste le point nodal de la démarche, et l’objection qu’un lecteur de La Bibliothèque de Circé est d’abord tenté d’opposer au premier postulat, laquelle tient dans un seul syntagme : l’autorité du texte. Qui lit pour commenter, a fortiori dans un contexte académique, regarde le texte comme nécessaire et doué d’une forme d’autorité : par quoi le commentaire se voue à justifier le texte tel qu’il est (comme le meilleur possible) ; quand celui qui lit pour récrire se défait de toute révérence à l’égard du texte source pour parvenir à l’imaginer autrement, en traquant dans sa lettre même la possibilité d’un autre texte. C’est précisément cette autorité du texte que deux entreprises théoriques à peu près contemporaines sont venues ébranler ou contester, en amont de la décennie dont nous parlons, dans les toutes dernières années du xxe siècle, pour libérer de nouveaux usages des textes littéraires et de nouvelles formes de discours critiques : le manuel de M. Charles déjà mentionné et la série des premiers essais de P. Bayard inaugurée aux éditions de Minuit par Le Hors‑Sujet. Proust et la digression (1996), suivi de Qui a tué Roger Ackroyd ? (1998), puis Comment améliorer les œuvres ratées ? (2000) et Enquête sur Hamlet (2002), en renouant avec une liberté « d’intervention » surles œuvres qui n’est pas sans exemples dans l’histoire de la littérature. L’introduction de La Bibliothèque de Circé esquisse une rapide histoire des rapports entre commentaire et récriture en s’attardant sur trois époques où le texte ne faisait pas autorité, et où les critiques se sentaient habilités à modifier la lettre du texte : la poésie lettrée de l’époque alexandrine, la translatio médiévale, et cet âge classique français où les différentes querelles révèlent des critiques dialoguant d’égal à égal avec les auteurs7. Les essais de P. Bayard sont venus signaler que nous sommes sans doute entrés dans une nouvelle période d’affaissement de l’autorité de l’auteur (l’actuelle hantise du plagiat en constituerait un autre signe, symétrique et paradoxal).
11Cette convergence entre les leçons de M. Charles et les « enquêtes » de P. Bayard a beaucoup compté pour S. Rabau comme pour moi‑même, et après nous pour toute une génération de jeunes chercheurs, parmi lesquels je veux citer au moins Florian Pennanech, Arnaud Welfringer et Laure Depretto8, tous soucieux de renouveler non plus les « approches critiques » sur les œuvres mais le discours second lui‑même, en s’autorisant par principe à imaginer le texte autrement — ce qui ne va pas sans humour bien souvent, et une forme calculée d’irrespect à l’égard des œuvres. (Je me suis expliqué ailleurs sur les liens entre la théorie littéraire ainsi entendue et l’humour, et je n’y reviendrai pas aujourd’hui. S’expliquer sur l’humour, disait un vrai philosophe, c’est comme disséquer une grenouille : cela ne sert pas à grand chose et à la fin la grenouille meurt9.) Cette décision de principe peut se dire encore autrement : il s’agit dans tous les cas de donner priorité à la littérature possible sur la littérature réelle, en émancipant le discours de l’obligation de justifier le texte tel qu’il est ; soit encore : de pratiquer une lecture des œuvres qui ne regarde pas vers le passé dont elles viennent mais vers le futur où l’on veut les accompagner.
122. Ce souci d’une lecture au futur est au cœur du second postulat, manière de pari théorique hérité d’un structuralisme partout décrié, qui tient dans la formule déjà énoncée (« Si la diversité des interprétations et des récritures à laquelle un même texte peut donner lieu est diachroniquement attestée, on doit pouvoir en rendre compte synchroniquement. »). Comment ? En élaborant une méthode de lecture qui substitue au préjugé de la cohérence du texte (de sa perfection ou complétude) un principe de pluralisation, pour déduire méthodiquement de la lettre du texte l’éventail des possibles dans lesquels la double postérité littéraire et critique de l’épisode s’est, par hypothèse, élaborée.
13Notre livre s’ouvre ainsi sur une analyse de l’épisode odysséen qui traque dans le texte tout ce qui fait signe vers des possibles non exploités susceptibles de conditionner au même titre l’exégèse et la récriture10 : ainsi de l’hypothèse pessimiste formulée par tel personnage (Euryloque), que la suite de l’aventure invalide mais qu’on pourrait prendre au mot (Ulysse est‑il bien prudent dans l’aventure ?) ; ou des silences du texte sur la nature exacte du cerf qu’Ulysse et ses compagnons dévorent au début de l’aventure, ou bien des loups et des chiens qui gardent le palais de Circé (faut‑il les regarder comme des animaux ou comme des êtres humains métamorphosés par Circé ?) ; ou encore de la valeur à accorder à la plante magique (la fameuse moly) donnée par Hermès et réputée protéger Ulysse des sortilèges de la magicienne (de quoi donc le talisman protège‑t‑il le héros, si celui‑ci se voit contraint, à son corps défendant, de « monter au lit de la belle Circé » : insuffisant « préservatif », souligne Mme Dacier…) ; ou encore du scénario de « l’oubli de la patrie » qui hante la fin de l’épisode, où il reste finalement sans effets, mais qui se trouve avoir des suites, si l’on ose dire : texte possible qui accouche d’un texte bien réel chez Hésiode, lequel fait naître un fils de l’union d’Ulysse et Circé — un Télégonos qui finira par tuer son père faute de le reconnaître…
14Ces quelques échantillons de « textes possibles » pourraient laisser penser que pareille description procède en quelque sorte à rebours et que, péchant par téléologie, elle ne cherche dans l’épisode que ce que la postérité y a déjà aperçu. Le détail de l’analyse, dans lequel il m’est impossible d’entrer ici, révèle pourtant qu’il y a encore bien de la place dans les rayons de la bibliothèque de Circé, bien des possibles encore inexploités et qui restent donc à écrire ; nul n’a encore songé à raconter, par exemple, quel pari engagé entre Hermès et Circé a pu conduire Ulysse dans l’île d’Aiaié (à l’arrivée d’Ulysse, Circé le reconnaît pour celui dont Hermès lui avait dès longtemps annoncé la venue — on n’en saura pas plus, jusqu’à ce qu’un lecteur bien inspiré forge ou affabule une suffisante analepse complétive) ; on aimerait lire aussi cette scène terrible où les compagnons comprendraient après coup qu’ils digèrent avec le cerf une chair toute humaine, à moins qu’Ulysse, nouveau Thyeste, ne se voie servir par Circé une viande dont rien ne lui indiquerait la nature antérieure (on comprendrait mieux qu’il puisse refuser de manger) ; on voudrait encore produire au grand jour cette version où Euryloque prendrait la fuite, sans plus obéir à Ulysse, quitte à croiser son chemin un peu plus loin ou un peu plus tard… On perçoit sur ces quelques exemples la nature des questions qu’une telle lecture pluralisante induit : des interrogations qui engagent le sens à donner à l’épisode dans l’exacte mesure où on en imagine une autre version, en procédant à quelque interpolation ou en lui donnant le cas échéant une suite ou un prolongement.
15Une nouvelle pédagogie s’invente dans cette lecture des textes « au futur », dont nous donnons au terme de l’ouvrage quelques échantillons, en suggérant de nouveaux exercices académiques. Je n’en retiendrai ici qu’un seul, pour faire le lien entre l’ouvrage dont je vous parle aujourd’hui et mon enseignement à Lausanne : l’apocryphe heuristique (sans oxymore), soit la production d’une variante ou, le cas échéant, d’une continuation, qui vienne offrir une solution logiquement satisfaisante à un problème mis au jour dans l’analyse d’un texte ou donner une fin plausible à une œuvre inachevée.
16Au terme de la visite de la Bibliothèque de Circé, je propose ainsi de lire la première partie de Manon Lescaut comme si la seconde était perdue — comme s’il s’agissait pour Des Grieux de monnayer les charmes d’une Manon bien vivante, quitte à affabuler une nouvelle suite qui puisse se substituer à l’invraisemblable épilogue américain que l’on sait, pour lequel Prévost a peut‑être bien recyclé, ou délégué à un secrétaire, un canevas manifestement conçu pour un autre roman (on a de sérieuses de le penser lorsqu’on connaît la genèse de Cleveland).
17À Lausanne, dans mon séminaire du semestre de printemps 2016, j’ai invité les étudiants de Master à confronter deux œuvres de fiction narrative d’un même auteur, dont l’une est considérée comme achevée et l’autre comme inachevée (exemples canoniques : Le Rouge et le Noir, Le Rose et le Vert). Pour l’œuvre achevée, ils avaient à réunir les informations sur les éventuelles versions concurrentes, les variantes, les hésitations, réfections, etc. du dénouement finalement retenu, pour projeter une fin alternative. Pour l’œuvre inachevée, je les invitais à rendre compte des raisons connues de cet inachèvement, de celles qu’on peut déduire de l’état du texte conservé, et d’imaginer les variantes nécessaires à un achèvement de l’œuvre sous la forme d’un synopsis d’une ou deux pages. L’exercice consistait donc dans les deux cas à élaborer la grammaire dans laquelle une œuvre se trouve écrite pour élaborer à partir d’elle des variantes plausibles, ou plus exactement un complexe de variantes cohérent. Certains étudiants se sont payés d’audace, et l’Atelier de théorie littéraire de Fabula devrait prochainement donner à lire la suite et la fin, sous forme de simples canevas, des Âmes mortes de Gogol, des Cent‑vingt journées de Sade, de L’Homme sans qualité de Musil…
18Je tiens qu’un tel exercice, où le commentaire s’écrit sous forme de variantes ou d’une version concurrente, permet d’évaluer une pleine intelligence des œuvres, soit, tout à la fois, un savoir érudit sur leur élaboration, une connaissance approfondie de leur logique interne, et un libre examen de leurs potentialités. Il s’agit ni plus ni moins que d’un exercice de poétique, si ce terme a encore un sens. C’est cette pédagogie du lirécrire — du lire pour écrire — que nous appelons en tous cas de nos vœux, et que j’essaye pour ma part de mettre en œuvre partout où elle est… possible (à Beyrouth avant‑hier, à Saint‑Denis hier, à Lausanne aujourd’hui). La Bibliothèque de Circé, c’est celle dont tout lecteur peut sortir avec un livre non pas à la main mais en tête — celui qu’il est à même d’imaginer et, pourquoi pas ?, d’écrire.

