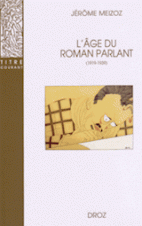
Les débuts du roman parlant
1« Une exploration de l’inconscient littéraire ». C’est en ces termes que Pierre Bourdieu, dans une préface aussi brève que stimulante, résume le nouveau livre de Jérôme Meizoz, version abrégée d’une thèse soutenue à l’Université de Lausanne en 2000. La formule pourrait s’appliquer à l’ensemble des recherches de l’auteur. Ce dernier, lui‑même écrivain et critique littéraire, se fait depuis une dizaine d’années l’observateur persévérant de ce qui motive l’écriture en tant que pratique complexe, éloignée du mirage de la création exnihilo et de la notion circulaire de littérarité.
2Ses travaux avaient jusqu’à présent examiné l’inscription au plus profond des textes du rapport de force qui tenaille chaque écrivain francophone non français, pris entre les sirènes du centre parisien et la fidélité à la vie littéraire locale. L’étude de Charles‑Ferdinand Ramuz avait ainsi montré comment ce compatriote, à force de ruser avec la légitimité du centre, était devenu un véritable Passager clandestin des lettres françaises(Zoé, 1997 ; cf. Europe 853, mai 2000). La fécondité de l’analyse devait déjà beaucoup au pari, difficile, d’envisager ces fameuses « lettres françaises » non pas d’abord comme un patrimoine textuel, mais comme un système international de possibles esthétiques, à la manière de la « stylistique sociologique » de Bakhtine. Or, le cas de la poétique ramuzienne permet de poursuivre ce mouvement d’élargissement de la problématique du double stigmate national et régionaliste, lié aux soubassements politiques de la littérature française. Cette fois en effet, et tout en maintenant la perspective relationnelle et différentielle, J. Meizoz propose à son lecteur un voyage au bout d’une piste plus souterraine encore et néanmoins plus large, celle qui mène vers les fondements linguistiques de la littérature en langue française.
3Un de ces fondements, auxquels se heurte Ramuz, est la règle de l’incompatibilité du code littéraire et de la langue populaire. Le Zola de L’Assomoir avait, parmi d’autres, enfreint cette loi, en faisant entendre dans son roman, à la faveur du discours indirect libre, la voix de groupes sociaux indignes. Son époque, où existait un véritable « devoir démocratique en littérature » (Nelly Wolf), était loin d’être une parenthèse. Ramuz allait faire un nouveau pas décisif, au‑delà même des transgressions inouïes de Barbusse dans LeFeu, en donnant la parole à un narrateur illégitime, à savoir lisiblement non lettré, et en faisant donc voler en éclats le principe de ce qui est appelé ici le « cloisonnement des voix », dernier rempart contre le péril populaire. Par là, le Vaudois faisait plus qu’affirmer une originalité helvétique ; il récusait, bien avant Giono ou Céline, l’une des principales lettres de noblesse et en même temps l’une des plus solides évidences d’une littérature française pas entièrement sortie de l’Ancien Régime. C’est sur ce plan‑là que se situe l’essentiel des enjeux de ses expériences scripturales.
4Apparaît alors à quel point celles‑ci correspondent à d’autres innovations « bien connues » qui allaient suivre ; apparaît alors l’hypothèse selon laquelle, durant l’entre‑deux‑guerres, la littérature a elle aussi fait son cinéma parlant sous la forme d’un « roman parlant », récit fictivement oralisé où le lecteur a l’impression que quelqu’un s’adresse à lui, directement, sans y mettre les formes de l’écrit. « La littérature », disions‑nous, ou du moins certains détracteurs un peu fous des belles‑lettres, de la Littérature avec majuscule, celle du « bien‑écrire » et de la correction grammaticale. Comme l’avait déjà souligné Anne‑Marie Thiesse (notamment dans Écrire la France, P.U.F., 1991), les écrivains francophones non français ne sont pas les seuls à pâtir du centralisme français et de ses effets d’inertie et de conservation. Ceux-ci pèsent d’un même poids, quoique différemment, sur les nombreux collègues français que leurs origines sociales et géographiques amènent à contester l’ordre établi des hiérarchies esthétiques et des convenances linguistiques. Les écrivains qui cherchent à rendre acceptables pour leurs pairs des techniques relevant du « roman parlant » ont ainsi en commun de prendre pour cible l’académisme de ceux qui ne visent qu’à « faire de la littérature », à commencer par les grands auteurs de romans psychologiques. Mais on les voit aussi s’en prendre à la langue française elle‑même, cette matière première devenue encombrante à force d’avoir été codifiée jusqu’à l’asphyxie pendant trois siècles. Après le pionnier Ramuz, il s’agira d’Henry Poulaille, Louis Aragon, Blaise Cendrars, Giono, Céline ou encore Raymond Queneau. Les monographies dont ces écrivains font ensuite l’objet précisent peu à peu les contours et les enjeux d’une querelle des Anciens et des Modernes en pleines années folles et finissent par faire émerger tout un pan de l’impensé littéraire de l’entre‑deux‑guerres.
5À cet effet, l’auteur ne se contente pas de convoquer les travaux, essentiels et nombreux depuis ceux de Renée Balibar, consacrés à l’institution scolaire, institution où s’origine tout un système de dispositions littéraires élémentaires. Sa démonstration — il la désigne très justement comme une « enquête » — a en outre le mérite de rapporter le débat littéraire aux discussions que mènent vers la même époque d’autres spécialistes de la langue, dans des champs qui ont un impact sur le fonctionnement général du champ littéraire : les grammairiens, les linguistes, les pédagogues et les journalistes littéraires. Et son propos n’est manifestement pas de contribuer à la description plutôt cumulative du « discours social » (Marc Angenot) d’une époque, mais de comprendre pourquoi et en quoi les redéfinitions de l’oral en cours dans ces champs trouvent dans la littérature de multiples échos. L’enquête n’en est ici qu’à ses débuts, mais les documents sélectionnés autorisent d’ores et déjà une première série de rapprochements probants : ainsi, certains écrits du linguiste suisse Charles Bally, lequel, auteur d’une saisissante « théorie générale de l’énonciation » élaborée longtemps avant Benveniste, est le premier à faire de la langue parlée un objet légitime d’investigation scientifique ; ainsi également, des prises de position puristes, voire mortifères (« écrivons le français comme une langue morte ») du grammairien et chroniqueur littéraire André Thérive ; ainsi, enfin, des critiques révolutionnaires que le pédagogue Célestin Freinet, lié notamment à Barbusse et à Poulaille, adresse à l’enseignement traditionnel de la langue. Autant de voix qui, se répondant d’un champ à l’autre sous l’égide de discours politiques toujours plus soucieux de démocratisation, tissent une nouvelle conception de la langue non écrite susceptible sinon de valoriser, du moins d’encourager les romanciers dans leur entreprise de ressourcement de la langue littéraire.
6La réorganisation des médiations entre langue romanesque et lecteur revêt pour ces écrivains une signification avant tout esthétique. C’est ce qui distingue Poulaille de ses confrères (et c’est peut‑être ce qui explique son statut actuel d’auteur méconnu) : s’il refuse les injonctions communistes (orthodoxes, surréalistes ou barbussiennes), le promoteur d’une « littérature prolétarienne » indépendante désapprouve tout autant la neutralité et l’esthétisme bourgeois de l’école populiste de Léon Lemonnier et André Thérive. C’est du reste ce que permet de mieux comprendre une lecture serrée de ses romans « parlants ». Car outre les autres discours professionnels sur la langue, la méthode choisie inclut le texte littéraire, « cette visée fétiche, cet horizon inatteignable » de la sociologie de la littérature que celle‑ci, selon ses opposants un peu provocateurs, ne parviendrait jamais à prendre « vraiment » en compte. À la suite d’un Pierre V. Zima notamment, J. Meizoz relève le défi, en s’appuyant sur les propositions d’Alain Vialavisant à combiner dans une « sociopoétique » les apports de la poétique et de la sociologie, mais surtout en se plaçant pour chaque auteur examiné « Face aux textes », titre de section qui sonne comme une revendication. On peut estimer, du reste, que ce titre contient encore une caution involontaire de ce qui est pourtant réfuté, à savoir la séparation de l’auteur d’avec ses productions, alors que les deux sont traversés de part en part, comme le livre montre très bien, par des logiques sociales étrangères à l’illusion bien fondée de l’opposition texte‑extratexte.
7Toujours est‑il que les analyses « sociopoétiques » réunies ici, où les méthodes les plus actuelles de la critique génétique, de l’analyse discursive, de la narratologie, etc., se complètent mutuellement, éclairent les textes et révèlent leur étroite corrélation avec les positions occupées dans l’espace littéraire par leurs auteurs respectifs. C’est que, au‑delà d’un certain nombre d’« effets de langue‑peuple » observables dans tout le corpus — par exemple, le fameux « ça », récurrent sous la plume de Ramuz, de Céline, etc. au point d’être parodié par Queneau —, les procédures d’oralisation du récit se différencient selon les tendances et les modalités de travail spécifiques à chacun. LeChiendent atteste ainsi que Queneau est celui qui, le plus radicalement et avec ironie, place son « roman parlant » sous le signe de la pureté littéraire et de la liberté formelle de l’écrivain ; sans doute gagnait‑on à se demander si sa position dans les cercles de LaN.R.F. lui permettait d’attaquer frontalement l’idéal néo‑classique incarné par cette revue, autrement dit, si sa liberté n’était pas conditionnée au moins par ce que la littérature rêve de ne pas être : une institution. Lesbeaux Quartiers d’Aragon, quant à eux, portent la marque d’un travail de réappropriation du nationalisme littéraire monopolisé par les concurrents de droite. LesConfessions de DanYack sont bien d’un écrivain, Cendrars, dont l’expérience de déracinement linguistique (notamment en tant que Suisse polyglotte très au fait de l’antirationalisme de Nietzsche ou de Freud) est à l’origine de son parcours littéraire. À ce propos, on espère que l’analyste donnera un jour une étude comparant ce Cendrars dont les aspirations petites‑bourgeoises déçues l’inclinent à rechercher dans le peuple ce qui peut faire de lui un « bourlingueur » à son compatriote Ramuz rêvant d’une carrière littéraire contre le projet social de son père et se forgeant un style pseudo‑paysan en guise de re‑père — bref, une étude sur ce que J. Meizoz nomme le « fantasme de rachat social » de l’écrivain. Enfin, l’amateur comme l’expert de Giono (Un de Baumugnes) ou de Céline (Mort à crédit, Bagatelles pour un massacre) trouveront de quoi approfondir certain débat sur la dialectique instaurée par ces auteurs entre leurs « postures » d’écrivains du peuple et leurs écritures.
***
8On le voit, la grille de lecture mise en œuvre n’a rien d’une grille et tout d’un modèle ouvert suscitant sans cesse chez le lecteur réflexions, hypothèses, etc., et allant jusqu’à lui donner réellement envie de lire ou de relire les textes présentés, ce qui n’est pas rien. Le décloisonnement de la sociologie de la littérature par l’ouverture de cette discipline sur des questions poétiques et rhétoriques et par l’implication de champs connexes s’imposait pour ainsi dire s’agissant de l’observation de ce travail collectif de décloisonnement énonciatif. La démarche n’en est pas moins fort précieuse et incite à toute une série de remises en question. Mais la force du livre tient surtout à ce que, loin de tout dogmatisme méthodologique, J. Meizoz avance sur son terrain de prédilection avec la rigueur et l’audace de celui qui sait devoir tenir ensemble des choses réputées incompatibles. Ni genre, ni à vrai dire mode d’écriture, le « roman parlant » est d’abord un outil d’observation exigeant qui permet de mieux cerner une ligne de tension fondatrice du champ littéraire et d’en identifier les déterminants hétéroclites. Les perspectives qu’il offre sur la littérature ont quelque chose de vertigineux, du fait des perspectives qu’elles laissent deviner.

