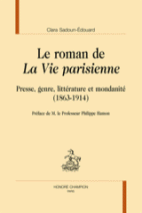
La Vie parisienne ou la fabrique médiatique de la mondanité
1L’opéra‑bouffe de Jacques Offenbach, La Vie parisienne1, semble avoir quelque peu éclipsé dans la mémoire collective la revue du même nom, qui voit pourtant le jour trois ans avant sa création au Théâtre du Palais‑Royal. Clara Sadoun‑Édouard redonne une existence à cet objet négligé, déconsidéré – déconcertant à bien des égards –, au travers d’une importante monographie, tirée de sa thèse de doctorat, soutenue en 2010 à l’Université Libre de Bruxelles. La Vie parisienne est un hebdomadaire illustré, fondé en 1863 par Émile Planat, plus connu sous le pseudonyme de Marcelin, qui connaît un succès tout particulier sous le Second Empire et à la Belle Époque. Le sous‑titre de la revue – Mœurs élégantes. Choses du jour. Voyages. Théâtre. Musique. Modes – souligne son orientation ouvertement mondaine, sa qualité de miroir, fantasmé et fantasmatique, des loisirs et des plaisirs de la haute société parisienne d’alors. L’ouvrage se situe à ce titre dans le prolongement des études initiées depuis près d’une vingtaine d’années dans le champ de l’histoire littéraire autour de la presse et de la culture médiatique, sous l’impulsion notamment de Marie‑Ève Thérenty et d’Alain Vaillant2 ou, plus récemment, de Guillaume Pinson3, et qui ont abouti à cette remarquable synthèse qu’est La Civilisation du journal4. L’ouvrage implique de fait plusieurs champs d’étude, au croisement de l’histoire littéraire, de l’histoire culturelle et de l’histoire sociale. Par son titre – syntagme évocateur et proliférant –, la revue de Marcelin renvoie en outre à un mythe5 – celui du Tout‑Paris plutôt que de Paris, celui du demi‑monde plutôt que du grand monde – qui s’inscrit dans « le long xixe siècle6 » et que l’hebdomadaire contribue à sa façon à refléter et à approfondir, par l’écriture et par l’image.
2Notons au passage l’exceptionnelle longévité de ce journal, apparu sous le Second Empire et publié, avec plus ou moins de régularité et de succès, jusqu’en 1971. Cl. Sadoun‑Edouard circonscrit ses recherches à la période courant de 1863 à 1914, attachée, après le retrait de Marcelin en 1885, aux directions d’Arnaud Beaudoin (1885‑1901), de Fernand de Rodays (1901‑1907) et de Charles Saglio (1907‑1930). L’étude marque toutefois un intérêt plus particulier pour les années Marcelin, années où se met en place une formule éditoriale qui n’évoluera guère par la suite qu’au rythme des changements politiques et sociaux. Le xxe siècle voit, d’autre part, le contenu de la revue, pourtant considérée d’emblée comme suspecte, tant par les conservateurs républicains ou catholiques que par les tenants des avant‑gardes artistiques, se dégrader progressivement et, en l’occurrence, s’orienter – pour user de l’euphémisme – vers un lectorat masculin et « un libertinage plus brutal que le “libertinage élégant” prôné par Marcelin » (p. 19).
3L’ouvrage, divisé en quatre parties, se présente à la fois comme une possible synthèse de la période la plus emblématique de la vie de la revue et comme une série d’études de cas venant l’appuyer. D’un point de vue méthodologique, il cherche moins à appréhender La Vie parisienne sous l’angle de son histoire et de son évolution diachronique qu’à restituer le ton, l’esprit et l’imaginaire constitutif du journal tel que l’avait conçu Marcelin – un journal‑livre en quelque sorte –, en privilégiant deux grands axes de réflexion : la galanterie et ses avatars, l’obsession de la femme et du féminin. Son fonctionnement éditorial et ses collaborations éclectiques permettent infine de rendre compte de la porosité entre le monde de la presse et le monde littéraire et, dès lors, de la grande plasticité du support médiatique.
Fictions du journal
4La première partie de l’ouvrage s’attache, fort classiquement, à replacer la revue dans le contexte foisonnant de la presse de la seconde moitié du xixe siècle, à en retracer la généalogie, notamment à travers la biographie de son créateur, à en détailler la matérialité et à en exposer le fonctionnement éditorial. L’homme et l’œuvre – si l’on peut dire – ne font qu’un ici, comme ils ne font qu’un avec la société parisienne du Second Empire, mythifiée à travers eux. D’emblée, l’histoire de La Vie parisienne semble concurrencée, voire dépassée, par sa légende – noire ou rose, c’est selon –, nourrie tout autant par les représentations qu’elle forge dans ses pages que par la rumeur – cet aliment essentiel de la vie mondaine –, volontiers recherchée et entretenue par Marcelin. Les sources, concernant tant Marcelin que le journal, sont, curieusement, peu nombreuses et surtout peu fiables. Le chercheur se voit dès lors contraint de recourir aux témoignages des contemporains, publiés pour la plupart dans d’autres journaux, et qui, pour intéressants qu’ils soient, s’avèrent souvent contradictoires. C’est néanmoins dans cette indécision que réside l’une des grandes forces de l’ouvrage – force véritablement romanesque, conformément à son titre –, qui vise à appréhender la revue sous différents angles et points de vue, et à ainsi mettre en lumière, par‑delà sa futilité réelle ou supposée, ses paradoxes. Fils naturel – à tout le moins spirituel – de Nestor Roqueplan, fondateur de la première mouture du Figaro, auquel il aurait repris le titre de son ouvrage, Regain. La Vie parisienne7, Marcelin apparaît, à travers cette mosaïque de voix juxtaposées, comme une personnalité complexe et pour le moins ambivalente. Les témoignages le montrent, tour à tour et simultanément, en dessinateur talentueux, faisant ses classes dans la presse satirique de Charles Philipon8, en opportuniste proche des cercles de l’aristocratie impériale, en esthète et collectionneur passionné d’estampes, en travailleur émérite, en libertin superficiel, en autocrate ou en artiste raté, victime des conditions économiques imposées par une société bourgeoise et capitaliste. Quand les Goncourt en font un emblème du mélange des genres et de la confusion des valeurs attachés à un Second Empire sur le déclin, Nadar le peint acontrario en révolutionnaire, donnant à voir en filigrane des pages de son journal la vacuité et la corruption du régime de Napoléon III.
5De la légende de Marcelin, on glisse vers une autre légende, délibérément cultivée par ce dernier, celle attachée aux rédacteurs du journal. En cette ère médiatique, caractérisée par une multiplication des titres de presse et une professionnalisation accrue des journalistes, Marcelin met en place une recette éditoriale inédite, poursuivie par ses successeurs, qui permet à sa revue de se distinguer de la production de masse et de conquérir le public highlife qu’elle ne cesse de fantasmer à travers ses pages, et qui n’est d’ailleurs, peut‑être, qu’un public halflife – de demi‑mondains9 –, voire de provinciaux fascinés par la capitale10, fonctionnant par mimétisme avec le grand monde. Cette stratégie repose sur une fiction, destinée à flatter l’appétit de distinction de ce lectorat putatif, celle d’un journal « sans le concours de journalistes », selon la formule de Charles Joliet (p. 99), autrement dit d’un journal écrit non par des rédacteurs professionnels, mais par des collaborateurs mondains, dissimulés sous des initiales ou des pseudonymes pittoresques. Cl. Sadoun‑Edouard déconstruit avec une savante érudition ce mythe fondateur en montrant notamment que derrière cette armée de dilettantes blasés et d’aristocrates oisives, au service de la ligne éditoriale imposée par l’homme‑orchestre qu’est Marcelin, se cachent tantôt des journalistes aguerris, venus pour un certain nombre de la petite presse, tantôt des écrivains, soit déjà consacrés – tel Hippolyte Taine, ami proche de Marcelin –, soit en devenir et pour lesquels la revue joue un rôle de « matrice littéraire », pour reprendre l’expression de M.‑E. Thérenty11. La généralisation de la formule hétéronymique à l’ensemble du journal contribue à instaurer une connivence avec un lectorat mondain ou supposé tel, à créer l’illusion d’« un entre‑soi brillant où se mélangent lecteurs et rédacteurs dans un sentiment commun d’appartenir à une élite raffinée et spirituelle » (p. 104).
6L’analyse de la critique d’art, menée dans la seconde partie de l’ouvrage à travers l’exemple de la réception du Salon de 1865, vient confirmer cette analogie entre la poétique du journal et l’éthique mondaine, qui relève en quelque sorte de sa politique – de sa poétique – promotionnelle. La critique d’art, si elle est un lieu important de la revue, n’y relève pas d’une rubrique régulière. L’exposition y est en outre principalement considérée sous l’angle de l’événement mondain. Les « promenades » au musée de Thilda, signataire de cette série de critiques, dont le pseudonyme en forme de clin d’œil à la Princesse Mathilde, cousine de l’Empereur, participe de la stratégie de mystification mondaine instaurée par la revue, se construisent ainsi selon un modèle conversationnel – modèle stylistique qu’on trouve parallèlement à l’œuvre dans le feuilleton dramatique des grands titres de presse d’alors12. Le ton, qui se rapproche de celui d’une causerie de salon, mime l’oralité et affecte une forme de spontanéité, en recourant massivement à l’interpellation au lecteur. La critique peut ainsi se laisser aller au plaisir de la partialité et de l’impression personnelle, marquant son refus de l’érudition et cultivant le goût du paradoxe, ainsi qu’un certain anti‑intellectualisme, en phase avec le dilettantisme présumé de ses rédacteurs comme de son lectorat. L’enjeu de la formule hétéronymique s’avère, outre un enjeu d’écriture, un enjeu de genre – objet de la troisième partie de l’ouvrage –, puisque derrière certains pseudonymes féminins peuvent se cacher des hommes (Thilda est le pseudonyme de Gustave Droz), de même que sous certains pseudonymes masculins, à tout le moins ambivalents, se dissimulent des rédactrices (Ange‑Bénigne est le pseudonyme de la comtesse Paul de Molènes, Camille Selden celui d’Élisabeth de Krimnitz).
7Dans la stratégie élaborée par Marcelin – homme de presse, mais aussi dessinateur et graveur, rappelons‑le –, il ne faut pas négliger enfin la place fondamentale qu’occupe l’illustration, véritable outil de promotion – et de séduction – de la revue. Sa présence massive, en lien étroit et à égalité avec le texte – qui en fait à certains égards l’héritière aussi bien du Magasin pittoresque ou de L’Illustration que des publications satiriques de Philipon–, renvoie à la prégnance de l’image dans la culture du xixe siècle – phénomène bien mis en lumière dans la recherche littéraire récente, sous l’influence notamment des visual studies. Comme le rappelle à juste titre Cl. Sadoun‑Edouard, si le journal de Marcelin est resté dans la mémoire littéraire, c’est, d’abord et avant tout, par ses dessins, ou plutôt ses « gravelures » – terme en forme de jeu de mots forgé par Pierre Larousse. De fait, c’est par l’image que se construit, sur la durée, ce fameux mythe de la vie parisienne, que cristallisera l’ouvrage d’Offenbach, et qui est tout autant, dans cet univers parfumé et froufroutant, le mythe de la Parisienne que le mythe de Paris comme ville féminine et comme capitale du monde (la preuve – éloquente – par la représentation que la revue donne, en contrepoint, de Londres, objet de l’un des chapitres). Mise en scène sur la couverture de la revue, à la manière d’une « promesse », d’un « programme » et d’un « cahier des charges » (p. 155), la Parisienne de Marcelin incarne l’idéal d’une femme « antinaturelle » (p. 158), qui n’est pas sans évoquer les aspirations, sensiblement à la même époque, d’un Baudelaire. Continûment mise en scène et mise en images par la revue, cette coquette impénitente, immédiatement reconnaissable à ses lignes au graphisme standardisé, séduit par un corps tout en « courbes et ondulations » (Augustin Fillon, p. 158), mais aussi par sa gaieté, son élégance raffinée et… ses mœurs délurées, autant de « vertus » qui en font véritablement l’emblème de la fête impériale et d’un Paris mythifié à travers elle.
Ressaisir l’esprit de La Vie parisienne
8Qu’en est‑il, dans ce cadre éditorial, du contenu de La Vie parisienne– de sa « manière » et/ou de sa « matière » (l’une semblant se confondre avec l’autre) ? Celle‑ci est successivement abordée à travers le prisme, doublement romanesque, de la galanterie (deuxième partie) et de la femme (troisième partie), qui en infléchissent le caractère strictement mondain. Vue sous ces deux angles particuliers, certains commentateurs contemporains n’hésitent pas à évoquer la revue, dont le sous‑titre n’annonce pourtant rien, a priori, que de très anodin, par le biais de la métaphore olfactive, qui, pour être puissamment évocatrice, n’en possède pas moins un caractère dégradant, venant ainsi justifier sa mauvaise réputation, celle tenant, non d’une mondanité évaporée, mais d’une grivoiserie délétère. Pour résumer, le « musc », parfum capiteux, sinon sulfureux, signalerait l’ancrage de la revue dans un xviiie siècle fantasmé – un xviiie siècle de « petits maîtres » et « en voie de décomposition »–, le « patchouli », qui en est comme la version moderne, corrompue et bon marché, viendrait de son côté rappeler que la revue naît et « prospère dans un xixe siècle industriel, mercantile et factice » (p. 184). Dans les deux cas, l’image du parfum tendrait à associer La Vie parisienne à l’idée de « dissimulation » et à celle de « décomposition » (p. 184). « Dissimulation » des bas instincts de l’homme et « décomposition » d’une société corrompue qui s’étourdit dans la fête, le paraître et le matérialisme – celle‑là même dont La Vie parisienne s’affiche comme le parfait miroir –, l’allusion, avec ses connotations naturalistes ou fin‑de‑siècle, semble transparente.
9Par-delà les rumeurs, qui tendent donc à en souligner la nocivité, l’examen attentif des discours publiés dans la revue conduirait plutôt à la situer, du moins dans sa première mouture, dans un entre‑deux : celui d’un « esprit français » – notion complexe que l’auteur s’essaye d’ailleurs à définir dans un chapitre spécifique – pris dans une tension, quand ce n’est pas une collusion, entre musc et patchouli, galanterie et grivoiserie, bon goût et polissonnerie, humour et gauloiserie. Le feuilleton Monsieur, Madame et Bébé, signé Gustave Droz, peintre devenu écrivain grâce au soutien de Marcelin, permet de tracer quelques linéaments de l’imaginaire du journal. Cette publication de 1865 est ainsi appréhendée comme un événement éditorial – un texte‑phare dans le succès de la revue – à même de définir la voix du journal – un mélange de dilettantisme et de parisianisme – et son esthétique – laquelle tient avant tout du tableau de genre ou de la chose vue. Le roman de Droz se fait par ailleurs le creuset d’un discours social inédit sur la conjugalité, qui n’exclut pas l’érotisme et le libertinage, directement en phase avec le lectorat moderne – forcément riche, heureux et oisif – de la revue. Les nombreux commentaires qu’il suscite croisent enfin, jusque chez ses détracteurs, la double référence au Second Empire, dont Droz serait parvenu à capturer l’esprit, et au xviiie siècle, dont il aurait su simultanément ressusciter l’art de vivre.
10Cette analyse d’un roman oublié, qu’on pourrait juger a priori anecdotique et secondaire, mais qui apparaît dans la démonstration comme une clé importante de l’esprit de La Vie parisienne, trouve des prolongements passionnants dans la réflexion menée autour de la référence au xviiie siècle, constante de la revue depuis sa création jusqu’en 1910 au moins. La « dix‑huitiémomanie » (Colette Cosnier‑Hélard, p. 246) de la seconde moitié du xixe siècle est un phénomène déjà exploré par la recherche13 et que permettent notamment d’apprécier, à peu près à la même époque, les écrits sur l’art d’Arsène Houssaye ou des Goncourt. La Vie parisienne se fait le relais – et le reflet – de cette fascination, tant esthétique qu’éthique, qui participe de l’identité de la revue au même titre que la parisianité. Elle tend même, si l’on suit l’analyse, à l’amplifier, au sens où elle n’y revêt pas qu’une simple valeur pittoresque. Cl. Sadoun‑Edouard l’identifie par exemple dans la présence de contes libertins, à la manière de Crébillon, dans la critique d’art et la critique littéraire, dans les chroniques de mode et jusque dans la matière visuelle et iconographique du journal – le style présidant à certaines gravures de mode ou les putti inspirés de Fragonard ornant ses pages. Elle la détecte aussi dans des détails plus subtils, déterminant l’esthétique même de la revue, comme le goût rococo pour la mignardise, le bibelot ou l’objet féminin érotisé, qui renvoient à un xviiie siècle rêvé, résolument hors du temps et apolitique. La Vie parisienne creuse ainsi le fantasme, en plein xixe siècle, d’une société galante, à la Watteau, uniquement vouée au jeu, au plaisir et au culte de la beauté.
11Cette beauté, on comprend qu’il s’agit d’abord et avant tout de celle de la femme, ce « joujou », ce « bibelot » magnifique qu’elle ne cesse non seulement d’exalter, mais aussi d’explorer, et qui, plus encore que son « esprit », en constitue véritablement « la matière matricielle » (p. 280). La Vie parisienne appelle à nouveau la métaphore du parfum, qui trouble les sens et/ou dissimule l’obscénité, avec ses connotations tout à la fois galantes, grivoises, naturalistes – misogynes aussi bien sûr –, xviiie et xixe siècles mêlés. Jules Lemaître écrit à cet égard qu’elle « est d’abord le recueil d’écriture le plus profondément imprégné de cette odor di femina qui flotte sur le monde depuis qu’Ève s’est dressée parmi les grandes fleurs du Paradis terrestre, ou depuis que Vénus a tordu ses cheveux ruisselants de l’eau de la mer Ionienne » (p. 280). À l’image olfactive se conjugue celle, tout aussi ambivalente, du boudoir, dérivée de celle du salon, dans l’intimité duquel le lecteur est invité à pénétrer. Cette prégnance du féminin – d’un féminin fatalement stéréotypé – dans les pages de la revue, qui se qualifie elle‑même en 1899 de « feuille‑femme », conduit donc Cl. Sadoun‑Edouard à l’examiner, dans la troisième partie de l’ouvrage, sous l’angle de la question du genre, question qui n’est pas là pour satisfaire à l’air du temps, mais qu’appelle effectivement la composition de la revue. Pensée sur le mode de « l’itératif, moteur même de la mondanité » (p. 284) – du retour du même au fil des saisons –, La Vie parisienne s’impose en effet, de prime abord, comme une « revue pour dames » (p. 288), à la fois par sa forme, très illustrée, par ses nouvelles, sentimentales ou mondaines, par ses rubriques – y compris celles qui ne sont pas a priori genrées, comme la critique littéraire ou théâtrale –, ou encore par son écriture, conçue sur le mode léger de la conversation mondaine. Pour autant, et bien que la rédaction de la revue soit ouverte à nombre de plumes féminines, les représentations qu’elle façonne ne sont pas, dès l’origine, exemptes d’ambiguïtés. Au travers notamment de sa double page centrale ou de ses séries illustrées d’études anatomiques et physiologiques, La Vie parisienne offre une vision fétichiste et fantasmatique du corps de la femme – qu’on découvre tantôt « mise en morceaux », tantôt réduite à des accessoires affriolants –, qui l’adresse à un lecteur curieux et placé dans une attitude ouvertement voyeuriste. Elle peut, à ce titre, être aussi envisagée comme une « revue pour messieurs » – une dimension qui ne fera que se renforcer avec le temps et le tournant « pornographique » de la revue au xxe siècle. Marquise, bourgeoise ou bien grisette, la femme de La Vie parisienne – Parisienne majuscule qui fait corps avec la ville – ne peut donc exister en dehors de la fiction, très normée, conçue par Marcelin, celle d’« une femme composite, mondaine et demi‑mondaine, distinguée et libertine » (p. 296), résolument aux antipodes de la femme zolienne, par nature « désérotisée ». Il y a là, sans nul doute, matière à penser la distinction entre « presse féminine », qui parle et met en scène la femme sans pour autant faire émerger un discours féminin, et « presse féministe », dont La Fronde14, évoquée au travers d’un court chapitre, fournit un contre‑exemple à la même époque.
Penser La Vie parisienne dans le champ littéraire
12Au travers de cette enquête au long cours, un fil directeur se dessine peu à peu, au fil des chapitres : comment la revue, ode « poudrée » et « musquée » à la superficialité et au stéréotype, que Cl. Sadoun‑Edouard définit d’emblée par son « indifférence à la littérature » (p. 140), s’inscrit-elle, paradoxalement, dans le champ littéraire ? Les déclarations de Marcelin, appuyées par l’étude détaillée, dans la première partie, des profils des collaborateurs de la revue et, dans la troisième, de la participation active de nombreuses femmes de lettres à sa rédaction, montrent pourtant que La Vie parisienne est loin de s’abstraire du champ littéraire et qu’elle en est même pleinement partie prenante, jusque dans ses postures ironique ou parodique. Les études de cas viennent confirmer à l’occasion ces liens et s’accompagnent en outre de comparaisons très stimulantes entre les discours produits par le journal et ceux émanant de la littérature contemporaine, notamment autour des valeurs et des significations de la « dixhuitiémité ». Objet d’un chapitre complet, qui ouvre stratégiquement l’analyse de la manière de la revue, le feuilleton de Gustave Droz, Monsieur, Madame et Bébé, est présenté comme un succès tout à la fois médiatique et littéraire, qui consacre, selon certains critiques, l’émergence d’un nouveau genre littéraire, le « genre Vie parisienne » (René Doumic, p. 216), Ce genre se définit par un ton particulier, qui renvoie à ce fameux « esprit français » si complexe à cerner : « léger dans la caricature et léger dans l’épanchement sentimental, il reste à la surface et se présente comme un produit de la mode et de l’instant suspendu et festif des dernières heures du Second Empire » (p. 218). Le feuilleton de Droz préfigure en outre d’autres séries du même type, signées Gyp (dont presque toute la production est liée à La Vie parisienne), Henri Lavedan, Paul Bourget, Paul‑Jean Toulet ou Colette, qui deviendront de grands succès d’édition. La quatrième partie de l’étude, qui systématise et approfondit la réflexion autour des relations entre presse et littérature, examine de son côté l’émergence de quelques‑uns de ces nouveaux genres inventés par la revue, notamment le roman dialogué mondain, adaptation du roman psychologique, hérité de Paul Bourget, au format du journal, dans lequel Cl. Sadoun‑Edouard décèle un genre « qui s’érige en négation de la littérature » ou en fait simplement « un objet de consommation éphémère et futile – à l’image de La Vie parisienne » (p. 498). On pourrait aussi voir là comme une forme d’apothéose de la morale du dilettantisme, conjuguée à l’esthétique mondaine de la causerie, promues continûment par la revue à travers ses chroniques.
13Dans cette perspective, le dernier volet de l’ouvrage propose une nouvelle série d’études de cas qui confrontent la revue aux grands courants esthétiques dominants de la fin du xixe siècle. Plutôt que d’« indifférence » – terme emprunté à Barbey d’Aurevilly15 –, Cl. Sadoun‑Edouard préfère d’ailleurs parler là de « désinvolture » (p. 381) de la revue à l’égard du champ littéraire. De fait, celle‑ci cultive un snobisme, s’exprimant par un anti‑intellectualisme, doublé d’un rejet des appartenances d’école, qui la mettent d’emblée en porte‑à‑faux avec une bonne partie de la production littéraire contemporaine, que ce soit le roman naturaliste ou les avant‑gardes poétiques – Huysmans ou Mallarmé pour faire court –, volontiers soupçonnées de « fumisterie » (p. 385). Il est frappant à cet égard de constater, à quelques chapitres de distance, la parenté entre le discours qui se dessine dans les causeries sur l’art de Thilda et celui qui se construit au travers des chroniques littéraires. On y trouve en effet une même revendication d’impressionnisme et de partialité, un même refus du formalisme et de l’abstraction, une même défense du « beau » académique, qu’il soit pictural ou langagier, un même culte du bon sens bourgeois – de celui qui se satisfait de choses simples et élégantes –, autant de postures susceptibles de définir le ton et l’esprit général de la revue, par‑delà les domaines abordés. Cl. Sadoun‑Edouard en souligne d’ailleurs la permanence à travers le temps. Dans les années vingt, ce sont, fort logiquement, Arnold Schönberg pour la musique et les surréalistes pour la littérature qui paieront le prix de cette « désinvolture » revendiquée.
14Campée dans ses positions rétrogrades, qui ne sont pas sans évoquer, mutatismutandis, le combat d’un « art officiel » contre un « art dégénéré », La Vie parisienne semble subir en retour le rejet d’à peu près tout ce qui compte alors sur le plan intellectuel, non seulement des écrivains naturalistes et des représentants des avant‑gardes, mais aussi des tenants de la morale, républicaine ou catholique, qui voient dans la revue l’expression même du délitement intellectuel et moral du Second Empire. Ainsi s’installe la mauvaise réputation de La Vie parisienne, déconsidérée par ses positions et sa culture de la futilité, et pas même rachetée par son soutien à Paul Bourget, dont le « naturalisme mondain » et l’écriture en forme de « croquis pris sur le vif » (p. 482) semblent se retrouver pleinement dans le projet de la revue telle que l’avait initialement conçue Marcelin16, fortement préoccupé lui aussi de peinture de mœurs. Le grand intérêt de cette dernière partie est justement d’avoir su dépasser les postures et les discours de façade en montrant, à travers des analyses tout à la fois fouillées et nuancées, que la revue de Marcelin non seulement donne une place importante à la littérature à travers ses chroniques, mais aussi constitue un lieu de passage et de création pour un grand nombre d’écrivains et, de surcroît, d’écrivains porteurs d’une exigence littéraire. Dès lors, une autre approche de la revue, qui ne la réduit pas à un simple objet « anti‑littéraire », devient possible. Au‑delà même de La Vie parisienne, nous avons dans ces pages, indéniablement, pléthore de pistes de réflexion et de recherche permettant de penser les relations qui se bâtissent entre la presse et les esthétiques littéraires en place ou en formation.
15La rencontre semble, à vrai dire, presque aller de soi avec les « poètes impeccables » que sont Baudelaire, Gautier et Barbey d’Aurevilly. Le premier y publie une partie de l’essai Le Peintre de la vie moderne, notammentl’« Éloge du maquillage », ainsi que quelques poèmes, et l’on peut sans peine rapprocher sa défense de l’artifice et son horreur de la « femme naturelle » de l’idéal féminin promu par La Vie parisienne. Quant aux deux autres, ils sont des lecteurs et admirateurs revendiqués de la revue. Leur dandysme, mais on pourrait ajouter leur dédain commun de toute forme de littérature engagée, se retrouvent pleinement dans l’apolitisme, partant l’amoralisme, de La Vie parisienne. La rencontre de la revue avec l’esthétique naturaliste, dont elle se présente à bien des égards comme l’antithèse, est sans nulle doute plus inattendue. Elle se fait, du reste, sur un mode polémique dans la nouvelle de Huysmans, Un dilemme, qui utilise la référence à La Vie parisienne comme un repoussoir – la revue emblématise ce « bourgeoisisme » qu’il exècre –, dont il démythifie au passage les stratégies de séduction et les ressorts mercantiles. Le cas de Zola paraît plus représentatif de l’ambivalence des relations de la revue au champ littéraire en général : dans son traitement de l’écrivain, elle témoigne certes de sa « désinvolture » – il y est l’une des figures les plus souvent caricaturées –, mais aussi de sa capacité à jouer le rôle de matrice à la création littéraire – il y publie notamment une nouvelle mondaine, La Caque, écrite dans l’esprit et le ton de La Vie parisienne. Cl. Sadoun‑Edouard clôt sa réflexion sur des analyses, qui mériteraient sans doute d’être poursuivies, proposant de repenser l’esthétique de la revue sous l’angle de l’adaptation (au « naturalisme canaille » d’un Zola répondrait le « naturalisme élégant » de La Vie parisienne, tout comme le « roman dialogué » ferait écho au « roman psychologique ») et du transfert culturel (avec l’avènement du genre théâtral dit de La Vie parisienne dans les années 1890 ou l’inspiration de la revue par la mouvance dite « fantaisiste »), par‑delà, donc, son opposition paradigmatique au littéraire en général et au naturalisme en particulier.
***
16Il faut saluer en premier lieu l’entreprise de Cl. Sadoun‑Edouard, qui a relevé le défi de la monographie en se confrontant à cinquante années de la vie d’un journal, qu’elle prend le parti d’assumer non pas seulement à travers le prisme d’une rubrique, d’une thématique ou d’une collaboration emblématiques, comme cela a souvent été le cas dans les études littéraires sur la presse, mais bien dans sa totalité, partant dans sa banalité et son ressassement, comme dans ses paradoxes et ses coups d’éclat. Il est à cet égard difficile de rendre compte de la richesse d’un tel ouvrage, qui propose une série d’études d’une densité et d’une érudition remarquables, porteuses de surcroît d’une grande force de persuasion, grâce notamment au sens aigu de la nuance et du contrepoint qu’elles manifestent. Dotés d’une relative autonomie, ses chapitres successifs, autour de la galanterie, de la femme ou de l’implication de la revue dans le champ littéraire, se font subtilement écho et se révèlent infine solidaires, permettant de donner une incarnation à des notions aussi floues et impressionnistes que « la manière », « l’esprit », « le ton » d’un journal et d’en reconstituer ainsi « l’imaginaire » ou, pour reprendre le titre de l’étude, « le roman ». Si la première partie ne cherche pas à éluder les difficultés méthodologiques de l’entreprise, la plongée effective dans les textes de la revue autorise par la suite la démonstration à prendre son envol. Les directions et les articulations en sont d’une grande clarté et les analyses, en dépit de l’abondance des informations et des sources mentionnées, d’un dynamisme appréciable, donnant lieu au passage à de vrais bonheurs d’écriture. Les grilles de lecture adoptées permettent ainsi de saisir, au regard d’autres publications journalistiques de l’époque, la spécificité, pour ne pas dire le caractère exceptionnel, de cette revue, qui, par‑delà sa qualité revendiquée de miroir social, s’inscrit dans une forme d’inactualité – une actualité romanesque – propre à forger son mythe. Les ouvertures comparatistes mentionnées dans la conclusion (Gil Blas, Punch, Berliner Leben) sont par ailleurs bienvenues et stimulantes pour le chercheur.
17Qu’il nous soit toutefois permis d’exprimer deux petits regrets. Si les axes privilégiés pour aborder l’esprit de la revue sont parfaitement cohérents et exploités avec finesse et fermeté, ils nous semblent toutefois minimiser ou laisser de côté d’autres formes de « mœurs » ou de « choses du jour » mises en lumière par la revue de Marcelin – nous pensons en particulier au traitement qu’elle réserve, par le texte et par l’image – et souvent aussi par le biais du pastiche ou de la parodie –, au spectacle et à l’univers des théâtres, qui participent pourtant pleinement du mythe de la vie parisienne et, parallèlement, de sa déconstruction. De même, si l’importance de l’image dans la composition éditoriale de la revue est soulignée et si celle‑ci donne effectivement lieu à des descriptions et à des analyses, il est dommage que les contraintes attachées à une publication académique ne permettent pas de mettre véritablement en valeur – de donner à voir dans sa relation dialogique avec le texte – cet aspect essentiel et tout à fait singulier de la revue. On signalera à ce titre, en écho à la publication de la somme de Clara Sadoun‑Edouard, que l’Institut national de l’histoire de l’art vient d’achever son programme de numérisation et d’indexation de la revue pour la période 1863‑191317, qui donnera lieu à une journée d’étude le 25 septembre 2018, preuve supplémentaire de l’intérêt que suscite, dans le sillage de l’important renouvellement des études littéraires sur le journal du xixe siècle, la revue de Marcelin et le mythe qu’elle fabrique et cristallise tout à la fois.

