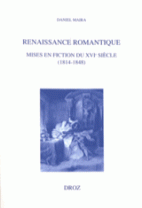
Pour une écriture « falsificatrice » de l’Histoire du XVIe siècle
1Depuis une dizaine d’années environ, les études de réception d’un siècle par un autre sont légion – on en appréciera le nombre par l’étendue de la bibliographie placée à la fin de l’ouvrage1. Souvent, ce sont le xixe siècle et ses écrivains qui sont conviés par les critiques pour saisir leurs modes d’appréhension littéraire des siècles passés, cet Ancien Régime si cher à Michelet. Daniel Maira se propose pour sa part d’interroger les romantiques qui mettent en scène dans leurs fictions ce que l’histoire littéraire a nommé la Renaissance. Plus largement, le critique montre la manière dont le xvie siècle est mis au service des idées politiques et sociales des romantiques – ou, pour le dire autrement, comment l’écriture de l’histoire est « falsifiée2 » par les écrivains eux-mêmes qui induisent leurs discours et récits à partir de leur interprétation des documents. Le titre, Renaissance romantique, peut dès lors se comprendre comme un double programme charpentant l’ensemble de la réflexion. Est-ce la période littéraire et historique qui s’habille des flammes du romantisme, tissant ainsi des liens avec son présent en recourant à des valeurs communes aux deux périodes ? Ou est-ce finalement une nouvelle naissance du mouvement littéraire romantique, qui renaît perpétuellement tout au long du xixe siècle grâce à ce retour vers cette Renaissance française ? Le sous-titre nous guide à mieux saisir le sens : Mises en fiction du xvie siècle (1814‑1848). Finalement, en supprimant à propos l’article défini de la formule consacrée, Daniel Maira a judicieusement rendu son titre ambigu pour mieux le démontrer : revisiter la Renaissance (le xvie siècle, par conséquent), c’est à la fois la (re)fabriquer pour en tirer toute « la substantifique moelle », mais aussi en faire « une défense et illustration » de l’identité et de la nation françaises.
Comprendre les enjeux des mises en fiction de la Renaissance
2Dès l’introduction, D. Maira s’intéresse au problème de la périodisation : si la renaissance (sans majuscule) avait été perçue comme celle des arts et des lettres par les humanistes, rapidement, les hommes du xixe siècle l’ont transformée en une « “époqueˮ intelligible de l’histoire, et donc en notion historique » (p. 13). Infirmant les propos de Lucien Febvre qui fait de Jules Michelet le concepteur de « la notion historique », la Renaissance, le critique affirme que « la périodisation, le concept et le terme de “renaissanceˮ bénéficient déjà d’une histoire remarquable lorsque cette notion arrive au xixe siècle » (p. 14), dès avant 1840, avec Pierre Leroux, Félix Davin, Stendhal, etc., dont les œuvres historiographiques et littéraires nourrissent les réflexions de Michelet. Il sera alors question pour l’universitaire de voir comment « la fiction construit et décore cette période » (p. 15), celle allant de l’avènement de François Ier (1515) à la mort de Henri IV (1610). Il s’intéressera aussi à ces images de la Renaissance et à ses inflexions qui se donnent à voir dans la littérature romantique, évoluant, encore et encore avec et dans le temps, et ce jusqu’à la fin de la Monarchie de Juillet. Rappelant « le pouvoir d’autorité et d’authenticité » des sources, D. Maira analysera les manipulations auctoriales du concept historiographique à des fins idéologiques, en en montrant les différents aspects : de « la réconciliation nationale » à « l’embourgeoisement des mœurs et de la culture », en passant par le « retour du sentiment chrétien » ou à « la professionnalisation du génie » (p. 23). Tout cela se passe comme si la mise en fiction de la Renaissance devenait un enjeu majeur pour les historiens et les écrivains – D. Maira n’hésite pas à utiliser la métaphore de « l’arme » pour désigner cette fonctionnalisation (p. 28, p. 60). Il y aurait par conséquent, explique-t-il, « autant de “Renaissanceˮ que de “croyances politiquesˮ qui cherchent dans le passé la légitimité ou la compréhension du présent » (p. 24). Sont alors convoquées à juste titre les préfaces des écrivains (H. Balzac, V. Hugo, P. Leroux, A. Esquiros, etc.) qui s’expliquent sur ce retour dans le passé. D. Maira confrontera leurs idées à celles des penseurs plus actuels, qui ont réfléchi plus largement sur ce passé recomposé ou à recomposer, à l’instar de Paul Ricœur ou Michel de Certeau.
Du Moyen Âge à la Renaissance : « une périodisation instable » ?
3S’il fut un temps où le Moyen Âge avait été considéré comme une magnifique source d’inspiration, c’est la Renaissance qui l’a détrôné, le plaçant dans un avant, dans « une suite de siècles barbares. » Mais si ces catégories semblent aujourd’hui plus ou moins nettes – voire contestées –, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, les problèmes de périodisation sont analysés par D. Maira qui montre très justement qu’à l’époque de Chateaubriand rien n’est moins sûr puisque lui-même pense vivre « entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves. » Ce flux transitoire où les frontières temporelles sont floues et problématiques montre toute la difficulté à fixer des limites chronologiques de « la Renaissance ». D’autant plus problématique qu’en fonction de l’idéologie de l’écrivain, le xvie siècle peut être perçu comme « le début des Temps Modernes » (ce que D. Maira appelle l’« optique évolutionniste ») ou comme le « début de la déchéance » contrairement à la période précédente, le Moyen Âge chrétien, qui avait marqué « le début de la civilisation européenne » (« dans une perspective conservatrice […] qui apprécie le modèle d’une société fondée sur l’unité religieuse, politique et culturelle », p. 43). De cette périodisation élargie, émergent des images contrastées : une Renaissance des lettres et des arts, mais aussi un moment où s’exprime un « esprit audacieux de doute et d’examen », celui de la Réforme, dans lequel se cristallise l’idée de rupture avec une pensée et un passé conservateurs. Dans ce moment-Renaissance, se fait entendre une « pluralité de voix » qui s’adonnent à de « bruyantes discussions sur des nuances » (Michelet), toutes légitimes, mais peu objectives. Sous la Monarchie de Juillet, certains, comme Michelet ou Quinet, s’insurgent contre l’idéalisation de ce Moyen Âge, préférant « l’avènement d’une modernité constituée et unifiée à partir de ses différences » (p. 59), autrement dit : « une Renaissance révolutionnaire et républicaine » (p. 61). D’autres n’y voit qu’une dégénérescence de l’ordre moral, civil et religieux causée par le républicanisme, l’incroyance, le rationalisme et le relativisme, à l’instar de Bonald, Maistre ou Lamennais. Enfin, suivant en cela Marchangy, l’histoire est conçue comme cyclique et porte en elle à la fois les principes de la civilisation et ceux de sa propre déchéance. Les voix et les discussions ne se taisent pas pour autant. Émergent progressivement une conception palingénésique de l’Histoire ainsi qu’un syncrétisme qui tentent d’associer les pôles afin de mieux borner la temporalité renaissante. Ainsi Chateaubriand souhaite-t-il une « religion du passé », capable de concevoir un renouveau, voire des continuités, où « le passé et le présent sont deux statues incomplètes » (dans René), car la modernité, conclut le critique, « est une métamorphose continue » (p. 75). De condamné, le xvie siècle finit par être réhabilité « dès lors que l’humanisme participe au progrès des vérités catholiques (néo-catholicisme social) » (p. 77).
La chevalerie au service de l’idéologie
4Les contre-révolutionnaires et les Ultras font de la Renaissance une « Renaissance Troubadour », empreinte de cet esprit de chevalerie qui exprime au mieux « la nostalgie d’un passé mythique » pour relancer « les valeurs de la monarchie féodale et de l’ancienne noblesse ». Les conflits sociaux et politiques ne se dénouent que sous la protection divine, minimisant ainsi les idées de la pensée libertaire du xviiie siècle et de l’esprit révolutionnaire, conjurant ainsi « la mémoire d’une réalité conflictuelle » (p. 81). Les romantiques, quant à eux, ont une vision muséologique de la Renaissance, dans une sorte de gaieté « de la vieille France », où les « bonnes choses des vieulx tems » se montrent simplement et « ont une fonction cathartique et surtout régénératrice dans une société en décadence ». Croire à l’avenir en regardant le passé chevaleresque, tel est le principe de cette Renaissance Romantique. Enfin, la Renaissance moderniste est celle d’un Sismondi, d’un Guizot ou d’un Eugène de la Gournerie, capable de soulever le peuple, en lui faisant prendre conscience de sa force. La chevalerie est bannie des mœurs du xvie siècle, et le roi peut dès lors devenir « homme et citoyen français » (p. 89). C’est à travers cette image forte d’une Renaissance qui se coupe définitivement du Moyen Âge que la modernité se revendique, celle d’un Stendhal, d’un Mérimée ou d’un Dumas qui envisagent alors de « militer » (p. 92) « pour les libertés civiles et politiques de la nation et de l’individu ».
La Réforme : de la religion au libéralisme
5Pour légitimer « l’avènement du Tiers-État », Républicains et Libéraux cultivent une vision téléologique de la Révolution. C’est à travers la Réforme religieuse du xvie siècle qu’ils expliqueront à leur génération la cause principale de l’esprit séditieux des Français, au point, écrit D. Maira, que la Réforme est « souvent assimilée, par analogie, à la Révolution » (p. 95). Il faut donc se fonder sur cette expérience forte pour tenter d’expliquer la nécessaire remise en question des temps présents, en s’appuyant sur ce que prônait la Réforme, à savoir « les principes de l’esprit d’examen » et « les libertés individuelles » (p. 97). Contre cette vision associant Réforme et Révolution, certains conservateurs (Bonald, de Maistre et surtout Lamennais) choisissent la Réforme comme origine du déclin de la société française. Pour ces derniers, « la religion a perdu ainsi toute fonction de cohésion sociale du moment qu’elle s’est parcellisée pour défendre les affaires domestiques » (p. 110). Pour Chateaubriand, la Réforme n’est-elle pas « un contre-génie » du christianisme nécessitant par conséquent une action sociale du catholicisme, soutenue par l’idée d’une monarchie catholique ? (p. 115). Cependant, pour les Républicains, prolongeant en cela la pensée de Condorcet, l’esprit d’examen prôné par la Réforme favoriserait l’affirmation d’« une indépendance de l’individu à l’égard d’une autorité extérieure et [rendrait nécessaire] de la constituer comme sujet de droit. » Pour les conservateurs, cet individualisme mène alors à « l’idéologie politique du libéralisme », dont la filiation est perçue comme un problème moral et social sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. C’est parce que la libre pensée émerge au xvie siècle, annonçant en cela « la marche hégélienne en avant vers une modernité » (p. 125), qu’elle a partie liée avec la vision politique au xixe siècle, telle qu’elle s’entend dans les œuvres de Stendhal ou de Mérimée, à cela près que pour l’auteur de Chronique sous le règne de Charles IX, il faut interroger les religions avant de les propager ou de les nier à l’instar de son personnage George de Mergy, athée convaincu, et, assurément, double de l’auteur. Pour Balzac, en revanche, la Réforme mine les autorités institutionnelles et sociales comme l’État, la religion (l’esprit d’examen est avant tout antimonarchique et anticlérical) et la famille, car elle conduit à « l’expression pessimiste du scepticisme et du désenchantement » (p. 133). La représentation de la Réforme peut donc être mise en intrigue, instrumentalisée par la politique, à son service, dans un camp ou dans l’autre, soit pour réfléchir et défendre l’idée monarchique, soit, au contraire, pour en faire un mythe d’opposition et de résistance contre un pouvoir rétrograde et théocratique (« libéralisme protestant ») ou contre les inégalités et les injustices d’une caste bourgeoise (« protestantisme révolutionnaire ») (p. 148).
Instrumentaliser Henri IV : « la propagande » royaliste
6La mise en intrigue des Guerres de Religion passe d’abord par la manière dont est mis en scène le roi Henri IV. Son culte, écrit très justement D. Maira, « est à géométrie variable » (p. 155), et le personnage littéraire « n’existe que par son potentiel d’actualisation » (p. 182) : le divinisant, les royalistes le voient comme le fondateur d’une nouvelle dynastie, capable de « resacraliser » et « rechristianiser » la monarchie déchue (p. 156). Réimaginé par les partisans du royalisme, Henri IV est aussi celui qui permettra non seulement à la génération postrévolutionnaire de saisir les vraies valeurs royalistes, mais également de rehausser le destin des Bourbons ; les aristocrates, quant à eux, le louent, car il s’oppose dans les faits à l’absolutisme royal. Enfin, les libéraux le font protecteur des parlements et de la Charte. Chacun l’instrumentalise à son profit, d’où résulte une profusion, voire « une inflation », d’ouvrages biographiques (à l’instar de celui de Dumas en 1855) qui répètent à outrance les mêmes clichés. Ainsi « juxtaposant les différentes anecdotes » sur le roi, le public des théâtres et les lecteurs d’ouvrages « peu[vent], affirme l’universitaire, se forger un portrait en mosaïque du roi, de l’homme et de son siècle » (p. 167). Bien plus, les références historiques concernant Henri IV s’estompent au profit d’une valeur symbolique visant à une promotion incarnée du régime restauré. Mais les voix discordantes s’élèvent face à cette littérature, comme celle de Roderer, qui, même s’il concède la grandeur du roi Henri IV, n’envisage pas que le pouvoir soit entre les mains d’un seul. On le voit, Henri IV passe du tout au tout, « glissant d’un mythe de propagande de “droiteˮ à un mythe d’opposition de gauche » (p. 183). À travers un roi ainsi « cloné » (p. 190), on recolore la nation, « à la recherche d’une unité » (ibid.). Dès le début de la Restauration, Louis XVIII rétablit la statue équestre de Henri IV et les différents morceaux du corps reflètent cette unité indivisible, comme une métaphore du système politique ressuscité.
La mise en fiction de la Saint-Barthélemy (enfin !)
7L’instrumentalisation du passé, pour les besoins d’une cause, passe nécessairement par « une écriture “falsificatriceˮ de l’Histoire » (p. 208). Après le roi Henri IV, c’est la Saint-Barthélemy qui passe sous le fil de l’écriture. L’évocation des troubles civils aboutit, écrit D. Maira, « à la célébration de l’ordre établi » dans cette première partie du xixe siècle. Elle permet par conséquent d’aligner les troubles du passé sur les conflits du présent. Ainsi « on glisse de la posture patriotique des tragédies à une pensée philosophique du politique » (p. 217, nous soulignons), c’est-à-dire une pensée du présent qui met en débat la citoyenneté, la religion, ce qu’est un « bon gouvernement », les rapports entre les pouvoirs temporel et spirituel et surtout la liberté d’opinion. Les Guerres de religion, particulièrement le massacre de la Saint-Barthélemy, « est enrôlé dans le combat de l’opposition » (Claude Duchet3), alors que le pouvoir en place aurait préféré « passer sous silence cette période honteuse », d’où résulte une certaine censure des œuvres qui mettent en scène l’événement comme les scènes de Ligue de Vitet. L’opposition littéraire (Outrepont, Stendhal), dont le théâtre et les romans deviennent « une tribune politique », cible un régime qui pourrait porter le pays vers une nouvelle exaspération civile. Aussi faut-il présenter la noblesse comme dépravée et le pouvoir comme absolu, incapable de gouverner, comme le pense Roderer (p. 287), alors que le peuple, acteur de second plan, est plutôt à considérer comme « une victime manipulée par les ambitions des grands ». Les œuvres des modérés, certains libéraux et doctrinaires, se caractérisent par cette modération, cristallisée dans la mise en scène de personnages historiques dont la légende dorée a transformé en homme prudent, tolérant et sage à l’instar des Coligny, Michel de L’Hospital ou Montaigne. Sentinelles des abus du pouvoir et de ses conséquences néfastes, ils jouent le rôle de maîtres à penser, issus du passé, mais actualisés dans le présent.
8Ces œuvres qui traitent de la Renaissance engagent donc les hommes de lettres du xixe siècle à réfléchir et à faire réfléchir aux prérogatives de la nation, mais aussi à « la nature constitutionnelle du pouvoir exécutif, [à] la souveraineté de la nation, [au] fanatisme religieux et [à] une politique de la modération » (p. 304).
De la traque du protestantisme au romantisme : le pas est franchi
9Vitet le dit : le romantisme est « le protestantisme dans les lettres et les arts » (p. 223), où, ajoute D. Maira, le terme est « à entendre comme un synonyme de libéralisme » – reprenant à son compte l’idée hugolienne édictée dans la préface d’Hernani. La peinture de cette « Renaissance romantique » se profile alors comme une époque idéale pour s’opposer au pouvoir établi et aux traditions esthétiques – dès 1827, Chateaubriand et Hugo s’opposent aux Ultras. Ils refusent le style troubadour, un romantisme royaliste et enfin un néoclassicisme gouvernemental (p. 224). Progressivement, et parce que l’opposition libérale passe au gouvernement, on glisse « de la représentation de grands hommes à celle de personnages inventés, de l’érudition historique à l’imagination romantique, d’une explication nomologique à l’irréel du possible » (p. 225). L’esprit constitutionnel peut être défendu par le romantisme libéral, en dépréciant les monarchies passées et présentes. Il faut donc qu’émergent de nouvelles formes, puisant dans l’Histoire, mais qui engendre(raie)nt) une nouvelle vérité poétique « où le pittoresque » arrange(rait) la vérité historique (F. Davin), en lui insufflant une âme. Les écrivains s’autorisent contours et détours de l’histoire, desquels surgissent libertés et anachronismes. L’écriture romantique se fait peinture passionnée des caractères et des mœurs du xvie siècle : mœurs frivoles, énergie des passions, crimes irrationnels, magie, et rêves prémonitoires sont alors le ciment de la « couleur locale ». On n’est plus dans l’universalisme de l’Histoire, mais dans « le relativisme des mœurs et des passions du “Français au xvie siècleˮ » (p. 242). Les grands hommes divinisés sont descendus de leur piédestal, ils peuvent être humains et grotesques, et les lecteurs sont à même de les suivre dans leurs entrelacements passionnels, entre politique et vie privée, au prisme de leurs vies anecdotiques qui deviennent « un spectacle ».
Renaissance romantique ou la vision genrée du pittoresque
10D. Maira poursuit son étude en se demandant comment le pittoresque « construit conjointement un régime de normalisation historiographique (la Renaissance) et la naturalisation genrée (le masculin) » (p. 248). Pour étayer son hypothèse, il problématise la manière dont les écrivains du xixe siècle entérinent le pouvoir par/de l’homme ou, pour le dire autrement, comment « le genre masculin fabrique la Renaissance à son image » (ibid.). Ainsi, il est des cas où le roi, tout particulièrement Henri III, est souvent féminisé (ou en perte de virilité) à cause de sa mollesse et de son goût pour la poésie. Ce qui trouble le pouvoir masculin et montre que sa représentation découle d’une crise du pouvoir. Le critique observe alors un déplacement symbolique du pouvoir vers la figure de Catherine de Médicis, une femme virile dans sa pratique du pouvoir (l’influence des femmes) et de surcroît italienne (pratiquant l’ingérence politique), qui dérange « l’ordre normatif » masculin. Elle devient par conséquent, pour D. Maira, queer (p. 264). A contrario, une surmasculinité (ou une re-masculinisation) apparaît dans l’image de Henri IV, seul capable de redresser la barre du masculin fort et de l’image patriarcale du bon père, protégeant ainsi la politique de l’intrusion des femmes, du féminin et de l’étrangère.
La Renaissance : un contre-présent ?
11La Renaissance romantique est aussi ce moment où les écrivains transforment cette période en un espace de révoltes et de libertés qui sclérose les hommes. Pour eux, « la représentation littéraire des excès de la Renaissance se transforme en un répertoire subversif adressé contre [sic] l’hégémonie du pouvoir dominant » (p. 330). En cela, et toujours selon D. Maira, « pour les romantiques, la Renaissance est queer dans la mesure où elle est une époque qui se démarque de l’ordre et des normes morales préétablies » (ibid.). Elle est donc ce « contre-présent » qui cautionne l’insurrection à travers une représentation des dangers qui minent la société de l’intérieur. C’est aussi à la Renaissance italienne que les écrivains du xixe siècle font souvent allusion, à la manière de Stendhal qui y admire à la fois l’âge immoral et générateur de génie. Il n’est plus étonnant de voir intervenir dans les fictions les Benvenuto Cellini (dans Dumas par exemple) et les Médicis de Florence. Cette Renaissance appelle alors à la résistance et au droit à la révolte. L’immoralisme ainsi révélé s’écrit donc dans la littérature, sans jugement, car les écrivains comprennent que c’était un autre temps, « un âge de passions » que le peuple peut faire sien. Progressivement, l’esthétique et l’éthique défendent des positions politiques favorables à la tolérance du pluralisme. Émerge de cette liberté énergique l’opinion publique, et c’est l’écriture du passé fantasmé qui fait craindre aux conservateurs « une dictature qui risque d’amener au désordre social et aux licences morales » (Ballanche), « une anarchie culturelle sous le signe de la médiocrité » (Nodier) ou « l’immobilité politique » (Balzac) (p. 489). Ceux qui regardent l’avenir, les autres par conséquent, se réjouissent des libertés individuelles que la Renaissance, et avec elle l’imprimerie, les grandes découvertes et les voyages, ont apporté au peuple. Il faut savoir les utiliser avec raison pour diffuser la bonne parole « républicaine ».
***
12L’étude de D. Maira est stimulante à plus d’un titre même si l’on regrettera l’intrusion au milieu de cette étude historico-littéraire d’une partie gender studies (p. 247‑274), non pas pour en discuter le bien-fondé (qui est à notre avis dans l’air du temps, même si le terme répété queer nous semble ici maladroit), mais parce qu’elle rompt la linéarité du propos. D’autant plus dommage que ces réflexions sur l’insuffisance du masculin avaient déjà paru dans un autre recueil à propos des « Masculinités insuffisantes au pouvoir : Henri III et sa cour d’Alexandre Dumas4 ». Il aurait été peut-être plus judicieux, pour ne pas rompre la démonstration des oppositions et l’analyse de la fabrique de la Renaissance, de nommer cette étude en note de bas de page. Au-delà de ce grief, l’ouvrage trace de façon très structurée la manière dont le xixe siècle devient lecteur du xvie siècle5. À travers de grands thèmes, sans doute un peu stéréotypés, mais nécessaires, il parvient à montrer la manière dont les romantiques s’emparent des différentes représentations de la Renaissance/des Renaissances, non pas pour la/les faire revivre telle(s) qu’elle(s) étai(en)t, mais telle(s) qu’ils la/les voyaient dans un premier temps, puis telle(s) qu’ils la/les fantasmaient dans un second temps. En filigrane, Renaissance romantique. Mises en fiction du xvie siècle est un ouvrage qui s’écrit aussi en suivant la courbe du temps, celui du romantisme : de ses limbes à son affirmation la plus libertaire. Sans jamais prendre parti, D. Maira, et c’est aussi l’intérêt de cette étude, décrit les forces en opposition, car son livre n’est in fine qu’une somme d’oppositions, perçues par la même personne. Il réussit en cela les objectifs qu’il s’était fixés dès l’introduction (p. 17, p. 20). Il réussit aussi à convaincre : ses hypothèses de lecture (p. 22, p. 31, etc.), clairement énoncées, ne sont jamais perdues de vue, leurs démonstrations sont étayées avec rigueur et assurance.

