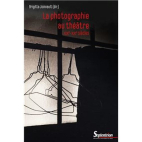
La photographie au théâtre : une épistémologie foisonnante à l’épreuve de la scène
En ce qui concerne la photographie, elle se développe sous la forme d’un paradoxe : celui qui fait d’un objet inerte un langage et qui transforme l’inculture d’un art « mécanique » dans la plus sociale des institutions1.
1Ce paradoxe évoqué par Roland Barthes s’impose comme la pierre angulaire d’une réflexion intermédiale entre la photographie et le théâtre dont témoigne l’ouvrage collectif La Photographie au théâtre xixe‑xxie siècles, publié sous la direction de Brigitte Joinnault. Ce champ d’étude n’est pas complètement nouveau et fut l’objet d’une thèse au cours des années 1980 sous la plume de Chantal Meyer‑Plantureux. Cependant, les publications se sont rapidement raréfiées jusqu’au tournant du millénaire. Dès la fin du xxe siècle, la révolution scénique s’accompagne d’un décloisonnement des champs disciplinaires acceptant plus facilement de nouveaux médias. Cette ouverture favorise le passage de la « photographie de théâtre à la photographie au théâtre » (p. 15). Ce déplacement anime l’ensemble de la réflexion autour d’un média à la fois objet de création et de répulsion. La photographie a progressivement pris place dans l’univers théâtral en supplantant le dessin et la peinture. Cependant, si elle a pu régner en maître pendant près d’un siècle, son piédestal semble chanceler sous le poids de l’apparition du numérique. En outre, le regard posé sur la photographie souffre d’une idée bien ancrée depuis son apparition. Elle serait le contre‑point du théâtre puisque définie par son immobilité. Cette opposition entre théâtre et photographie, entre vivant et inanimé, place ces deux arts en confrontation directe. La photographie ne serait qu’un témoin fixe capable de rendre compte d’une œuvre, elle, éphémère. Cette posture exclut immédiatement la photographie du cadre esthétique et scénique, comme ne faisant pas pleinement partie de la production artistique. Le média apparaît alors dans toute sa complexité, terreau fertile vers de nouvelles réflexions et réalisations artistiques. C’est en ce sens que Michelle Debat parle de « la pensée photographique2 » en tant que mise en scène des corps et du mouvement. Ce média, nouvellement conceptualisé et accepté, n’apparaît pas seul mais fait son entrée en scène accompagné d’autres médias comme la télévision, le cinéma ou encore l’internet, relayant parfois la photographie à un rang subalterne. Toutefois, c’est une foisonnante « épistémè intermédiale » (p. 14) qui prend corps depuis 2015 dans la mesure où le théâtre ne cesse d’entrer en conversation avec d’autres pratiques. Dans La Photographie au théâtre xixe‑xxie siècles, B. Joinnault réunit dix-sept interventions qui font suite au colloque international des 23 et 24 novembre 2017 à l’auditorium de l’INHA et du 25 novembre à la maison de la recherche de Paris 3 au sein du laboratoire THALIM du CNRS. Ces participations, aussi riches que variées, semblent s’agencer autour d’un désir de légitimation d’un sujet trop souvent délaissé, voire dénigré. Les questions avancées par B. Joinnault articulent réflexions et pensées du dispositif dans sa pratique vivante et dynamique afin de retracer les grandes questions qui animent le couple théâtre‑photographie.
De l’acte mémoriel à la performativité
2Dès son apparition dans le champ artistique, la photographie a pris un rôle mémoriel en tant que support de choix afin de conserver la trace d’une représentation. Le désir de conserver, de protéger l’art de l’oubli s’inscrit alors dans la substance même du média. La photographie se définit donc par le geste archivistique et parfois même commercial. En effet, Stéphane Poliakov étudie3 la présence du média photographique dans le travail de Stanislavski, témoin direct de l’émergence du nouveau média dans l’art théâtral. La photographie n’est au début qu’une activité sociale et familiale pour l’homme de théâtre qui la pratique en amateur, et devient rapidement une ressource commerciale non négligeable grâce aux cartes postales qui peuvent être dédicacées par les artistes et dont la revente revient aux œuvres de la société théâtrale. Ces cartes permettent ainsi de prolonger le souvenir du spectacle en les rapportant chez soi. Les dimensions commerciales et mémorielles se confondent et intègrent pleinement l’autour théâtral, c’est‑à‑dire qu’elles participent au souvenir du moment sans en être un vecteur purement scénique. Cependant, il ne serait que trop réducteur d’assigner la photographie à un rôle purement conservatoire et publicitaire. En effet, la pratique revêt très rapidement une dimension plus performative intégrant pleinement et immédiatement l’acte théâtral. Jean‑Marc Larrue et Émeline Rotolo interrogent (p. 29‑47 et p. 73‑88) la performativité médiatique de la photographie, initialement conçue dans son geste archivistique. La place de la photographie dans les archives des théâtres nationaux confirme la part mémorielle et conservatoire du média. En 1966, Jean Vilar veut déposer toutes les archives de ses années de direction. C. Meyer‑Plantureux publie alors un article intitulé « La photographie de théâtre, trace de l’essentiel ou de l’accessoire4 ? » L’emploi du mot « trace » prend une tournure polysémique, voire symbolique. Il s’agit de l’empreinte laissée sur un support mais également des vestiges d’une activité humaine. Le mot se colore donc d’une double référence à la fois physique et visible dans l’empreinte laissée et plus mémorielle en tant que témoin de l’invisible, en tant que témoin de pratiques passées. Elle permet aussi de mettre dans la lumière les couturier·e·s et décorateur·rice·s, travailleurs de l’ombre, sans qui la représentation ne pourrait se réaliser. Elle est aussi une réelle source documentaire alimentant les services de communication dans la promotion d’un spectacle. Enfin, la photographie devient, au même titre que les comédiens, un acteur de la représentation. Elle permet d’incarner pour l’artiste « une identité professionnelle, de se reconstruire un statut par l’image en se rendant attractif pour la performance scénique. » (p. 87). L’idée principale de la conservation des clichés serait « la formation d’une mémoire théâtrale » (p. 29). Le mot « formation » rappelle la part artificielle du geste puisqu’il ne serait que la reconstruction postérieure d’une mémoire, intégrant dès lors une « utopie documentaire5 » puisque dépourvue de témoin direct. Lors d’une publication, l’auteur recherche la photo oubliée, inédite, capable de donner corps à sa propre réflexion. Cet emploi des photographies donne « l’illusion qu’elles participent bizarrement, comme par magie, à la validation de nos hypothèses historiques et théoriques » (p. 31). Le geste archivistique est donc suppléé par la symbolique de l’image conservée. Cette réflexion n’a pas été sans retour dans le monde artistique faisant éclater le débat Phelan‑Auslander. Ce débat éclot dans le monde anglophone au cours des années 1990 transformant les Performances Studies et se faisant « acte de naissance de la pensée intermédiale au théâtre » (p. 34). Du côté de Phelan, l’idée d’un « théatrocentrisme » (p. 37) est ouvertement annoncée. Le théâtre est le lieu du présent, du vivant et d’une relation dynamique entre les acteurs et les spectateurs, excluant immédiatement tout ce qui n’appartient pas à l’humain. En effet, « seule la vie est au présent. La représentation ne peut pas être sauvegardée, enregistrée (…) si elle fait cela, elle devient autre chose6. » Cette conception uniquement vivante de la pratique théâtrale met de côté tout média technologique et répond à une position anti‑mécaniste prenant sa source au cours de la Révolution industrielle. Pourtant, comme l’a expliqué Chiel Kattenbelt, le théâtre est un « hypermedia7 » par excellence, c’est‑à‑dire un média composé d’autres médias. Auslander s’oppose alors à cette conception théatrocentriste dans Liveness Performance in a mediatized Culture. La présence ne se fait pas le contre‑point de tout ce qui est médiatisé. Les médias technologiques peuvent aussi devenir arts de la présence. Ce débat ouvre la voie vers une réflexion plus large sur l’intermédialité dont Grusin s’empare dans son deuxième essai Premediation : Affect and mediality after 9/11 où la médiation peut être aussi considérée dans une forme d’immédiateté. Richard Grusin tente d’élargir le cadre de la médiation mais d’autres essayent d’aller encore plus loin en la dégageant de son carcan communicationnel. E. Thacker amorce donc l’idée de « Dark Media8 », c’est-à-dire de médias « excommunicants » (p. 44) dont la photographie fait partie. En ce sens, « ces médias révèlent plutôt l’inaccessibilité en elle-même et d’elle-même, ils rendent accessible l’inaccessibilité, dans son inaccessibilité9 ».
3La photographie dépasse donc le cadre archivistique, mémoriel et commercial pour intégrer, dans sa performativité, l’acte théâtral. Cependant, si l’emploi de la photographie au théâtre a été source de débats et d’oppositions multiples, force est de constater que la nature même de la photographie est plurielle. L’emploi ne sera pas le même en fonction de sa nature ou de l’objet photographié. En ce sens, à l’inverse de l’homme pour qui « l’existence précède l’essence10 », l’essence même de la photographie précède sa réalisation. L’intention détermine la performativité de la photographie. C’est pourquoi il faudrait davantage parler des photographies et de leurs intentions multiples. L’essence de la photographie ne permettrait‑elle pas de déterminer ses utilisations et effets ?
Entre mise à distance & réappropriation du processus photographique
4La photographie prend alors progressivement corps sur la scène et devient un vecteur d’inspiration dynamique de la composition artistique. En effet, S. Poliakov, s’il rappelle la dimension essentiellement publicitaire et commerciale de la photographie dans l’œuvre théâtrale de Stanislavski, explique que le média peut aussi y prendre une place plus scénique en se référant à sa mise en scène des Trois Sœurs de Tchekhov en 1901 au Théâtre d’Art de Moscou. Une photographie des parents d’Andreï devient le fil rouge de la représentation. Lors du premier acte, la photographie se trouve sur un trépied à l’avant‑scène pour être ensuite placée au deuxième acte au lointain et à jardin. Un portrait des parents de Prozorov est ensuite visible au même endroit mais dans la chambre d’Olga où les personnages se réfugient pendant l’incendie. La photographie n’a pas de rôle physique concret, elle ne soutient pas directement le jeu des acteurs mais participe à la mise en place d’une atmosphère référant à l’espace de la maison. Son rôle est donc certain mais sa légitimité est remise en question. Stanislavski n’intègre pas la photographie à son esthétique théâtrale dans laquelle elle reste un outil secondaire. L’intégration de la photographie dans le processus scénique est donc effective mais mise à distance dans l’œuvre stanislavskienne. Dans ses Mémoires, Alexeï Popov, ancien élève de Stanislavski, mentionne une anecdote en lien avec la photographie. Une élève du Deuxième Studio, Sofia Golindeï, avait fait faire son portrait photographique dans une boutique afin d’envoyer l’image à sa mère. Cependant, le photographe avait affiché le portrait dans sa vitrine, déclenchant la colère de Stanislavski selon qui il faut aimer « l’art en soi et non soi dans l’art » (p. 134). L’utilisation du média peut donc être controversée en fonction de son emploi, voire devenir source de répulsion. La présence de ce dispositif mis à distance chez Stanislavski est, à l’inverse, source de création chez d’autres. Céline‑Marie Hervé étudie la présence du média dans les mises en scène de Beckett dont le processus dramaturgique se rapproche du processus photographique. Dans L’Image de Beckett, le protagoniste raconte une longue promenade et termine en disant que « c’est fait, j’ai fait image11 ». Le discours doit donc servir de substance à l’élaboration d’une représentation visuelle digne d’une image. Les personnages de Beckett, une fois dans la boite, « sont condamnés à faire des images jusqu’à épuisement » (p. 201). La figure de l’humain dépasse toutefois le mécanisme puisque c’est elle qui guide la prise de vue, reprenant alors la pensée de Barthes pour qui « l’organe du photographe ce n’est pas l’œil (…), c’est le doigt12 ». François‑Marie Bernier, photographe portraitiste, rejoint ce parallèle entre la scène et la boite photographique en transposant son art du gros plan sur les planches. Gyöngyi Pál analyse (p. 209‑216) notamment Nous ne connaissons pas la même personne écrit en 1978. Dans cette pièce de théâtre, deux individus se retrouvent par erreur en conversation téléphonique. Chacun voulait initialement appeler la personne aimée mais ils commencent à parler sans pour autant écouter l’autre. Ils racontent alors leur propre histoire par le prisme de l’anonymat de l’interlocuteur. Il ne s’agit pas d’un vrai dialogue mais de deux monologues superposés, dirigés vers un seul objectif. Cependant, F.‑M. Bernier ne cherche pas à décrire l’échec de la communication mais au contraire la distance nécessaire pour mieux comprendre l’autre. Le motif de l’écran interposé pour mieux voir rappelle le processus photographique. Lors d’un entretien avec Didier Grappe, Julie Noirot transcrit le regard de l’artiste sur ses quinze années au côté du théâtre du Radeau et de ses expérimentations multiples. L’immersion dans les différents espaces désorganisés crée une atmosphère propre à la création et à l’intermédiarité. Les mouvements du théâtre et de la photographie semblent parallèles tout en partageant des intentions communes. Il s’agit moins d’une guerre intermédiale que d’une conversation enrichissante permettant la reconstruction. C’est alors que la relation entretenue entre le théâtre et la photographie « ressemble terriblement à un dialogue amoureux » (p. 266), nourri par des différences, voire des oppositions, mais dont le jeu d’attraction et de répulsion ouvre la voie vers de nombreuses créations.
Pallier l’échec de la parole & les limites du visible
5Certains, comme Philippe Ortel, parlent de « révolution invisible13 ». La photographie a profondément changé la manière de concevoir la littérature. Arnaud Rykner propose donc trois approches autour du regard et du rapport entre le visible et l’invisible. Il étudie tout d’abord la fonction « documentaire », comme l’ont fait J.‑M. Larrue et E. Rotolo, où la photographie « valorise ce qui dans le vif ouvre sur le mort, maintient le théâtre vivant par‑delà l’éphémère » (p. 65). De ce constat, l’auteur aborde une seconde fonction orientée vers « l’imaginaire » et la « médiation du désir ». Il s’agit de faire sortir le théâtre du cadre strict de la scène en tant qu’extension temporelle. À travers le « photo‑programme » le spectateur emporte un bout du spectacle avec lui après la représentation ou, s’il y a accès en amont, conditionne, en quelque sorte, son attente de la représentation. Le pouvoir de l’auteur, du texte est donc relativisé au profit du spectacle en tant que tel et de ses interprètes. Cet élargissement de l’acte théâtral par la photographie permet d’aborder une troisième fonction, davantage tournée vers l’invisible, c’est‑à‑dire la fonction « modélisante ». La photographie permettrait de pallier l’échec de la parole en cristallisant ce que les mots ne peuvent saisir. Pierre Piret analyse (p. 163‑176) la présence du média sous cet angle communicationnel dans Elle de Jean Genet et dans La Main qui ment de Jean‑Marie Piemme. Il prend comme appui la réflexion de Walter Benjamin au sujet de la performativité du théâtre et de la photographie dans L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique. Le premier pôle de son étude vise à montrer que l’œuvre d’art ne doit pas nécessairement être vue pour agir au même titre qu’un objet de culte dont la valeur symbolique est la principale substance. Toutefois, dans une conception plus moderne, le deuxième pôle montre que la valeur d’une œuvre d’art ne tient que par le fait d’être exposé. À l’heure de la reproduction, la valeur d’exposition annihile donc la valeur cultuelle. Dans Elle de Jean Genet, un photographe est convié au Vatican afin de photographier le pape. Bruno Bayen, dans sa mise en scène de 1990 au Theatro Due de Parme, fait jouer le pape par la célèbre actrice, Maria Casarès. Le metteur en scène affirme par ce choix une dimension clairement métathéâtrale par le dédoublement d’un corps à la fois intime et public. La séance se déroule dans la salle d’audience du pape où tout l’espace est pensé en fonction du regard du spectateur qu’il s’agit d’impressionner. Un appareil photo est donc caché derrière un voile noir, élément structurant de l’adaptation et présent dès le texte de Genet. Le pape semble constamment échapper à l’image et quand le photographe parvient à ses fins, il oublie de prendre la photographie, complètement happé par le moment. L’ensemble du texte gravite autour de l’attente de cette acmé. La valeur cultuelle du personnage semble alors suppléer sa valeur d’exposition. De même, dans La Main qui ment de J.‑M. Piemme, la photographie motive entièrement le processus théâtral. Dans un contexte d’après‑guerre, Anna et Milan Kovac vivent heureux. Il vient d’obtenir le prix Nobel de biologie et se retrouve interrogé par une journaliste qui parvient à confondre son secret. Il est, en réalité, un ancien ennemi qui s’est automutilé et a revêtu la tenue militaire adverse afin de ne pas être condamné. Des photographies sont alors projetées au lointain de manière fragmentaire afin de symboliser le souvenir. Elles ne sont pas forcément exactes et potentiellement fallacieuses. Le statut de l’image est alors interrogé. Ce n’est qu’à la fin, au moment de la révélation, que l’écran de projection est transpercé. La photographie semble donc compenser les limites du langage et du visible en ouvrant la voie vers un espace plus symbolique et fragmentaire. La photographie ne semble plus être uniquement l’empreinte directe d’un moment mais aussi la transformation possible des limites du visible.
Transformer le regard
6Le regard est donc nécessairement modifié. Michel Poivert enrichit la réflexion en analysant (p. 49‑58) le renversement de valeur subi par la photographie au cours du xxe siècle. En effet, si pendant longtemps l’image fixe a été perçue comme une « image naturelle » (p. 49) riche de son objectivité, le début des années 1930 remet en cause cette pensée à travers les multiples possibilités de retouches et de modifications. Les images deviennent des « images qui mentent » (p. 49). La photographie est alors théâtralisée, elle est une « image performée » (p. 54) qui n’est plus une fixation du réel mais une augmentation. En ce sens, sous l’impulsion de Michel Foucault, il s’agit de percevoir une désacralisation du regard sur un mode « antinaturaliste » (p. 57). Le regard ne doit pas simplement s’apparenter au coup d’œil mais s’engage progressivement dans la capture affective d’un moment. Barthes voyait alors dans ces tableaux vivants la marque du plaisir transformant le spectateur en « voyeur plus qu’en regardeur » (p. 58). Il affirmait dans La Chambre Claire que ce n’est pas « par la peinture que la photographie touche à l’art, c’est par le théâtre14 ». La photographie ouvre alors des perspectives de création multiples comme l’explique Arianna Novaga (p. 177‑185). La scène expérimentale italienne a particulièrement puisé son inspiration dans la technologie comme la troupe Societas Raffaello Sanzio plus proche de la performance. Le projet Rooms initié par la compagnie Motus se place au carrefour des médias usant du live instant, c’est‑à‑dire de photographie prise sur l’action. Ces photographies élaborent un nouveau rapport entre le regardé et le regardant comme l’explique Marie‑Noëlle Semet Haviaras (p. 187‑193). En effet, ces dispositifs se font les « métaphores de l’œil de l’artiste, du “créateur” et qui invitent le spectateur à se faire voyeur » (p. 188). Un parallèle peut être fait entre la scène à l’italienne et la boite photographique. La vision fixe rappelle les spectateurs statiques ou encore le point de fuite central, l’œil du prince. Dans sa mise en scène de Médée en 2012 au Théâtre des Champs‑Élysées, Pierre Audi reprend ce parallèle en pensant le décor comme une maquette donnant l’impression de voir des personnages réduits. Le disque, venant couronner Médée après son double infanticide, rappelle la lentille de l’appareil. Ce dernier parallèle est souvent repris dans les mises en scène de Romeo Castellucci avec l’utilisation d’un écran de tulle ou de plastique venant flouter la vision. Toutes ces mises en scène, en reprenant le motif de la boite photographique, mettent en lumière une posture nouvelle du spectateur érigé en observateur plus qu’en regardeur. Aline César et Josette Féral décrivent (p. 217‑243) l’expérience de recherche‑création menée au cours de l’atelier Au bord. Le point de départ de cette expérimentation est une photographie publiée dans le Washington Post le 21 mai 2004. Une militaire américaine tient en laisse un prisonnier arabe nu dans une prison d’Abu Ghraib à Bagdad. Cette image devient alors une source d’inspiration pour Claudine Galea qui en fait une histoire récompensée en 2011 par le grand prix de littérature dramatique. La question centrale est alors de déterminer la place qui doit être accordée à cette photographie dans la représentation. C. Galea amène le spectateur vers une perte progressive des repères en faisant d’une image « obscène » (p. 219), « une image pour la scène » (p. 219). La première partie de l’expérience consiste à écouter une partie du texte lu par la voix enregistrée de C. Galea dans le noir. Une actrice, Lucie Leclerc, poursuit ensuite la lecture en direct avec la lumière. L’image participe à la création d’un nouvel espace. Il est alors difficile de donner une place à cette photographie. Paul Ardenne souligne la dimension « logicide15 » d’une image aussi brutale. La question se pose alors de montrer ou non la photographie sur la scène.
7Le texte est ensuite relu avec l’image projetée puis avec l’image en gros plan. C. Galea propose de voir la photographie à travers un gros plan fait sur le visage de la militaire. Dès lors, par le changement d’échelle, la photographie se fait paysage. Le travail se situe « dans l’interstice de la vision et de l’action car, c’est dans l’espace de l’imaginaire et non dans celui du réel que la photo agit » (p. 227). La dimension du vertige est ensuite assumée avec l’image qui se meut sous les yeux des spectateurs. Progressivement, d’autres images intérieures se superposent à l’image projetée, comme en témoignent les prises de parole de l’auditoire. L’image devient donc performative puisqu’elle laisse place au mouvement. La photographie est ensuite projetée en même temps que la lecture du texte mais en petit format au lointain. Les temporalités semblent alors se rencontrer. L’image est montrée par la suite sous forme de mosaïque s’inscrivant sur le mode de la répétition voire de la « rumination » (p. 236). La dernière étape consiste à nouveau à projeter l’image mais à travers un gros plan exacerbé puisque pixelisé. Dès lors, l’extrémité de l’image semble coïncider avec une extrémité de la mise en scène. La photographie comme vecteur d’augmentation esthétique est aussi le point d’accroche de l’analyse de Camille Courier de Mèré (p. 149‑160). En effet, dans sa mise en scène de La Mouette de Tchekhov en 2016, Thomas Ostermeier faisait intervenir une peintre, Marine Dillard, créant en direct et au lointain un paysage. Christèle Ortu a photographié au cours des représentations le travail de l’artiste‑peintre. Au‑delà du geste archivistique, ces clichés ont permis à M. Dillard d’interroger sa propre pratique. L’acte performatif s’inscrit dans une temporalité parallèle à la pratique des acteurs tout en amplifiant la scène. L’aspect progressif de la création participe à l’élaboration d’un espace énigmatique mettant les spectateurs face à d’inépuisables « incitations à déduire, à spéculer et à fantasmer16. »
Une réappropriation du monde & des corps
8La photographie dépasse enfin le simple rôle de suppléant ou de vecteur créatif pour s’ériger en tant qu’espace particulier d’expérimentions. Marion Chénetier‑Alev et Sophie Lucet étudient (p. 91‑108) le rôle de la photographie dans les revues théâtrales de la Belle Époque. En 1902 La Revue Théâtrale, succédant à La Rampe, accorde à la photographie une place centrale. Il s’agit de faire évoluer un modèle qui se cherche encore. Geisler, le directeur de la revue, y voit le lieu idéal pour la diffusion de la photographie et conçoit le périodique comme un véritable laboratoire. Les couvertures sont faites pour être collectionnées et se dédoublent d’enjeux commerciaux et artistiques. Le rédacteur en chef et Geisler agencent leur revue comme un véritable « musée vivant du théâtre au début du xxe siècle » (p. 96). Les images sont aussi riches que variées. La revue « déploie l’hétérogénéité de la vie théâtrale, en communique la palpitation » (p. 96). Les lecteurs y retrouvent des croquis, des schémas, des photographies de répétition, d’apprentissage ou encore des images de la salle ou même du public. Les formes artistiques sont aussi élargies et il n’est pas rare d’y retrouver des passages sur l’art de la marionnette, du cirque ou encore du music‑hall. La revue prend le contre‑pied des portraits d’artistes habituels en adoptant plus largement l’emploi du gros plan. Il s’agit d’effacer la représentation canonique de l’actrice montrée dans sa spectacularité, métaphore de la séduction. Les portraits tentent davantage de rendre compte d’une « expression caractéristique17 ». Les couleurs utilisées sont plus sombres, le sourire n’est plus obligatoire et il ne s’agit plus de donner à voir une beauté extérieure mais bien l’incarnation d’une expression plus intérieure. L’écriture est quasiment absente et le gros plan produit donne une impression d’incarnation ou de présence. Le spectateur peut s’approprier le spectacle comme s’il y avait assisté. La revue se transforme en « scène individuelle » (p. 106), développant sa propre existence en marge de la représentation hic et nunc. Cette réappropriation, si elle peut sembler satisfaisante, questionne toutefois le rapport entre le spectateur et la représentation. Une relation presque factice, recomposée, voire inventée peut émerger de cette lecture. C’est alors « l’imaginaire cinématographique qui est déjà en route » (p. 108) à travers cette façon de « déprécier la présence charnelle de l’acteur18 » au profit d’une « présence mythique19 ». La photographie s’invente en tant qu’espace détaché du moment de la représentation pour évoluer de son existence propre. Dans ce jeu de réappropriation du réel, Jean Baptiste Richard rappelle (p. 109‑117) que la photographie, comme la peinture, peut se jouer de la réalité en l’imitant sans pour autant l’avoir vue. Il élabore alors un parallèle entre la retouche photographique et Canard sauvage d’Ibsen. Dans cette pièce de théâtre, les êtres sont comparés à des canards. La didascalie de l’Acte IV explique que Gina vient de terminer une séance de photographie de portrait. Le matériel utilisé est donc visible et le métier de photographe est, probablement pour la première fois, mis en scène. De même, à l’Acte III, Hjalmar et Hedwig retouchent une photographie dont la description dans les didascalies va s’étirer sur une vingtaine de pages. À l’inverse, le rangement du matériel de Gina se fait très rapidement. À ce moment, Ibsen se comporte comme un photographe et « isole narrativement, voire scéniquement la retouche » afin de nous donner à saisir le temps de la manipulation. Dans sa mise en scène au théâtre de la Colline, en 2014, Stéphane Braunschweig utilise les nouveaux médias numériques. Les retouches sont informatisées. En ce sens, « le filage de la métaphore est donné à l’appréciation du spectateur comme les personnages le font avec le canard » (p. 117). Petra Kolářová dénie également (p. 139‑148) la place décorative accordée à la photographie en étudiant la pensée du corps dans l’art du mime d’Étienne Decroux. Il collabore avec Étienne Bertrand Weill, diplômé de l’École nationale de Photographie et de Cinéma. Tous deux questionnent le corps en mouvement. Ainsi, pour Decroux « si l’artiste n’est pas un photographe, le mime n’est pas un singe20. » Decroux, profondément influencé par Edward Gordon Craig, est fasciné par sa sur‑marionnette. Dans cette quête du surhumain, Weill montre dans La Médiation de 1957 un corps en équilibre incertain. Il s’agit, peut‑être paradoxalement, de capter le mouvement dans l’immobilité. Weill et Decroux voient aussi dans ces images une manière efficace de fixer « la pensée visuelle » (p. 144) et de transmettre, à la manière d’un aide‑mémoire, l’art du mime. Les artistes recherchent de nouvelles expérimentations esthétiques en décloisonnant le regard. Ils perçoivent le corps comme une marionnette vivante et recherchent par la pose longue à mettre en lumière « la sculpture du corps en images » (p. 147). En fragmentant le corps par le cliché photographique, les artistes tentent de « rendre visible l’infinité de formes du mouvement » (p. 148).
—
9Le média photographique, s’il a pu être critiqué, voire rejeté sur la scène, a su devenir une source d’exploration artistique infinie. L’ouvrage collectif La Photographie au théâtre xixe‑xxie siècles, publié sous la direction de Brigitte Joinnault, rend compte de cette évolution. La révolution numérique des années 1990 n’a fait qu’élargir les possibilités créatrices du média. La photographie a très rapidement dépassé son carcan archivistique pour intégrer pleinement le processus théâtral en tant qu’acte performatif. Il ne s’agit plus de concevoir la photographie comme la trace permanente d’un acte éphémère. Cette binarité ne saurait rendre entièrement compte du processus photographique. L’écriture même des textes s’en est emparée, que ce soit pour installer une atmosphère particulière ou pour reprendre de manière mimétique et métaphorique son processus de production. Le média est devenu également un actant incontestable de la représentation palliant l’échec de la parole et les limites du visible. Sa présence sur la scène a profondément changé le regard du spectateur invité à scruter et recomposer un espace souvent fragmenté par l’image. La photographie semble enfin s’émanciper du cadre de la représentation pour exister en tant que « scène individuelle » (p. 106) se réappropriant le monde et les corps. Le théâtre et la photographie forment donc un couple complexe. Les mouvements du théâtre et de la photographie semblent parallèles tout en partageant des intentions communes. Il s’agit moins d’une guerre intermédiale que d’une conversation enrichissante permettant de nouvelles explorations.

