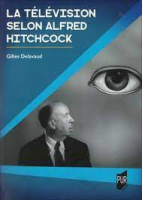
Pratique & critique de la télévision dans Alfred Hitchcock Presents
1L’approche de la série Alfred Hitchcock Presents proposée par Gilles Delavaud, professeur en sciences de l’information, modifie sensiblement le regard porté sur ce programme, dont la figure de proue présente la particularité d’avoir servi à fonder la « politique des auteurs » dans la critique cinématographique française des années cinquante. Comment traiter en effet d’un ensemble qu’Alfred Hitchcock nous « présente », mais dont il ne réalise que dix‑sept épisodes sur deux cent soixante‑huit diffusés, suivant les critères établis par Truffaut, Chabrol, Rohmer et consorts, qui font du metteur en scène l’auteur principal d’un film ? Dans le même temps, il peut apparaître délicat de faire fonctionner une grille de lecture plus contemporaine où la figure du showrunner supervise une œuvre télévisuelle dont il est l’unique garant. D’une part, le degré d’implication d’Hitchcock sur la durée reste incertain, au long de sept années au cours desquelles il réalise par ailleurs six films, parmi lesquels North by Northwest, Vertigo et Psycho. D’autre part, les rôles de Joan Harrison (p. 212‑219) et de Norman Lloyd1 apparaissent avec le temps de plus en plus prépondérants. Leurs recherches de sujets et scénarios correspondants à la formule du programme pourraient, dans une certaine mesure, faire d’eux les principaux garants de la cohérence de la série, même si, paradoxalement, c’est en fonction de leur connaissance d’Hitchcock, qu’ils effectuent leurs choix artistiques (p. 32‑33).
Délimitations d’une œuvre télévisuelle
2En dressant le tableau de cette collaboration artistique, G. Delavaud manifeste d’emblée l’ambition de traiter non, une nouvelle fois, du metteur en scène Hitchcock à travers sa série mais bien de l’œuvre elle‑même. Les épisodes cités, ceux qui sont analysés plus en détail, sont donc pris dans l’ensemble du corpus et pas seulement dans le petit nombre qu’il a réalisé. Cet élargissement du champ d’étude s’accompagne d’une redéfinition d’un autre ensemble, celui de la demi‑heure d’Alfred Hitchcock Presents où la triade formée par la présentation, la fiction et la conclusion est entrecoupée de publicités (p. 78‑82).
3De cette approche doublement structurale (confrontation de tous les épisodes entre eux et de tous les éléments de chaque épisode tels que les reçoit le téléspectateur) se dégagent des lignes de force qui valent à l’échelle de l’ensemble des sept saisons. Ainsi, Hitchcock présentateur ne se résoudra jamais à accepter comme naturelles ou indifférentes les interventions publicitaires. Rejetant la posture de complicité élogieuse avec les annonceurs, caractéristique d’autres présentateurs de l’époque, il exprimera sur tous les tons son acrimonie envers ces réclames, dont il lui est, comme producteur de programme télévisé, impossible de s’affranchir. Un autre principe constant de la série touche au contenu des récits eux‑mêmes, qui sont des crimes projetés ou commis dans le cadre familial, souvent au sein de couples ordinaires (p. 186‑187). Quant à la structure des épisodes, elle est invariable aussi et synthétisée par Norman Lloyd : « suspense, with a twist » (p. 88).
4G. Delavaud attire notre attention, en revanche, sur des références plus occasionnelles à des débats de l’époque, qu’il s’agisse de la montée de la délinquance juvénile — ou de sa plus grande visibilité — et de ses causes, ou encore du rôle assigné à la télévision entre l’ambition civique de formation de citoyens des uns et la volonté, chez d’autres, de développer un outil commercial. Les problèmes de l’alcoolisme, du retour des blessés de guerre ou du contrôle de la vente d’armes à feu trouvent aussi un écho dans plusieurs fictions de la série (p. 164‑178).
Capter l’attention : les audaces d’un présentateur
5Néanmoins, la caractérisation du regard porté autant sur la nature humaine que sur le fonctionnement de la société américaine par Hitchcock, immigré aussi fasciné que lucide, ne constitue pas l’apport majeur de la recherche de G. Delavaud. Plus exactement, le tableau de cette vision prend un relief singulier dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le programme télévisé perçu comme discours adressé au téléspectateur2. L’originalité fondamentale de la télévision par rapport au cinéma repose, selon l’auteur, sur une relation plus directe, où le public est visé de manière plus complice, à son domicile. La personne à l’écran, elle, est comme invitée dans cet espace intime, celui de la vie ordinaire, et ne s’y maintient que suivant le bon vouloir du téléspectateur.
6G. Delavaud rappelle par ailleurs que les débuts d’Hitchcock à la télévision correspondent au moment de la transition des programmes diffusés en direct (notamment des anthologies dramatiques comme Studio One) aux programmes enregistrés, transition qui déplace le lieu de la production télévisuelle de New York à Hollywood, où les studios vont pouvoir restaurer leur influence en devenant les fournisseurs des contenus diffusés sur le petit écran (p. 28‑29). Ce point de bascule offre à Hitchcock présentateur la possibilité d’exploiter les ressources du direct, devenu fictif, et du différé. Bien que l’ensemble du programme soit enregistré, les introductions et conclusions jouent, en effet, de l’ancienne proximité entre spectateur et public. Ainsi, il semble que la fiction à venir et ses personnages sont dans le même univers que celui du présentateur tandis que, dans le même temps, se met en place l’illusion que la frontière entre Hitchcock et le public est abolie. Dans ce que le critique nomme une esthétique de l’émergence (p. 170), le présentateur serait ainsi en mesure de constater que le téléspectateur fait peu d’efforts pour avoir une tenue présentable quand il paraît devant lui ou encore qu’un aquarium qui fuit au‑dessus du poste de télévision obligerait l’homme dans la lucarne à ouvrir son parapluie à l’écran.
7Ce lien direct établi avec le public fait de la performance du réalisateur célèbre la véritable attraction du programme, tandis que la mise en scène des fictions ne peut, elle, déroger au principe que le petit écran souffre de la comparaison avec le cinéma dans le domaine du spectaculaire : « Dans ses introductions, Hitchcock ne promet pas de spectacle, ou alors il s’agit d’une fausse promesse : le spectacle, c’est lui. » (p. 58)
8À cet égard, la mise en parallèle avec ses contemporains est seule à donner une réelle idée de sa singularité. S’appuyant sur les textes qu’écrit pour lui James Allardice, Hitchcock fait preuve d’une radicalité qui le démarque d’un Robert Montgomery ou d’une Jane Wyman3. G. Delavaud se réfère à la théorie de Roger Odin, selon laquelle le spectateur de la télévision éprouve un désir de cinéma au moment de visionner un film sur le petit écran. Pour combler l’écart entre ce désir et la réalité, le présentateur intervient avec pour vocation de plonger le public dans une illusion de cinéma (p. 243‑244). Le paradoxe est qu’Hitchcock, figure emblématique du septième art, ne fait rien d’autre que rappeler à longueur d’introductions et de conclusions que l’on se trouve à la télévision. À coup de déguisements saugrenus, de dispositifs improbables et d’un humour pince‑sans‑rire dévastateur, il s’adresse au téléspectateur pour évoquer les conditions de production du programme et établir une certaine distance avec l’objet fictionnel présenté mais aussi avec un élément caractéristique du médium, la publicité.
Charge contre la publicité : un discours critique inscrit dans la création
9Absentes, pour certaines, des éditions DVD européennes de la série, les attaques du metteur en scène contre les annonceurs représentent une charge à rebours des codes de l’époque contre des sponsors dont il refusera toujours de prononcer le nom, et que ses succès d’audience l’autoriseront à brocarder (p. 98‑107), au cours de cinq années sur CBS puis de deux autres sur NBC4. Les présentateurs de l’époque s’apparentent à d’élégants bonimenteurs, versions embellis des camelots5, qui combinent traditionnellement l’aptitude à attirer l’attention et à susciter l’envie d’achat. Hitchcock, lui, tout en se donnant en spectacle, joue sa partition contre les annonceurs, stigmatisant, à travers eux, la société de consommation naissante et un modèle stéréotypé de vie heureuse passant par le mariage et la vie de famille6.
10À ce titre, bien que le programme repose sur une esthétique du pot‑pourri7, alliant des éléments au statut aussi distincts que le discours du présentateur, la fiction et la publicité, une double cohérence se dessine à travers cette forme apparemment impure. D’une part, la critique de l’American way of life amorcée par le discours du présentateur sur les spots publicitaires se prolonge dans les fictions où, on l’a signalé, la famille américaine moyenne, souvent en voie d’exil dans les banlieues pavillonnaires, se révèle être moins un asile édénique qu’un lieu étouffant d’où l’amour a, au minimum, disparu depuis longtemps quand ne s’y est pas substituée une haine meurtrière au sein du couple, des fratries ou entre parents et enfants. Les récits dévoilent ainsi l’envers du décor des spots ou des sitcoms familiales proposées par le petit écran.
11D’autre part, les publicités qui viennent interrompre la création imaginée par Alfred Hitchcock et ses collaborateurs deviennent, à l’insu des annonceurs, des éléments d’un processus par lequel l’auteur cherche, après avoir captivé le téléspectateur, à le mettre comme à distance du récit qu’il a suivi. On sait que la formule de la série repose sur une tension dramatique construite tout au long de l’épisode. Celle‑ci débouche sur un élément inattendu, parfois en décalage avec la direction prise par les événements précédents s’enchaînant généralement suivant une mécanique implacable, dans un temps réduit. L’implication émotionnelle du téléspectateur atteint donc un climax qui tient moins, note G. Delavaud, à une identification au personnage, qu’à l’intensité du regard dirigé sur eux, alors qu’ils sont absorbés dans une situation qui prend la tournure d’un piège. À l’instar des interventions d’Alfred Hitchcock, la publicité participe d’un mouvement de reflux, d’un relâchement de la tension par lequel le public est invité à réfléchir sur ce qu’il vient de voir, mais aussi plus simplement à se remettre de ce qui a pu le choquer (p. 82). Signalons au passage qu’un nombre non négligeable de récits contient des retours en arrière ou un véritable enchâssement du récit principal dans un récit‑cadre. Ces emboîtements complètent le principe de mise à distance qui paraît systématiquement indissociable d’une histoire souvent saisissante ou perturbante dans sa conclusion.
Les libertés du créateur & celle du téléspectateur
12À rebours d’une vision qui montrerait un créateur emprisonné par les codes télévisuels, des censeurs institutionnels ou des publicitaires sourcilleux, G. Delavaud souligne, en s’appuyant sur les propos d’Hitchcock lui‑même, que cet espace permet au metteur en scène de s’affranchir de l’obligation du happy end au cinéma. De fait, une certaine noirceur et une représentation pessimiste de la nature humaine prévalent (p. 178‑182). Hitchcock et ses associés imaginent d’ultimes secondes de la fiction tour à tour sombres ou tragiques, voire scandaleuses ou traumatisantes ; en relatant de supposées suites aux récits, l’intervention du présentateur se charge, pour finir, de faire les concessions nécessaires à la morale.
13L’ironie de ces ajouts improbables achève de fonder ce qu’on pourrait interpréter comme une relation adulte au téléspectateur. Cette figure inscrite par Hitchcock dans son programme est à la fois consciente des motivations commerciales de l’industrie du spectacle qui diffuse les programmes, informée des contraintes qui s’imposent aux créateurs, capable de réfléchir sur le modèle de société qui lui est proposé comme un idéal et sur les réalités sociales et humaines qu’il dissimule. On pourrait arguer que ce téléspectateur semble bien à distance de l’histoire qui lui est narrée au cœur du programme, mais ce n’est en réalité que parce qu’il aura été provisoirement absorbé par ces situations dans lesquels se débattent des individus ordinaires que le second mouvement s’effectuera pleinement.
Prolongements & place de l’œuvre
14Variant la focale, G. Delavaud mène des études de cas détaillées, compare des récits originaux à leur adaptation à l’écran, mais aussi embrasse ce grand ensemble que représente, pour Alfred Hitchcock Presents, sept saisons de trente‑neuf épisodes chacune. Les œuvres cinématographiques du réalisateur ne sont pas oubliées, de même que, ponctuellement, la production de l’époque sur grand écran8. Dans quelle mesure The Rope constitue‑t‑il une expérimentation télévisuelle ? En quoi la situation du personnage de James Stewart dans Rear Window correspond‑elle à celle des téléspectateurs du programme télévisé, observant des personnages ordinaires dont l’un est un criminel ? Les rapprochements, à cet égard, sont à la vérité si nombreux et complexes qu’ils pourraient faire l’objet de plusieurs études. Jean‑François Rauger9 a également creusé ce sillon et même les ouvrages sur l’auteur et son œuvre à destination du grand public multiplient les passerelles entre la série et les films10. À cet égard, on sera gré à G. Delavaud de ne pas faire trop mécaniquement de l’œuvre télévisuelle d’Hitchcock un laboratoire de ses films mais de considérer de près, et pour elles‑mêmes, ces courtes fictions, comme en témoigne son analyse de The Crystal Trench, où la prise en compte du point de vue adopté tord l’interprétation habituelle d’un épisode souvent commenté.
15Pour le lecteur désireux d’apprécier toutes les dimensions du programme produit par Hitchcock, cet ouvrage et celui de Jean‑François Rauger s’avèrent complémentaires. Dans le second, on en apprendra un peu plus sur l’influence déterminante de l’agent artistique Lew Wesserman sur la dernière partie de la carrière d’Hitchcock, influence liée à l’évolution des studios dans les années soixante. Par ailleurs, au moment où le réalisateur s’entoure d’une bonne partie de l’équipe de sa série pour tourner Psycho, Rauger réserve une place à ces autres cinéastes qui font aussi le choix de la petite forme sur grand écran, quand la tendance générale est au monumental et à la parodie. Jacques Tourneur, qui fit une partie de sa carrière à la télévision, mais aussi John Ford ou Howard Hawks, semblent plus ou moins sous influence télévisuelle dans une période où l’on est traditionnellement plus attentifs aux metteurs en scène qui, comme Robert Mulligan, Sidney Lumet ou Robert Altman, réalisent leurs premiers films après avoir fait leurs armes dans les programmes en direct ou les séries comme Alfred Hitchcock Presents.
16Les deux ouvrages bénéficient de maquettes leur permettant d’illustrer largement leurs analyses. G. Delavaud propose, pour sa part, une iconographie abondante, qui se révèle particulièrement précieuse quand il s’agit d’illustrer les facéties du présentateur Hitchcock. Leur caractère hétéroclite et leur dimension spectaculaire soulignent la tension qui existe entre une représentation quelque peu figée du metteur en scène, dont le générique pourrait être l’emblème (un profil tracé en quelques traits et une ombre qui vient lentement s’y superposer), et les situations, imaginées par James Allardice, qu’il accepte de jouer.
***
17Le propos tenu dans La Télévision selon Alfred Hitchcock offre des perspectives pour une approche plus détaillée encore de ces sept années de fictions qui ne peuvent être entièrement traitées dans un ensemble de moins de trois cents pages. La tâche reste ample, peut‑être à envisager à l’échelle d’une saison ou à mener sur les première et dernière année pour saisir les évolutions perceptibles. L’impression d’un bloc homogène domine encore trop souvent et les aspérités11 de cet ensemble massif ne sont sans doute pas toutes identifiées, tant les récurrences, les variations subtiles de motifs attirent le regard critique, jusqu’au vertige, parfois, lorsqu’on fait entrer le cinéma d’Hitchcock dans l’équation12. Enfin, on aimerait mieux saisir les effets de circulation qui s’opèrent entre ce programme et ceux qui lui sont entièrement ou partiellement contemporains. Si Gilles Delavaud nous montre que le développement du western est spectaculaire sur la période, on sait que les auteurs de nouvelles, de scénarios, les réalisateurs aussi passent d’un programme à l’autre, ce qui crée presque naturellement des échos entre eux, malgré les formules propres à chacun. Ainsi, on pourrait à coup sûr déceler quelques parentés entre The Twilight Zone, dont la production démarre en 1959 et Alfred Hitchcock Presents. La principale reste sans doute le sentiment très troublant pour le téléspectateur des deux programmes que le monde connu vacille, que les repères traditionnels s’effacent. Cette absurdité qui affleure peut évidemment questionner celui qui la regarde, pensant avoir sombré dans la folie mais les deux programmes partagent la vision d’un dérèglement généralisé des sociétés, tranquillement démontré semaine après semaine, dérèglement qui toucherait donc moins l’esprit d’individus mais bien une collectivité entière vivant un cauchemar on ne peut plus réel, celui du temps présent.

