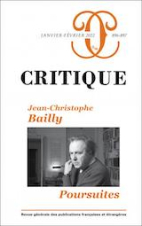
« Cette tension vers la résonance »
1Par où saisir l’œuvre de Jean-Christophe Bailly ? Quelles clés proposer, sans toutefois l’immobiliser dans une grille de lecture, pour y ouvrir des embrasures ? Tel est le défi relevé par les contributeurs du dernier numéro spécial de la revue Critique paru au début de l’année 2022, intitulé Jean-Christophe Bailly : poursuites, pour valoriser en son œuvre « l’importance de l’engagement de la pensée dans la forme et de la résistance, par la phrase et par l’attention, aux idées hâtives, aux négligences, aux complaisances » (p. 3). Même si l’accent est mis sur ses dernières publications, c’est la globalité de son œuvre qui se voit ici abordée1, à la poursuite des fondamentaux qui en soutiennent l’élan.
2Ces articles nous emmènent sur les sentiers ouverts par Bailly parmi les choses du monde, les villes, les animaux, les formes, les mots, à travers de véritables lignes de désirs, ni les plus courtes ni les plus faciles (contrairement à ces chemins créés dans la nature par la circulation des hommes ou des animaux), mais les plus suggestives en ce qu’elles révèlent des échappées et des tensions. Il faut, pour espérer suivre Bailly et comprendre la nature de l’élan qui anime son œuvre, croiser les domaines de pensée, comme il est souvent d’usage dans la revue Critique pour combiner précision de l’information et ouverture de la réflexion, à travers littérature, poétique, histoire, philosophie, esthétique, photographie, géologie, lexicologie…, ce que font les onze contributeurs dont chaque étude poursuit de nouvelles pistes. Nous les suivrons, après un préambule, à travers trois parcours dans l’ouvrage afin d’y révéler des échos, rapprochements et variations, entre les analyses des contributeurs, et saisir les échappées offertes par les « poursuites » en question en une « tension vers la résonance2 », vers le monde et la langue, vers le poème, et vers la recherche d’un sens.
Amorces
3L’œuvre de Bailly se saisit d’abord en elle-même, grâce à deux textes inédits : « Klaus Michael Grüber ou le dépassement de l’intention » (p. 6-14) et « Les yeux puis ce qu’ils voient » (p. 15-26).
4Le premier transcrit une communication faite par Bailly au Théâtre National de Strasbourg le 29 janvier 2011. Bailly y étudie la force d’accomplissement du théâtre de Grüber, sa « netteté » et la « plénitude de la résonance [dans] sa tension vers la vérité » (p. 6) qu’il y découvre. Bailly trouve dans le spectacle de Grüber une écoute, une attention aux commencements, une clarté y compris dans l’obscurité, qui confèrent le sentiment d’une équation entre les choses. Aussi les noms « fidélité », « authenticité », « vérité » composent-ils l’abécédaire déployé par Bailly pour valoriser la rupture de Grüber avec les codes formels mensongers (p. 11), le choix d’une « pure effectuation » (p. 11) donnant lieu à une œuvre épurée, profonde et légère qui touche à une grâce de la présence de l’être. Bailly souligne aussi la « responsabilité » (p. 12) éthique et politique de l’œuvre d’art, qui vise à « effacer la pesanteur de l’intention » (p. 12) pour laisser place à l’œuvre elle-même, à sa liberté et à sa souveraineté intrinsèque.
5Le second texte, « Les yeux puis ce qu’ils voient », a été lu à l’Université de Liège le 12 mars 2015. Bailly y relate des épisodes d’éveil au monde grâce au regard, soit au cours d’un voyage en train, soit sur des photographies. Les yeux parlent de notre rapport au dehors mais aussi au sens de l’existence : « Ce que disent tous ces yeux, et il en irait de même, j’y tiens, pour ceux des bêtes, c’est qu’ils ont vu l’immensité, qu’ils l’ont frôlée, c’est que dans tous les temps des yeux ont vu cela : le vertige d’être vivant dans l’espace et de n’y passer qu’un temps » (p .17-18). Bailly reprend de Walter Benjamin la puissance ontologique de cet éveil offrant le « pouvoir de lever les yeux3 » sur les choses dans le monde. Il en conclut que « rien ni personne n’est sur terre sans avec ou sans autre » (p. 21) : cet être-avec, partagé par tous dans la communauté du vivant, témoigne des « coulisses de l’existence » (p. 21). L’éveil, c’est ce qui brille de la chose dans son surgissement dans le monde, c’est l’écho qui nous en touche et qui achemine, progressivement, la pensée en même temps que l’éclat du monde (son fragment, mais aussi son aura). Le poème naît, dit Bailly, de ce mouvement dans le monde et d’un « étonnement continu » (p. 26) offert par le regard, à préserver, à poursuivre.
6Ce que Bailly poursuit, dans ces deux textes liminaires, résonne avec ce que les contributeurs de l’ouvrage cherchent en son œuvre et que leurs articles éclairent ensuite. Aussi est-il particulièrement intéressant que ces deux textes de Bailly posent d’abord les jalons des chemins à emprunter pour le suivre.
Poursuites du monde, du nom à la phrase
7L’imaginaire de Bailly est traversé de mots-clés qu’il met en lumière dans un entretien avec Marielle Macé et Martin Rueff (« L’envolée des noms », p. 27-35). En un libre abécédaire permettant d’inventer à trois voix une suite au Propre du langage. Voyage au pays des noms communs4 publié en 1997, Bailly évoque les élans portés dans son imaginaire par les mots « poursuites », « chute », « forêt », « descente », « passant », « corde », « palper », « palpiter », venue », « évasion », « ricochet », « copeau », « feuille », « lynx »… (p. 27-32). Ces mots soutiennent sa tension vers le dehors et soulèvent son désir, car, comme le montre Suzanne Doppelt dans « Le promeneur rêve » (p. 141-143), ils portent et guident la rêverie du promeneur qui explore le dehors en l’effleurant, attentif à « l’invisible de chaque existence » (p. 143). L’entretien de Bailly avec M. Macé et M. Rueff met en évidence une approche anti-idéaliste dans laquelle ces noms convoqués portent l’espoir d’un accord profond et sensible entre la matière des mots et celle du monde. Chacun des noms mentionnés s’échappe vers une chose du monde, appelant un autre mot, le nom d’un poète (Francis Ponge, p. 31), le titre d’un conte mythique (Tristan et Iseult, p. 31) ou d’un ouvrage d’anthropologie (Les Âmes sauvages de Nastassja Martin, p. 33). De la matière du mot à l’image du monde qu’il renvoie, se tisse une continuité qui s’érige contre un absurde rapport de forces, et qui parle d’une habitation du monde devenu « paysage », c’est-à-dire « expérience qu’on en fait » (p. 35).
8Dans « Phraser » (p. 36-60), M. Macé souligne justement ce que l’on accueille du monde et de l’homme en les nommant. Bailly « ouvre, avec quelques alliés comme lui poètes et philosophes, un monde de phrases : un monde de pensées-vies qui avancent dans le réel comme des sondes, un monde pour ainsi dire capable de se déclarer, de s’énoncer lui-même et de lui-même » (p. 36). La langue de Bailly recueille la palpitation du vivant, ce qui fait de la phrase le lieu du monde. Le monde s’échappe dans la langue, à travers la langue, au lieu de s’y enferrer, ce qui s’accomplit dans le « phraser » (p. 36) plus que dans la phrase, comme y insiste M. Macé avec une grande clarté, car, dans la forme infinitive du verbe « phraser », s’entend le vœu d’échapper à l’immobile et au stérile. Il faut féconder la phrase pour y faire advenir le monde et proposer une œuvre qui en soit une humble épiphanie dans la langue. M. Macé s’appuie sur une histoire de la phrase dans la littérature française pour en venir à la phrase de Bailly. D’abord marqueur d’une personnalité stylistique d’un auteur (comme chez Flaubert), la phrase s’arrache ensuite à cette personnalisation pour se tourner vers la littérature qu’elle construit et à laquelle elle donne un sens, c’est-à-dire à la fois une signification et une direction, qui témoignent d’une vision et d’une pensée du monde. La phrase, « conviction, calmement pratiquée, quant aux rapports entre la pensée, la langue, et la vie » (p. 39), est « assoiffée de monde » (p. 39). Par sa vertu instauratrice et épiphanique5, la phrase, bien plus qu’une construction syntaxique, est donc une apparition du rythme du dehors, avec ses pulsations et ses syncopes, et qui suggèrent que, rétive à toute aliénation, la phrase se donne, si bien qu’il faut la laisser surgir, car elle est « dictée du réel » (p. 42), ce qu’évoque aussi M. Rueff dans son article « Poésie puissance n » (p. 144-155), en montrant que le poème accueille « la dictée des choses » (p. 153) dans leur rythme.
9En s’appuyant sur Le Propre du langage. Voyage au pays des noms communs, M. Macé montre que nos représentations valorisent le nom et son pouvoir symbolique, alors que c’est dans la phrase que tout se joue et que le nom peut quitter son arbitraire pour devenir une matière vibratoire. Absorbant les qualités concrétisantes de l’écriture de Bailly, M. Macé donne à sentir sa propre perception de la phrase, qu’elle assimile à une « rivière » qui « coule dans la voix » (p. 46), à un « serpent » (p. 45), à une « sonde » (p. 46) de la réalité ; elle compare les mots à des « oiseaux » (p. 45) qui s’envolent, à des « mues » du serpent phrase (p. 45), rejoignant par-là sa propre attention aux présences du vivant dans la littérature6. M. Macé entre ainsi dans l’intimité de la phrase de Bailly, partageant une approche sensible et subjective des effets du phrasé de Bailly sur la lectrice qu’elle est. La phrase de Bailly ne peut en effet se satisfaire d’une froide approche théorique ; pour révéler la puissance évocatrice et invocatoire du langage de Bailly, M. Macé recourt aux ressources du mythos plus que du logos. Cependant, débordant une simple approche métaphorique, cela nécessite une philosophie des liens entre le langage et le monde pour comprendre comment les langues viennent au/dans le monde et comment la phrase devient l’écrin du dehors. Par exemple, quand Bailly évoque une ville, la phrase s’adapte à sa forme et tente de la saisir telle qu’elle est en communiquant le sentiment de son étendue, sans la recadrer ni la redécouper, offrant « un être-saisi, pour saisir » (p. 51). De même, dans Le Versant animal et dans Le Parti pris des animaux7, Bailly donne à ressentir le vivre des animaux dans le phrasé.
10La force de l’écriture de M. Macé est de proposer des expressions marquantes à travers des mots-valises ou des formules aux vertus concrétisantes, qui ont la délicatesse de ne pas affadir les tensions à l’œuvre dans l’écriture de Bailly. Dans une perspective spéculaire, ces expressions véhiculent la dialectique inhérente à la pensée et au phraser de Bailly : les « pensées-phrases » (p. 56), l’« être-phrase » (p. 48), l’« être-saisi » (p. 51), « les bêtes sont des pensées » (p. 56), « une phrase, […] c’est une piste d’être » (p. 56), « la phrase, donc, est comme une porte qui s’ouvre au-devant du mot » (p. 45), « phraser, c’est aller palper la réalité » (p. 46).
11Dans ses « Sillages gallois » (p. 61-71), Samuel Martin analyse les quatre récits inspirés chez Bailly par le Pays de Galles dans Saisir. Quatre aventures galloises8, à travers les histoires du peintre Thomas Jones, du poète Dylan Thomas, du romancier Winfried Georg Sebald, et de mineurs de charbon du sud gallois. Comme M. Macé, S. Martin souligne la façon dont le Pays de Galles appelle une écriture chez Bailly, qui essaie d’épouser avec justesse les contours humides du pays en une « prose ruisselante » (p. 66) dont le rythme cherche les connexions entre les choses et les œuvres. Le chapitre sur Dylan Thomas y est d’ailleurs une occasion pour Bailly de réfléchir à ce qui passe dans la transposition d’une langue en une autre. En effet, pénétrer la langue, c’est pénétrer le monde, et inversement, si bien que tout langage constitue d’abord une traduction du monde : traduire devient, au sens propre, com-prendre le monde. « Ce n’est donc pas seulement telle ou telle langue que l’on peut traduire en paroles (que ce soit pour soi-même ou pour autrui), c’est toute dimension de l’existence » (p. 68), écrit S. Martin, si bien que la phrase « émet » (p. 68) le monde via les paysages et les personnages en une « traduction en paroles du Pays de Galles » (p. 69). Ce « poème [se voit] élargi » (p. 69) des territoires traversés et saisis grâce à une attention désirante de Bailly qui fait de la langue l’hôte de ce qui arrive du et dans le dehors.
12Nathalie Piégay, dans « Les ressources narratives du lointain » (p. 91-102), étudie Café Néon et autres îles et Jours d’Amérique. 1978-2011 9, qui sont des carnets tenus sur une trentaine d’années par Bailly lors de séjours en Amérique et en Grèce, et transcrits lors des derniers confinements. Ces carnets sont le témoin et le relais d’un rapport au dehors qui passe par les mots, les notes, les observations de Bailly sur ses lectures, ses visites, ses rencontres, dont témoignent parfois des tickets et autres documents qui composent des éclats du monde vu. Par ces notations, l’auteur se porte au dehors, sans chercher à faire retour sur son perçu subjectif : en effet, malgré quelques réflexions personnelles, ce n’est pas l’intime qui surgit, c’est le dehors qui est éclairé. Ces carnets mémoriels et documentaires forment des archives discontinues dont les « traces du passé, “copeaux” arrachés au présent » (p. 94) pourront former la base archéologique de futurs poèmes. Ce réservoir des traces du monde et de l’à-venir du poème se voit sauvé par une écriture qui ne cherche pas l’exhaustivité ni le résumé chronologique des événements, mais qui doit en rendre le tempo. C’est pourquoi les carnets de Bailly se caractérisent, d’après N. Piégay, par une « irrégularité » et une « arythmie » (p. 94) : comme le montrent aussi M. Macé et S. Martin, l‘écrit se met au rythme du dehors et rend compte du tempo du voyage, avec ses étirements, ses accélérations et ses ruptures. Le carnet de « copeaux » (p. 96), à la fois concret et léger, est le résidu des choses vues dont le scripteur détache un peu de matière pour le saisir : « la notation érafle le réel et entame sa continuité temporelle » (p. 97). Il accueille les éclats du monde réel, de manière humble et authentique puisqu’il dédaigne la reconstruction artificielle d’une continuité. La notation y est un double matériau, du langage et du monde, poursuivant le vieux rêve d’une alliance entre langage et choses, laquelle n’effacerait pour autant pas les particularités de chacun, et rechercherait, au contraire, une « hétérogénéité » (p. 101) apte à dire, dans la dimension composite et hybride du livre qui tient à la fois du journal de bord, du poème en prose, du récit…, celle du monde, pour une juste « arythmie » (p. 101). En plus de révéler le monde du dehors, les carnets témoignent du voyage dans l’écriture par leur dimension « généalogique » (p. 101), dont N. Piégay souligne la portée métapoétique pour éclairer la fabrique du texte de Bailly.
13Cette confrontation de l’écriture de Bailly au dehors est développée par Nina Rocipon dans « La ressemblance émancipée : la chaussette, le gant et l’éléphant » (p. 117-128). Si N. Rocipon souligne aussi l’hétérogénéité générique de l’œuvre de Bailly, elle insiste en particulier sur sa grande cohésion autour d’une idée à laquelle donne son nom le titre du recueil d’articles de Bailly, La Fin de l’hymne10. En faisant finir l’hymne (le discours idéologique ou savant) pour gagner d’authentiques « retrouvailles avec un réel perdu » (p. 118), Bailly renouvelle l’acte de naissance de la modernité qui se porte aux devants du réel pour le voir (re)naître dans la langue.
14Enfin, au lieu d’essayer d’ « attraper » (p. 129) Bailly par ses mots écrits, Daniel de Roulet propose avec originalité de « le prendre avec ses gestes et à l’oral » (p. 129), dans « Jean-Christophe Bailly à l’oral » (p. 129-131). Évoquant la langue orale et paraverbale de Bailly en entretien, D. de Roulet souligne les étapes de l’expression de sa pensée, accompagnées et rythmées par les mouvements de ses mains, qui se serrent puis se quittent, de même que le mouvement de la phrase accompagne et fait naître le monde. Selon D. de Roulet, l’on assiste ainsi avec fascination (p. 130) à l’éclosion puis au développement d’une parole qui s’alimente en s’échappant à la poursuite de diverses pistes d’idées : « il produit, il révise ce qu’il a écrit, commente, empile des incises » (p. 129). Dans ce penser-parler, « il ne parle pas, il pense avec les mains » (p. 130). Les mains de Bailly, à l’image de ses phrases, habitent l’espace, comme pour y chercher un écho à une pensée dont les fluctuations se donnent à entendre en profitant de la liberté offerte tant qu’elle n’est pas cristallisée par l’écrit. C’est dans cette phase-là, selon D. de Roulet, que la pensée de Bailly est la plus forte, la plus belle et la plus personnelle.
15Ainsi, ce numéro de la revue Critique propose une immersion dans la fabrique de la phrase et du texte de Bailly, qui se fait instantanément fabrique du monde. La phrase de Bailly est une insistance dans le vivant, ainsi qu’une contractualisation entre deux parties : le langage et le monde se voient ici offrir des territoires en partage, sans être les simples déversoirs ou recueils de l’un et de l’autre. Pour le résumer, Martin Rueff propose à la fin du recueil, dans « Poésie puissance n » (p. 144-155), de faire d’Écho « la nymphe tutélaire de cette définition de la poésie » (p. 155), car le langage est le souvenir de l’écho du monde, que l’écriture de Bailly a la charge de libérer. Ces études suggèrent le nécessaire dépassement d’une poéthique qui viserait à simplement habiter le monde. Ces articles suggèrent que Bailly opère une synthèse ainsi qu’un dépassement des précédentes phases de la littérature contemporaine qui a cherché son lieu dans la langue ou dans le nouage avec le monde : avec Bailly, le « ou » devient un « et », et s’autorise des échappées vers d’autres formes que le poème tout en le cherchant sans cesse.
Pour suivre le parti pris du poème
16« C’est vers le poème que selon moi tout doit tendre », écrit Bailly dans ses carnets de voyage Jours d’Amérique. 1978-200111. Ses notes et ses proses convergent vers le poème, qui semble être pour lui l’autre nom de la création et de l’écriture12. S’entend dans cette présence du mot « poème » comme point focal de la création littéraire chez Bailly son sens originel dérivé du grec ποιε ́ω, « fabriquer, faire, créer ». Les « poursuites » éponymes sont aussi, peut-être, celles du poème niché en chaque geste créateur, y compris hors du poème.
17La phrase de Bailly interroge la capacité de la langue à organiser des points de rencontres du locuteur et du monde, tout comme le voyage mis en mots dans le carnet devient une interrogation sur la nature et le rôle de l’écrivain, comme le souligne Nathalie Piégay dans « Les ressources narratives du lointain » (p. 91-102). Dans ses « Détroits, isthmes, communisme(s) » (p. 103-116), Philippe Roux propose l’idée d’une langue-monde dans laquelle le lexique de la géographie permettrait de comprendre le travail de Bailly. Ainsi, les noms « isthme » et « détroit » métaphorisent le rôle du poème, séparant et reliant tout à la fois en préservant la possibilité d’un passage, d’un mouvement, d’une jonction qui permettent d’« être-avec » (p. 107). La connexion de l’écrit et du monde sensible, chez cet « écrivain des égards » (p. 113) qu’est Bailly, montre un poète capable de rester aux aguets pour se laisser traverser par les choses du monde, devenant lui-même écrivain-isthme ou écrivain-détroit.
18Dans « Poésie puissance n » (p. 144-155), Martin Rueff montre que la poésie de Bailly est une recherche d’elle-même. Si l’œuvre de Bailly comprend huit titres de poésie, où le poème assume et affiche sa forme à travers le choix du vers, il n’en reste pas moins que toute sa poésie tend à un « élargissement13 » vers son autre, qui peut être la prose. Le poème n’est pas une question de genre : débordant la notion générique, il trouve son lieu dans une ouverture gagnée grâce à la vertu exploratoire de cette forme malléable et mobile. Chez Bailly, la « fin de l’hymne » correspond à la perte du souffle emphatique du poème et de l’identité lyrique de la Poésie. Ainsi, plus qu’une extériorisation spectaculaire, le poème cherche la dimension spéculaire qui lui permettra, tout en accueillant la voix du monde et en regardant le dehors, de se regarder et de se comprendre lui-même. Se reconnaît dans cette approche, même s’il n’est pas nommé, l’influence sur la critique moderne des travaux de Jean-Michel Maulpoix sur le lyrisme critique14 qui, par le biais du dédoublement engendré par la crise de la modernité, amène le poète à regarder son propre travail sur la langue en refusant toute complaisance naïve envers le chant. Chez Bailly, la « fin de l’hymne » constitue une augmentation en puissance de la poésie, et non pas sa réduction, d’où le titre de l’article de M. Rueff : « Élargissement de la poésie + Fin de l’hymne = poésie – hymne = poésie puissance n. Non pas “haine de la poésie”, mais poésie puissance n » (p. 147). À force de s’« élargir », le poème court-il à sa perte, la prose est-elle l’avenir du poème ? Bailly montre au contraire que le poème, dans sa persévérance, peut demeurer poème tout en s’élargissant vers la prose. M. Rueff s’attache à préciser les dettes de Bailly dans sa poursuite d’une forme du poème, envers les surréalistes (« la césure, la provocation, la tension, l’émulsion », p. 148), les romantiques (« l’affranchissement des genres, l’envergure spéculative, la dispersion rigoureuse, l’élargissement du poème et l’exigence du fragmentaire, un départ toujours nouveau, la conscience de soi de la poésie, l’imprudence », p. 148), Cesare Pavese (« un besoin de concrétude », p. 149, qui amène à côtoyer le récit et à refuser la dimension lyrique et emphatique de la métaphore), les poètes américains (« le poème-continent, le tout-venant, la situation sans intention », p. 150), Dylan Thomas (« la ruine de l’idée parfaite, l’insondable du langage », p. 150), Paul Celan (le poème comme « seuil » du monde, p. 150), tous (« le refus que le poème vienne s’abîmer dans la poésie », « la vraie poésie se moque de la poésie car elle ne croit même pas à l’idée de vraie poésie », p. 151). C’est aussi cela, l’élargissement du poème : sa tension vers les résonances qui lui permettent d’explorer sa forme et son devenir. Le propos, convaincant, de M. Rueff est de montrer que le poème est d’autant plus puissant qu’il résiste avec ténacité à la poésie, c’est-à-dire qu’il se refuse à une assimilation expéditive à un genre ou à un mode, et qu’il cherche sa forme, donc sa raison d’exister. M. Macé le soulignait déjà dans son article « Phraser » (p. 36-60) en montrant l’insistance de la phrase, assimilée à une « piste d’être qui insiste dans le vivant, et, en cela, une raison de vivre » (p. 56). Les poèmes de Bailly témoignent de cette résistance, notamment par le choix du prosimètre, par l’insertion de fragments, de copeaux ou de vignettes dans le poème (p. 152). M. Rueff rapproche à ce sujet Bailly de Jean-Luc Nancy15 qui précise cette capacité à résister : « L’histoire de la poésie est l’histoire du refus persistant de laisser la poésie s’identifier avec aucun genre ou mode poétique […], pour déterminer, incessamment, une nouvelle exactitude16 ».
19L’un des grands mérites de cet ouvrage est de montrer comment Bailly poursuit l’idée de poème, à travers les nombreux dialogues entre les diverses œuvres de Bailly, mais aussi avec celles d’autres auteurs : ces échos infra et extragénériques révèlent la singularité et la résonance de la quête de Bailly. Ainsi, dans « Penser en peintre : Bailly lecteur de Baudelaire » (p. 132-140), Julien Zanetta étudie la préface au Salon de 1846 de Baudelaire17, et montre que Bailly, en renouvelant le regard trop souvent peu critique porté sur Baudelaire, mêle admiration et distance pour interroger la poiesis baudelairienne, notamment en soulignant la « méthodique gradation des idées » (p. 136) de Baudelaire qui conduit du rôle de la critique à la définition du romantisme puis à la couleur et enfin à Delacroix. Les tons se mêlent sous la plume de Bailly, entre explications historiques et allusions à l’époque présente, mettant son intuition et son sentiment au service d’une critique qui se refuse à la froideur de la stase théorique pour lui préférer des associations improbables ou subjectives. Bailly aime en Baudelaire l’iconoclaste qui remodèle les formes et qui « s’en prend aux gloires établies, aux réputations usurpées » (p. 136). Distance, humour, jeu et ironie se mêlent pour offrir, à travers l’étude de la force de dévoilement de l’art, une « clairvoyance » (p. 137). Ainsi, Bailly nous aide à (re)lire avec lucidité Baudelaire, en sachant « allier respect et liberté, connaissance profonde de la peinture de cette époque et volonté d’exercer un regard interrogateur, admiratif, certes, mais critique, surtout, sur un auteur à qui, depuis beau temps, l’on passe tout » (p. 135). Mais, surtout, J. Zanetta montre que l’approche de Bailly déborde les genres (p. 140), en cherchant dans le texte baudelairien les mouvements d’un genre à l’autre et les échappées de la critique d’art vers le poème. Son regard sur la critique baudelairienne est en fait un regard sur le poème : « il s’agit de comprendre la ligne que tracent les essais de Baudelaire sur l’art. Soit encore, de déterminer le rôle qui revient à la poésie » (p. 140), en laquelle Baudelaire voit une « qualité », « Bailly devine en 1846 un “devenir prose de la peinture18” (p. 56) qui prolonge, accompagne, ou devance même un devenir prose du poème » (p. 140). Les diverses approches adoptées par Bailly dans cette préface à l’écriture hybride (politique, philosophie, esthétique, poétique), se rejoignent dans la « mise en mots » (p. 140) de la peinture, si bien que tout y court au poème, que Bailly tente de réfléchir par ce détour.
20Enfin, Laurent Jenny, dans « Puissances de l’atténuation » (p. 84-90), étudie La Reprise et l’Éveil. Essai sur l’œuvre de Jean-Marc Cerino19. Cet essai forme pour L. Jenny le point de départ d’un élargissement de la réflexion sur la nature et la portée du geste artistique. L. Jenny s’attache à souligner les résonances entre l’œuvre de Cerino et le travail de Bailly : Cerino appose au pinceau une écriture seconde sur des photographies, notamment d’archives, ce qui leur redonne une lumière ; la reprise se veut réparation, mais sans voiler la nature première de la photographie. Le travail de Cerino, vu comme une « trace » (p. 86), est une présence vouée à l’effacement ; cette puissance du positif-négatif et de la présence-perte véhicule une interrogation sur le rapport dialectique entre l’unicité et la reproductibilité de l’image : la photographie, image unique d’une réalité unique, est dupliquée par la reprise picturale. L. Jenny souligne également le sens du geste artisanal de Cerino, qui fait du support du verre une matière à la fois translucide et opaque, réactivant la mission du « palimpseste » (p. 88), qui, en un jeu de transparence et de masquage, montre ce qu’il veut cacher : « par un étrange effet d’émergence la vérité effacée de l’image transparaît sous sa fausse tranquillité » (p. 88). L’essai de Bailly sur l’œuvre de Cerino ouvre une voie dans l’univers des images, entre leur surabondance et leur invisibilité, ce qui parle, de façon détournée encore, du poème et de la création. L. Jenny considère Bailly comme un « médiateur » (p. 84) qui fait de l’image non pas un donné figé, mais un « “envoi” qui n’en finit jamais d’arriver » (p. 85) pour révéler sa part aléthique. Après le révélateur technique permettant le développement de la photographie, la peinture agit comme un second révélateur de l’image. L’image renvoie à la fois à sa propre réalité et à l’épisode historique qu’elle présente, si bien que s’y observent simultanément une image et son autre. Dans ce travail duel entre le même et l’autre, Cerino offre la possibilité de mieux voir, et de voir plus, en découvrant une vérité auparavant restée dissimulée, c’est-à-dire en révélant la nature profonde du geste poiétique. L. Jenny qualifie le travail de Cerino de « poche de résistance, où l’on se pose moins la question de “l’art” que celle de la nécessaire figuration et refiguration du monde » (p. 90) qui prouve que l’art a encore une place et un sens dans notre monde. Ce plaidoyer pour la force de dévoilement de l’art souligne la capacité de résonance existentielle de l’art qui, contrairement à ce que montre Yves Michaud dans ses essais20 sur la sur-esthétisation dans la société actuelle, n’est pas soumis à la marchandisation ni au règne de l’esthétique chez Cerino et chez Bailly.
21Ainsi, plusieurs articles de ce Critique mettent en lumière la capacité respiratoire du poème, qui s’ouvre à d’autres phrasés que les siens, qui s’élargit de ses échanges avec d’autres voix et de ses poursuites d’autres formes. Tout y concourt à souligner la puissance tenace et persévérante de l’être-là du poème, en tension dans l’ensemble de son œuvre.
Que poursuivre ?
22L’introduction de Critique rappelle que Bailly a intitulé un recueil de textes sur le théâtre Poursuites21, nom qui désigne un « projecteur mobile susceptible d’accompagner le déplacement d’un acteur sur le plateau22 », autrement dit qui met en lumière ce qu’il faut observer. Que poursuivent les textes de Bailly, et que nous montre-t-il à observer du monde dans ses écrits ? Suivant Bailly, que nous faudrait-il poursuivre de nos assiduités ?
23Dans son entretien avec M. Macé et M. Rueff intitulé « L’envolée des noms », Bailly précise que le terme « poursuites » évoque le mouvement, la mobilité, le passage, le contraire du mur. Cette tension exploratoire favorise les « points de suture entre le ciel et la terre » (p. 29), qui relient plus qu’ils ne referment, portés vers « une intuition sans fin recommencée » (p. 29). Le poème forme une exploration, à la fois physique et intellectuelle, où la palpitation de la langue et du dehors permet d’espérer trouver une « respiration » (p. 29) en laquelle le monde offre sa part d’illimité qui suscite une poursuite infinie.
24Dans « Ce qui vient avec les rivières… » (p. 72-83), Elvina Le Poul propose une approche que l’on pourrait qualifier d’« aquasophe », en interrogeant la sagesse acquise par l’observation des rivières et des fleuves qui forment les points de départ du Dépaysement23. Cet essai décrit une traversée de la France pendant trois ans, où Bailly se laisse guider par les fleuves et les rivières pour établir un « pacte […] autour d’un appel mutuel » (p. 72), pour qu’en retour, l’eau « accompagne et instruise un ensemble de pensées respirantes » (p. 72). Ils font naviguer vers la question de l’identité française, en amenant à regarder la France à l’aune de ses eaux (en riposte au projet puis à la création d’un ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale par le président Nicolas Sarkozy en 2007-2010). Dans la leçon donnée par la porosité des eaux et des territoires, Bailly va contre les replis identitaires, si bien que, sous sa plume, la rivière prend une valeur antinationaliste en ce qu’elle décentre notre regard sur le pays pour nous dé-payser, c‘est-à-dire sortir de notre idée du pays, de ses normes et de ses barrières. L’écriture poursuit ici le rêve politique du partage (des droits de la terre et de la nature, du sensible, du chant du monde), pour légitimer la voix des choses du monde et « caractériser leur mode de présence » (p. 75), non pas en leur donnant une voix anthropomorphe, mais en réhabilitant leur voix, en mettant en lumière leur présence et leur surgissement, sans les personnifier, de façon à respecter leur manière d’être. Cette écriture se veut politique en ce qu’elle endosse une responsabilité quant aux choses du monde, qui nous amène à nous intéresser à elles, à entendre leur appel, à leur répondre, à travers une attitude de « confiance éthique » (p. 77) qui pourrait s’inspirer de la forme même de la rivière, avec ses méandres et sa fluidité, échappant aux paradigmes et aux systèmes qui replient l’histoire sur elle-même. Cette politique prend place dans ce qu’E. Le Poul nomme une « éthique de la forme » (p. 79) qui « s’oppose à ce qui de la forme, verse dans ce que l’on appelle le formel, d’où dérive la formalité – tout le registre de l’installation normative et de la fixité ; tout ce qui confond la loi avec l’arrêté24 », et qui incarne la liberté et la tolérance, autres noms de l’ouverture et de l’élargissement…
25Cette portée politique et éthique est aussi louée dans « Détroits, isthmes, communisme(s) » (p. 103-116). L’originalité de la lecture de Philippe Roux est d’aborder l’œuvre de Bailly à l’aune de l’idée de communisme pour y rechercher une « communauté des existences » (p. 103), en partant d’un propos de Bailly : « Mise en commun, le mot est déjà là et désigne, qu’on le veuille ou non, un communisme. […] Ce n’est pas le communisme “réel” tel qu’il a existé derrière nous avec son erreur fondamentale et ses atrocités mais un communisme toujours à venir dans lequel le schème de la dispersion, de la dissémination est aussi fondamental que celui du rassemblement25 ». Ainsi l’idée de communisme éclairerait la poétique de Bailly, en signalant l’importance de l’être-avec, dans la recherche d’un libre « assemblement » (p. 105). Tel que le présente P. Roux, le projet de Bailly est de rechercher le « seuil où nous sommes en commun. Séparés mais en commun, réunis » (p. 107). Le seuil devient une topique pour penser la possibilité d’une communauté et d’un partage, ce qui amène P. Roux à parler de « conception politico-utopique de la révolution permanente vue par Bailly » (p. 107), qui recherche « l’infinie connexion des choses » considérées dans leur égalité morale mais sans l’assimilation monolithique que pourrait véhiculer l’idée de communisme. Le « communisme » est ici l’autre nom de la présence aux choses, l’effort et la tension pour être pleinement là, dans le partage du vivant. P. Roux cherche à mettre lui-même en œuvre cette approche dans la construction de son article, qui n’a de cesse de mettre Bailly en relation avec d’autres, en le rapprochant du philosophe Jean-Luc Nancy, du rêve des surréalistes, de la recherche d’une vérité de l’instant chez Cesare Pavese, du rêve de partage chez les prolétaires de Tchevengour d’Andreï Platonov, de la pensée de la discontinuité chez le philosophe Walter Benjamin26, pensée qui inspire chez Bailly la pratique, contre une langue lisse et uniforme, d’une langue de fragments qui se tiendrait à hauteur du monde pour y trouver un « en-commun » (p. 114). Ainsi, P. Roux montre que la principale question de Bailly, « comment se tenir dans l’ouvert ? » (p. 106), poursuit un rêve de partage et de communauté.
26Dans « Puissances de l’atténuation » (p. 84-90), Laurent Jenny souligne la dimension politique des photographies choisies par Cerino et évoquées par Bailly : ces « archives de désastres historiques » (p. 87) sont des images de ruines, d’événements collectifs politiques (révoltes ou manifestations), d’essais d’inventions abandonnées : il porte son attention, « entre effacement et esquisse », « là où des potentialités ont été étouffées par l’Histoire mais où la vigilance d’un regard peut sans doute les ranimer » (p. 87). L’utopie d’une vigilance du regard peut rendre visible l’oublié, à travers une « anamnèse historique » (p. 88), comme dans les romans de W.G. Sebald qui dévoilent le vrai par la fiction, constituant une mémoire qui fait la lumière sur des traumatismes enfouis.
27Cette quête d’un ancrage dans le temps est aussi mise en valeur par Elvina Le Poul, dans « Ce qui vient avec les rivières… » (p. 72-83). Elle propose de lire dans l’attachement de Bailly aux rivières et aux fleuves qui traversent la France une « poétique mémorielle » (p. 82). Le souvenir « mobile et sédimentaire » circule dans la rivière et déploie une force de germination qui devient un éveil ; cette mémoire passe par les mots, si bien que la Loire déclenche la survenue du Loir mais aussi des épisodes historiques afférents (l’épisode du procès des Égaux revient à l’esprit quand on voit le Loir traverser la ville de Vendôme, p. 82), grâce à une « resémantisation du flux : à ce qui passe et qui liquide le temps dans un espace plan, se substitue une réalité dense et mnémonique » (p. 82). Dans la phrase de Bailly, toute la « mémoire hydrographique » (p. 82-83) de la France vient s’enrouler autour de la mémoire de la langue ; comme de manière proustienne, le paysage déclenche le souvenir autour de la rivière qui est à la fois du passé et du futur, du perdu et du encore là.
28Si la phrase-rivière peut devenir une gardienne de la mémoire, c’est aussi, selon Nina Rocipon dans « La ressemblance émancipée : la chaussette, le gant et l’éléphant » (p. 117-128), parce qu’elle active dans les moments d’épiphanie du monde, et notamment du réel perdu, le phénomène particulier de la ressemblance. Pour N. Rocipon, la ressemblance est une notion fondatrice dans la poétique éthique et politique de Bailly par sa puissance de mise en contact entre le sujet et le dehors. Sans qu’une assimilation factice et épuisante rabatte une idée ou une image sur une autre ou sur un paradigme, la ressemblance revêt une force d’ouverture nourrie d’une grande « densité phénoménologique » (p. 119). Loin de toute conformité, elle révèle une façon sensible d’être dans le monde qui semble vraie sans mimétisme. C’est une ressemblance en soi, dans un emploi absolu, sans analogie (qui serait un enfermement), une « ressemblance sans référent » (p. 120), donc « émancipée » (p. 119) et « libérée » (p. 120). Elle offre par conséquent la « sensation d’une coïncidence entre l’être et son apparence » (p. 120), en exaltant l’objet perçu plutôt que l’analyse de son référent : la chose est donc aussi émancipée du jugement imposé par l’observateur. Cette singularité d’une ressemblance sans référent ni mimétisme souligne l’héritage de Walter Benjamin chez Bailly : la ressemblance se réalise dans une expérience vécue, par exemple dans l’image de la chaussette qui change de forme et de destination tout en gardant son identité de chaussette, pour être tour à tour contenant, contenu et chaussette27, l’image de la chaussette se transformant chez Bailly en celle du gant (p. 125-126) qui colle l’image de la main sur la main en rendant absolument adéquats l’enveloppant et l’enveloppé. Cette notion de ressemblance est celle de vérité de la chose, qui renvoie chez Benjamin au regret de la chose perdue, et chez Bailly à la saveur joyeuse et onirique du contact avec la chose. En fin d’article, la chaussette et le gant conduisent vers l’éléphant28, dont l’apparition déclenche la joie en ce qu’il surgit dans l’imaginaire tel qu’on l’attend mais aussi tel qu’on le rêve. Ainsi, la ressemblance, émancipée, se fait émancipatrice, en ce qu’elle délivre des schémas de pensée et ouvre vers un ailleurs dans les mots.
29Cette projection vers un autre monde rejoint la tâche fondamentale de la littérature, soulignée par Marielle Macé dans « Phraser » (p. 36-60) : grâce au langage, inventer des utopies pour proposer d’autres manières de vivre. La conclusion de M. Macé, dans « Phraser », souligne la portée aléthique de l’œuvre de Bailly : c’est une littérature de vérité grâce à la langue ; pour cela, et pour préserver l’idée d’utopie d’une vérité à poursuivre, la phrase suscite une tension entre le présent et l’à-venir, tout en habitant en plein dans le monde. M. Macé souligne son goût pour les livres de Bailly : « elle vous met davantage dans le monde cette lecture, le monde mobile, vivant, vibrant, elle vous y verse, comme un estuaire, elle ouvre la fenêtre et les poumons et fait respirer – respirer dans les choses et dans la parole, respirer enfin » (p. 60). Encore plus qu’une politique du vivre-avec et qu’une éthique de la clairvoyance, l’œuvre de Bailly suscite la vie-même, le désir et l’« appétit » (p. 52) du monde, car « la forme, toute forme, est un rêve du monde qui se pense en se faisant » (p. 55).
***
30Poursuites… du monde, de la langue, du poème, d’un rêve : ce numéro de Critique marque un tournant majeur des études sur l’œuvre de Jean-Christophe Bailly, en offrant à la fois une synthèse et de nouvelles pistes pour comprendre sa poétique et son éthique. Les nombreux et riches échos proposés montrent à quel point l’œuvre de Bailly se situe au croisement de diverses approches créatrices et épistémologiques. Tournée vers l’autre et vers le dehors, – en témoignent les nombreuses préfaces qu’il a rédigées pour accompagner des œuvres variées, ainsi que la capacité exploratoire de son écriture irradiant vers une polygénéricité –, l’écriture de Jean-Christophe Bailly est en élan dans lequel compte peut-être plus la poursuite que le fait de savoir exactement ce qui est poursuivi.
***
BIBLIOGRAPHIE
Bailly, Jean-Christophe, Le Propre du langage. Voyage au pays des noms communs, Paris, Seuil, coll. « La librairie du XXe siècle », 1997.
Bailly, Jean-Christophe, Poursuites, Paris, Christian Bourgeois, 2003.
Bailly, Jean-Christophe, Le Versant animal, Paris, Bayard, coll. « Le rayon des curiosités », 2007
Bailly, Jean-Christophe, Le Dépaysement. Voyages en France, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2011.
Bailly, Jean-Christophe, Le Parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgeois, coll. « Détroits », 2013.
Bailly, Jean-Christophe, L’Élargissement du poème, Paris, Christian Bourgeois, 2015.
Bailly, Jean-Christophe, La Fin de l’hymne, Paris, Christian Bourgeois, 2015.
Bailly, Jean-Christophe, Saisir. Quatre aventures galloises, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2018.
Bailly, Jean-Christophe, Café Néon et autres îles, Paris, Arléa, 2021.
Bailly, Jean-Christophe, Jours d’Amérique. 1978-2011, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2021.
Bailly, Jean-Christophe, La Reprise et l’Éveil. Essai sur l’œuvre de Jean-Marc Cerino, Macula, 2021.
Bailly, Jean-Christophe, Charles Baudelaire, Salon de 1846 précédé de « Baudelaire peintre », Paris, La Fabrique, 2021.
Bailly, Jean-Christophe, « Ponctualité du poème », Po&sie, L’agencement des mobiles. Manifestes, 2022/1-2, n°179-180.
Macé, Marielle, Chercher une phrase, Paris, Christian Bourgeois, coll. « Détroits », 1991.
Macé, Marielle, Phrase, Paris, Christian Bourgeois, coll. « Détroits », 2000.
Macé, Marielle, Une pluie d'oiseaux, Corti, coll. « Bibliophilia », 2022.
Manno, Yves di et Isabelle Garron, Un Nouveau monde. Poésies en France. 1960-2010, Paris, Flammarion, coll. « Mille & une pages », 2017.
Maulpoix, Jean-Michel, Pour un lyrisme critique, Paris, José Corti, coll. « En lisant en écrivant », 2009.

