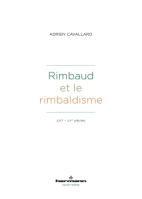
Appliquer Rimbaud. Note sur les études de réception
La « dérive herméneutique »
1Après l’âge de l’Auteur, puis l’âge du Texte, les années 1970 ont commencé à promouvoir l’âge du Lecteur, accomplissant en partie le programme d’un Émile Hennequin, approfondissant les thèses de Valéry, de Sartre, ou de Barthes. Malgré les travaux de l’École de Constance, malgré la rhétorique de la lecture, la sémiotique de la lecture, la sociologie de la lecture, l’histoire des conditions matérielles et idéelles de la lecture, un Jean-Marie Schaeffer pouvait regretter en 2011 un certain manque de « travaux empiriques précis » consacrés aux faits de « dérive herméneutique1 ». Si le constat mérite d’être nuancé2, un livre comme celui d’Adrien Cavallaro, tiré de sa thèse de Doctorat — Rimbaud et le rimbaldisme. xixe-xxe siècles, publié chez Hermann en 2019 — vient enrichir la liste des contributions d’envergure données à ce chantier de recherche. Soulignons d’emblée que ces lignes n’ont pas pour ambition de rendre compte de la totalité de l’ouvrage, très riche d’implications, dense dans son effort de théorisation, d’autant qu’il se signale aussi par son ampleur diachronique (du symbolisme aux derniers feux du surréalisme, avec des incursions au-delà), comme par la multiplicité des références littéraires. Faute de légitimité comme de compétences, je centrerai mon propos, à visée épistémologique, sur les études de réception, et non sur les études rimbaldiennes. De fait, l’auteur fait preuve d’une réelle conscience critique, à travers 70 pages de « discours de la méthode », et ne cache pas son ambition théoricienne, en partie programmatique, en signant un appel « pour une refondation des études de réception rimbaldienne » (p. 9), qu’il a le premier entendu.
2Plusieurs directions « idéales-typiques » semblent s’ouvrir pour qui entreprend d’écrire l’histoire des réceptions successives d’un auteur ou d’un texte, si l’on écarte la simple doxographie énumérative, pourtant souvent pratiquée sous le nom assez usurpé de « réception ». Tantôt, on enregistrerait un certain pluralisme exégétique en dressant une histoire et / ou une typologie des interprétations : c’est une voie plutôt relativiste et descriptive, qui peut s’enraciner dans l’herméneutique littéraire héritée de Jauss lecteur de Gadamer ; tantôt, au contraire, l’effort historique ou typologique peut conduire à un jugement, assumé comme tel. Les études de réception paraissent alors tirer l’une de leurs légitimités de leur capacité à identifier, en les objectivant, les phénomènes de « dérive herméneutique » : c’est une voie qui va alors osciller entre un pôle « critique » (dévoiler un impensé) et un pôle « clinique » ou « normatif » (rétablir une vérité jugée « objective », dissoudre de fausses généalogies), qui s’appuie sur une philologie de l’intention de l’auteur, de la lecture grammaticale, de la sollicitation des « sources », plus ou moins positiviste, permettant de mesurer un écart entre ce qu’Umberto Eco appelait « interprétation » d’un côté, « utilisation » de l’autre3. Dans l’une ou l’autre voie, si l’étude est approfondie, l’un des enjeux majeurs consiste à analyser une série de schèmes interprétatifs variables en fonction des processus de recontextualisation, dégager un « outillage mental » individuel ou collectif, cerner des « communautés interprétatives » (Stanley Fish), et des conflits d’interprétation. Les études de réception seraient ainsi amenées à interpréter les interprétations, ou à évaluer les évaluations.
3Une troisième direction peut sembler fructueuse, doublant l’approche historique d’un pli méta-historique, ce que ne prévoyait pas vraiment l’École de Constance : enquêter sur le processus de formation et de transformation des « opinions littéraires » (Roger Fayolle), sur l’histoire du canon littéraire, sur les processus de « classicisation » (Alain Viala), sur les médiations qui assurent la transmission d’une œuvre dans la durée, sur l’histoire de la mémoire littéraire, sur l’histoire des disciplines littéraires dans leur manière de construire leur objet, et donc sur l’histoire de l’histoire littéraire. À cela s’ajoute une analyse des incarnations institutionnelles des « horizons d’attente », en rattachant les « prises de position » à des « positions », en précisant le statut professionnel et symbolique des critiques vus comme des créateurs de valeur, pour reprendre l’idée de Remy de Gourmont. L’enquête, plus ou moins tributaire d’une sociologie du public et des biens symboliques, d’une étude comparatiste des transferts culturels, ou d’une histoire des pratiques culturelles arrimées à des institutions « sacralisantes » (« champs » ou « mondes » de la presse, de l’enseignement, des manuels scolaires, des programmes de cours et de concours, de l’Université, de l’édition, des bibliothèques, des librairies, des sociétés savantes, des académies, des salons, des cénacles, des cours princières, etc.), se fait alors généalogique ou archéologique, en se fondant sur la question fondamentale, bien souvent inaperçue ou négligée par les études littéraires, de Royer Fayolle : « comment la littérature nous arrive4 » ? Bourdieu lecteur de Spinoza en avait cerné l’enjeu de la sorte : contre la « routine des exégèses herméneutiques », contre le monopole de la « lecture liturgique », inséparable à ses yeux de la « fausse éternisation d’un embaumement rituel », le sociologue posait en effet la question de la réception active en cherchant à savoir « en quelles mains [le livre] est tombé […], quels hommes ont décidé de l’admettre dans le canon, comment les livres reconnus comme canoniques ont été réunis en un corps5». Les études de réception pourraient alors se définir comme des études de construction, et donc de « dé-naturalisation », selon un mouvement de re-historicisation. Il n’est pas « naturel » de pouvoir lire Rimbaud en 2023 ; il n’est pas « naturel » de voir en Rimbaud un « symboliste », un « précurseur du surréalisme », ou un « voyant ».
4Une fois ce panorama esquissé, reste l’une des questions majeures, qui traverse ces orientations méthodologiques : la tension entre sens et contresens, signification et signifiance, philologie et allégorie, singulier du texte et « pluriel du texte », œuvre fermée et « œuvre ouverte », que certaines herméneutiques peuvent reformuler en accueillant plus favorablement toutes les formes de jeu avec un sens dit « littéral », « contextuel », ou « auctorial », jusqu’à nier, dans le sillage de la déconstruction, l’existence même de la notion de « contresens », au nom du refus du « signifié transcendantal ». Jauss, on le sait, entendait sortir d’une vision tout à la fois objectiviste et formaliste, essentialiste ou historiciste des œuvres, pour mettre en place une « herméneutique de la question et de la réponse » voyant dans l’œuvre un double « horizon » objectif et subjectif, un événement existentiel et un « partition » à actualiser ; Pierre Hadot quant à lui, qui retrace par exemple l’histoire de l’aphorisme d’Héraclite « la nature aime à se cacher », parlera de « contresens créateur6 » ; des travaux ont été menés sur la notion de lecture « contre-auctoriale7 » ; Yves Citton, proche de l’approche pragmatique de Fish — lire, c’est faire — en forgeant le concept de « lecture actualisante8 », redécouvre, après Gadamer et Jauss, la vieille tradition piétiste de « l’applicatio », qui n’est pas sans lien avec le « braconnage » de Michel de Certeau. Dans le cas de Rimbaud, le conflit herméneutique a été posé une première fois, de manière inaugurale et décisive, par René Étiemble : philologie versus mythologie.
Le « legs d’Étiemble » (p. 41)
5Dans le cas si litigieux de Rimbaud, comme le rappelle bien évidemment Adrien Cavallaro après d’autres, le lecteur doit sans cesse affronter la question des « limites de l’interprétation » parce que le nom de Rimbaud convoque une somme de lacunes biographiques mais aussi parce qu’il ne cesse de rendre problématique la frontière entre ce qu’un binarisme superficiel, hérité d’une certaine histoire littéraire lansonienne, appelle « vie » d’un côté, et « œuvre » de l’autre. Une telle situation ne put que favoriser la fictionnalisation, comme l’instrumentalisation, suscitant ce que René Étiemble a appelé le « mythe », conformément à une longue tradition, puisque le poète, quasi immédiatement, fut pris dans un espace questionnant les notions de réalité et de vérité, comme le nota d’emblée Félix Fénéon en 1886 : « Déjà son existence se conteste, et Rimbaud flotte en ombre mythique sur les Symbolistes » (cité p. 14). En dépit de cette complexité placée sous le signe de la sous-détermination biographique (le « silence » du poète et la parole des « témoins ») comme de la surdétermination textuelle (« la complication de texte » chère à Todorov), l’auteur du Mythe de Rimbaud entreprit un vaste travail clinique, orthopédique, de rationalisation, de démythologisation, retrouvant le lien que la science de l’époque de Max Müller nouait entre mythologie et « maladie du langage » : « je me propose donc de décrire une affection de l’imaginaire collectif9 » ; l’universitaire croit en l’existence d’un « sens original10 », accessible en lisant les textes : « le seul moyen de faire la part du vrai de celle de la fable, c’est de lire les textes, en essayant de les comprendre pour en jouir11 ». La conclusion de sa vaste somme athéologique signale le moment historique de ce livre, antérieur à l’esthétique ou à la pragmatique de la réception ; il choisit la voie normative, corrective, comme si le livre mythique « sans orthographe » écrit à l’insu de l’auteur, contre l’œuvre, devait être aboli à peine mis en page. Étiemble, pastichant paradoxalement ces surréalistes égarés, a dissous « le mythe », pense-t-il : « revenir au texte, à son sens. Lisez Rimbaud. Un passage vous résiste ? Prenez votre grammaire, le Bescherelle, ou le Littré12 ». Grammaire contre grimoire, injonction philologique, mais avec une réduction du « répertoire » d’un lecteur à ses compétences linguistiques.
6Adrien Cavallaro, obligé de reconnaître toute une série de dettes vis-à-vis de ce grand devancier, « à l’ombre » (p. 9) duquel il écrit, à qui il emprunte sa périodisation (des années 1870 aux années 1950), avec qui il conclut (« Rimbaud Bible des temps modernes », p. 433), a opté explicitement et majoritairement pour notre première voie, celle qui se veut explicative et descriptive, non-normative, tout en faisant des incursions sur la troisième voie, plus généalogique, en dégageant les modes de construction du corpus rimbaldien, comme l’émergence de paradigmes critiques qui ont doté l’œuvre de cadres d’intelligibilité mobiles : tout cela est très précieux, et n’avait pas été fait de manière aussi précise. Le « rimbaldisme », défini alors avec Aragon comme « ensemble de notions, d’images, de réactions humaines, commandé par une forme très particulière de la sensibilité moderne » (p. 60), doit avoir un plein droit de cité dans la République des lettres, parce qu’il reste indissociable du « cas Rimbaud » en particulier, tout en étant propre à la vie des œuvres, comme ne manquait pas de le concéder Étiemble d’ailleurs — lui qui y consacra vingt ans de sa propre vie.
7En se déplaçant « du mythe au rimbaldisme » (p. 41), on change d’axiologie, ou l’on quitte idéalement l’axiologie, pour aller vers la généalogie ou l’archéologie, au sein d’un « champ d’études dont le principe interprétatif échappe à la dialectique de la vérité et de l’erreur » (p. 434). L’usage de Rimbaud sera ici abondance et non déviance, créativité et non morbidité ; on cherche à rompre avec les métaphores de la « pathologie », pour leur substituer celle de la fertilité, le mot courant tout au long de l’ouvrage. Le mythe n’est plus « un voile de l’erreur qu’il faudrait déchirer », mais « la surface des idées d’une époque » (p. 69). Le texte rimbaldien est solidaire de ses effets ou de ses usages, puisqu’il sera question ici d’une « lecture réconciliatrice de l’œuvre et de sa réception » (p. 53). Le « rimbaldisme », investi d’une forme de « neutralité axiologique », s’affirme dès lors comme « la continuation de l’œuvre par d’autres moyens » (p. 49). Mais dans les faits, le propos fera certes dominer l’approche critique, qui fait le point par exemple sur la convocation effective de Rimbaud dans l’émergence du vers libre, sans pour autant abandonner ici ou là, le tropisme ou le démon, de l’approche clinique, le commentateur occupant la position de surplomb de celui qui juge. L’incipit de l’essai donne le ton, et s’ouvre sur un extrait de la première thèse consacrée à Rimbaud, signée François Ruchon, dont le sous-titre (« sa vie, son œuvre, son influence »), seulement solidaire d’un moment épistémologique, est qualifié de « passablement banal » (p. 9), quand le chapitre sur la « poétique de la formule » se referme en mentionnant le dialogue rimbaldien de Pierrot le fou, « quelque peu désuet » (p. 331) ; il y aurait « une vis comica qui baigne tout un pan de la réception » (p. 289) de Rimbaud. La liste pourrait être étoffée. L’étude dite « de réception », alors, glisse vers autre chose, oublie son propre présent énonciatif, ainsi que les médiations qui la rendent possible.
Typologie contre mythologie
8Certes, Adrien Cavallaro, s’écartant d’Étiemble dont la somme dépliait dans l’espace tout un éventail de figurations, joue « l’histoire contre la structure » (p. 53), met en avant les grands jalons et les tournants majeurs d’un processus de réception suivi dans la longue durée, déroulé dans le temps. Le livre, et cela reste très utile d’un point de vue informatif, montre comment se configure et se reconfigure le corpus des œuvres, avec des découpages variables selon les moments, avec la mise en avant de « canons spécifiques » selon les orientations critiques. Le livre montre quand, comment, et pourquoi l’intérêt se porte tantôt sur le « sonnet des voyelles », tantôt sur « Alchimie du verbe », tantôt sur les lettres dites du « Voyant », etc. Il s’agit d’écrire une histoire différentielle et différenciée de la réception rimbaldienne en précisant, documents à l’appui, cette affirmation d’Étiemble située à la fin de son chapitre sur le surréalisme, dans une note : « dans l’œuvre de Rimbaud, chaque école a choisi trois ou quatre textes qui semblaient la justifier13 ». Il y aura ainsi un « canon claudélien » (p. 189).
9Mais l’apport principal à nos yeux du livre d’Adrien Cavallaro réside dans son effort de typologie, à partir d’un corpus critique et littéraire hérité d’Étiemble. Cet essai tourne le dos délibérément à la masse documentaire, à l’exhumation érudite de textes inconnus, déjà exhumés, pour opérer un tri ainsi qu’une accentuation des lignes de force, voire une hiérarchie : réception choisie, restreinte, pour contourner « la fatal nivellement de la perspective » (p. 47) auquel n’échappait pas son prédécesseur, mais aussi pour intégrer des textes allusifs, que le positivisme d’Étiemble avait exclu. Ce livre d’Adrien Cavallaro, s’il couvre la même période que Le Mythe de Rimbaud, ne se donnera pas le même corpus. L’universitaire abordera surtout ce que Thibaudet appelait « la critique des Maîtres », s’attardant longuement sur Verlaine, Mallarmé, Segalen, Claudel, Breton et Aragon, plus rapidement sur Suarès ou Jouve, tout en commentant le rôle des passeurs, des témoins (Ernest Delhaye, Paterne Berrichon, Isabelle Rimbaud), des représentants de la critique journalistique tels Félix Fénéon ou Jacques Rivière, mais laissant de côté par exemple, sans trop d’explications, Laforgue, Valéry ou Cocteau. À la différence de ce qui a lieu chez Étiemble, on ne vise pas une exhaustivité, mais une représentativité des références. C’est la raison pour laquelle l’analyse dégage un « rimbaldisme d’époque » (p. 65) qui conduit à décrire autant de « situations de Rimbaud » paradigmatiques, liées à un moment de l’histoire littéraire canonique (« le rimbaldisme symboliste »), ou à un champ littéraire saisi en synchronie, de manière duelle. Adrien Cavallaro choisit ainsi de dresser l’un en face de l’autre, après Aragon (p. 195), dans un rapport d’action et de réaction, le « rimbaldisme catholique » incarné par Claudel et le « rimbaldisme surréaliste » exemplifié par Aragon et Breton. L’auteur nomme alors « herméneutique » le schéma interprétatif à dominante idéologique qui oriente chaque lecture. Ainsi, une nouvelle typologie voit le jour : « herméneutique du double » chez Segalen ; « herméneutique de la parole » chez Claudel ; « herméneutique du message » chez les surréalistes. Le terme d’herméneutique, discrédité à l’époque du structuralisme, qui a connu un regain d’intérêt depuis le second Foucault, la relecture de Ricoeur par les littéraires14, est sans doute un peu abusivement employé ici dans la mesure où les auteurs considérés ne réfléchissent pas vraiment sur les conditions de possibilité de leur lecture.
10Ce « rimbaldisme d’époque » se voit distingué d’un « rimbaldisme idiosyncrasique » (p. 66), personnel, individuel, dans le but de rappeler qu’il ne faudrait pas confondre par exemple une lecture proprement « claudélienne » fondée sur le « physiologique », d’une lecture « catholique », plus large ou plus indéterminée.
Usages de Rimbaud : réception créatrice
11A. Cavallaro forge l’expression en apparence paradoxale de « poétique de la réception » (p. 221), qui fait de la lecture une forme d’écriture, renouant ainsi avec le Barthes de S/Z. Décrivant ce que l’on nomme habituellement « réception créatrice », ce que j’avais appelé dans mon Archive du Coup de dés « réception en actes15 », le livre décrit des « réécritures », soit des « réinvestissements de toute sorte de la langue rimbaldienne » (p. 69). La seconde partie du livre centrée d’abord sur la « formule », puis sur la « légende », explore un domaine que le parti pris normatif d’Étiemble ne pouvait que laisser de côté, à savoir le travail de réception active, pris au sérieux, tout à la fois démonté rhétoriquement et situé historiquement. C’est la partie la plus novatrice et la plus riche de la thèse à nos yeux.
12Il y a d’une part une véritable productivité de la « formule », selon une logique continuiste : l’art d’écrire programme un art de lire, la poétique de la production façonne une certaine « poétique de la réception ». Le style formulaire de Rimbaud entretiendrait ainsi un usage formulaire de ses textes, qui ont pu résonner, on le sait, comme des slogans, des « phrases-drapeaux » pour reprendre le mot d’Henri Meschonnic cité ici (p. 285), et constituer ce qu’Adrien Cavallaro appelle « la langue critique » (p. 434) de la modernité, promue progressivement « langue universelle » (p. 321), ou encore « la grammaire de la pensée de la poésie moderne » (p. 33). La langue rimbaldienne sert à parler de « l’extra-rimbaldien » (p. 437). La recontextualisation de certaines formules intéresse alors autant comme « supports critiques » devenus parfois « stéréotypes critiques », que comme « supports théoriques » ou « catégories esthétiques », voire comme « structure de la poésie moderne », Adrien Cavallaro reprenant et détournant le sens de l’expression d’Hugo Friedrich, non sans confusion.
13L’essai analyse le devenir et la circulation de quelques unités verbales rimbaldiennes, prélevées conformément à la logique qui voit dans l’acte de lire — legere — une activité de sélection et d’élection ; la matière du rimbaldisme, ce sont principalement des mots, des syntagmes, ou des énoncés monophrastiques, et non des unités macrotextuelles : « Alchimie du verbe » ; « peintures idiotes » ; « il faut être absolument moderne » ; « voyant » ; « changer la vie » ; « dérèglement de tous les sens ». Ainsi, par exemple, le livre montre très bien comment Une Vague de rêves réécrit « Alchimie du verbe ». On peut par contre s’étonner de l’absence de « JE est un autre », quand on se rappelle, exemple parmi d’autres, ces lignes des Pas perdus, soulignant « la conscience de cette effroyable dualité qui est la plaie merveilleuse sur laquelle il a mis le doigt16 ». Le rimbaldisme propose aussi un « support théorique » pour penser la « crise du sujet lyrique », domaine bien étudié en France depuis les années 1990, mais qu’une enquête précise et documentée aurait pu préciser historiquement, ce qui n’est pas le cas ici.
14Il y a d’autre part avec le « cas Rimbaud » l’émergence d’un « besoin de narrativisation d’un corpus centrifuge » (p. 432). La matière du rimbaldisme, ce n’est pas seulement une affaire de diction oraculaire reprise et continuée, mais aussi de fiction narrative, à partir du « biographique rimbaldien » (p. 33, et passim) ; aux « formules » s’ajoutent les « cellules pseudo-biographiques » (p. 432), les « anabiographèmes » (p. 432), pris dans un devenir littéraire et figural incessant, qui ont dessiné dans la durée la persona rimbaldienne si protéiforme. Aux « régimes d’historicité » (p. 143, et passim) qui ont scandé cette réception analysée dans la première partie de l’ouvrage, s’ajoutent des « régimes de fictionnalité » (p. 333), qui vont constituer le second objet d’étude de la deuxième partie dédiée aux « poétiques du rimbaldisme » présentes chez Verlaine, Max Jacob, Aragon, Claudel, Char, ou encore Gracq, dans un dialogue fécond avec les travaux de Martine Boyer-Weinmann sur la « relation biographique » (Champ Vallon, 2005).
15Ainsi donc, cet ouvrage prend pour objet ce que j’avais appelé à propos d’un texte unique, à savoir le Coup de dés de Mallarmé, « la productivité polymorphe d’une œuvre littéraire17 », laissant de côté les lectures « savantes », se refusant à interpréter les interprétations, préférant l’intertexte à l’entreglose. Le livre choisit ainsi la lecture des « Maîtres » déjà panthéonisés, en laissant délibérément de côté le domaine des médiations scolaires ou encore celui des histoires littéraires, comme celui des anthologies18. Or, comme le notait Fayolle à propos de Baudelaire, la date d’entrée dans le domaine public, comme la prise en compte des éditions destinées à une large audience, constituent des données fondamentales en matière d’histoire de la réception19. Cependant, l’introduction avait très bien délimité son objet, étranger autant à la « sociologie des publics » qu’à « l’effet de la lecture sur ces public », pour étudier « les productions textuelles sur Rimbaud » (p. 24) : il fallait faire des choix, dira-t-on.
16Le livre construit donc un rimbaldisme d’écrivains institués, un rimbaldisme des pairs, sans vraiment questionner le poids symbolique du commentateur au moment de sa prise de position — qui est Claudel en 1912 ? — et donc du premier « cercle de la reconnaissance20 », ce qui limite le sens de la notion d’« imaginaire collectif » (p. 33, et passim) souvent employée dans le livre. Le rimbaldisme figural par exemple, entre Étienne Carjat et Ernest Pignon-Ernest, aurait donné la matière d’un autre livre. Adrien Cavallaro épouse donc, pour la période analysée à travers ce corpus, le point de vue surréaliste, celui d’un Breton prenant ses distances avec les « plus ou moins savantes exégèses » (Flagrant délit, cité p. 433), tout en renvoyant en notes infrapaginales à la critique universitaire récente, postérieure à Étiemble. Mais celle-ci se voit peu questionnée, peu interrogée, assez nivelée, alors qu’elle n’est pas consensuelle, et ne peut l’être. La question de Roger Fayolle — « comment les textes nous arrivent ? » — reste donc partiellement intégrée ici. En tournant le dos à la généalogie du rimbaldisme universitaire, à l’archéologie du rimbaldisme des professeurs, ne risque-t-on pas de maintenir une coupure positiviste entre « mythe » et « vérité », entre « Rimbaud » (le point de vue des universitaires) et « rimbaldisme » (le point de vue des écrivains) ?
L’herméneutique de l’applicatio
17Le mérite de ce livre très stimulant tient pour nous dans le fait de tourner autour de la vieille notion d’applicatio, sans jamais la nommer21. Relisons Gadamer, à travers son projet de réhabilitation du présent de l’interprète, contre les dérives de l’historicisme. Dans l’herméneutique théologique, l’application consiste à envisager le prêche comme « actualisation de la révélation biblique » ; dans l’herméneutique juridique, l’application revient à définir la sentence comme « concrétisation de la loi ». Le philosophe précise le phénomène : il s’agit « de tout ce à quoi on peut penser lorsqu’on comprend un livre » ; ou encore « d’adapter le sens d’un texte à la situation concrète » de l’interprète. L’histoire de l’herméneutique nous a légué ce concept opératoire, qu’il aurait peut-être suffi de ressaisir, sans avoir besoin de théoriser à nouveaux frais. La « poétique de la réception » se nomme « application ». L’enjeu du livre réside donc dans le fait d’expliquer comment différentes singularités interprétatives (Claudel, Aragon), différentes « communautés interprétatives » (le groupe de La Vogue, le groupe de la NRF) ont pu appliquer Rimbaud. Ce mode de lecture anti-scolastique peut trouver l’une de ses formulations chez les écrivains étudiés ici, et ce de manière symptomatique dans l’introduction comme dans la conclusion du livre. Aragon :
Le rimbaldisme se prête aux rêveries de celui qui s’y adonne, j’en parle comme d’une drogue, il se conforme à son degré de science et d’ignorance, de culture et de sauvagerie. Ce n’est pas une philosophie, c’est un ciel. Chacun s’en arrange, il n’a qu’à lever les yeux pour en être ébloui. (cité p. 62)
18Breton :
La vertu d’une œuvre ne se manifeste que très secondairement dans les plus ou moins savantes exégèses auxquelles elle donne lieu, elle réside avant tout dans l’adhésion passionnée qu’en nombre sans cesse croissant lui marquent d’emblée les jeunes esprits […]. Au départ il ne s’agit pas de comprendre, mais bien d’aimer. (cité p. 433)
19C’est la raison pour laquelle, sur ce point, le « rimbaldisme surréaliste » présente sans doute un statut à part, comme l’a bien montré Peter Bürger dans sa Théorie de l’avant-garde22. La pensée avant-gardiste définie comme « reconversion de l’art dans la pratique de la vie23 », se donne a posteriori un certain Rimbaud comme modèle, et propose l’une des formes hyperboliques de l’applicatio, pensée au sein d’une autre herméneutique, non plus seulement textuelle, mais existentielle, celle de la vie désignée comme « cryptogramme », pour reprendre le mot de Nadja. Bürger note, en inversant la lecture téléologique de Friedrich, mais en validant la lecture avant-gardiste de Rimbaud : « ce n’est qu’à travers l’avant-garde que Rimbaud a pris la signification qu’on lui attribue justement aujourd’hui24 ». C’est pourquoi, encore, Adrien Cavallaro nous semble avoir pleinement raison de ne pas seulement opposer Claudel et Breton, mais de les apparier au sein d’une même logique, à savoir ce qu’il nomme « le statut extra-littéraire d’une œuvre exemplaire » (p. 200) ; une lecture appliquée qui tirerait Rimbaud, « hors de toute littérature » (formule de Fénéon).
20À côté du « rimbaldisme d’époque » et du « rimbaldisme idiosyncrasique », l’auteur parle aussi d’un « rimbaldisme idéologique » tributaire d’une vision du monde spécifique. On peut regretter à ce sujet qu’Adrien Cavallaro ne développe jamais ce versant décisif, ce qui conduit à « neutraliser », voire à « dépolitiser » l’approche du rimbaldisme. Comment lire la lecture de Fénéon sans creuser la piste de l’anarchisme, seulement évoquée en passant dans une note (p. 92) ? Comment suivre le rimbaldisme surréaliste sans le faire dialoguer avec le marxisme et le freudisme ? Comment ne pas poser la question du « rimbaldisme communard », lieu de nombreux conflits herméneutiques chez les rimbaldiens ? La « poétique de la réception », qui n’est pas une « politique de la lecture25 », comme son nom l’indique, offrira les limites propres à tout formalisme, avec le risque de transformer les « questions de vie ou de mort », moins en « question d’interprétation », pour reprendre l’idée de Bourdieu, qu’en questions de « formules ». La langue d’Adrien Cavallaro est celle justement de « la langue », avec ses variantes, « grammaire », « syntaxe », « dictionnaire », « assertion », mais aussi « voix » « parole », « message », « silence » ; ou bien le livre parle la langue de la logique des genres : « mythe », « légende », « fiction », « narrativisation », « intertextualité ». La question qui se pose, somme toute, à la lecture de l’ensemble, reste liée au contenu fondamental de cette « langue ». Que dit précisément « la langue » du rimbaldisme ? Même si l’on voit bien comment la notion, dans son indétermination, exprime toute la plasticité de la réception diachronique, ne peut-on s’empêcher de voir affleurer une certaine tautologie dans le propos soutenant que le rimbaldisme surréaliste est une « herméneutique du message », forcément « surréaliste » ? Idem pour Claudel, et son « herméneutique de la parole », forcément « catholique ».
21En outre, si l’on accepte une telle proposition, en toute rigueur, il faut préciser que le rimbaldisme n’est pas « la langue de la modernité », mais bien celle d’une certaine modernité, que le corpus critique étudié ou mentionné en passant, aura pris soin, depuis Albert Thibaudet, Marcel Raymond, Hugo Friedrich, on le sait, de distinguer de la modernité mallarméenne. La bipolarité mallarmisme-rimbaldisme constitue une enjeu historique majeur du rimbaldisme lui-même ; la réception de l’un passe dans la réception de l’autre, et cette logique structurelle serait vraie aussi, dans une moindre mesure, de Ducasse. Il apparaît alors difficile de soutenir que Raymond et Thibaudet n’ont fait qu’« intégrer » l’historiographie surréaliste (p. 314‑315). Thibaudet n’a pas attendu Breton et Aragon pour lire Rimbaud, qu’il couple souvent de manière différentielle à Mallarmé, dès les années 1910 : « voyez Mallarmé et Rimbaud26 » lit-on en 1914. C’est une histoire littéraire savante bifocale, très différente de l’histoire monofocale des écrivains, idéologiquement plus orientée : à partir de 1914, le Mallarmé des Poésies puis des Vers de circonstance est mort pour le groupe littéraire de Breton, vivant pour Thibaudet et le groupe de la NRF. Enfin, une telle étude fondée sur la définition du rimbaldisme comme « langue critique » laisse de côté le rimbaldisme vu comme héritage formel, filiation générique et pratique poétique. Un autre livre s’entrouvre, celui qui étudierait par exemple la transformation historique du fragment rimbaldien dans le verset claudélien ou le texte automatique surréaliste27. L’ouvrage montre en creux les frontières propres aux études de réception fondées sur la réception créatrice : le passage de l’histoire du métadiscours à l’histoire des formes, comme à la théorie des formes.
***
22Cette étude d’Adrien Cavallaro, riche d’une réelle conscience méthodologique, au-delà de la réflexivité heureuse et heuristique qu’elle apporte aux études rimbaldiennes, relance avec finesse un débat passionnant portant sur la légitimité des études de réception. Une manière de rappeler, avec ce Rimbaud appliqué, une évidence souvent oubliée, rappelée par le philologue et poète belge Robert Guiette, spécialiste de Villon, dans ses Questions de littérature de 1960 : « le plus grand tort des philologues, c’est de croire que la littérature a été faite par des philologues28 ». Et l’on pourrait ajouter pour des philologues.

