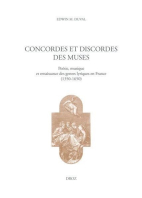
Repenser la poésie lyrique dans son rapport à la musique
1Voici un livre particulièrement riche et stimulant pour quiconque s’intéresse à la poésie lyrique, à la relation entre poésie et musique, et plus largement à la Renaissance. Cet ouvrage a d’abord le mérite de balayer quelques anachronismes (par exemple la confusion persistante entre le lyrisme personnel hérité du dix-neuvième siècle et la poésie lyrique renaissante), mais aussi quelques catégories habituelles de l’histoire littéraire (notamment l’idée reçue que la rupture entre formes anciennes et formes nouvelles daterait de La Deffence et Illustration et de la génération de Ronsard et Du Bellay) en rendant le lyrique au musical de manière claire, persuasive, discriminante. Edwin Duval part en effet de la pratique musicale pour évaluer la qualité proprement lyrique de chaque forme poétique, rendant le mot lyrique à son sens premier. Il éclaire ainsi d’un nouveau jour l’histoire de la poésie en France entre la fin du xve siècle et le début du xvie s. où se produit selon lui la véritable révolution lyrique. Joignant une vraie compétence musicale à ses qualités de subtil critique littéraire, il va ici au bout des analyses qu’il avait esquissées dès les années 1990 à propos de Scève ou de la Pléiade pour offrir un tableau complet des évolutions de la poésie lyrique en France du xive au xviie siècle.
2Le premier chapitre part du dernier moment de parfaite coïncidence de la poésie et de la musique, avant leur histoire tour à tour convergente et divergente retracée ici, celui où Guillaume de Machaut, le dernier poète-musicien, porte à leur perfection lyrique les formes fixes de la ballade, du rondeau et du virelai (« les seules qui comptent dans l’histoire de la musique et de la poésie françaises »). Est ainsi posée la base de la thèse développée de manière aussi cohérente que systématique tout au long de l’ouvrage. Les critères retenus par les arts poétiques, et les critiques littéraires à leur suite, de schémas strophiques et rimiques ne jouent selon Duval qu’un rôle secondaire. Compte avant tout l’« organisation musico-textuelle ». Ainsi de la strophe de ballade qui consiste en « deux unités ou propositions syntaxiques plus ou moins distinctes et parallèles » I-I, qu’il appelle couplets, chantés sur la même musique, et un groupe de vers librement développé chanté sur le thème II, qu’il appelle l’outrepasse. I-I et II s’organisant autour d’une volta (p. 30-31). Si sont également analysées les structures du rondeau et du virelai, le fondement de la démonstration est cette mise en lumière de la « structure profonde » de la strophe de ballade qui articule structure musicale, métrique et syntaxique et structure sémantique. C’est elle qui lui sert ensuite d’étalon pour analyser épigramme, sonnet ou ode et leur qualité plus ou moins lyrique. On retrouve bien ici le Duval « structuraliste » du « Design » rabelaisien, amateur et explorateur de structure profonde plutôt que de ce qu’il appelle ici les « bagatelles de versification ».
3Or tout l’art des poètes des xiv et xve s. est de fléchir, tordre et enfreindre la norme lyrique ici dégagée. Le chapitre 2 montre précisément comment Eustache Deschamps (par l’ajout de l’envoi) ou Christine de Pizan (en bouleversant la structure de la strophe de ballade), font émerger une poésie lyrique purement littéraire qui introduit diverses formes de libertés par rapport à ce schéma, au point de contribuer à la création d’une poésie non-chantée, « dé-lyrisée ». Le traitement du rondeau par les poètes de la fin du xve s. et du début du xvie s. en fait de même une forme purement poétique, le mouvement d’autonomisation de la poésie par rapport à la musique culminant avec les grands rhétoriqueurs.
4Cependant les musiciens (de Busnois à Josquin des Prés) créent de nouvelles formes de chansons en fragmentant les anciennes formes lyriques. La chanson nouvelle se développe en effet à partir de strophes de ballade ou rondeau, non sans influence de la chanson « populaire » sur la musique polyphonique. Après la délyrisation des formes fixes devenues purement littéraires, vient ainsi la relyrisation par la chanson nouvelle, révolution en marche dès la fin des années 1520 et le début des années 1530 dans la mise en musique des chansons de Marot comme ici démontré (chap. 3). Cela nous vaut des analyses précieuses et précises (dans le chapitre 4) des formes lyriques qui en découlent dans la décennie suivante : d’abord de l’épigramme, strophe de ballade musicale et chantable sur le « schéma de la vieille forme balladique » : I-I//II, telle que la pratiquent Marot mais aussi Scève dans Delie. Nous sont ainsi offertes des lectures renouvelées de ces épigrammes et même un mode de déchiffrement de dizains obscurs de Scève par la structure lyrique retrouvée. On citera un passage caractéristique de la démarche déductive d’ensemble : « Il est clair que pour Marot et pour Scève, comme pour bien d’autres poètes de la première Renaissance française, l’“épigramme” poétique est d’abord et surtout une forme lyrique, et que cette forme lyrique n’est autre que celle de la chanson nouvelle, qui n’est autre que celle de la ballade médiévale » (p. 214). Le sonnet que, comme Sebillet, Duval rattache à l’épigramme, est analysé dans cette lignée et constitue même le cœur de la démonstration, le point vers lequel tout semble tendre et converger. Les poètes français, à la différence des Italiens, lui imposent la structure de la strophe balladique, les deux quatrains constituant les deux couplets réitérés sur le même thème musical et les tercets l’outrepasse. Le sonnet lyrique (celui du Ronsard des Amours de 1552 par excellence) obéit à ce modèle comme le montrent les mises en musique, le sonnet discursif souvent influencé par l’Italie ne le fait pas et la démonstration passe par de précises études comparées. L’ode est elle aussi passée au crible de cette grille de lecture. Alors que l’ode-chanson de Saint-Gelais que cite Sebillet et que refuse Du Bellay correspond à une autre tradition, italienne, de la déclamation chantée avec accompagnement au luth, l’ode que pratique d’abord Ronsard obéit au principe de congruence de strophe à strophe. Mais malgré ce principe qui la rapproche de la chanson, la complexité fréquente de la structure strophique des premières odes attire peu les musiciens, qui, quand ils s’y consacrent, composent une musique continue, quand ils ne retiennent pas un fragment du poème pour en faire une chanson nouvelle, retrouvant ainsi les deux traditions illustrées par l’épigramme de Marot et la chanson de Saint-Gelais. Tout en préférant de loin les formes populaires et faciles des odelettes et des chansons de 1555-1556. Ainsi se séparent à nouveau les voies de l’innovation en poésie et en musique, ce qu’explorent les chapitres suivants, le 5 consacré aux innovations poétiques, le 6 aux innovations musicales.
5Le chapitre 5 déduit de la norme lyrique définie au départ une poétique de l’écart qui caractérise notamment Scève dans ses épigrammes, Ronsard ou Louise Labé dans leurs sonnets : tous trois contreviennent à la « loi lyrique », i. e. à la structure balladique, qu’ils respectent par ailleurs dans d’autres pièces, par toute une série d’irrégularités, de « techniques anti-lyriques » (p. 342). L’écart validant ici l’existence d’une norme. Pour l’ode, la démonstration est plus flottante, le phénomène allant de l’ode en rimes plates (donc sans strophes) aux rares odes qui s’achèvent sur une strophe non congruente. Le chapitre 6 montre comment de leur côté les musiciens cherchent à briser les entraves imposées par ces formes poétiques à leur liberté d’invention en les fragmentant et en inventant un nouveau rapport entre musique et poésie. La musique, se mettant au service des paroles et du sens s’attache à épouser le rythme de la phrase, autant qu’à illustrer les mots et à leur sens, ce qui contredit le principe même de la reprise musicale et tend à briser le moule formel pour évoluer vers une composition continue, « a-forme ». Cet « effondrement des formes lyriques », ce démembrement de la lyre d’Orphée, conduisent à ce qu’Edwin Duval appelle dans son dernier chapitre « le long crépuscule de la Renaissance lyrique ».
6Ce chapitre 7 retrace le chemin qui conduit de l’introduction de nombreux genres poétiques non-lyriques (élégies, hymnes, discours) dans le « jardin clos de la poésie lyrique » à l’insertion de pièces lyriques dans des cadres narratifs ou dramatiques. Après la floraison de mise en musique de sonnets dans les années 1570, cette forme poétique est abandonnée par les musiciens. Les poètes de leur côté diversifient les modèles rimiques de sonnets, ce qui entérine sa pratique discursive, dé-lyrisée. Les odes cependant ne disparaissent pas au profit des odes non strophiques mais sont largement concurrencées par les stances à partir de 1570, chez Desportes, Malherbe, Motin, Tristan, etc., formes en strophes courtes et en vers longs, à la différence des odes. Pourtant les stances sont chantées et mises en musique mais sur un autre modèle, celui de l’air de cour, avec une composition bipartite de la strophe. Une analyse conjointe des mises en musiques et des poèmes permet au critique de conclure à la relative indifférence des poètes à la musique, bien loin des ambitions lyriques affichées de la génération de la Pléiade, jusqu’à ce que Malherbe, sur les instances de Racan et Maynard, ne réforme la pratique poétique pour conformer la strophe, notamment le sizain, à cette nouvelle norme musicale, quelque limités qu’en demeurent les effets. Seul le ballet de cour perpétue la tradition d’une poésie chantée. Mais poésie et musique s’émancipent à nouveau l’une de l’autre, de la musique à danser au triomphe de la poésie dramatique et narrative au détriment de la poésie lyrique au milieu du xviie s. sans que l’opéra propose autre chose que des importations italiennes. La clé de l’ouvrage (et un de ses intérêts majeurs) est ainsi de tenter de définir une lyrique enracinée dans une tradition proprement française loin des idées reçues sur une Renaissance principalement italianisante ou antiquisante.
7Duval analyse pour finir les résurrections successives de cette tradition lyrique médiévalo-renaissante, du rondeau de Voiture ou de Théodore de Banville jusqu’aux odes des romantiques et aux sonnets nervaliens et baudelairiens, qui, quand ils sont mis en musique, le sont de manière très libre, sans plus de connivence entre création poétique et création musicale.
8Je laisse les musicologues statuer sur la pertinence des analyses musicales nombreuses et détaillées, mais je voudrais insister sur l’intérêt, la clarté et la richesse des analyses proprement littéraires qui en découlent, qu’il s’agisse de Marot, de Scève, de Ronsard, de Labé, ou de Desportes. Car malgré le côté systématique et sans doute trop étroit de cet étalon de la forme balladique comme critère principal du lyrique, ce point de vue permet de comprendre et d’embrasser l’ensemble d’un paysage poétique sur une chronologie longue, d’enregistrer et d’évaluer des évolutions, de déplacer et renouveler notre regard en bien des endroits. D’autant que les analyses de détail viennent souvent nuancer ce qui pourrait sembler un peu trop réducteur. Ainsi du cas de l’ode qui ne correspond que difficilement à la grille de lecture d’ensemble et dont l’étude permet souvent des pas de côtés. Un des charmes de l’ouvrage tient d’ailleurs au fait qu’il s’attache à construire un modèle (dont tout le livre nourrit ensuite la nostalgie) pour montrer à quel point les plus belles réussites des poètes et des musiciens y contreviennent. N’en est pas moins éclairé ici d’une lumière nouvelle un moment privilégié de l’histoire de la poésie française, d’une poésie spécifiquement française. Car ce qui demeure le plus nouveau, le plus stimulant, une fois le livre refermé, du moins pour la lectrice que nous sommes, est sans doute ce qu’il écrit de la réinvention proprement française de l’épigramme et du sonnet, et de l’étude comparée des traditions françaises et italiennes de ces formes. Un ouvrage donc à lire absolument pour quiconque cherche à comprendre et interroger à nouveaux frais ce qu’on appelle poésie lyrique.

