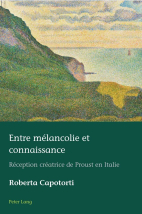
« Comme d’aimables poteaux indicateurs » : sur la réception créatrice de Proust en Italie
1L’ouvrage de Roberta Capotorti, docteure à l’Université de Milan et dont les recherches portent sur les études de réception et de traduction ainsi que sur les rapports entre littérature et cognition, s’inscrit dans la continuité des études sur la réception proustienne en Italie1 tout en revendiquant une certaine originalité. Dans l’introduction, Roberta Capotorti jette les prémisses de son enquête en explicitant sa thèse et sa démarche méthodologique. Le but envisagé consiste à fournir un aperçu inédit de la Recherche à travers le prisme de sa réception et des chemins de création poétique que le cycle romanesque a inspirés chez quelques-uns des principaux écrivains italiens du xxe siècle : Giorgio Bassani, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia et Goffredo Parise. L’enjeu de l’ouvrage consiste donc à mettre en relief, à l’aide d’une démarche comparatiste, « le mouvement dialectique entre l’exemple des maîtres et l’originalité spécifique de chaque auteur » (p. 4), un mouvement qualifié de « réception créatrice » dans la mesure où la lecture de la Recherche, loin d’être une activité d’appropriation passive de la source, implique aussi une métabolisation du modèle proustien, d’où ses épigones puisent des thèmes et, plus subrepticement, des paradigmes de narration et de connaissance (ce que la critique italienne a nommé la « fonction Proust2 ») qui sont déclinés selon le mode propre à chaque auteur du corpus analysé. Ce qui ressort au terme de cette enquête, c’est un tableau de la réception italienne de Proust situé entre la mélancolie due à l’« aporie insoluble entre vie et littérature » (p. 10) et la connaissance se dégageant de l’aspect méta-romanesque de l’œuvre proustienne qui permet de concevoir et de confronter de nouveaux modèles épistémologiques.
2La dialectique entre paradigme mélancolique et paradigme épistémologique se reflète par ailleurs dans la scansion quadripartite de l’ouvrage. D’un côté, les deux premiers chapitres illustrent les traits distinctifs des écritures de la mémoire de Bassani et de Lampedusa, écritures qui visent à inscrire la dimension autobiographique dans la perspective historique et à chercher des expédients esthétiques qui permettent de fixer la dimension du temps sur la page écrite. De l’autre côté, les deux derniers chapitres visent à mettre en avant la valeur gnoséologique de la Recherche à travers le projet cognitif de Gadda, tendant à la réalisation d’une summa encyclopédique capable de dégager la relativité des points de vue ainsi que la complexité des rapports composant le réel, et les récits de la jalousie de Moravia et Parise. Le tout est suivi d’une riche bibliographie ainsi que d’un index thématique et des noms de personnes.
3Puisque l’écriture de la mélancolie et celle de la connaissance ne s’excluent pas l’une l’autre, au lieu de rendre compte au cas par cas des chemins de création de chaque auteur en suivant l’ordre des chapitres, nous tâcherons de réunir ces mêmes écrivains sous le critère de la convergence thématique, de façon à montrer non seulement ce que l’écriture de chaque auteur du corpus doit au modèle proustien, mais aussi les carrefours où les chemins de création propres à chacun de ces romanciers italiens se rencontrent et s’entrecroisent.
Entre mémoire individuelle et mémoire collective
4L’une des affinités les plus patentes entre l’écriture proustienne et les œuvres des romanciers italiens Giorgio Bassani et Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c’est la réflexion poétique sur le fait historique à travers le prisme du vécu subjectif et individuel des protagonistes. De fait, Roberta Capotorti s’attache à montrer l’imbrication existant, tant chez l’écrivain ferrarais que chez l’écrivain sicilien, entre l’expérience intime et privée de l’individu et l’expérience que chaque sujet fait en tant que membre d’une collectivité spécifique à un moment historique donné. Qu’il s’agisse des courants d’antisémitisme qui traversent la société ferraraise ou bien du reculement de l’aristocratie bourbonnaise devant l’avance d’une bourgeoisie vénale et sans scrupule au lendemain de l’unification italienne, l’étude minutieuse de l’expérience individuelle constitue une condition préalable dans la compréhension des événements historiques — ici, tout lecteur proustien reconnaîtra la démarche inductive adoptée tout au long du roman par le Narrateur, qui de « fouilleur de détails » se fait chercheur des « grandes lois »3.
5Ce « regard à double focalisation » (p. 19) est présent notamment dans l’œuvre de Bassani, où l’urgence de perpétuer le souvenir de la Shoah est très ressentie en raison de la judéité de l’écrivain (un élément biographique qu’il partage avec Proust, qui est juif par sa mère). Chez Bassani, en effet, « [l]a mémoire est au centre de [s]es œuvres, elle est le sujet et la condition de la narration, placée en position médiane entre histoire et vie privée. » (p. 20) Loin de confier la mémoire de ces événements à un témoignage linéaire et objectif, Bassani choisit de brouiller les pistes optant pour un récit qui vise à dévoiler plutôt les effets que les causes de ces mêmes événements : à l’instar de Proust, il établit des « analogies anachroniques » consistant à déplacer dans le passé des événements qui ont eu lieu après et censés donner un sens rétrospectif et jusque-là inédit à ce qui s’est passé avant. Cette démarche est appliquée avec profit dans « La promenade avant dîner » (« La passeggiata prima di cena », 1953), récit mettant en scène, à partir des vicissitudes particulières d’un jeune couple judéo-catholique, le conflit entre les communautés juive et catholique de Ferrare. Ici, Bassani reproduit des syntagmes et des phrases tirés des journaux fascistes des années 1920 — tels que La Nazione — pour construire le discours de la société juive fin-de-siècle (époque où se déroule l’action) et mettre ainsi en évidence les comportements ambigus, de matrice préfasciste, des juifs qui adhéreront par la suite au fascisme. D’ailleurs, l’adoption par certains juifs d’une conduite antisémite n’est que le symptôme de la haine qu’ils éprouvent envers eux-mêmes en raison de leurs origines4 et qui constitue le moteur de leurs tentatives (manquées) d’assimilation aux groupes convoités : l’aristocratie catholique de À la recherche du temps perdu campée dans le Faubourg Saint-Germain ou la bourgeoisie catholique de Ferrare dont il est question dans le roman de Bassani Derrière la porte (Dietro la porta, 1964). Aussi le motif de l’antisémitisme devient-il chez Bassani, ainsi que chez Proust grâce à la lumière jetée rétrospectivement sur l’affaire Dreyfus par les ajouts datant des années 1914-1918, le prétexte pour aborder sur grande échelle les thèmes de l’assimilation manquée et de la conséquente exclusion des minorités.
6La même démarche inductive est aussi à l’œuvre dans le seul roman de Tomasi de Lampedusa, Le Guépard (Il Gattopardo, 1958). Ici, la crise individuelle du protagoniste, le prince de Salina, est symptomatique du bouleversement qui frappe la société italienne d’après l’unification, une société où l’aristocratie s’avère une institution désormais anachronique et de plus en plus inadéquate pour faire face aux enjeux de l’Italie naissante ainsi qu’à l’ascension d’une bourgeoisie aussi astucieuse qu’opportuniste lorsqu’il s’agit de poursuivre ses intérêts. De cette lutte entre une noblesse agonisante et une féroce bourgeoisie — les Guermantes et les Verdurin chez Proust ; les Salina et les Sedara chez Tomasi — émergent deux caractères aristocratiques, le baron de Charlus et le prince de Salina, des personnages d’autant plus exceptionnels qu’ils s’élèvent de leurs semblables par leur culture ainsi que par la lucidité désenchantée avec laquelle ils observent et commentent les bouleversements de l’histoire : songeons aussi bien à la tirade de Charlus sur la guerre dans Le Temps retrouvé qu’à celle du prince de Salina devant le ministre Chevalley, toutes les deux scandées par l’ironie désinvolte et négligente (la sprezzatura) qui leur est propre.
« C’est le chagrin qui développe les forces de l’esprit » : sur la valeur épistémologique de l’amour et de ses souffrances
7On sait désormais que, pour Proust, le seul moyen de surmonter la perte de l’être aimé consiste à aller jusqu’au bout de sa souffrance, à parcourir à rebours les étapes de la passion amoureuse jusqu’à parvenir à l’oubli et à l’indifférence initiale. Ainsi, tels l’Orphée du mythe, le narrateur proustien et le héros du roman de Bassani, Le Jardin des Finzi-Contini (Il giardino dei Finzi-Contini, 1962), descendent dans les enfers de la souffrance due à la jalousie et à la douleur de la perte de l’être aimé, dont la fuite (d’Albertine) ou la trahison (de Micòl) sont suivies de sa disparition physique. Quoique douloureux, ce voyage se révèle nécessaire et fructueux pour les narrateurs, en ce qu’il leur permet de devenir conscients de leur vocation littéraire et de retrouver l’être aimé à travers un processus de (re)création artistique.
8Quant à l’œuvre de Carlo Emilio Gadda, la souffrance y naît plutôt d’un sentiment de culpabilité vis-à-vis des figures parentales, notamment de la mère qui fait en même temps l’objet de l’amour et de la haine filiaux, sa présence étant considérée comme un obstacle à la réalisation de la vocation artistique du fils. Le motif de la profanation et du rapport controversé avec la figure maternelle, que l’on retrouve chez Proust dès ses premières épreuves5, constitue également le noyau de l’écriture de Gadda et de son roman au titre emblématique : La Connaissance de la douleur (La cognizione del dolore, 1963). Selon l’écrivain lombard, la souffrance dérivant du péché et du vice, qui sont innés chez les hommes, serait susceptible d’être compensée par la pureté et par la « victorieuse connaissance » (ou « hyper-cognition ») acquises grâce à la création artistique. Cependant, si chez Proust la possibilité d’un rachat est consubstantielle au motif de la profanation grâce à la supériorité reconnue à l’œuvre d’art, la rédemption n’est possible chez Gadda qu’à travers un récit humoristique et brut, à cause de l’impossibilité d’interroger et d’élaborer le deuil de la mère à travers l’écriture, ce qui contredit de fait l’idée selon laquelle l’hyper-cognition permette de surmonter les échecs existentiels — lorsqu’il est question notamment du deuil maternel.
9Les romans L’Ennui d’Alberto Moravia (La noia, 1960) et L’Odeur du sang de Goffredo Parise (L’odore del sangue, 1979) voisinent avec le « cycle d’Albertine » pour la manière d’aborder le thème de la jalousie ainsi que pour la valeur épistémologique attribuée à ce sentiment maladif. Ici, ainsi que chez Proust, la recherche de la vérité sur la voie de la création artistique assume les contours d’une véritable enquête policière où le narrateur, tel un détective, essaie de traquer chez l’être aimé les moindres signes susceptibles de valider ses suspects de trahison, voire sa jalousie — selon le modèle du paradigme indiciaire proposé par Carlo Ginzburg6. D’ailleurs, la jalousie étant apparentée à une maladie qui échappe à toute tentative de connaissance rationnelle, le déchiffrement des symptômes susceptibles de trahir les mensonges de l’être aimé procède, du fait de leur nature involontaire et extra-verbale (gêne, honte, rougeur, ton de la voix, etc.), par une série d’hypothèses et de conjectures sans pour autant parvenir à un savoir codifié. Néanmoins, l’expérience de la jalousie se révèle fructueuse du point de vue de la création, dans la mesure où elle secoue l’existence des héros de Proust, de Moravia et de Parise, en les faisant sortir de l’impasse due à l’ennui qui les empêche de s’adonner au travail artistique ou intellectuel.
Un kaléidoscope d’écritures
10Après avoir mis en avant les instances thématiques et narratives de matrice proustienne qu’ont à cœur les auteurs italiens étudiés par Roberta Capotorti, le moment est venu de s’interroger sur la manière dont ces activités de lecture et de récréation du modèle proustien se traduisent dans les œuvres de ces romanciers. Pour ce qui concerne Moravia et Parise, l’autrice de l’essai postule que « [f]onction méta-romanesque du récit, la jalousie est traitée comme une mise en abyme de la construction romanesque » (p. 217). En d’autres termes, bien que le jaloux soit vaincu dans la vie et dans l’amour, l’intellectuel peut racheter ses souffrances et ses défaites en parcourant à rebours les chemins de la passion et de la jalousie, « dans le but de changer le signe négatif de l’échec sentimental en signe euphorique du savoir et de la réussite narrative » (p. 218). Une fois appréhendée, la réalité vécue est soumise à une opération rétrospective de réorganisation formelle à travers le « travail rationnel et solitaire » (p. 215) de l’écriture.
11Influencé par la lecture de l’essai d’Edmund Wilson, Axel’s Castle, où l’auteur met le relativisme proustien en relation avec les lois phénoménologiques de la physique moderne, Gadda conçoit la Recherche, et son écriture métaphorique, comme le modèle d’une épistémologie nouvelle permettant d’accéder à la vérité grâce à une relecture de la notion du temps, envisagé en tant qu’instrument narratif apte à traduire sur la page le relativisme des perspectives et des rapports interdépendants qui sous-tendent la réalité. Chez Gadda aussi, la modalité privilégiée de connaissance de la réalité, conçue comme un système au sein duquel la partie et le tout sont imbriqués, est constituée par le paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg, qui consiste à inférer les causes des effets, à remonter du particulier au général. Ce paradigme, d’ailleurs, se traduit chez Proust par la métaphore de l’art militaire selon laquelle le général, tel que l’écrivain, doit être à même de deviner les rapports complexes existant entre son armée et le monde (voire entre la partie et le tout) et de connaître la structure générale d’une bataille sur laquelle se superposent, comme un calque ou un palimpseste, d’autres batailles. L’écriture métaphorique sert donc à traduire à l’écrit la déformation et la décomposition des rapports composant la réalité, réalité que l’écrivain tâche ensuite de reconstruire et de recréer sur la page en lui attribuant de façon rétrospective une signification nouvelle.
12Pour finir, Bassani et Lampedusa envisagent la Recherche comme une « tentative exemplaire de maîtriser le temps par la forme, d’organiser la mémoire dans les plis d’une écriture à même de brider le temps et l’espace » (p. 222). Chez les deux écrivains, la lecture rétrospective des événements collectifs sert à la fois à problématiser et légitimer le vécu privé de l’individu et à conférer de la profondeur au récit biographique à travers la dislocation des plans temporels obtenue au moyen des « analogies anachroniques. » De même, les deux romanciers s’interrogent sur la possibilité pour la littérature de restituer la vie : pour Bassani, cela est possible à travers une « poétique de la distance et de la profondeur » (p. 17), qui permette à l’écrivain d’entreprendre un voyage rétrospectif en descendant dans les profondeurs de son âme, à savoir dans l’enfer de sa jalousie et du deuil de l’être aimé. Celui-ci constitue donc l’intermédiaire censé guider l’écrivain vers sa vocation artistique, dont l’accomplissement demande de « mourir au monde », soit de renoncer à la vie et à la femme aimée pour les retrouver dans la dimension éternelle de l’œuvre d’art. Chez Lampedusa, au contraire, l’impossibilité de transposer le récit de vie, due au caractère fragmentaire et épisodique de l’existence, marque l’échec du projet de maîtrise du temps par l’écriture, ce qui se traduit du point de vue thématique par la manière de poursuivre le désir amoureux : un désir qui est aussi mélancolique, en ce qu’il est destiné à demeurer inassouvi.
*
13L’essai de Roberta Capotorti a le mérite d’adopter une démarche comparatiste inédite, qui permet de faire découvrir les éléments structurels et thématiques que les romanciers italiens empruntent à la Recherche, et grâce à laquelle les différentes déclinaisons que ces mêmes motifs assument dans le corpus des œuvres analysées témoignent de la richesse inépuisable du cycle proustien, qui brille d’une nouvelle lumière à chaque fois qu’un auteur de la postérité choisit de le prendre pour modèle. Cela nous permet de conclure que Proust s’inscrit dans la lignée de ces écrivains qui, « comme d’aimables poteaux indicateurs »7, montrent la bonne route à suivre tout en laissant au voyageur la liberté de rejoindre la destination finale par les longs et multiples détours de la (re)création artistique.

