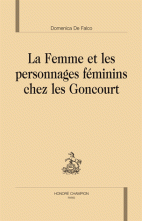
Objet de haine ou élément fondamental d’un projet esthétique ? La femme dans l’œuvre diaristique & romanesque des frères Goncourt
1« La femme : la plus belle et la plus admirable des pondeuses et des machines à fécondation » (cité p. 17). Ce type d’avis péremptoire, dont le Journal des frères Goncourt abonde, a largement contribué à reléguer les deux auteurs dans une catégorie figée d’irrécupérables misogynes, décourageant sans aucun doute les chercheurs à approfondir la question de la représentation féminine dans leur œuvre. Or, si la femme apparaît fréquemment méprisée, rabaissée, perçue avant tout dans son « animalité », force est de constater qu’elle se révèle omniprésente, voire centrale, dans la réflexion et le projet esthétique de Jules et Edmond. C’est ce que démontre Domenica De Falco dans son ouvrage La Femme et les personnages féminins chez les Goncourt qui entend combler une lacune importante des travaux goncourtiens et apporter une lecture novatrice de leurs ouvrages.
2Délaissant quelque peu le pan historique de l’œuvre des Goncourt, l’étude de D. De Falco se veut davantage centrée sur les romans et le Journal, véritable chantier des textes des deux frères. L’alternance constante entre extraits de fiction et écriture diaristique rend le propos d’autant plus convaincant qu’il tend vers l’approche génétique. Soumettre le Journal à une analyse méthodique permet à l’auteure de décrypter la pluralité du discours goncourtien sur les femmes. Sous leur plume « intime », plusieurs types féminins se bousculent en effet, donnant lieu à autant de positions contradictoires : la femme idéalisée (l’aristocrate du xviiie siècle, éminemment positive parce qu’inaccessible) y côtoie ainsi la Femme (abstraite, généralisée, foncièrement négative) et la femme réelle (envers laquelle le discours misogyne s’atténue). Mais qu’en est‑il des personnages romanesques ? Comment les héroïnes s’ancrent‑elles dans l’univers symbolique qui les entoure ? Telles sont les interrogations présidant à l’entreprise. La pertinence de ces problématiques apparaît évidente dans le cadre d’une étude des œuvres fictionnelles goncourtiennes, qui offrent une place de premier choix aux protagonistes féminines. Qu’il suffise, pour en témoigner, de citer les titres d’une grande majorité de leurs romans dont le personnage principal est une femme et auxquels l’essai est consacré : Sœur Philomène (1861), Renée Mauperin (1864), Germinie Lacerteux (1864), Manette Salomon (1867), Madame Gervesais (1869), La Fille Élisa (1877), La Faustin (1882) et, enfin, Chérie (1884). Le choix de prendre en considération les textes d’après 1870 et la mort de Jules n’est pas anodin et influence grandement les conclusions de la recherche. Tandis que de nombreux historiens de la littérature ne résistent pas à la tentation de « considérer deux voix comme si elles n’en faisaient qu’une » (p. 18), l’auteure souligne la différence de position1 entre les deux hommes et participe à réhabiliter l’œuvre d’Edmond, souvent considérée comme inférieure.
Inéluctable involution ?
3D. De Falco repère trois éléments significatifs dans le traitement des personnages féminins, faisant de chacun d’eux l’objet d’une partie de son ouvrage critique. Intitulées « Corps », « Parure » et « Discours », les différentes composantes de l’essai se révèlent intimement liées dans la logique d’effacement que les frères Goncourt imposent à leurs héroïnes.
Le corps se détraque et souvent meurt, la parure s’appauvrit, et le langage vient compléter ce processus de « néantisation » (la parole de la femme s’atténue jusqu’au silence). (p. 21)
4Analysant en détail les étapes de cet amoindrissement, la chercheuse se donne pour objectif d’éclairer sa signification.
5La première partie s’ouvre sur une mise en contexte. Prenant appui sur des écrits de la seconde moitié du xixe siècle (A. Strindberg, J. Michelet), D. De Falco rappelle le recours fréquent des théoriciens à la question physiologique pour expliquer l’infériorité naturelle de la femme. En littérature également — avec la montée des différents réalismes —, une vision matérialiste et désenchantée du corps féminin se substitue peu à peu à la représentation de la muse idéale. « La femme est un corps », nous disent les Goncourt dans le Journal (cité p. 43), suivant en cela la doxa de leur époque. Il ne semble donc pas étonnant que les protagonistes des deux frères soient tout entières placées sous le signe du corporel. La typologie des corps féminins établie par l’auteure montre efficacement à quel point le devenir des personnages dépend du physiologique. Le « corps malade » est le plus amplement représenté. La féminité s’avère en effet, pour Jules et Edmond, directement liée au registre pathologique. L’exemple le plus probant de cette corrélation réside à nos yeux dans le chapitre intitulé « Jeunes filles malades ». Traitant de Chérie et de Renée Mauperin, celui‑ci démontre comment le passage à la féminité s’accompagne nécessairement d’une dégradation physique : « Elle devenait et se sentait devenir plus femme », écrivent par exemple les Goncourt à propos de Renée, alors souffrante (cité p. 251). Mais la maladie, dans l’œuvre de ces écrivains, ne sert pas juste à actualiser le « devenir femme » des protagonistes. Leur faiblesse et leur passivité constitutives, les prédisposant à un état névrotique, sont également ce qui les mène à la dévotion religieuse2 (Sœur Philomène, Madame Gervesais) ou à l’hystérie (Germinie Lacerteux). Réduite à un corps qui l’entraîne fatalement vers la déchéance, aucune de ces héroïnes n’a d’emprise sur sa destinée. Semblablement, le « corps marchandise » (celui de la prostituée dans La Fille Élisa), par l’exposition continue qu’il suppose, engendre automatiquement une aliénation, une dépossession complète de la personnalité. Dernier « type » physiologique, le « corps spectacle » (La Faustin, Manette Salomon) est présenté comme l’unique échappatoire à cette prédétermination dégradante.
6La réflexion sur le corps féminin s’accompagne au xixe siècle d’un questionnement connexe : la parure, qui est le propre de la femme, doit‑elle être considérée comme embellissement (nature) ou tromperie (artifice) ? S’étant intéressés de près à la thématique de la mode dans un chapitre de leur ouvrage historique La Femme au xviiie siècle dont D. De Falco retrace les grandes lignes, les Goncourt font de la toilette féminine un élément fondamental de leur esthétique romanesque. Loin d’être des accessoires, les vêtements se révèlent les véritables alter ego des protagonistes. Amplement décrite par Edmond, la toilette luxueuse, blanche et vaporeuse de Chérie se détériore au fil du temps et des désillusions de la jeune fille qui tarde à trouver un mari. La chute de la coquetterie, le dépouillement vestimentaire accompagnent pareillement la perte de tout espoir et accentuent la déperdition sans retour des autres héroïnes. Le vêtement peut abandonner le corps par étapes (Renée Mauperin), perdant peu à peu sa fonction de protection (Germinie Lacerteux), symboliser l’anonymat (les habits des prostituées sont décrits ensemble, sans aucune individuation dans La Fille Élisa), l’aliénation (lorsque Élisa, envoyée en prison, se voit imposer une tenue austère) ou le rejet graduel du monde vivant (la garde‑robe de plus en plus dépouillée de Madame Gervesais et l’uniforme religieux noir, rigide et épais, de Sœur Philomène). Chargée d’un rôle symbolique important, ainsi que le démontrent les nombreux extraits choisis par l’auteure, la parure figure le rapport de « l’être au monde » et suit l’évolution du personnage.
7Un processus d’effacement semblable affecte la parole des protagonistes, à laquelle la troisième partie de l’essai est consacrée : comme le corps et le vêtement, la capacité/volonté de locution diminue avec celles‑ci jusqu’à la mort métaphorique ou réelle. Le point consacré à La Fille Élisa nous semble à ce sujet révélateur. Si elle s’inscrit dans la tradition naturaliste du roman de la prostituée, cette fiction présente pour principal dessein de dénoncer un type de régime carcéral qui imposait le silence complet aux détenues. La question de la parole s’y avère donc centrale ; elle permet à Edmond d’établir un lien de cause à effet entre la « confiscation » de celle‑ci et l’animalisation radicale de la jeune femme, perdant toute emprise sur son histoire. Le silence mystique de Madame Gervesais, le mutisme volontaire de Germinie Lacerteux, les troubles locutoires de Chérie et Renée Mauperin affectées par la maladie participent d’une même « clôture », d’un discours intériorisé. À son opposé, l’extériorisation excessive du langage théâtral, déclamatoire de l’actrice dans La Faustin apparaît également inadéquate pour traduire l’état d’âme de celle qui le prononce, tout comme s’avère inefficace la parole religieuse de Sœur Philomène. Les héroïnes des frères Goncourt, oscillant constamment entre deux extrêmes (la logorrhée et l’aphasie), témoignent donc de l’incommunicabilité de leur langage. Associé au mensonge (lorsque la femme parle) ou à la dissimulation (lorsqu’elle ne dit rien), le discours féminin paraît caractérisé par sa valeur négative et participe amplement à l’annihilation progressive des personnages.
8Quel sens accorder à cette involution qui frappe les héroïnes goncourtiennes aux points de vue physiologique, vestimentaire et langagier ? J.‑L. Cabanès a perçu dans l’œuvre des deux frères « le désir de porter jusqu’à son point extrême la vaporisation des apparences, la dilution des formes et des contenus de la conscience tout en retournant cette dilution en expérience esthétique » (cité p. 49). De là, l’hypothèse émise par D. De Falco selon laquelle la femme pourrait être chez eux le symbole d’un tel projet nous paraît audacieuse mais non moins légitime.
9Cette « dilution », pourtant, ne s’applique pas à toutes les protagonistes. L’évocation du « corps spectacle » permet d’entrevoir un possible renversement du mécanisme de dégradation. Les personnages féminins, en effet, ne font pas obligatoirement l’objet d’une appréhension négative. Nous traiterons à présent de certains de ces éléments qu’analyse la chercheuse pour relativiser la misogynie des deux frères. Bien qu’ils soient, au sein de l’ouvrage critique, insérés dans la structure tripartite déjà mentionnée, ils seront présentés ici à part afin de souligner leur valeur symptomatique.
Une misogynie relativisée
10Tandis que la plupart des personnages féminins sont destinés à une chute certaine, les détentrices d’un « corps spectacle », soumis à un regard pluriel, échappent à une telle logique. C’est à cette typologie physiologique qu’appartiennent le modèle (Manette Salomon) et l’actrice (La Faustin) ; la spectacularisation de leur corps, mêlée à un narcissisme aigu, leur permet de ne jamais se concéder entièrement à quiconque et de conserver ainsi la maîtrise de leur destinée. Cette possibilité de salut offerte aux femmes constitue aux yeux de D. De Falco un premier élément important dans sa déconstruction d’un préjugé tenace.
11Ce dont témoigne également l’histoire de la Faustin et de Manette, c’est que la surface l’emporte sur la profondeur et que le personnage féminin gagne à devenir « un charmant et frêle objet d’art » (Chérie, cité p. 65). La parure joue un rôle primordial dans l’obtention de ce statut ; l’harmonie des détails vestimentaires, le savant agencement de la toilette sont hautement valorisés par les deux auteurs. En conséquence de leur caractéristique « plastique », les protagonistes féminines, plus que tout autre élément fictionnel, sont envisagées comme les composantes d’un tableau au sein de la narration. Ce fait est significatif chez des écrivains qui ont fait de l’art leur centre d’intérêt principal et dont la poétique se caractérise par une quête constante de l’effet pictural. De nombreuses études universitaires, présentées en introduction, l’ont assez amplement démontré : la recherche pittoresque des formes et des couleurs (P. Bourget), la volonté d’esthétisation du monde (B. Vuilloux) sont ce qui semble définir aujourd’hui l’écriture des Goncourt. Il est donc aisé de comprendre que, favorisant un « investissement iconographique du réel », la femme puisse être sujette à une réappropriation positive.
12D. De Falco, nous l’avons mentionné, insiste sur le fait que la parole des héroïnes balance dans les romans entre deux pôles négatifs. Le dernier chapitre de l’essai, s’attachant à analyser l’image d’une personnalité réelle dans le Journal, permet de relativiser cette aversion des Goncourt pour la conversation féminine. Les nombreuses allusions à la Princesse Mathilde — dont le cercle fréquenté par les deux frères leur paraît un juste milieu entre le modèle salonnier aristocratique du xviiie et les salons bourgeois de leur temps, considérés comme de détestables ersatz de cette sociabilité révolue — servent en effet à montrer que le discours misogyne s’édulcore envers certaines femmes de leur entourage3. Jules et Edmond reconnaissent ainsi à la Princesse des qualités qu’ils nient par ailleurs à leurs héroïnes romanesques. Sa vivacité d’esprit, son autonomie de jugement, sa « langue d’artiste », presque virile, forcent leur admiration. Pourtant, la grande dame n’échappe pas totalement aux attaques virulentes des deux hommes qui émettent à son propos une opinion ambiguë, entre tentative d’individuation et irrésistible généralisation : « Cette femme spirituelle, mais au fond, bête et inintelligente comme une femme » (Journal, cité p. 47). Malgré cela, l’étude approfondie de ce cas s’avère révélatrice. La position des Goncourt se présente en effet bien différente dans la fiction et dans la peinture du réel, où leurs contemporaines peuvent apparaître exemptées de véritable haine.
***
13L’objectif de Domenica De Falco n’est pas de nier la misogynie indéfendable des frères Goncourt, mais plutôt de montrer que celle‑ci se présente « parcourue de failles, de paradoxes, de dénégations ponctuelles » (p. 22). Tout au long de son ouvrage, la chercheuse parvient à mettre en évidence la fréquence avec laquelle ces auteurs se sont intéressés à la femme. Derrière le mépris affiché, l’auteure dévoile une volonté vive chez Jules et Edmond de cerner le « mystère » féminin envers lequel ils éprouvent une sorte de « fascination répulsive », engendrant de facto un discours ambivalent qui méritait d’être examiné. De ce point de vue, les conclusions de l’essai sont éloquentes. L’on regrettera seulement que la place accordée à l’œuvre historique des deux écrivains ait été à ce point amoindrie. Si elle évoque la conception idéalisante développée dans La Femme au xviiie siècle, l’auteure passe sous silence le portrait des personnes du « beau sexe » dans d’autres textes tels que Histoire de Marie‑Antoinette, Histoire de la société française pendant la Révolution ou encore Histoire de la société française pendant le Directoire, qui aurait certainement gagné à être analysée afin de compléter le tableau du féminin chez les Goncourt4. L’ouvrage ici présenté n’en demeure pas moins un essai de qualité, dont l’intérêt dépasse le cadre des travaux goncourtiens. S’appuyant sur de multiples sources externes au corpus, D. De Falco laisse entrevoir une réflexion plus large sur l’image de la femme dans le champ critique et littéraire de la seconde moitié du xixe siècle. Ce faisant, elle apporte une belle contribution à l’étude des représentations genrées.

