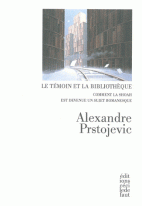
« Fiction vs témoignage » ?
1Il ne faut pas se méprendre sur le titre du livre Le Témoin et la bibliothèque. Comme Alexandre Prstojevic prend soin de le préciser dans son sous‑titre, son projet est de raconter « [c]omment la Shoah est devenue un sujet romanesque » et non de traiter du témoignage. Parmi les cinq écrivains étudiés dans cet essai, figurent pourtant deux survivants d’Auschwitz, Piotr Rawicz et Imre Kertész ; mais, soutient l’auteur en introduction, ceux‑ci comme les trois autres — les « enfants cachés » Danilo Kiš et Georges Perec et l’écrivain allemand W. G. Sebald — « revendiquent le statut de romancier avant celui de témoin » (p. 131), et la constellation que forment ensemble ces cinq auteurs se distingue ainsi de celle plus vaste formée par les témoins de la première heure, en ce qu’elle produit une littérature de fiction, — « constitutive » et non « conditionnelle2 ».
2La thèse d’A. Prstojevic est en effet de considérer que c’est par cette sortie du témoignage vers la fiction que la Shoah advient comme sujet de la littérature, lui « permettant […] de s’agréger au fonds thématique de la bibliothèque occidentale et, ce faisant, de faire partie intégrante de notre culture » (p. 14‑15), moyennant un ressourcement des auteurs dans la modernité romanesque de Proust, de Joyce, de Woolf ou de Pilniak.
La fiction contre le témoignage, ou le parti du kitsch : le cas de l’« anti‑témoin » Piotr Rawicz
3Tout commence, selon l’auteur, par une « révolution rawiczienne » (p. 85), avec la publication du Sang du ciel en 1961, « œuvre scandaleuse qui chamboulera profondément le système poétique établi de facto par les premiers textes littéraires sur la Shoah » (p. 45). En quoi consiste cette révolution, fondamentalement ? Dans le parti de délier l’éthique et l’esthétique de façon à reconquérir l’autonomie de l’art — contre le témoignage. A. Prstojevic emploie l’expression d’« anti‑témoin » (p. 55) à propos d’un personnage de Rawicz, David G., mais c’est en général le portrait qu’il nous propose de l’écrivain lui‑même, lequel a de fait refusé de témoigner, soutenant que « [son] livre n’est pas un document historique » (voirp. 46).
4Délier l’éthique et l’esthétique, dans Le Sang du ciel, c’est poser « la question de l’ethos du témoin » (p. 55) de façon à aboutir à une « désacralisation du témoin » (p. 69) ; ainsi, au topos testimonial du témoin « non seulement digne de confiance, […] mais aussi moralement digne d’écoute » (p. 68), la fiction de Rawicz oppose une figure de témoin « [a]u‑delà de l’éthique » (p. 57) voire une figure de l’« avilissement éthique » (p. 59), de façon à « démontrer et [à] soutenir littérairement la possibilité de l’inadéquation entre responsabilité éthique et mission testimoniale » (p. 63). Or cette démarche anti‑testimoniale de Rawicz est ici soutenue par l’auteur, d’une façon qui ne rend certes pas justice aux témoignages et à leurs auteurs. En mettant en cause l’« unité éthico‑testimoniale » (p. 68) revendiquée par des témoins épris de vérité tels qu’Elie Wiesel, affirme‑t‑il, Rawicz est en fait « celui qui a élevé la question éthique de la Shoah au rang littéraire », car il a su montrer « la figure du témoin aux prises avec la “zone grise” » (p. 80) ; dans cette optique, l’« hypothétique droiture morale » (p. 60) du témoin participerait surtout d’une « idéologie de la survie » (p. 63) par laquelle il reconstruirait a posteriori une exemplarité éthique, puisque, n’étant pas le « témoin intégral » disparu dans les camps dont parle Primo Levi, il ne serait en réalité pas assuré d’être le vrai témoin3. Selon A. Prstojevic, Rawicz a donc le mérite de « traduire l’ambivalence de la nature humaine », et ce, grâce aux « possibilités offertes par le roman » (p. 63).
5Il faut comprendre que « la dévaluation du régime testimonial » est double, dans Le Sang du ciel. Le développement ci‑dessus montre qu’elle passe par « une attaque en règle des deux thèmes majeurs de la littérature de la Shoah que sont le combat pour l’humanité des victimes et la vision de la survie comme engagement à témoigner pour ceux qui n’ont pas survécu » (p. 60) ; mais elle passe encore par une « littérarisation », autrement dit par une opposition à « la doxa testimoniale des années quarante et cinquante, qui voyait dans l’apparat littéraire, avant toute chose, une technique coupable de trahison envers une mission sacrée » (p. 59). Clairement, pour A. Prstojevic, il s’agit d’interroger l’appartenance du témoignage à la littérature, étant donné, comme il le développe à partir de l’introduction, que cette intégration va à l’encontre de « l’intentionnalité auctoriale » (p. 9) : que la posture éthique des témoins rend leurs témoignages, « à quelques exceptions près, tous tributaires du paradigme juridique », et que, dans ce souci de déposition contre les bourreaux, les auteurs considèrent souvent eux‑mêmes la « “littérature”, entendue la plupart du temps comme fiction », comme un « repoussoir » (p. 30). Ainsi, Rawicz est loué de manier le « ravalement ironique » (p. 60) du modèle fruste de ces auteurs qu’est « le récit documentaire sans artifice littéraire ; le rapport fait sous serment » (p. 31) ; car lui comprend que la littérature de la Shoah « doit être davantage qu’un “hurlement articulé” », et ainsi « accepter sa littérarité », en « accéd[ant] à la modernité littéraire » (p. 50‑51) — par exemple en représentant « le corps de la victime » non « plus uniquement [comme] un lieu de souffrance mais aussi [comme] un objet de désir et une source de jouissance » (p. 69).
6On peut s’étonner d’un tel éloge de l’« érotisme diffus » (p. 70), de « l’irrévérence » (p. 80) et en général « d’une écriture qui n’ancre plus exclusivement son origine dans le fait historique mais puise ses racines dans le contexte artistique », faisant de « la forme » sa « grande affaire » (p. 81). Le résultat pourrait pourtant faire l’objet d’une critique du kitsch, si l’on observe par exemple que « l’un des passages stylistiquement les plus remarquables de cette œuvre noire » (p. 71‑72) vise à exalter la beauté d’une scène de viol (voir p. 72 : « La masse immense du viol, fleur multicolore et exotique, s’épanouit dans la pièce »). Il n’est pas question ici de spéculer sur la morale des auteurs, au demeurant hors de cause, mais de critiquer un parti pris esthétisant, qui ne se méfie pas du « beau » (comme Paul Celan en formulait pourtant l’exigence4) et de l’attrait ambigu qu’il peut donner complaisamment à l’odieux ; précisément ce qui fait pour Walter Benjamin qu’un témoignage de culture peut se révéler « en même temps un témoignage de barbarie5 ». À cet égard, la fiction de Rawicz en 1961 — fondée à la fois sur une expérience de déportation et sur le refus d’en témoigner — peut être qualifiée, non de faux témoignage, mais de témoignage faux, au sens où elle « néglige infiniment trop » que la « connaissance » de cette expérience n’est pas seulement « un acte vivant » mais « aussi un contenu6 ». Cette critique d’un manque d’assimilation de l’expérience traverse le siècle de façon discrète mais néanmoins tenace, dans le sens de Robert Musil et de sa défense de l’empirisme. Dès les années 1929‑1930, Jean Norton Cru l’adressait, entre autres, aux combattants romanciers Henri Barbusse et Roland Dorgelès et à leur représentation de la guerre falsifiée par le goût du sensationnel et de la légende7 ; Benjamin, aux combattants auteurs de Guerre et Guerriers rassemblés autour d’Ernst Jünger, à leur « mystique » de la « guerre “éternelle” » et à leur représentation de « champs de bataille d’ores et déjà mythiques8 ». Après les camps nazis, la démarche de Rawicz s’apparente à celle de romanciers tels que Robert Merle et Erich‑Maria Remarque, auxquels Jean Cayrol reprochait en 1953 d’user du « charme de l’écriture » et des « broderies de l’invention » pour élaborer un « folklore » des camps de concentration et « donner des week‑end palpitants [aux lecteurs] mieux qu’une série livide ou blafarde », en les faisant « frémir, le soir, après dîner9 ». À l’« appel au spectaculaire » de ces romanciers qui visaient une « émotion immédiate », Perec et Cayrol opposaient le « refus du gigantesque et de l’apocalyptique10 » chez des témoins révoltés comme Robert Antelme, qui faisaient encore valoir que « [l]a maxime La vraie littérature se moque de la littérature n’a jamais été aussi vraie qu’ici11 ». Au contraire, A. Prstojevic prend le parti d’un auteur qui n’a selon ses propres dires « aucune faculté d’indignation » (voir p. 60‑61), et qui « aspire à occuper une place dans le “temps long” de l’histoire littéraire » (p. 52).
La fiction avec le témoignage : du « pas à pas » testimonial à l’expression de la hantise
7Un autre problème, cependant, est de situer un témoin comme Kertész ou des écrivains comme Kiš, Perec et Sebald dans le sillage de Rawicz — même si celui‑ci a voulu reconnaître une « fortune de sa poétique » (p. 83) dans Sablier de Kiš. Car, au demeurant, il ressort des développements d’A. Prstojevic que, chez ces auteurs, le parti de la fiction n’est pas du tout pris contre mais bien plutôt avec le témoignage.
8Chez Kertész évidemment, qui porte témoignage tardivement dans Être sans destin en se posant la question de savoir ce qu’il a « encore en commun avec la littérature », étant donné qu’Auschwitz est « une ligne infranchissable » qui « [l]e sépar[e] de la littérature et de ses idéaux, de son esprit » ; et qui, dans son effort pour « chercher la vérité », opte sobrement pour la « linéarité » en s’interdisant « de trouver une forme romanesque plus brillante »12. A. Prstojevic note que cette « méthode heuristique » du romancier, induite par la « voie linéaire des découvertes » qu’il a faites au cours de sa déportation, « coïncide curieusement avec celle développée dans Si c’est un homme de Primo Levi » (p. 130), mais cela n’est pas si curieux si l’on observe que ce choix narratif, fondé sur « l’expérience individuelle concrète de Kertész » (p. 133), procède précisément d’une éthique testimoniale.
9À cet égard, il ne paraît pas juste d’associer la figure du témoin chez Kertész à celle du « témoin non fiable » chez Rawicz (p. 136‑137). Il est vrai que le personnage de György Köves est « un héros atypique et immature » et que le ton distancié et presque indifférent qu’il adopte en tant que voix narrative a quelque chose d’irrévérencieux et de troublant — mais il est problématique de soutenir qu’il « ne comprend pas ce qui lui arrive » (p. 135). Quand Köves affirme par exemple « qu’avant que le soir du premier jour ne soit tombé [à Auschwitz] [il] étai[t] en gros à peu près précisément au courant de tout » (voir p. 144), ce n’est pas un propos ironique, il l’explique deux pages plus loin : « c’est de ce moment‑là que datent mes connaissances les plus précises. À cet instant‑là, là‑bas, en face, brûlaient nos compagnons de voyage […]13 ». En général, l’épreuve de l’incompréhension est une expérience fondamentale de la déportation dans les camps nazis. C’est ce que le narrateur de Kertész exprime de façon cocasse lorsqu’il note « qu’en quatre ans d’école [il] n’avai[t] pas entendu un traître mot à ce sujet [Auschwitz] » et que « [l]’inconvénient, c’était [qu’il avait] dû apprendre seulement sur place14 ». C’est un « inconvénient », vu que la perversion de la loi est au principe du fonctionnement des camps, que les règles n’y ont d’autre but que de détruire l’humanité et la vie humaine. Alors, si l’on a la chance de ne pas être sélectionné immédiatement pour la chambre à gaz dans un camp comme Auschwitz, la découverte de la réalité et des possibilités de survivre jour après jour ne peut se faire que « pas à pas », « petit à petit ». Et c’est tout l’intérêt narratif de raconter les « événements » comme ils « [ont] eu lieu », « en suivant le cours normal des minutes, des heures, des jours, des semaines et des mois » et non pas « tous à la fois, dans une sorte de tourbillon, de vertige unique » ; car il serait contraire à la vérité de donner à penser que « les nombreux participants perdent l’esprit tous en même temps » (voir p. 131).
10La « méthode heuristique » de Kertész ne produit pas un « roman de l’in‑connaissance » (p. 134), mais vise à « transformer l’expérience inexprimable des camps de la mort en vécu humain » (voir p. 135) et donc à permettre une compréhension de cette vérité vécue. Dans ce sens, cette méthode est analogue entre autres à celle d’Antelme, telle que Perec en faisait l’éloge dans son article consacré à L’Espèce humaine. À propos de cette méthode, A. Prstojevic parle justement d’une « critique de la vision totalisante du passé » (p. 132), or cette vision totalisante est le propre des mauvais témoignages, selon Perec — de cette littérature concentrationnaire qui « a entassé les faits » dans la croyance qu’ils parlaient d’eux‑mêmes, qui « a multiplié les descriptions exhaustives d’épisodes dont elle pensait qu’ils étaient intrinsèquement significatifs » alors qu’« ils ne l’étaient pas15 ». Ce qu’il y a de faux et « qui est implicite dans ces récits [même scrupuleusement conformes à la vérité], c’est l’évidence du camp, de l’horreur, l’évidence d’un monde total, refermé sur lui-même, et que l’on restitue en bloc ». Par opposition, dans un témoignage comme L’Espèce humaine,
[l]’univers concentrationnaire est distancié. Robert Antelme se refuse à traiter son expérience comme un tout, donné une fois pour toutes, allant de soi, éloquent, à lui seul. Il la brise. Il l’interroge. Il pourrait lui suffire d’évoquer, de même qu’il pourrait lui suffire de montrer ses plaies sans rien dire. Mais entre son expérience et nous, il interpose la grille d’une découverte, d’une mémoire, d’une conscience allant jusqu’au bout16.
11C’est bien ici la question de la transmission qui est l’enjeu : la façon dont Antelme entreprend de parer à la tentation du déni — du discours sur l’« inimaginable », très en vogue dès les retours de déportation. Il ne faut donc pas attendre Être sans destin pour que la « crainte de la réception » (p. 147) conditionne l’écriture testimoniale. En revanche, on peut affirmer que le problème du déni auquel se confrontent si douloureusement les témoins devient la matière même de la littérature dans le reste de leur œuvre (quand ils n’écrivent pas qu’un livre, comme Antelme) ou dans celle de leurs héritiers17. À cet égard, la proposition que fait A. Prstojevic de considérer toute l’œuvre de Kertész comme « une réflexion sur la capacité de la culture européenne à entendre [son] témoignage de 1975 » (p. 161) est passionnante. Mais c’est aussi sous cet angle qu’il convient précisément d’appréhender les fictions documentaires de Kiš, de Perec et de Sebald.
12Kiš et Perec héritent du régime testimonial d’abord dans ce qu’A. Prstojevic « propose d’appeler une esthétique de l’émergence » (p. 118). Dans Sablier (et plus largement dans Le Cirque de famille) de Kiš comme dans W ou le souvenir d’enfance de Perec, le projet de raconter son enfance se transforme en projet de raconter la disparition du père (Kiš) ou de la mère (Perec) ; c’est ainsi que la narration mène chaque fois en son point d’aboutissement à la citation d’un document qui en forme l’origine : « à la lettre du père qui en constitue l’explication » (p. 118), chez Kiš ; à un extrait de L’Univers concentrationnaire (1946) de David Rousset, chez Perec. Comme si l’œuvre tout entière n’avait d’autre fin que de nous préparer à cette lecture qui nous confronte à la réalité de la déportation. Il s’agit pour ces écrivains orphelins d’appliquer la « méthode heuristique » du « pas à pas », mais comme à rebours, suivant le modèle de la « fouille archéologique » (p. 114) — « à travers une exploration minutieuse, presque obsédante à force de précision, de détails » (voir p. 109).
13Mais, si l’on retrouve dans ces textes la fonction testimoniale de l’hommage aux disparus, il faut noter que leurs auteurs ne sont pas seulement mus par la quête d’un passé catastrophique qu’il s’agirait de reconstituer morceau par morceau. A. Prstojevic est attentif au fait que Kiš et Perec qualifient tous deux leur livre de « Bildungsroman » (voir p. 113) — de « roman d’éducation » ou de « roman de formation littéraire » ; et en effet, c’est ce que notait Benjamin des « véritables souvenirs », qui doivent « moins procéder du rapport que désigner exactement l’endroit où le chercheur a mis la main sur eux », et donc « donner en même temps une image de celui qui se souvient18 ». La question qui se pose au cœur de ces textes, ainsi, vise à connaître quelle vie d’homme — et quelle œuvre d’écrivain — je peux construire sur le fond d’une destruction de l’humanité qui m’atteint si personnellement. C’est ce qui fait que W et Le Cirque de famille ont représenté pour chacun des auteurs une longue et tortueuse aventure, procédant du temps long de l’analyse ; ce qui fait aussi que ces textes forment chacun comme la clé de voûte de l’œuvre complète19.
14Le sujet dont traitent les auteurs n’est donc pas celui des camps et du génocide nazis tels qu’ils ont été dans le passé (ce qui est le sujet des témoins) mais celui de leur hantise dans le présent. C’est le sujet de Kiš et de Perec, mais encore des autres auteurs qu’étudie A. Prstojevic : de Sebald, à qui il consacre un dernier chapitre admiratif, ou des Laurent Binet, Yannick Haenel et autres Daniel Mendelsohn évoqués en conclusion. La problématique de tous ces auteurs est en effet formulée par Y. Haenel, lorsqu’il traduit et interprète une expression de Celan en épigraphe de Jan Karski en 2009 (voir p. 219) ; elle est de témoigner pour le témoin, comme en réponse à l’appel du poète orphelin de Cernovitz. Non pas de s’identifier à un témoin et de mimer son témoignage, ce qui reviendrait à fabriquer un faux, — mais d’accompagner les témoins dans leur hantise du passé et leur deuil inachevable des disparus ; et donc, depuis leur propre place dans et face à l’histoire, de lutter à leur suite contre l’œuvre cicatrisante naturelle et immorale du temps, en enquêtant sur ce qui reste de ce temps passé.
15C’est en cela que, loin de s’opposer au témoignage, la fiction peut le relayer ; la fiction étant le mode du récit qui convient le mieux à l’expression de la hantise. C’est ce qu’avait compris Cayrol lorsqu’il développait sa théorie du « romanesque lazaréen » au tournant des années cinquante, puis concevait avec Alain Resnais Nuit et Brouillard « comme un dispositif d’alerte » au moment de la Guerre d’Algérie ; car il s’agissait de ne pas faire « comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres » et de ne pas « f[eindre] de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays », tandis qu’« autour de nous […] on crie sans fin20 ». La fiction de W comme « fantasme » d’univers concentrationnaire en Terre de Feu permet de façon analogue à Perec d’« éclaircir » la « brume insensée où s’agitent des ombres », puisque, sous la houlette des « fascistes de Pinochet », « plusieurs îlots de la Terre de Feu sont aujourd’hui [en 1974] des camps de déportation21 ». Et c’est encore à cette fonction de la fiction d’abolir toute distance entre le passé et le présent que fait appel Sebald de façon exemplaire, le temps semblant même ici « séduit par la géographie » (p. 193) — comme pour ouvrir un espace où règne l’inconscient : l’inconscient visuel des lieux (en Europe) finissant par avoir raison de l’inconscient pulsionnel qui pousse les personnages (tel Jacques Austerlitz) et les lecteurs au déni (en l’occurrence, à la cécité), et faisant ainsi apparaître que « la Shoah » est le « trauma qui influence inconsciemment la vie de l’Europe contemporaine » (p. 207).

