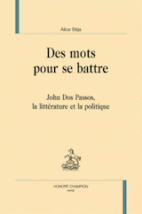
Dos Passos ou l’avènement du roman politique
1« All right we are two nations » : ce cri lancé par Dos Passos dans sa formidable trilogie USA relève à la fois du constat et du mot d’ordre, cri de protestation et cri de ralliement. Mots du rêve américain trahi, mots de la lutte. C’est en quelque sorte à leur généalogie qu’est consacré l’ouvrage qu’Alice Béja a tiré de sa thèse. Sans s’attarder sur le parcours strictement biographique de celui que Sartre tenait « pour le plus grand écrivain de [son] temps1 », ce livre retrace en effet l’élaboration par le romancier américain d’une littérature éminemment, structurellement politique, de ses romans de jeunesse à l’apogée de sa grande trilogie, USA. Refusant une conception « spéculaire » (p. 9) qui ferait du roman le miroir reflétant les positions politiques de son auteur, A. Béja montre comment l’écriture romanesque de Dos Passos est littéralement indissociable de son projet de critique politique. Ce faisant, elle contribue avec brio au renouvellement de la question plus générale de l’articulation entre littérature et politique et livre un revigorant tableau de la littérature radicale américaine des années 1920 et 1930.
Sonder les failles du récit national : le roman radical américain
2Tout en substituant au récit de l’engagement biographique de l’écrivain l’analyse de « la politique de l’écriture qui se joue dans le texte » (p. 21), A. Béja n’omet pas de restituer le contexte dans lequel s’inscrivent les recherches et les expérimentations de Dos Passos. Plus qu’un rappel historique, le premier chapitre de son ouvrage redonne vie aux intenses débats, politiques et littéraires, qui ont animé les États‑Unis de l’entre‑deux‑guerres, plaçant au cœur de son propos toute une littérature que l’on connaît doublement mal : peu lus, nombre des romans évoqués dans ce chapitre sont habituellement relégués au rang de documents, sociologiques ou historiques. C’est l’un des premiers mérites de ce livre que de rappeler l’existence d’une littérature foisonnante née de la volonté d’inventer une écriture intrinsèquement politique et de l’envisager en tant que telle.
3Ce panorama introductif, où l’on croise les noms qui figureront en bonne part dans la trilogie de Dos Passos (Randolph Bourne, Eugene Debs, Woodrow Wilson, Thorstein Veblen…), remet en cause les oppositions binaires qui ont profondément marqué le discours critique et qui ont donné une vision quelque peu schématique de ces années 1920 et 1930. D’abord, il est important de nuancer l’antagonisme posé entre les roaring twenties et les angry thirties : si le krach de 1929 marque un moment déterminant pour de nombreux écrivains et intellectuels états‑uniens, l’effondrement du système économique et la grande crise qui l’a suivi ont souvent été interprétés comme la manifestation spectaculaire d’un mal plus profond et plus essentiel, lié à la nature même du capitalisme américain. La plupart des radicaux n’ont pas attendu le tournant de la décennie pour s’engager politiquement — que l’on se souvienne de l’exécution de Sacco et de Vanzetti, en 1926, et de la vague de protestations qu’elle souleva.
4Plus fondamentalement, c’est l’opposition entre modernisme et radicalisme que discute A. Béja. Sans passer sous silence ce qui distingue ces deux grands mouvements littéraires spécifiquement états‑uniens, elle les envisage comme deux réponses apportées à une même interrogation : comment élaborer un nouveau langage apte à révéler l’imposture d’un rêve américain mis à mal par le déferlement jusqu’alors inédit de propagande lors de l’entrée en guerre des États‑Unis en 1917 puis par la crise généralisée ouverte par le krach de 1929 ? Modernistes et radicaux font le choix des marges, géographiques (l’expatriation en Europe) ou idéologiques (le socialisme). À la fois politique et esthétique, le détour, par un autre continent et/ou par un autre système de pensée, permet de critiquer les États‑Unis contemporains au nom d’une Amérique dont il semble impossible, pour les uns comme pour les autres, de faire le deuil. Pour les modernistes comme pour les radicaux, l’enjeu consiste à définir une modernité autre que celle que promeut une société industrielle en plein essor — une modernité au sein de laquelle la littérature exercerait une fonction essentielle et non plus ornementale. En dégageant cette revendication commune, A. Béja met au jour la dimension politique du modernisme et, parallèlement, la dimension littéraire du radicalisme, brouillant des frontières trop hâtivement érigées.
5L’auteur en profite pour se livrer à une sorte de réhabilitation de la littérature prolétarienne made in the USA. Nous éloignant un peu plus de Dos Passos, le propos peut paraître quelque peu pointilliste au regard de l’enjeu posé d’explorer la littérature radicale, qui se voit un peu vite réduite à cette expression particulière de l’écriture protestataire. Ce qui pourrait apparaître comme un flou notionnel est pourtant vite balayé par le plaisir de découvrir des auteurs et des romans malmenés par la critique et dont la réception elle‑même compose une page importante de l’histoire intellectuelle états‑unienne. Le dénigrement d’œuvres présentées comme entièrement soumises aux diktats du parti communiste — ce qui n’a guère de sens dans un pays comme les États‑Unis, où la contrainte ne saurait s’exercer de façon autoritaire — est en effet le fait de critiques qui avaient eux‑mêmes appartenu au PCUSA dans les années 1930 ; la caricature et la relégation des romans radicaux hors de la littérature, ainsi que la promotion parallèle des œuvres relevant du modernisme, ont représenté une sorte de passage obligé pour ces intellectuels qui marquaient ainsi leur prise de distance à l’égard des engagements de leur jeunesse. En rappelant la dimension idéologique de la réception d’œuvres qui ne l’étaient pas moins, A. Béja refuse de se plier à la réécriture de l’histoire à laquelle se sont livrés nombre des acteurs de ces années d’entre‑deux‑guerres — à commencer par Dos Passos lui‑même — et esquisse le portrait d’un champ littéraire fortement politisé. La prolifération des manifestes et des questionnaires témoigne de la vivacité des débats, mais aussi de la permanence des interrogations : si elle n’est pas parvenue à être une littérature de classe, la littérature prolétarienne américaine n’a pas non plus été une littérature de parti. Marquée par la recherche d’une voix, individuelle ou collective, qui donnerait à entendre ceux qui ne sont jamais entendus, elle revendique son lien immédiat avec l’expérience vécue et se définit comme partie prenante des luttes politiques en cours. Le genre documentaire, qui connut alors un essor sans précédent, est l’une des expressions de cette volonté d’élaborer une écriture fondée sur l’art de persuader autant que sur l’ambition de rendre visible « l’autre Amérique », celle des laissés‑pour‑compte.
6S’appuyant sur de nombreux ouvrages critiques américains, mais aussi sur des documents d’époque, A. Béja reconstitue le paysage intellectuel et littéraire de l’entre‑deux‑guerres états‑unien en le plaçant précisément sous le signe de l’entre‑deux : nuançant les oppositions façonnées par une réception très marquée idéologiquement, elle restitue avec vigueur les débats qui ont agité cette époque, rappelant l’intensité des échanges d’un continent à l’autre, d’une position politique à l’autre, d’une conception de l’écriture à l’autre. Entre les mots d’ordre et les mots écrits s’ouvre un espace qui est précisément celui de la littérature politique.
Défaire le récit national : l’histoire américaine façon puzzle
7Au croisement du modernisme et du radicalisme, l’œuvre de Dos Passos témoigne exemplairement de la pertinence de cette approche favorisant l’entre‑deux. Le deuxième chapitre de l’ouvrage se concentre sur l’écriture de l’histoire, et en particulier du premier conflit mondial, à laquelle s’est livrée le grand romancier américain. On pourra regretter que ses premiers romans, et même Manhattan Transfer, ne soient envisagés qu’en regard de la grande œuvre à venir qu’est USA, comme autant d’étapes préparatoires du chef‑d’œuvre, point d’orgue que Dos Passos échouera d’ailleurs à dépasser. Si cette préférence manifeste ne rend peut‑être pas tout à fait justice aux œuvres qui précèdent et qui suivent la trilogie, ces dernières n’en sont pas moins l’objet d’analyses aussi précises qu’éclairantes — y compris les pièces de théâtre, trop rarement évoquées par la critique.
8Très fortement marqués par son expérience personnelle de la Première Guerre mondiale, les romans de jeunesse de Dos Passos ont pour protagonistes de jeunes gens qui ne sont pas à leur place : avides de voir le monde, de plonger enfin dans l’action, de participer à la grande histoire, ils ne peuvent se départir d’une distance insurmontable qui les maintient à l’écart de la collectivité des hommes. Ni Martin Howe (One Man’s Initiation : 1917) ni John Andrews (Three Soldiers) ne font corps avec l’événement. Au‑delà de sa dimension autobiographique, le choix de tels personnages n’est pas dépourvu, déjà, d’une portée politique : ces romans de guerre s’inscrivent en faux par rapport à la propagande belliciste et à ses héros courageux, mais aussi à ses formes narratives privilégiées : « La guerre fragmente tout, les corps, la perception, la narration elle‑même » (p. 160). Procédant par succession de séquences isolées, ces romans composent le portrait désarticulé d’un monde brisé, escamotant les événements spectaculaires comme les poncifs romantiques ; ils font « éclater la continuité », selon les mots de Walter Benjamin — celle de la vie individuelle, celle d’une époque, celle de l’histoire et de son récit.
9Dès ses premiers romans, Dos Passos rend ainsi indissociables écriture et politique : son refus de la linéarité et de la continuité défait les scénarios lisses et sans accroc échafaudés par la propagande gouvernementale. Contrairement à l’image façonnée par la postérité, en particulier au moment de la guerre civile espagnole, Dos Passos apparaît dès lors comme un écrivain nettement plus engagé politiquement que son ami Hemingway. Sous la plume de l’auteur de Farewell to Arms, la Première Guerre mondiale représente une étape décisive dans le roman de formation de son protagoniste, moment essentiel dans son apprentissage de l’autonomie. Pour Dos Passos, au contraire, sa représentation romanesque prend immédiatement une dimension sociale et politique, participant d’une vision critique de la machinerie aliénante devant laquelle l’individu serait tout à fait impuissant. L’un se moque, superbe, l’autre dénonce, écœuré.
10C’est d’ailleurs moins la violence de la guerre elle‑même qui est critiquée par Dos Passos que le formidable fossé qui sépare sa réalité de sa justification rhétorique. Là est le crime premier : avoir eu recours aux grands mots de « démocratie », de « liberté », d’« Amérique » même, pour appuyer une guerre incarnant leur contraire. Aussi le romancier ne donne‑t‑il pas à voir la brutalité des champs de bataille ; l’événement historique lui‑même échappe à la représentation. Dos Passos fait de la guerre un faisceau de discours, tous mensongers. Au‑delà de sa terrible dimension meurtrière, la Première Guerre mondiale signe l’entrée dans l’ère de la manipulation du langage : l’événement historique est aussi allégorique. Il est dans tous les cas tragique.
11Dès lors, il appartient à la fiction romanesque d’ouvrir « un lieu de mise en concurrence des textes et des discours » (p. 205) : le montage, dont Dos Passos fait un usage virtuose dans USA, permet de réécrire l’histoire en rompant les évidences trop vite établies par les liens de cause à effet, de mettre au jour sa dimension rhétorique et son origine éminemment politique. Dans 1919, deuxième volume de la trilogie, la guerre n’apparaît que dans le montage de documents et de citations. La méthode est radicalement critique : la juxtaposition de fragments défait les grands discours trompeurs qui dissimulent la réalité de l’événement, tout en articulant en silence une interprétation politique du passé national récent ; « le document n’est plus témoignage, mais injonction » (p. 224).
12Cette dimension critique innervait déjà Facing the Chair, le texte écrit par Dos Passos au moment de l’intense mobilisation en faveur de Sacco et de Vanzetti, sur lequel revient (un peu longuement) A. Béja qui a traduit en français ce livre singulier2. On quitte alors la Première Guerre mondiale pour (re)plonger dans l’agitation de ce qui est devenu l’affaire Sacco et Vanzetti, qui a si fortement marqué l’imaginaire radical américain. La comparaison entre le roman qu’Upton Sinclair lui a consacré3 et le texte de Dos Passos éclaire judicieusement l’utilisation singulière que ce dernier fait du document et la façon dont il conçoit l’écriture de l’histoire. Quand le premier intègre le document historique dans une narration homogène, effaçant les frontières génériques au sein d’un roman qui uniformise les discours, le second le restitue dans toute son altérité, dans une forme ouverte propice à la reconfiguration et invitant à l’interprétation. En donnant à voir la fabrique du texte, Dos Passos s’oppose à toute forme de discours (journalistique, historique mais aussi romanesque) qui se prétend objectif et dissimule ses procédés d’élaboration, dévoilant ainsi l’imposture du pacte d’adéquation entre discours et réalité.
13Dans USA, ce parti pris prend un tour vertigineux : les innombrables fragments relevant de quatre séquences narratives distinctes (passages romanesques, notices biographiques, souvenirs autobiographiques de l’Eye Camera et éclats des Newsreels) composent bien un portrait de l’Amérique, mais celui d’une Amérique aliénée par une multitude de discours qui prolifèrent de manière industrielle et noient le « speech of the people » censé être au fondement de la nation américaine. Les Newsreels, qui compilent gros titres, publicités et chansons populaires, restituent le désordre de la rumeur journalistique, dans une accumulation d’informations non hiérarchisées qui s’insinuent dans l’esprit des personnages des sections romanesques et les empêchent de penser. L’un des protagonistes de la trilogie, J. W. Moorehouse est un double à peine fictif de ces premiers professionnels de la parole que furent Edward Bernays et Ivy Lee, ces inventeurs de la publicité de masse, experts « de l’effet au détriment de la logique et du sens des mots » (p. 266). Le discours est devenu une marchandise.
14L’écriture de l’histoire à laquelle se livre Dos Passos ne relève donc pas de la seule chronique, même critique. Placée sous le signe d’une fragmentation généralisée qui ne cesse de s’accentuer au fil de ses romans, elle s’oppose à la linéarité et à l’univocité de la propagande, en révélant du même geste la nature trompeuse. C’est l’idéologie même du progrès qui est mise à mal dans cette écriture désarticulée de l’histoire récente des États‑Unis qui vise moins à prouver qu’à défaire. Dos Passos ne compose pas une histoire alternative, une nouvelle épopée radicale : il met en évidence la nature rhétorique de l’événement passé et de son récit, délitant les interprétations officielles sans en substituer d’autres. Procédant par éclats, la fiction romanesque se fait récit irrésolu : rupture narrative, rupture politique.
Écrire le cauchemar américain : vertiges & vacillements
15Le troisième chapitre de l’ouvrage plonge dans la fabrique du roman, conçu par Dos Passos comme une immense machine aux rouages et aux ressorts apparents : la mécanique de la composition est affichée au lieu d’être dissimulée, détruisant volontairement et systématiquement l’illusion réaliste. A. Béja a de nouveau recours à la démarche comparatiste pour appuyer son propos et convoque l’exemple de Döblin. Quand l’auteur de Berlin Alexanderplatz, qu’on rapproche souvent de Dos Passos, incarnerait la posture de l’artisan, travaillant les différents langages de la ville tout en imprimant sa marque sur sa narration et sur ses personnages, le romancier américain adopte au contraire les traits de l’ingénieur, attaché à la technique, au montage et au démontage du roman, assemblant des pièces sans les fondre dans une œuvre forgée par sa seule voix. En laissant les ressorts apparents, l’auteur de USA livre un édifice comme inachevé, ouvert à tous les vents, du moins à tous les discours : ce n’est pas la belle machinerie lisse et univoque de la propagande, mais une structure heurtée, pleine d’aspérités. Fragile cathédrale, vacillant monument qui ne cesse de saper ses propres fondations.
16« Roman omnivore » (p. 291), USA n’est donc pas une œuvre encyclopédique : c’est moins la totalité que la pluralité qui caractérise la trilogie, objet expérimental traversé par une multitude toujours irrésolue, immense réseau « où le sens se construit à la fois par accumulation (répétition), par juxtaposition (montage) et par entrecroisement (écho) » (p. 325). Il est dommage qu’A. Béja n’insiste pas plus sur le rôle que cette structure ouverte assigne au lecteur, auquel il revient d’assembler les pièces du puzzle. La lecture active impliquée par cette fabrique romanesque à ciel ouvert participe pourtant intrinsèquement de la portée politique de cette écriture se livrant à une forme de fascinant auto‑sabotage.
17Le lecteur est en effet constamment tenu à distance de USA : non seulement parce que la structure heurtée de la trilogie l’empêche de plonger pleinement dans les intrigues romanesques, toujours interrompues par le surgissement d’autres séquences narratives, mais aussi parce que ces intrigues elles‑mêmes sont bien peu propices à l’immersion. Difficile, par exemple, de s’identifier à leurs « personnages automates » (p. 329), qui ont si peu de prise sur leur vie qu’ils paraissent dépourvus de tout libre arbitre, marionnettes d’une force qui les dépasse. Déplaçant l’héritage naturaliste, Dos Passos soumet ses personnages non pas à une nature ou à une hérédité impitoyable, non pas à des pulsions irrésistibles, mais à une terrible emprise discursive. Le mal est social, non naturel. Dépossédés de leur propre voix, les protagonistes de USA deviennent littéralement des porte‑parole. Répétant des discours qu’ils ne maîtrisent ni ne produisent, ils ont perdu leur voix intérieure et avec elle toute capacité à penser et à agir de façon autonome. S’impose une « grammaire de l’impersonnel » (p. 341) qui éclipse la première personne.
18Privés d’intériorité, ces personnages souffrent aussi de « la disparition du quotidien » (p. 347) autour d’eux : ils sont en effet dépourvus de toute forme d’ancrage familial, social ou même géographique. Condamnés à l’errance, affective mais aussi spatiale, ils tournent en rond et « à la trajectoire linéaire du self made man s’oppose le schéma circulaire des échec successifs » (p. 352). Tous luttent pourtant, aspirent à autre chose que ce dont leurs parents s’étaient contentés ; mais ils ne produisent ni n’accomplissent jamais rien. Leur agitation est frénétique, mais vaine. Le systématisme même de leurs échecs articule à lui seul une critique radicale de l’idéologie qui fonde les États‑Unis : si eux se laissent prendre aux promesses du rêve américain, le roman en dévoile la nature mensongère voire meurtrière. À l’horizon se substitue le tourbillon.
Un récit national à ciel ouvert : réécrire les textes fondateurs de l’Amérique
19Le dernier chapitre opère un nouveau mouvement panoramique : si Dos Passos et USA restent au cœur du propos, c’est toute la littérature protestataire des années 1930 qui est convoquée dans ces pages interrogeant la possibilité même d’« écrire la dissidence dans la terre du consensus » (p. 423). Reprenant le fil esquissé dans son introduction, A. Béja insiste sur le lien singulier qui unit littérature et politique dans cette « nation narrative » (p. 10) fondée sur une story originelle, celle des Pilgrim Fathers, mais aussi sur la sacralisation des textes fondateurs que sont la Déclaration d’indépendance et la Constitution. En soulignant avec force la dimension intrinsèquement narrative de l’identité américaine, cette dernière partie dégage l’importance singulière que revêt le lien entre littérature et politique aux États‑Unis. Le discours politique y adoptant toujours la forme d’un récit — le fameux storytelling analysé par Christian Salmon4 —, la remise en cause des discours dominants implique celle des formes narratives qu’ils adoptent. Si la Grande Dépression a révélé les récits et les textes fondateurs comme une « aberration rhétorique », reste à inventer une écriture protestataire affranchie de ces modèles narratifs et de l’idéologie qu’ils véhiculent.
20En étudiant des exemples très peu connus de ce côté‑ci de l’Atlantique, A. Béja montre de façon extrêmement convaincante comment les écrivains radicaux « soumettent le roman à la question », le malmène comme pour « faire rendre raison à cette machine à fabriquer des histoires » (p. 14). Utilisant les outils de l’analyse littéraire, A. Béja fait apparaître la dimension intrinsèquement politique des partis pris narratifs de Michael Gold, de Grace Lumpkin, de Robert Cantwell et de Clara Weatherwax, entre autres : outre le milieu qu’ils décrivent, outre la ligne politique qu’ils défendent explicitement, leurs romans entendent défaire les fausses promesses des récits et des textes fondateurs, tout en donnant corps et voix au « we the people » dont ces derniers se réclament. Tous les romans mentionnés s’efforcent en particulier de redéfinir le système des personnages pour y introduire une catégorie absente des textes originels sacralisés : celle de la classe sociale. Comment faire exister cette catégorie ? La question est indissociablement politique et littéraire. L’enjeu est bien celui de la définition du « common people », qui ne saurait se réduire au peuple américain abstrait postulé par le mythe constitutionnel. Au protagoniste unique se substitue alors souvent le portrait d’une communauté en lutte au sein d’un espace qu’il s’agit de (re)conquérir : la rue, l’usine.
21Dos Passos pousse la contestation narrative et donc politique bien plus loin, jusqu’aux limites mêmes du récit. L’espace de ses USA n’est pas cartographié par des rapports de classes ; il est au contraire infiniment ouvert, traversé de part en part par des personnages qui empruntent frénétiquement tous les moyens de transport qui s’offrent à eux et qui ne les mènent nulle part. Plutôt que la dénonciation d’un espace socialement clivé et érigé en enjeu politique, la trilogie opère le « démantèlement du mythe de la société fluide » (p. 468), montrant la vanité et même la dangerosité que recèle la fiction d’un espace ouvert à tous les possibles et d’une mobilité sociale infinie. En perpétuel mouvement, les protagonistes de USA n’ont aucun point d’ancrage, ils n’appartiennent à aucune communauté : la notion de classe s’éparpille, s’égare, se perd.
22Car ce n’est pas en son nom que s’articule la critique de Dos Passos : « all right we are two nations », s’exclame le narrateur de l’Eye Camera dans l’une des plus belles pages de la trilogie, deux nations et non deux classes. La division est profondément politique : elle met face‑à‑face ceux qui sont américains et ceux ne le sont pas. Reconduisant le mythe de l’origine, Dos Passos érige « l’idée d’Amérique comme un système de valeurs » (p. 475). Mais redéfinissant l’identité américaine, il l’affranchit des critères raciaux, linguistiques ou nationaux pour la rendre indissociable de l’adhésion à certaines valeurs. L’ennemi, le « stranger », ce n’est plus le « foreigner » fraîchement débarqué, mais celui, souvent blanc, né aux États‑Unis et issu de la classe moyenne, qui a trahi l’esprit américain. Si on peut naître états‑unien, on ne naît pas américain : on le devient en luttant au nom de certaines valeurs. Aussi Sacco et Vanzetti sont‑ils les Américains par excellence : en faisant de deux anarchistes italiens les nouvelles incarnations des pères pèlerins, Dos Passos délivre un passeport à tous ceux qui ont été relégués aux marges de la nation, radicaux, ouvriers et immigrants, et en prive ceux qui en occupent le cœur, les puissants.
23Cette inversion opère une véritable actualisation des textes fondateurs : ces derniers ne sont pas seulement brandis pour souligner le fossé qui sépare les États‑Unis contemporains de l’Amérique rêvée par ses fondateurs ; ils sont réinterprétés à la lumière des luttes en cours, celles que mène « la nation des vaincus ». Le roman protestataire impose ainsi une nouvelle exégèse critique des textes de l’origine, en renouvelant la portée et les promesses. L’Amérique qui est la sienne est un objet textuel qu’il s’agit sans cesse de réécrire et de réinterpréter. USA,pourtant, n’en livre jamais le portrait cohérent et souhaitable : la « reconfiguration de l’épopée américaine par la fiction du désespoir » (p. 525) qu’opère la trilogie de Dos Passos ne saurait aboutir à un nouveau mythe, même renouvelé. Elle n’ouvre la voie qu’à des récits, multiples, divers, opposés, fissurés par des failles qu’il ne s’agit plus de dissimuler : « La démocratie du roman n’est pas un lieu de liberté absolue, mais un lieu de conflit » (p. 557).
***
24« Plutôt qu’à voir dans le politique le non‑dit de la fiction », Alice Béja a préféré « considérer les manières dont la fiction peut mettre en scène le non‑dit du politique, la rhétorique démocratique » (p. 30) : Rancière et sa « politique de la littérature »5 plutôt que Jameson et son « inconscient du politique »6. Le pari est indiscutablement relevé dans cet ouvrage qui ne conçoit pas le politique comme un sujet parmi d’autres traités par le roman, mais comme une dimension prenant corps dans le geste même de l’écriture romanesque. Le jeu entre différentes échelles d’analyse, du panorama culturel à l’étude de texte extrêmement précise, permet de saisir au plus près la portée politique qui se loge dans tous les interstices de cette écriture. Armée d’un réjouissant sens de la formule, A. Béja livre un ouvrage parfaitement documenté qui ne sent pourtant pas sa thèse, malgré quelques redondances. Elle adopte à plusieurs reprises une démarche comparatiste qui lui permet de souligner la singularité de l’œuvre de Dos Passos, tout en l’inscrivant dans le passionnant tableau d’une époque lancée à la recherche d’une littérature intrinsèquement politique.
25On ne la suivra pas forcément quand elle affirme que Dos Passos serait victime d’un certain oubli : le nombre de travaux cités qui lui ont été consacrés semble prouver le contraire, de même que la fréquence avec laquelle son œuvre est convoquée pour appuyer des réflexions autour du lien entre politique et littérature, de Sartre à Rancière. On regrettera que quelques notions soient rejetées sans appel : celles de littérature engagée ou de roman à thèse font ainsi figure de repoussoir sans être véritablement discutées. Comme si l’exploration de la « politique de la littérature » devait, pour être légitime, afficher son refus de genres qui la mettent évidemment en pratique. Le terme de littérature engagée ne paraît pas si obsolète pour rendre compte de romans qui revendiquent explicitement leur intention politique. Surtout, il est dommage que cet ouvrage ne se penche pas davantage sur la sommation que la reconfiguration des formes narratives, parfaitement étudiée, adresse au lecteur. A. Béja reste dans l’atelier du romancier. Or la relecture critique dont procède la réécriture des textes et des récits fondateurs semble se prolonger dans la lecture appelée par le démembrement des structures narratives et leur fragmentation généralisée. Autant qu’« entre les lignes », la portée politique de USA et de nombreux autres romans radicaux se loge bien dans la lecture interprétative exigée par le rejet de la linéarité et de la continuité.
26La lecture qu’A. Béja propose de la littérature radicale américaine n’en est pas moins passionnante et résonne avec l’actualité états‑unienne la plus récente. Son pari de faire « sourdre » la dimension politique des textes littéraires eux‑mêmes ne souligne pas seulement la puissance critique de la littérature : il met aussi en évidence la pertinence d’une critique politique qui passerait par l’analyse narratologique et aurait recours aux outils méthodologiques des études littéraires. La déconstruction des récits trop lisses et des scénarios trop simples a un bel avenir devant elle. N’est‑ce pas à elle, entre autres, qu’il revient de rendre visible « la déchirure7 » qui traverse à la fois les édifices littéraires et l’espace démocratique ?

